Résumé de "Steve Jobs" de Walter Isaacson : la biographie autorisée de l'un des entrepreneurs les plus doués du XXe siècle, qui a changé notre rapport aux technologies numériques — un best seller du New York Time ayant donné lieu à un film avec Michael Fassbender en vedette.
Walter Isaacson, 2011, 453 pages.
Titre original : Steve Jobs (2011).
Chronique et résumé de "Steve Jobs" de Walter Isaacson
Introduction — La genèse de ce livre
Walter Isaacson raconte que Jobs l'a appelé en 2004, en lui demandant d'écrire sa biographie. Au départ, l'écrivain refuse. Selon lui, la personnalité de Steve Jobs fait controverse et sa carrière n'est pas encore complètement établie.
Toutefois, lorsque Steve Jobs tombe malade du cancer pour la deuxième fois, Walter Isaacson accepte la mission en se disant que c'est maintenant ou jamais. En deux ans, il réalise une quarantaine d'entretiens et de conversations — avec le principal intéressé, bien sûr, mais aussi avec son entourage (amis, famille, collègue).
Selon l'auteur, ce livre est une biographie qui peut inspirer chacun d'entre nous, car elle "est pleine de leçons sur l'innovation, le caractère, le leadership et les valeurs".
1 — L'enfance : abandonné puis choisi
Steve Jobs a été adopté lorsqu'il était enfant.
Ses parents biologiques, Joanne Schieble et Abdulfattah Jandali, préfèrent l'abandonner car ils vivent une situation familiale compliquée. Ils ne sont pas mariés et le père de Joanne désapprouve fortement leur relation. Lorsque celle-ci tombe enceinte, la décision de se séparer de l'enfant est prise.
Mais le couple pose une condition : que les parents adoptifs aient étudié à l'université.
Bien que ce ne soit pas le de Clara et Paul Jobs, le petit Steve entre dans cette nouvelle famille. Ce sont des travailleurs et, surtout, ils promettent de s'investir complètement dans la vie de leur fils adoptif.
Dès son enfance, Steve Job sait qu'il est adopté : Clara et Paul lui disent même qu'il est, en fait, un enfant spécial parce qu'ils l'ont choisi. Ce sentiment d'élection est un puissant moteur de confiance en soi.
À l'école, l'enfant s'ennuie. Il trouve peu de sollicitations.
C'est en dehors de l'école, dans la Silicon Valley, qu'il découvre ses premiers hobbies. Il apprend les rudiments de mécanique avec son père, Paul, qui répare des voitures. Il se passionne aussi pour l'électronique au sein du Hewlett-Packard Explorers Club voisin.
Vivant au cœur de la révolution informatique, au moment même où les premiers ordinateurs y sont assemblés (par Hewlett-Packard, justement), Il tourne naturellement toute son attention vers ce nouveau domaine en plein boom.
2 — Un couple improbable : les deux Steve
Dans ce chapitre, Walter Isaacson relate la rencontre entre Steve Jobs et Steve Wosniak. Celui-ci a cinq ans de plus que l'autre Steve. Pourtant, ils font connaissance autour d'intérêts communs (l'électronique et l'informatique). Steve Wosniak est déjà à l'université mais Steve Jobs, lui, est toujours au lycée.
Un jour, les deux amis veulent répondre à une annonce trouvée dans un journal. Il s'agit de créer un dispositif permettant de passer des appels interurbains gratuitement. Au départ, ils voient cela comme une blague et comme un passe-temps. Mais ils réussissent pourtant à créer des "Blue Box" (boîtes bleues), puis à les vendre (pour 150 $/pièce).
C'est le début d'une fructueuse — et tumultueuse — relation d'affaires.
D'un côté, Steve Jobs, assez manipulateur et très ambitieux, plutôt tourné vers le design et le marketing (comme cela apparaîtra plus tard) ;
De l'autre, Steve Wosniak, plus calme, profondément geek et s'intéressant avant tout à la conception technique.
Un soir, dans une pizzeria de Sunnyvale, quelqu'un leur vole une Blue Box en les menaçant avec une arme à feu. C'est un choc. Mais cela ne décourage pas les amis de continuer à travailler ensemble et à développer d'autres projets.
Pour Steve Jobs :
« Sans les Blue Boxes, il n'y aurait pas eu de pomme. » (Steve Jobs, Chapitre 2)
3 — Tout lâcher : harmonie, ouverture, détachement…
À la fin de ses études secondaires, Steve Jobs se met en couple avec Chrisann Brennan, une jeune fille cool, artiste peintre. Ensemble, ils explorent les trips d'acide (LSD) et leur sexualité. Ils partagent même, durant tout un été, un petit studio, où ils expérimentent la vie commune.
Lorsque Steve Jobs entre à l'université, il est conscient de réaliser le souhait de sa mère biologique, qui souhaitait ardemment le voir faire des études supérieures. Pourtant, il s'ennuie vite et son caractère, qui devient de plus en plus affirmé, dérange.
Il quitte le Reed College (son université) rapidement. Il a l'impression de ne rien apprendre. Cela dit, il se consacre à quelques cours en élève libre, tels que la calligraphie. C'est également à cette époque qu'il se lie d'amitié (de courte durée) avec un adepte des spiritualités orientales et, notamment, de l'hindouisme.
4 — Atari et l'Inde : du zen et de l'art de concevoir des jeux
Après cette expérience universitaire, Jobs revient chez ses parents à Los Altos. En cherchant son premier emploi, il s'intéresse à la société de jeux vidéo Atari. Sa personnalité fait le reste : il convainc l'ingénieur en chef Al Alcorn qui lui offre un poste de technicien.
Steve Jobs est ainsi l'un des cinquante premiers employés d'Atari.
Mais ses excentricités ne font pas l'unanimité. Au niveau social, les manières du jeune homme ne laissent pas indifférent. Hippie, son comportement et son hygiène détonnent dans l'entreprise…
Après quelques mois seulement, il décide de partir pour l'Inde. Il veut y rejoindre un ami : Daniel Kottke.
À son retour, le chef d'Atari, Nolan Bushnell, le met au défi de développer une version solo du célèbre jeu de l'entreprise : Pong. Il recevra même un bonus, lui dit son supérieur, s'il peut minimiser les puces informatiques utilisées.
C'est là que Steve Jobs va faire appel à son vieux camarade, Steve Wosniak.
À l'époque, celui-ci travaille chez Hewlett Packard (également dans la Silicon Valley). En quatre jours seulement, les deux Steve créent le programme et parviennent à miniaturiser les puces !
Dans un entretien réalisé par Walter Isaacson, Steve Wosniak se souvient que Steve Jobs ne l'a pas rémunéré justement. En fait, alors qu'il avait reçu le bonus promis par Atari, il ne l'a pas partagé avec son ami. Toutefois, cela ne compromet pas leur collaboration.
5 — L'Apple I : allumage, démarrage, connexion
Dans ce chapitre, Walter Isaacson raconte l'histoire de la naissance d'Apple.
Il rappelle que la Silicon Valley est alors électrisée entièrement par le projet de développer et de démocratiser les ordinateurs qui sont encore, à l'époque, des machines réservées à quelques élites et passionnés.
Steve Wozniak est particulièrement fasciné par l'arrivée des microprocesseurs sur le marché. Il observe des amateurs créer leurs propres ordinateurs à partir de ces nouveaux composants et veut faire de même. C'est en y travaillant qu'il a l'idée de créer un ordinateur personnel qui pourrait être utilisé par tous.
C'est l'origine d'Apple I, l'ordinateur.
Steve Wozniak le construit avec l'intention d'en donner les plans de fabrication gratuitement, en s'inspirant de l'éthique des hackers. Toutefois, Steve Jobs parvient à convaincre Steve Wosniak qu'il sera plus profitable de les vendre.
C'est l'origine d'Apple Computers, l'entreprise.
Selon l'histoire racontée ici, le nom Apple aurait été donné tout simplement à la suite d'une visite de Steve Jobs dans une ferme de production de pommes.
L'entreprise est un succès ! En 30 jours seulement, Apple fait des bénéfices substantiels qui lui permettront de développer son activité de façon exponentielle.
6 — L'Apple II : l'aube d'une ère nouvelle
L'enthousiasme du succès initial doit maintenant faire place à une vision rationnelle et pragmatique. Bref, l'entreprise doit se solidifier de façon durable autour de produits phares.
Steve Jobs est ici à la manœuvre. Il se rend compte que le prochain ordinateur, l'Apple II, doit "être emballé dans un produit de consommation entièrement intégré". En somme, il faut que le client achète un produit complet, facile d'accès et au packaging attrayant.
Pour l'aider dans cette tâche, le jeune entrepreneur embauche Mike Markkula.
Cette approche s'avère être un grand succès, puisque l'Apple II se vend à plus de six millions d'unités dans le monde. L'entreprise à la pomme décolle pour de bon !
Selon Walter Isaacson :
"Plus que toute autre machine, [l'Apple II] a lancé l'industrie de l'ordinateur personnel;"
Encore une fois, la paire des deux Steve fonctionne.
Steve Wozniak fournit le talent et l'expertise techniques ;
Steve Jobs tient les rennes de l'entreprise et apporte ses idées sur l'expérience du consommateur et le design des produits.
7 — Chrisann et Lisa : celui qui a abandonné…
Retour sur l'histoire personnelle. La petite amie de Steve Jobs, Chrisann, tombe enceinte.
Le jeune homme, complètement tourné vers sa réussite professionnelle, refuse toute implication. Il va même jusqu'à refuser de reconnaître la paternité de la petite Lisa et accuser l'un de ses amis d'être le père.
Cette réaction met un terme à la relation entre les deux amants.
Plus tard, Chrisann réalise un test qui démontre la paternité de Steve Jobs. À partir de ce moment, celui-ci se décide à payer une pension alimentaire. Mais il agit contraint par les événements et ne s'implique toujours pas dans la relation avec sa fille.
Plus tard, Steve Jobs exprimera des remords face à la façon dont il s'est comporté pendant cette période. Comme pour se racheter, il concevra même un ordinateur du nom de sa fille…
8 — Xerox et Lisa : les interfaces graphiques
Après ce nouveau succès entrepreneurial, Steve Jobs est persuadé qu'il doit développer un produit qui portera sa griffe, son nom. En effet, dans le monde informatique et dans l'entreprise elle-même, il est clair que c'est d'abord Steve Wosniak qui est crédité pour le résultat final de l'Apple II.
De nouveaux projets voient le jour :
L'Apple III ;
Lisa, un nouvel ordinateur personnel doté d'une interface graphique (GUI pour graphic user interface) et d'une souris.
Ces deux nouveaux modèles d'ordinateurs sont des échecs commerciaux.
Pourtant, il est indéniable que les idées de Steve Jobs se révèlent porteuses. En effet, c'est grâce à lui que se forme peu à peu l'environnement bureautique et numérique que nous connaissons aujourd'hui.
Mais l'entrepreneur ambitieux et capricieux devra attendre son heure. Malgré tous ses efforts, la direction d'Apple décide de sanctionner ces échecs et le dépossède de ses fonctions exécutives ; il n'a plus la main sur la conception des ordinateurs.
Il s'en sent très frustré. C'est, de son point de vue, la première trahison professionnelle qu'il subira.
9 — Passer en Bourse : vers la gloire et la fortune…
Apple entre en bourse moins de quatre ans après sa création. Un exploit !
À la fin des années 1980, l'entreprise est évaluée à 1,79 milliard de dollars. Pour Steve Jobs, qui n'a que 25 ans, cela signifie une fortune de 256 millions de dollars…
Comment appréhender cette richesse quand vous êtes un jeune hippie intéressé aux spiritualités orientales ? Dans ce chapitre intéressant, Walter Isaacson étudie la relation de l'entrepreneur à la pomme avec la richesse.
D'un côté, Steve Jobs a une vision du monde anti-matérialiste. Mais de l'autre, il aime profondément certains objets de consommation haut de gamme, tels que les Porsche, les couteaux Henckels ou les pianos Bösendorfer. Il cherche avant tout la beauté dans des objets de luxe ; c'est un esthète.
Qui peut aussi être un requin. Lors de l'entrée en bourse d'Apple, Steve Jobs interdit à de nombreux employés de la première heure d'acheter des options. Il se les réserve.
À l'inverse, Steve Wozniak offre généreusement un nombre important de ses propres actions pour compenser le comportement égoïste de son compagnon.
10 — Le Mac est né : vous vouliez une révolution
Le Macintosh ou Mac est certainement l'ordinateur le plus connu de sa génération. Vous le connaissez sans doute mieux que les Apple I et II. Le voilà, le premier grand succès commercial véritablement signé Steve Jobs !
Pourtant, en réalité, ce projet était initialement dirigé par Jeff Raskin. Ce spécialiste talentueux des relations homme-machine, d'abord embauché pour écrire un manuel pour l'Apple II, avait fait son chemin dans la hiérarchie, au point d'être aux commandes du projet.
D'ailleurs, c'est lui qui donna son nom au Macintosh, qui est en fait sa variété de pomme préférée !
Mais Steve Jobs, grâce à ses qualités rhétoriques et à son ambition, reprend peu à peu le contrôle et met toutes les cartes de son côté pour faire du Mac une véritable "révolution technologique".
11 — Le champ de distorsion de la réalité : imposer ses propres règles du jeu
Walter Isaacson décrit en effet un phénomène intéressant concernant Steve Jobs. Celui-ci est capable, selon ses propres collègues, de créer un "champ de distorsion de la réalité" grâce auquel il parvient à convaincre les gens et à les faire travailler à son avantage.
Selon l'auteur :
« À l'origine de la distorsion de la réalité se tenait la croyance de Jobs que les règles ne s'appliquaient pas à lui. »
D'où lui vient ce pouvoir et cette croyance ? Sans doute de son enfance. À force de lui avoir répété qu'il était spécial et "élu" par ses parents, Steve Jobs avait l'impression d'avoir à accomplir un destin hors norme.
En bref, le jeune entrepreneur veut être le nouvel Einstein ou Ghandi et pense pouvoir y parvenir !
Ce caractère charismatique a ses avantages et ses inconvénients.
Côté inconvénients : ses collègues se plaignent de sa vision du monde étriquée où vous êtes soit un génie, soit un abruti. Par ailleurs, Steve Jobs n'a pas peur de s'approprier les idées des autres sans leur en reconnaître le mérite.
Côté avantages : chef né, il parvient à créer des équipes talentueuses et motivées, qui veulent absolument faire partie de l'aventure Apple — malgré les désavantages !
12 — Le design : les vrais artistes simplifient
Steve Jobs a une ambition : trouver le design parfait. C'est là sa "patte" spécifique et ce qu'il espère infuser dans tous les aspects du projet Macintosh. Le Mac doit être un objet parfait et total.
"La simplicité de la conception devrait être liée à la facilité d'utilisation des produits." (Steve Jobs, Chapitre 12)
L'entrepreneur veut que les produits Apple soient intuitifs. L'expérience utilisateur doit être aisée. C'est notamment pourquoi, selon lui, il insiste sur le caractère fermé des ordinateurs Apple (impossible à modifier et incompatibles avec d'autres marques).
Mais plus important encore, Steve Jobs veut que ses ingénieurs se perçoivent comme des artistes ou des artisans à l'ancienne. Pour lui, créer un Mac est du domaine de l'art avant d'être uniquement un produit technologique.
Pour symboliser cette vision, il demande à tous les membres de l'équipe Macintosh de graver leurs noms dans chaque Macintosh, tout comme le feraient des artistes pour leur œuvre.
13 — Fabriquer un Mac : le voyage est la récompense
Pour Walter Isaacson, une autre caractéristique importante de la personnalité de Steve Jobs est sa compétitivité. Même au sein de l'entreprise, il cherche à gagner sur tous les fronts.
C'est ce qui se passe avec les projets Macintosh et Lisa. Comme il a été évincé du projet Lisa, il reporte toute son attention sur le projet Macintosh et fait tout pour que celui-ci soit sur le marché avant l'autre.
C'est pourtant le Lisa qui sera mis sur le marché avant… et qui connaîtra un échec (voir le chapitre 8).
Tous les regards se tournent déjà vers le Macintosh qui est, de fait, bien plus avancé que le Lisa. Et Steve Job en est bien plus fier.
L'anticipation est telle que le magazine Time décide de publier un article sur les coulisses du projet. L'ambitieux entrepreneur pensait devenir « l'homme de l'année » en 1982, mais, à la place, c'est le Mac lui-même qui est élu « Machine de l'année » !
14 — Entrée en scène de Sculley : le défi Pepsi
Dans le même temps, Steve Jobs recrute John Sculley, ancien président de PepsiCo, pour assumer le rôle de PDG d'Apple. Encore une fois, l'entrepreneur doit user de ses compétences rhétoriques pour le convaincre d'accepter.
Une fois en place, John Sculley et Steve Jobs deviennent très proches. Ils s'entendent si bien dans les premiers temps que la compréhension est totale. Cela dit, des querelles vont apparaître au fil du temps.
Leur premier désaccord majeur porte sur le coût du Mac.
Steve Jobs prévoit un prix à 1 995 $.
John Sculley, quant à lui, souhaite le pousser à 2 495 $, pour prendre en compte le coût des campagnes marketing.
Finalement, c'est le PDG John Sculley qui l'emporte. Steve Jobs regrettera cette décision, car elle a permis à Microsoft, selon lui, de dominer le marché pendant plus longtemps (au niveau des logiciels installés dans les ordinateurs, voir le chapitre 16).
15 — Le lancement : changer le monde
Un autre concurrent attire l'attention de Steve Jobs et de ses collègues. En effet, IBM commence à dépasser Apple sur le marché des ordinateurs personnels.
Pour résoudre ce problème, Steve Jobs décide de faire appel à la publicité. Il souhaite créer une publicité mémorable qui retienne l'attention des consommateurs comme jamais.
Pour ce faire, il en appelle au célèbre directeur Ridley Scott (réalisateur d'Alien, entre autres). Apple dépense 750 000 $ pour créer la campagne publicitaire la plus célèbre des années 1980 et peut-être du XXe siècle.
C'est la désormais mythhique publicité télévisée "1984". Celle-ci met en scène le Mac comme étant l'ordinateur anti-establishment, le moyen de contrer un pouvoir dystopique de type orwellien. Qui est la cible ? Les jeunes rebelles créatifs qui veulent se libérer de toutes les contraintes.
La publicité est diffusée au Super Bowl de 1984. C'est un événement. Considérée par certains comme la plus grande publicité télévisée de tous les temps, elle fait son effet : c'est en partie grâce à elle que le Mac devient un succès planétaire.
16 — Gates et Jobs : quand deux orbites se croisent
Revenons à Microsoft, l'autre grand concurrent de Apple. La rivalité est personnelle : Bill Gates est presque l'antithèse — sur le papier au moins — de Steve Jobs. Excepté le fait qu'ils travaillent tous dans le secteur de la tech et qu'ils sont nés en 1955, tout les sépare !
Steve Jobs est un ancien hippie à la spiritualité orientale. Il est intuitif, avec un caractère fort et désinhibé.
Bill Gates est le fils d'un riche avocat de Seattle, chrétien. Il est rationnel, doué pour le codage informatique et timide.
Au départ, la relation d'affaires officielle est bonne. Microsoft (Gates) écrit des logiciels pour le Macintosh ; essentiellement des programmes de traitement de texte et de feuilles de calcul (Word et Excel, aujourd'hui).
Cette collaboration fructueuse se grippe lorsque Bill Gates (qui est aussi un ambitieux) annonce le lancement de Windows, qui concurrence directement le système d'exploitation Mac.
Pour Bill Gates, Steve Jobs a, comme lui, pris son inspiration chez une troisième entreprise : Xerox. Il considère donc qu'il n'a rien volé à la firme à la pomme. Mais pour Steve Jobs, c'est une nouvelle trahison.
17 — Icare : à monter trop haut…
Le lancement du Mac est un véritable événement et un succès. Pour autant, les ventes se tassent après un petit temps.
L'ordinateur a en effet ses limites. Malgré son caractère novateur et son design attractif pour l'époque, il est lent et peu puissant.
Ces mauvaises performances amènent Steve Jobs sur une mauvaise pente. Il commence à être particulièrement désagréable, voire agressif avec les propres membres de son équipe. Au point que certaines personnes décident de quitter l'entreprise par sa faute.
Ces problèmes internes vont si loin que ce sera finalement lui qui sera mis à la porte !
En effet, John Sculley, pourtant ami et PDG de Apple, décide — avec l'aval du conseil d'administration — de virer Steve Jobs. Évincé de son propre business, l'entrepreneur se sent à nouveau trahi.
18 — NeXT : Prométhée délivré
Mais celui-ci rebondit. Il crée "NeXT" en finançant lui-même l'entreprise et en embauchant d'anciens employés d'Apple. Son objectif : vendre des ordinateurs et des dispositifs numériques aux écoles et aux universités.
Steve Jobs veut absolument soigner l'apparence et l'expérience utilisateur. Pour lui, du logo jusqu'au design de l'objet, les éléments esthétiques sont primordiaux.
Mais les prouesses techniques ne sont pas au rendez-vous. L'ordinateur de NeXT est un échec car ses performances ne sont pas la hauteur de ses concurrents.
19 — Pixar : quand la technologie rencontre l'art
C'est toutefois pendant cette périodre que Steve Jobs va trouver à se diversifier. Il s'intéresse de près à la division d'animation de la société de George Lucas, Lucasfilm : Pixar. Steve jobs achète 70 % de l'entreprise pour la bagatelle de 10 millions de dollars.
Au départ, l'entrepreneur n'a pas pour souhait de promouvoir le contenu animé. Il s'intéresse avant tout à la technologie qu'il pourrait exploiter et vendre. Mais c'est un nouvel échec.
Pourtant, il décide de ne pas abandonner. Lorsqu'il voit ce que les employés de Pixar sont capables de faire au niveau de l'animation, il décide tout de même de continuer à investir pour la réalisation de films.
En 1988, après avoir investi 50 millions de dollars dans la société, Pixar sort un court-métrage, Tin Toy, qui remportera l'Oscar du meilleur court métrage d'animation.
20 — Un homme comme les autres : Love is a four letter word
La vie personnelle de Jobs est également mouvementée . Plusieurs relations amoureuses marquent sa vie à cette époque :
Avec Joan Baez (la chanteuse) ;
Et Jennifer Egan (la romancière).
Après la mort de sa mère adoptive, il cherche aussi à renouer avec sa mère biologique. Il la rencontre finalement et découvre qu'il a également une demi-sœur, Mona, qui écrit et vit à Manhattan.
Steve Jobs cherche aussi à entretenir de meilleures relations avec sa fille Lisa. Mais celles-ci sont très instables. Ils se disputent, puis renouent avant de se disputer à nouveau. Il arrive qu'ils ne se parlent plus pendant des mois.
En 1989, Jobs rencontre sa future épouse : Laurene Powell. Laurene Powell est étudiante en MBA (Master of business affairs) à la Stanford Business School, où Steve Jobs est invité à prononcer un discours. C'est la rencontre.
Laurene tombe enceinte lors de leurs premières vacances en couple à Kona Village, Hawaï. Ils se marient en 1991 et organisent une cérémonie intime dans le parc national de Yosemite. Trois enfants naitront de ce mariage : Reed, Erin et Eve.
Lisa, la fille de Steve Jobs, emménagera un temps avec la famille avant d'aller à l'université de Harvard.
21 — Toy Story : Buzz et Woody à la rescousse
Dans ce chapitre, Walter Isaacson raconte comment Pixar et Disney se sont associés pour créer Toy Story, qui a été le point de départ d'un succès massif de Pixar dans l'industrie du divertissement.
C'est le PDG de Pixar, John Lasseter, qui présente l'idée du film à Disney pour que cette entreprise le distribue. L'idée est simple : c'est un film de copains sur des jouets… vivants. La plus grande crainte de ceux-ci consistant à être rejeté par leur propriétaire au profit de nouveaux jouets.
Le succès de Toy Story a donné lieu à un accord entre Disney et Steve Jobs qui durera plusieurs années.
22 — La Seconde Venue : le loup dans la bergerie
Selon Walter Isaacson :
"Au milieu des années 1990, Jobs trouvait du plaisir dans sa nouvelle vie de famille et son triomphe étonnant dans l'industrie du cinéma, mais il désespérait de l'industrie des ordinateurs personnels." (Steve Jobs, Chapitre 22)
Or, le temps du retour en grâce ne se fait plus attendre très longtemps. Chez Apple, le cours des actions est en baisse et John Sculley quitte le navire. Un nouveau PDG, Gil Amelio, le remplace. Et il fait appel à Steve Jobs en tant que consultant. Son rôle : insuffler une nouvelle dynamique à la multinationale.
Onze ans après son départ spectaculaire en 1985, Steve Jobs est nommé conseiller du PDG. Son entreprise, NeXT, est rachetée par Apple. Désormais, l'entrepreneur a les cartes en main pour jouer un nouveau coup de poker.
23 — La restauration : car le perdant d'aujourd'hui sera le gagnant de demain
Jobs commence par placer ses collègues les plus fidèles de NeXT à des postes de de direction chez Apple.
D'un autre côté, Steve Jobs s'assure des soutiens à l'extérieur. Le célèbre fondateur d'Oracle, Larry Ellison, lui déclare qu'il est disposé à acheter Apple et à l'installer à sa tête.
Steve Jobs refuse toutefois l'offre. Comme il refuse d'ailleurs de prendre les rennes en tant que PDG lorsque le conseil d'administration d'Apple l'invite à remplacer Gil Amelio. Il attend un moment plus favorable et plus sûr.
Mais l'entrepreneur exerce bel et bien son influence. Grâce à son statut, il conclut un accord historique avec Microsoft. Pour encourager la collaboration, Microsoft continuera à développer des logiciels pour le Mac. En échange, l'entreprise de Bill Gates recevra des actions Apple.
Ce pacte a mis fin à une bataille de longue haleine entre les deux géants de l'informatique et a instantanément augmenté la valeur d'Apple en tant qu'entreprise sur les marchés boursiers.
24 — Think Different : Jobs, iPDG
Steve Jobs va plus loin. Face à la crise que connait l'entreprise, il décide qu'il est temps de galvaniser à nouveau les foules grâce à une nouvelle campagne publicitaire audacieuse.
Le résultat ? La campagne publicitaire — elle aussi désormais légendaire — de "Think Different". À nouveau, Apple se positionne comme une entreprise pour les rebelles qui souhaitent exprimer leur créativité en s'opposant aux normes en place.
Steve Jobs choisit aussi de réorienter la production. Moins de nouveaux projets et de produits, mais plus de conception de produits de grande qualité.
Pour l'auteur, Walter Isaacson :
« Cette capacité à se concentrer a sauvé Apple. ».
Finalement, les efforts de Steve Jobs se révèlent payants. Un nouvel élan commercial en faveur d'Apple voit le jour et l'entreprise commence progressivement à retrouver sa valeur sur le plan financier.
25 — Principes de design : le duo Jobs et Ive
Comme auparavant, les principes esthétiques sont fondamentaux pour Steve Jobs. Celui-ci veut des produits faciles d'usage et beaux comme des œuvres d'art.
C'est pour cette raison qu'il embauche Jony Ive, un designer talentueux qui va l'aider à définir encore davantage l'essence des produits Apple. Leur collaboration durera de nombreuses années.
Obsédés par la valeur d'un design parfait et simple, ils prennent divers brevets de conception pour les produits Apple. Tout est pensé : même des choses aussi simples que l'emballage des produits sont conçues avec soin dans le but d'augmenter l'engagement des consommateurs pour le produit..
26 — L'iMac : hello (again)
Apple renaît. Grâce à la collaboration de Steve Jobs avec Jony Ive, de nouvelles idées émergent. L'iMac fait son apparition : un boîtier bleu translucide où l'on devine la mécanique de la machine, sans pouvoir y accéder.
Chaque détail a été pensé intelligemment. Faut-il un lecteur CD avec boîtier ou non ? Encore une fois, Apple cherche la précision et la perfection.
Son prix ? Environ 1 200 $. Conçu pour les utilisateurs de tous les jours. Et c'est un phénomène commercial, tout le monde en veut un à l'époque.
Lors de sa sortie en 1998, l'iMac devient l'ordinateur le plus vendu de toute l'histoire d'Apple.
27 — JOBS P-DG : toujours aussi fou malgré les années
Après le succès de l'iMac et de la campagne publicitaire "Think Different", Steve Jobs revient définitivement aux commandes d'Apple en tant que PDG.
Il n'exige qu'un salaire symbolique de 1 $, mais ne se laisse pas aller pour autant : avec 20 millions d'options d'achat d'actions en compensation, il a de quoi voir venir.
Entre-temps, Apple est devenu une entreprise globale qui a des fans dévoués dans le monde entier. Cette Apple mania, comme on le sait, n'est pas près de s'éteindre.
Bref, Steve Jobs prouve, à l'aube des années 2000, qu'il peut être à la fois un visionnaire d'affaires et un génie créatif. Et ce n'est, d'une certaine manière, que le début !
28 — Les Apple Store : genius bar et grès de Florence
Obsédé par l'expérience client, Steve Jobs envisage un espace de vente au détail où seuls les produits Apple seraient vendus. Et il le fait !
Après la construction d'un prototype en 2001 en Virginie, des magasins Apple commencent à émerger partout dans le monde. Souvent situés dans des endroits stratégiques et prestigieux, ils accueillent, dès 2004, plus de 5 000 visiteurs par semaine en moyenne.
Conçus de façon minimaliste et luxueuse, ces espaces de vente sont les premiers magasins de détail technologiques du genre. Ils sont organisés pour mettre en évidence le caractère unique des produits Apple.
À nouveau, Steve Jobs fait mouche. Il a cette capacité fascinante d'offrir à ses clients des expériences nouvelles et de créer de nouveaux désirs.
29 — Le foyer numérique : de l'iTunes à l'iPod
Et l'entrepreneur ne s'arrête désormais plus. Alors que tout le monde se met à télécharger de la musique en ligne et à la graver sur des compact-discs, lui voit plus loin.
Convaincu que la musique sera une fonction essentielle des outils numériques, il cherche le moyen de "disrupter" le secteur. C'est comme ça qu'il développe en parallèle :
iTunes, la plateforme pour télécharger de la musique en ligne de façon légale ;
l'iPod, à savoir le baladeur audio qui permet d'écouter la musique téléchargée.
C'est là, véritablement, le début de l'hégémonie d'Apple dans le domaine technologique. L'entreprise a une longueur d'avance sur tous ses concurrents.
Et l'entrepreneur pense connexion entre les appareils. C'est-à-dire : connexion entre les outils Apple. En effet, la logique commerciale est claire : si les utilisateurs peuvent transférer leur musique de l'iPod vers leur iMac (et vice-versa), il y a de bonnes chances pour que ceux-ci achètent l'ordinateur qui leur permettra de le faire.
30 — L'iTunes Store : je suis le joueur de flûte
Alors que l'iPod est devenu un énorme succès commercial, Jobs a vu le besoin de l'iTunes Store, qui contournerait le processus d'achat de musique, ajoutant ainsi à la fois légitimité et commodité à l'expérience client.
Les dirigeants de grandes maisons de disques ont eu du mal à lutter contre le piratage et les téléchargements illégaux, ils étaient donc venus chez Apple - à Jobs - pour obtenir de l'aide.
La proposition de Jobs était une plate-forme plus transparente et intégrée pour l'achat de musique, qui comprenait des téléchargements de 99 cents pour des chansons individuelles. iTunes a changé la donne pour l'industrie de la musique et, à bien des égards, a contribué à la sauver du piratage.
Au cours de sa première année d'existence, l'iTunes Store a vendu 70 millions de chansons.
31 — Music Man : la bande-son de sa vie
Dans ce chapitre, Walter Isaacson parle de l'amour de Steve Jobs pour la musique. En particulier, l'entrepreneur, ancien hippie, est un inconditionnel de :
Bob Dylan ;
Les Beatles.
Obsédé par le catalogue musical de ces artistes, il cherche à les rendre disponibles sur sa plateforme. Et il y réussit.
Pour Bob Dylan, cela s'avère plutôt facile. L'utilisateur peut s'offrir toutes les chansons du chanteur rebelle pour 199 $ seulement. Le célèbre parolier apparaît même dans une publicité pour l'iPod à l'occasion de son dernier album, Modern Times.
Pour les Beatles, c'est plus compliqué. Il faudra attendre quelques années — jusqu'en 2010 — avant de pouvoir télécharger leur musique via iTunes.
Par ailleurs, U2, le célèbre groupe de rock irlandais, s'associe à Apple pour promouvoir :
Leur album How to Dismantle an Atomic Bomb ;
La sortie d'un iPod spécial.
Enfin, l'auteur mentionne la passion de Steve Jobs pour un autre artiste, plus classique : Jo-jo Ma. Ce violoncelliste virtuose jouera aux obsèques de l'entrepreneur quelques années plus tard.
32 — Les amis de Pixar : … et ses ennemis
Steve Jobs, qui possède Pixar, veut conclure un accord avec Disney. Dans ce nouvel accord :
Disney achète Pixar ;
Mais Pixar conserve sa propre identité indépendante.
Après la conclusion de l'accord, Jobs a déclaré :
"mon objectif a toujours été non seulement de fabriquer d'excellents produits, mais aussi de construire de grandes entreprises […] nous avons gardé Pixar comme une grande entreprise et avons aidé Disney à le rester aussi." (Steve Jobs, Chapitre 32)
33 — Le Mac du XXI siècle : Apple se démarque
Alors que de nombreuses marques se contentent de copier des designs ou de fabriquer des ordinateurs sans aucune originalité, Apple cherche constamment à se renouveler et aller au-delà de ce que l'entreprise a déjà fait. Quitte, parfois, à échouer à nouveau.
Dans les années 2000, Apple sort un ordinateur portable grand public, ainsi que le Power Mac G4 Cube. C'est un échec, mais l'ordinateur sera tout de même exposé au Musée d'art moderne de Californie.
C'est le caractère entrepreneurial profond de Steve Jobs. Oser échouer et expérimenter sa créativité.
34 — Premier round : memento mori
Mais tous les hommes sont mortels. Et même Steve Jobs.
Celui-ci apprend qu'il a un cancer du pancréas lors d'un examen urologique de routine en octobre 2003. Il refuse la chirurgie pendant neuf mois. À la place, il a recours à des médecines alternatives et suit un régime strict.
Mais cela ne fonctionne pas. Ses médecins lui intiment de se faire opérer, sans quoi — lui prédisent-ils — il mourra.
Il subit donc une opération en juillet 2004. Mais il découvre dans le même temps que le cancer s'est propagé, gagnant d'autres parties du corps. Une chimiothérapie est nécessaire.
En juin 2005, il prononce son célèbre discours d'ouverture à l'université Stanford. Aaron Sorkin, ami et célèbre scénariste, l'aide dans la rédaction.
Steve Jobs réfléchit bien sûr à sa mortalité. Il cherche à faire amende honorable pour certaines erreurs du passé. Il se demande, aussi, si son travail acharné pour Apple et Pixar ne l'ont pas conduit à développer ce mal qui le ronge.
Le coût de son génie serait-il ce mal physique ?
35 — L'iPhone : trois produits révolutionnaires en un
L'entrepreneur charismatique va pourtant aller encore plus loin. Après le succès de l'iPod, Steve Jobs entrevoit la suite : un téléphone avec écran tactile et, comme toujours, un design élégant et minimaliste.
La recherche est complexe. Il faut trouver les matériaux adéquats et réussir à tout assembler. L'équipe en charge du projet doit s'y reprendre à deux fois. Mais finalement, le premier iPhone est mis en vente en juin 2007.
En 2010, comme le note Walter Isaacson :
"Apple avait vendu quatre-vingt-dix millions d'iPhones, et elle a récolté plus de la moitié des bénéfices totaux générés sur le marché mondial des téléphones cellulaires."
C'est indéniable : le smartphone a changé nos existences, tout autant — voire peut-être plus — que les ordinateurs personnels.
36 — Deuxième round : la récidive
Désormais, les épisodes de rechutes s'accélèrent. En 2008, le cancer de Jobs refait surface. Il doit subir une opération de transplantation du foie en 2009.
Durant de longs mois, il ne divulgue pas ses problèmes de santé. Mais le secret, peu à peu, s'évente.
Affaibli par la greffe du foie, il revient néanmoins à la charge et retrouve son caractère combatif et novateur. Il a déjà eu de nombreux succès ? Qu'à cela ne tienne ! Un nouveau défi l'attend…
37 — L'iPad : l'ère post-PC
L'iPad a reçu le surnom de « tablette Jésus » lorsqu'elle a été présentée au grand public en 2010. C'est, en effet, un petit objet miraculeux qui permet de se passer de l'ordinateur pour bien des tâches. Une sorte d'hybride entre un téléphone et un ordinateur.
C'était d'ailleurs un projet que Steve Jobs avait depuis longtemps, mais qu'il avait mis en pause afin de sortir l'iPhone d'abord.
Apple vend plus d'un million d'iPads au cours du premier mois, puis quinze millions au cours des neuf premiers mois de son existence, ce qui en fait "le lancement de produits de consommation le plus réussi de l'histoire".
Isaacson note :
« avec l'iPod, Jobs avait transformé l'industrie de la musique. Avec l'iPad et son App Store, il a commencé à transformer tous les médias, de l'édition au journalisme en passant par la télévision et les films » (503).
Encore une fois, Steve Jobs réussit à surpasser tout le monde. Les autres entreprises suivront, plus tard, en créant des tablettes en tous genres.
38 — Nouvelles batailles : un écho des anciennes
Quelques jours seulement après la révélation de l'iPad au public, Steve Jobs s'en prend au système Android de Google, qui, selon lui, est une copie du système d'exploitation d'Apple.
À nouveau, l'entrepreneur vit cette concurrence comme une trahison personnelle. Pourquoi ? Car, au départ, Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google, avaient manifesté leur respect pour lui.
Steve Jobs intente une action en justice, en invoquant une violation du droit d'auteur.
Au milieu de cette bataille, Jobs est resté attaché à l'idée d'un système fermé, compatible uniquement avec d'autres appareils Apple afin de fournir aux consommateurs une expérience optimisée et simplifiée.
Pourtant, même en insistant sur des notions qui déconcertaient souvent les autres, Jobs est resté profondément passionné par les choses qui lui tenaient vraiment à cœur, y compris enfin l'introduction des Beatles sur iTunes, ce qui s'est produit à l'été 2010.
39 — Le nuage, le vaisseau spatial, et au-delà
Après avoir mis sur le marché l'iPad 2, Steve Jobs donne la priorité à deux autres projets :
l'iCloud ;
Le nouveau siège social d'Apple, avec ses douze mille employés, et son allure de "vaisseau spatial".
Épuisé mais convaincu par ces projets, l'entrepreneur se donne corps et âme pour les mener à bien. Mais la maladie le rattrape encore et, cette fois, il doit faire face à la dure réalité.
40 — Troisième round : dernier combat au crépuscule
En 2010, Steve Jobs souhaite à tout prix assister à la cérémonie de remise des diplômes d'études secondaires de son fils, Reed. Ce jour-là, il écrit à Walter Isaacson que c'est "l'un des jours les plus heureux de sa vie".
À la même période, Steve Jobs rencontre le président Barack Obama pour parler d'éducation, et en particulier sur la formation d'ingénieurs, trop peu mise en avant lors des cursus scolaires.
Selon lui, c'est la raison pour laquelle Apple, et tant d'autres entreprises mondiales, font fabriquer leurs dispositifs électroniques dans d'autres pays.
Les derniers mois de Steve Jobs sont consacrés à sa vie intime. Il ne participe plus à de grandes réunions ou à des lancements historiques. Il cherche à se ménager et à ménager ses proches, à qui il doit faire ses adieux.
Il se retire également de la direction d'Apple en août 2011. Tim Cook, l'un de ses collaborateurs passionnés, prend le relais en tant que PDG.
41 — Héritage : "Jusqu'au ciel le plus brillant de l'invention"
Quel est l'héritage de Steve Jobs ? Selon Walter Isaacson :
"Steve Jobs est devenu le plus grand dirigeant d'entreprise de notre époque, celui dont on se souviendra le plus certainement dans un siècle. (...) L'histoire le placera dans le panthéon juste à côté d'Edison et Ford » (566). (Steve Jobs, Chapitre 41)
Pour autant, l'auteur ne cache pas les difficultés. L'entrepreneur a été, bien souvent, un être à l'ambition démesurée. Pour parvenir à ses fins, il s'est montré parfois calculateur, désagréable et même manipulateur.
Il n'en reste pas moins que son impact sur le monde est durable et évident.
C'est pourquoi, à côté de ses défauts, il faut ajouter sa vision. Steve Jobs rêvait de l'impossible et il avait la force de le réaliser. Il souhaitait allier l'art à la technologie et mettait la créativité et l'innovation au cœur de toute sa démarche.
Isaacson cite ensuite les propres mots de Steve Jobs pour conclure le livre :
"Nous essayons d'utiliser les talents que nous avons pour exprimer nos sentiments profonds, pour montrer notre appréciation de toutes les contributions qui nous ont précédés et pour ajouter quelque chose à ce flux. C'est ce qui m'a motivé. » (Steve Jobs, Chapitre 41)
Conclusion sur "Steve Jobs" de Walter Isaacson :
Ce qu'il faut retenir de "Steve Jobs" de Walter Isaacson :
J'avais déjà donné mon avis sur ce livre dans une vidéo et un court article. Mais l'ouvrage valait bien un compte rendu complet, tant il est important ! Alors, voilà : je vous conseille vivement la lecture de Steve Jobs si vous ne l'avez pas encore lu.
C'est tout simplement une biographie de référence sur cet entrepreneur d'exception aux multiples visages. Et c'est, surtout, une mine d'idées inspirantes pour vous aider à vous lancer, vous aussi, dans l'aventure de l'entrepreneuriat — ou de l'infopreneuriat.
Par ailleurs, si vous voulez continuer à explorer ce thème, je vous conseille la lecture de :
Les secrets de présentation de Steve Jobs ;
Les 65 meilleures citations de Steve Jobs ;
Bill Gates et la saga Microsoft.
Points forts :
Ce livre est très bien écrit, c'est un "page turner" ;
Il vous fera entrer dans l'aventure entrepreneuriale la plus saisissante de notre temps, à la charnière entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle ;
Vous apprendrez à comprendre la personnalité complexe de Steve Jobs ;
Et vous pourrez utiliser sa pensée pour avancer dans vos propres projets.
Point faible :
Je n'en ai pas trouvé.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu le livre de Walter Isaacson, « Steve Jobs » ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Walter Isaacson, « Steve Jobs ».
Visitez Amazon afin d’acheter le livre de Walter Isaacson, « Steve Jobs ».
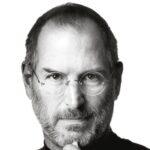 ]]>
]]>Résumé de "La véritable histoire de la monnaie | De l'âge de bronze à l'ère numérique" de Jacob Goldstein : à travers un fascinant voyage dans le temps, cet ouvrage nous révèle les origines et les mutations de la monnaie. Il nous montre comment cette invention sociale qui régit nos échanges depuis des millénaires, de façon si ordinaire et mystérieuse à la fois, a fondamentalement façonné nos sociétés et nos relations économiques.
Par Jacob Goldstein, 2022, 240 pages.
Titre original : "Money: The True Story of a Made-Up Thing"
Chronique et résumé de "La véritable histoire de la monnaie | De l'âge de bronze à l'ère numérique" de Jacob Goldstein
Introduction | Note de l’auteur
La monnaie est profondément sociale
Dans une note introductive, Jacob Goldstein, l'auteur de "La véritable histoire de la monnaie", commence par raconter comment une discussion avec sa tante sur la nature de la monnaie a, un jour, éveillé sa curiosité de journaliste :
"La monnaie est une fiction. Au début ça n’existait même pas », me dit-elle. C’est là que j’ai compris que la monnaie est beaucoup plus étrange et intéressante que je ne l’avais jamais imaginé."
En cherchant à comprendre la crise financière de 2008, l'auteur découvre le podcast Planet Money et décide de rejoindre leur équipe. Il y est alors amené à approfondir sa réflexion sur l'essence de la monnaie : une invention sociale qui a, dit-il, profondément évolué au fil de l'histoire.
"La monnaie semble appartenir au monde froid des mathématiques, à mille lieues de celui, plus confus, des relations humaines. Il n’en est rien. La monnaie est une invention, une fiction partagée. Elle est foncièrement, irrévocablement un fait social. (...) Comme la fiction, la monnaie a profondément changé au fil du temps, non sans heurts. Avec le recul, on observe de longues périodes de relative stabilité, puis, soudain, la monnaie entre en crise quelque part dans le monde : un génie sort de la bouteille avec une idée nouvelle, ou bien le monde connaît un bouleversement qui requiert une nouvelle sorte de monnaie, ou encore un effondrement de la finance provoque la version monétaire d’une crise existentielle. Il en résulte un changement durable du concept de monnaie : sa nature, qui a le droit de l’émettre et dans quel but."
Revenir aux origines de la monnaie pour mieux la comprendre
Jacob Goldstein observe que la définition de la monnaie résulte, en fait, de nos choix collectifs. Ces choix ont façonné le monde actuel et façonneront la future monnaie.
Aussi, pour l'auteur, revenir aux origines de la monnaie est le meilleur moyen de saisir sa nature et ses enjeux. Cet ouvrage, annonce-t-il, est "l’histoire des événements – plein de surprise, de joie, d’intelligence et de folie – qui ont façonné la monnaie telle que nous la connaissons aujourd’hui".
Partie 1 | L’invention de la monnaie
Dans la première partie de "La véritable histoire de la monnaie", Jacob Goldstein nous montre que l'origine de la monnaie est, contrairement aux idées reçues, plus complexe et fascinante qu'un simple passage du troc à un moyen d'échange pratique. Elle est, signale-t-il, intimement liée aux relations sociales, aux rituels et à l'émergence des premières cités.
Chapitre 1 - L'origine de la monnaie
Le chapitre 1 de "La véritable histoire de la monnaie" explique comment la théorie classique selon laquelle la monnaie serait née du troc pour le faciliter, défendue par des penseurs comme Adam Smith ou Aristote, est aujourd’hui remise en question par les anthropologues et historiens.
Jacob Goldstein nous fait observer que, dans les sociétés prémonétaires largement autosuffisantes, les échanges prenaient, en réalité, souvent la forme de dons ritualisés. Ces dons visaient à gagner en prestige.
Pour l’auteur, la monnaie trouve donc son origine autant dans ces pratiques que dans le troc.
1.1 - Dettes de moutons
Il y a plus de 5000 ans, les premières cités émergent en Mésopotamie.
Un système de jetons d'argile scellés dans des boules creuses s’y développe pour matérialiser les dettes de moutons. Les symboles gravés sur ces boules donnent alors naissance à l'écriture. Les premiers témoignages sont des reconnaissances de dettes :
"Garder trace de qui devait quoi à qui devenait plus compliqué. Des serviteurs des temples (qui faisaient aussi office d’hôtel de ville) ont eu l’idée d’améliorer le système d’empreintes de jetons. Munis de stylets en roseau pour marquer des tablettes d’argile, ils se sont mis à utiliser des symboles pour figurer les chiffres. Les premiers écrivains n’étaient pas des poètes, mais des comptables. Longtemps, il n’y a pas eu d’autres écritures. Ni billets d’amour, ni élégies, ni récits. Uniquement des reconnaissances de dettes de moutons. Ou, comme l’indique une tablette exhumée d’un célèbre tumulus de la ville sumérienne d’Uruk (en Irak aujourd’hui) : "Lu-Nanna, chef du temple, a reçu une vache et ses deux veaux allaitants en cadeau royal des mains d’Abasaga"."
L'argent métal commence ensuite à être utilisé comme monnaie, bien que de nombreuses civilisations (comme les Incas) fonctionnaient sans, et ce, grâce à une économie planifiée et redistributive.
1.2 - La monnaie change tout
Vers 1100 av. J.-C., la civilisation mycénienne de la Grèce antique s’effondre. De nouvelles cités-États appelées "polis" se développent alors sur un modèle plus horizontal :
"Les citoyens (les polites) tiennent à être associés à la répartition des richesses (qui donne quoi à qui). Il leur faut une organisation de la vie publique et des échanges affranchis du pouvoir vertical d’un souverain autoritaire et de l’horizontalité des réseaux familiaux : il leur faut de la monnaie."
Vers 600 av. J.-C., le royaume de Lydie invente alors les premières pièces de monnaie en électrum. Ces dernières sont rapidement adoptées par les cités grecques.
"Des bouts de métal standardisés, c’est exactement ce dont les cités-États avaient besoin pour bâtir leur nouvelle société, trop grande pour être gérée selon les règles de la réciprocité familiale, mais trop égalitaire pour l’être selon le régime du tribut. Bientôt, des centaines d’ateliers monétaires apparaissent partout en Grèce, frappant des pièces d’argent. En quelques décennies, les quasi-monnaies que les Grecs utilisaient jusque-là pour mesurer la valeur et échanger des biens (rôtissoires en fer ou lingots d’argent) ne sont plus considérées comme telles. La monnaie, ce sont les pièces, et les pièces sont la monnaie."
Cela transforme profondément la société. L'agora (= une place publique, lieu de rassemblement et de discours des citoyens) devient un marché. Et "la population bascule dans la nouvelle économie salariale" écrit l'auteur : le salariat remplace les engagements à long terme.
La monnaie offre plus de liberté mais aussi une plus grande précarité aux individus.
Malgré les critiques d'Aristote, les pièces se répandent dans le monde entier.
Chapitre 2 - Où l'on invente le papier-monnaie, déclenche une révolution économique et glisse tout sous le tapis
2.1 - L’invention du papier-monnaie
Le deuxième chapitre de "La véritable histoire de la monnaie" nous ramène au 13ème siècle. En effet, il commence par raconter comment, en 1271, Marco Polo vit, en Chine, une expérience monétaire inédite : le papier-monnaie.
L’auteur revient ici sur cette invention.
Les Chinois, indique-t-il, ont inventé les pièces en bronze à la même époque que les Lydiens.
Mais la rareté du bronze dans certaines régions et le poids des pièces posaient problème : "La plupart des pièces sont alors frappées en bronze, mais le bronze étant rare au Sichuan, on utilise du fer. Dans un monde où la valeur des pièces est essentiellement fondée sur le métal qui les constitue, le fer est une calamité. Pour acheter une livre de sel, il faut une livre et demie de pièces en fer. Comme s’il fallait aujourd’hui payer ses courses exclusivement en pièces d’un centime !"
Vers 995, un marchand de Chengdu, la capitale du Sichuan, trouve une solution : il émet des reçus en papier échangeables contre des pièces en fer (l'imprimerie a fait son apparition deux siècles plus tôt en Chine).
Rapidement, les gens s’emparent de ce système de reçus comme monnaie. Ainsi, malgré les contrefaçons, le papier-monnaie connait un vif succès.
2.2 - Une monnaie sans garantie
Quand, au 13ème siècle, les Mongols envahissent la Chine, ces derniers adoptent immédiatement le papier-monnaie. C’est une monnaie idéale pour leur vaste empire commercial et leur mode de vie nomade, souligne l’auteur.
Dès qu'il devient empereur, Kubilai Khan crée un nouveau type de papier-monnaie utilisable dans tout l'empire et interdit, sous peine de mort, les pièces de bronze. Mais après deux invasions ratées du Japon, le grand khan émet un nouveau type de billets que plus personne ne veut échanger contre du métal précieux :
"Les billets affichent toujours des images de pièces en bronze, mais ce ne sont plus que des images. Les autorités refusent de les échanger contre de l’argent ou du bronze ; les gens ne peuvent plus troquer leurs bons du trésor pour un trésor. On peut imaginer la panique que cela provoque. L’inflation décolle : les prix grimpent à mesure que la monnaie perd de sa valeur."
Malgré l'inflation initiale, l'économie se stabilise : les Chinois ont compris que le papier pouvait être une monnaie fiable, même sans garantie matérielle.
Cette expérience d'il y a 1000 ans rappelle quelque part notre époque où l'on voit la richesse augmenter : "en raison des mutations technologiques, la plupart des gens sont plus riches que leurs ancêtres".
L'auteur considère ainsi que la Chine a connu sa propre révolution économique et technologique 800 ans avant l'Europe, mais elle a ensuite stagné, indique-t-il. Une hypothèse est que les empereurs Ming, hostiles au commerce et à la monnaie, ont voulu revenir à une économie agricole autosuffisante basée sur le tribut en nature. Le papier-monnaie y a alors disparu.
Cet âge d'or chinois, aussi long que notre expérience actuelle du papier-monnaie, montre que le progrès économique et technologique n'est jamais garanti : les civilisations peuvent aussi s'appauvrir et la monnaie elle-même peut disparaître.
Partie 2 | L'assassin, le Dauphin et l'invention du capitalisme
Dans la deuxième partie de son livre "La véritable histoire de la monnaie", Jacob Goldstein nous plonge dans l'effervescence de l'Europe du 17ème siècle.
Durant ce siècle, le hasard transforme des orfèvres en banquiers, et vont naître la Bourse et l'entreprise moderne. Au cœur de cette période charnière, Jacob Goldstein nous présente notamment John Law. Ce personnage fascinant et controversé incarne à lui seul les bouleversements de cette époque fondatrice du capitalisme.
Chapitre 3 - Où les orfèvres réinventent la banque par hasard (et sèment la panique en Grande-Bretagne)
3.1 - La crise monétaire anglaise du 17ème siècle et l’invention de la banque moderne
L'auteur commence le chapitre 3 de "La véritable histoire de la monnaie" en nous décrivant l'état lamentable de la monnaie en Angleterre au 17ème siècle.
Les pièces rognées contiennent moins de métal précieux que prévu. Elles suscitent alors méfiance et disputes. Les bonnes pièces, quant à elle, connaissent une fuite vers l'étranger, aggravant la pénurie de numéraire.
C'est alors que les orfèvres, en stockant l'or et l'argent de clients fortunés contre des reçus, résolvent involontairement le problème.
En effet, l'auteur explique ce tournant crucial : lorsque les orfèvres se mettent à prêter en échange de simples promesses de remboursement, ils créent de la monnaie ex nihilo, comme le font les banques modernes avec le système de réserves fractionnaires :
"Les banques actuelles font ce que faisaient les orfèvres il y a quatre cents ans : lorsque vous déposez de l’argent à la banque, celle-ci en prête une partie à quelqu’un d’autre. Cet argent, votre argent, se trouve désormais à deux endroits simultanément. C’est le vôtre, sur votre compte, dans votre banque, mais c’est aussi celui de l’emprunteur qui peut le déposer dans une autre banque qui peut à son tour en prêter une partie à quelqu’un d’autre. Le même dollar (ou euro) se trouve désormais dans trois endroits à la fois. C’est ce qu’on appelle le "système de réserves fractionnaires" et c’est ainsi que la plus grande partie de la monnaie est créée aujourd’hui."
3.2 - John Law : premier acte
L'auteur introduit ensuite John Law, né en 1671 au-dessus de l'atelier de son père orfèvre.
Après une jeunesse dorée mais dispendieuse, John Law tue en duel un certain Edward Wilson en 1694. Condamné à mort, il parvient s'évader de prison grâce à des appuis puissants.John Law s'enfuit sur le continent, au-devant d'une révolution intellectuelle qui façonnera sa destinée : "une révolution intellectuelle qui va transformer le regard porté sur l’avenir etla monnaie et lui faire gagner une fortune" livre l'auteur.
Chapitre 4 - Où l'on fait fortune grâce aux probabilités
Dans le quatrième chapitre de "La véritable histoire de la monnaie", Jacob Goldstein relate comment, durant ses années de cavale, John Law découvre la théorie des probabilités.
"Les dix années qui suivent sont mal connues. Law disparaît de la chronique, puis réapparaît à Paris, à Venise ou à Amsterdam. À chaque fois qu’il sort des brumes, on le trouve à une table de jeu en compagnie des élites locales ; à chaque fois, il gagne. Il n’est pas particulièrement chanceux, il ne triche pas non plus, semble-t-il. Il gagne parce qu’il a découvert une discipline intellectuelle née à son époque, une façon de voir le monde qui va modifier celle dont des millions de gens envisagent Dieu, l’argent, la mort et l’avenir. Cette discipline est la théorie des probabilités. Elle est à la base d’une bonne partie de la finance moderne et, par-là, de la pensée moderne. Elle a été inventée par des joueurs."
4.1 - La découverte de la théorie des probabilités
L’auteur commence par expliquer ce qu’est la théorie des probabilités.
Ainsi, cette théorie révolutionnaire permettait, nous apprend-il, de quantifier les chances de gain ou de perte au jeu. Ce sont alors les mathématiciens Blaise Pascal et Pierre de Fermat qui furent les premiers à résoudre le "problème du partage des gains", en calculant les probabilités de chaque issue possible.
Aussi, l'auteur souligne l'impact considérable de cette découverte : pour la première fois, l'homme pouvait prédire l'avenir par les mathématiques, et non plus seulement s'en remettre au hasard ou à la providence.
Il rapporte comment Pascal a même appliqué ce raisonnement probabiliste à la question de l'existence de Dieu, concluant qu'il valait mieux parier sur son existence au vu des gains infinis en jeu.
4.2 - Les probabilités dans la vie
L'auteur décrit ensuite comment John Law a donc eu recours à sa maîtrise des probabilités pour s'enrichir au jeu, tandis que d’autres les appliquent alors à des domaines comme les rentes viagères et l'assurance-vie.
Il détaille les travaux du mathématicien Edmond Halley qui, en analysant les registres de naissances et décès de la ville de Breslau, parvient à chiffrer la probabilité de décès à chaque âge et grâce à cela, à déterminer le juste prix d'une rente.
Puis l'auteur raconte comment deux pasteurs écossais s'inspirent, à cette époque, des tables de mortalité de Halley pour créer un fonds d'assurance-vie pour les veuves de pasteurs. Ces derniers ont, en fait, réussi à anticiper les cotisations nécessaires avec une précision remarquable.
Jacob Goldstein conclut le 4ème chapitre de son livre "La véritable histoire de la monnaie" en soulignant combien le raisonnement probabiliste est désormais devenu omniprésent et tenu pour acquis dans nos sociétés.
Chapitre 5 - Où la finance est un voyage dans le temps
5.1 - Nouveau modèle de financement
Dans le chapitre 5 de "La véritable histoire de la monnaie", Jacob Goldstein explique qu'au début du 17ème siècle à Amsterdam, les marchands hollandais (qui parcourent les océans et ramènent des marchandises de lointaines contrées) résolvent le problème du financement de leurs expéditions maritimes en Asie grâce à un nouveau modèle : la compagnie marchande. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC) en est un exemple.
"Les marchands hollandais qui organisent ces expéditions maritimes lointaines et périlleuses sont confrontés à un problème ancien. Ils ont un projet pour faire fortune, mais ils doivent d’abord en dépenser une pour le réaliser. Il leur faut construire des navires, recruter un capitaine et un équipage, les envoyer à l’autre bout du monde et les faire revenir. Ce problème de "j’ai besoin d’argent pour en gagner plus" se décline à l’infini. Je veux acheter une voiture pour me rendre à mon nouveau travail qui me permettra de gagner plus. Mais c’est maintenant que j’ai besoin de cet argent que je gagnerai demain avec mon nouveau job pour payer la voiture qui doit m’y conduire pour gagner plus, etc. "
5.2 - La finance pour connecter des gens aux besoins opposés
Avec ce nouveau modèle de financement, l’auteur souligne que la finance permet de faire "voyager l'argent dans le temps". Pour cela, elle met en relation ceux qui sont prêts à en prêter maintenant pour en gagner plus demain, et ceux qui en ont besoin aujourd'hui quitte à en rembourser davantage plus tard :
"Heureusement, d’autres ont plus d’argent qu’ils n’en ont besoin à l’instant présent. Et ils acceptent de renoncer à le dépenser aujourd’hui, pour me donner une chance d’en gagner plus demain. C’est ainsi que je peux obtenir un prêt et que les Hollandais ont trouvé les ressources pour envoyer leurs navires en Asie, et c’est, entre autres, ce que la finance fait de plus utile : appairer des gens prêts à renoncer à de l’argent maintenant dans l’espoir d’en avoir plus demain, à d’autres qui ont besoin d’argent maintenant et qui sont prêts à en rembourser plus demain."
5.3 - Naissance de la Bourse
Jacob Goldstein explique enfin comment la VOC innove en permettant à tous d'acheter des parts, et en autorisant leur revente avant l'échéance initialement prévue.
Cela donne naissance à la première Bourse au monde, où acheteurs et vendeurs se rencontrent pour échanger leurs titres. Les horaires d'ouverture restreints, imposés par la ville, favorisent la liquidité et l'efficacité du marché.
5.4 - Shorter en bref
Jacob Goldstein retrace ensuite la première histoire de vente à découvert (ou "short"), une pratique permettant de parier sur la baisse du cours d'une action.
C'est Isaac Le Maire, un actionnaire en conflit avec la VOC, qui va utiliser, pour la première fois, cette technique pour attaquer la compagnie.
Les administrateurs parviennent d'abord à faire interdire cette pratique. Mais Isaac Le Maire se défend en plaidant que "la chute du cours était due à la mauvaise gestion de l’entreprise".
L'auteur termine ce chapitre en soulignant que le rôle de la Bourse est de trouver le "bon prix" des actions, en agrégeant toutes les informations disponibles, et non de faire monter les cours à tout prix.
Chapitre 6 - Où John Law fait marcher la planche à billets
6.1 - La création d’une banque publique à Amsterdam et les propositions visionnaires de John Law
Le chapitre 6 de "La véritable histoire de la monnaie" commence en nous informant que la ville d'Amsterdam, malgré sa prospérité, souffrait d'un problème non "pas de pénurie comme en Grande-Bretagne, mais d’une trop grande diversité de pièces".
Pour y remédier, la ville fonde, en 1609, une banque publique où les marchands ouvrent des comptes. Les paiements se font alors par simple jeu d'écritures, sans manipulation d'espèces : "leur argent, leur monnaie, c’est leur compte à la banque, le chiffre dans ses registres. Qui plus est, le système fonctionne mieux ainsi qu’avec les pièces" ajoute l'auteur.
De retour en Écosse, John Law tente de convaincre le Parlement de créer une banque publique émettant du papier-monnaie gagé sur des terres. Sa proposition se solde par un échec. Malgré cela, ce dernier continue à promouvoir ses idées à travers l'Europe, avant de s'installer à Paris en 1714.
6.2 - De l'Angleterre à la France : l'évolution des systèmes bancaires au début du XVIIIe siècle
Cette partie du livre "La véritable histoire de la monnaie" nous apprend que l'Angleterre a résolu son problème monétaire en créant la Banque d'Angleterre.
En effet, en 1694, est fondée la Banque d’Angleterre, sur un modèle innovant qui combine actionnariat public, prêt à l'État garanti par un impôt dédié, et émission de papier-monnaie :
"La Banque d’Angleterre a été un immense succès. Elle a créé une nouvelle façon sûre pour les gens de placer de l’argent au présent, pour en espérer davantage plus tard. Par le truchement de la banque, ils pouvaient prêter à l’État de façon prévisible et transparente, la loi garantissant qu’ils seraient remboursés. Et comme la banque prêtait plus de monnaie qu’elle n’en avait dans ses coffres, elle en créait davantage pour l’Angleterre dans son ensemble, de façon plus sûre et stable que ne l’avaient fait une poignée d’orfèvres en distribuant des reçus."
En 1715, John Law propose au Régent de France, le duc d'Orléans, un système financier complet inspiré de l'expérience anglaise. Il obtient alors l'autorisation de fonder la Banque générale. Malgré les moqueries initiales, la banque survit grâce au soutien du Régent qui y dépose d'importantes sommes d'or.
Le tournant décisif intervient en 1717, lorsque le Régent impose de payer les impôts en billets de la banque. Ce papier-monnaie devient alors la monnaie de référence.
Fort de ce succès, John Law s'apprête à frapper un grand coup.
Chapitre 7 - Où l'on invente les millionnaires
Le 7ème chapitre du livre "La véritable histoire de la monnaie" raconte comment, après avoir obtenu le monopole du commerce sur le Mississippi pour sa Compagnie de l'Ouest, John Law propose aux détenteurs d'obligations d'État de les échanger contre des actions de sa compagnie, promettant les richesses du Nouveau Monde.
Malgré les réticences initiales, Law parvient à faire prospérer son entreprise, notamment en liant sa banque à la Compagnie du Mississippi.
7.1 - "On ne parlait que par millions"
L'auteur décrit alors l'ascension fulgurante de John Law et de sa Compagnie.
En procédant à des fusions, en acquérant des monopoles et en émettant de nouvelles actions liées aux précédentes, Law fait flamber les cours.
La France s'enfièvre pour le "Mississippi" : on se rue pour acheter des parts, faisant émerger les premiers millionnaires.
Dès lors, John Law consolide la dette de l'État, réforme la fiscalité et devient l'homme le plus puissant du pays après le Régent.
7.2 - L'économie réelle contre la bulle du Mississippi
L'auteur souligne toutefois le décalage important entre les promesses de richesses du Mississippi et la réalité bien plus modeste de la colonie. La finance s'emballe et se déconnecte de l'économie réelle, provoquant une forte inflation.
John Law tente de stabiliser l'économie en retirant du numéraire, mais ses mesures désespérées pour imposer le papier-monnaie provoquent des émeutes. C'est l'effondrement : le Régent abandonne la banque et le papier-monnaie, Law doit s'enfuir. Il finira sa vie à Venise, jouant pour subsister.
Jacob Goldstein réfute l'image d'escroc souvent accolée à John Law.
Selon lui, le système de ce dernier n'était pas intrinsèquement mauvais. S’il a échoué, c’est plutôt à cause de l'excès de pouvoir entre ses mains sans suffisamment de contre-pouvoirs dans le contexte d'une monarchie absolue. Car les pressions contradictoires entre les différents acteurs sont nécessaires pour stabiliser un système monétaire moderne.
Partie 3 | Plus de monnaie
Pendant longtemps, on croyait que la quantité d'argent dans une économie était limitée. Mais quelques dizaines d'années après la mort de John Law, une idée révolutionnaire émerge : on réalise en effet qu'il est possible de créer de l'argent. Et avec cela, que désormais, tout le monde peut avoir plus d'argent, même si cela ne garantit pas que tous en auront effectivement plus.
Chapitre 8 - Où tout le monde gagne plus d'argent
Dans le 8ème chapitre du livre "La véritable histoire de la monnaie", l'auteur revient d’abord sur une étude de l'économiste William Nordhaus. Celle-ci porte sur l'évolution du prix de l'éclairage artificiel au fil des siècles. Il montre qu'à Babylone, une journée de travail ne procurait que 10 minutes d'éclairage, contre une heure au 18ème siècle grâce à l'huile de baleine. La révolution industrielle du 19ème, portée par de nombreux progrès scientifiques (comme les débuts du kérosène), a ensuite permis de quintupler ce temps d'éclairage.
L'auteur poursuit en décrivant comment de nouvelles innovations financières ont rendu possible l'invention de l'ampoule par Thomas Edison en 1879. Ces innovations, ce sont la société à responsabilité limitée qui facilite les levées de fonds, et le brevet qui offre un monopole temporaire sur une idée nouvelle. C’est bien grâce à elles qu’Edison a pu financer ses recherches et déployer le premier réseau électrique à New York, nous apprend Jacob Goldstein.
L'auteur termine ce chapitre en soulignant qu'en un siècle, le temps d'éclairage obtenu pour une journée de travail a finalement été multiplié par 20 000. Cette explosion de la productivité, malgré ses dégâts environnementaux, a rendu tout le monde plus riche en termes réels.
Chapitre 9 - Où l'on se demande si avoir plus d'argent est vraiment à la portée de tout le monde
Le chapitre 9 du livre "La véritable histoire de la monnaie" explique que si les innovations technologiques, comme les ampoules, enrichissent globalement la société, elles détruisent aussi des emplois, comme ceux des allumeurs de réverbères. Le même phénomène se pose vivement aujourd'hui avec la révolution numérique.
9.1 - L'histoire des Luddites au début du 19ème siècle en Angleterre
L'auteur relate ici l'histoire des Luddites, ces ouvriers du textile anglais, bien rémunérés jusque-là, qui ont vu, au début du 19ème siècle, leur métier menacé par l'introduction de machines. Sous la bannière d'un chef fictif, Ned Ludd, ils ont, nous raconte l’auteur, déclenché une guerre clandestine contre ces machines, dans un contexte de bouleversement technologique inédit.
Malgré la répression violente (les destructions de machines sont punies de mort), le mouvement a perduré plusieurs années. Mais les Luddites ont fini par disparaître, tout comme les métiers manuels du textile.
Jacob Goldstein souligne que, malgré la promesse d'une prospérité future, les Luddites et leurs enfants n'ont pas vu leur sort s'améliorer. Durant la révolution industrielle, les salaires ouvriers ont peu progressé malgré l'explosion de la productivité. Seuls les propriétaires d'usines et certains corps de métier en ont profité.
9.2 - Un parallèle à faire avec la révolution numérique actuelle
Ce précédent historique tempère l'argument des économistes selon lequel les problèmes liés aux bouleversements technologiques ne seraient que temporaires. L'auteur y voit, de fait, un parallèle avec la révolution numérique actuelle, qui détruit aussi de nombreux emplois :
"Nous vivons le deuxième âge de la machine. Il ne s’agit plus de métiers à tisser, mais d’ordinateurs et de logiciels. Mais le même genre d’événements est en train de se produire. On évoque l’essor des 1 %. La stagnation des revenus des gens ordinaires. Le changement technologique en est pour partie responsable. La réponse habituelle des économistes est de dire que ces problèmes sont temporaires. Grâce à la technologie, les gens auront plus d’argent à long terme. Mais c’est une chose que les Luddites nous ont apprise : le long terme peut durer très, très longtemps."
Partie 4 | La monnaie moderne
Dans la quatrième partie de "La véritable histoire de la monnaie", Jacob Goldstein met en lumière deux moments clés de l'histoire monétaire :
Le 19ème siècle, avec l'essor de la productivité, la disparition des Luddites et l’avènement de l'étalon-or.
L'époque moderne, avec l'échec de l'étalon-or, qui a failli détruire l'économie mondiale et la naissance de notre système monétaire actuel, où les États émettent la monnaie sans contrepartie.
Jacob Goldstein montre ainsi le contraste entre ces deux périodes et leurs systèmes monétaires, en décrivant comment l'un a, en fait, succédé à l'autre suite à une crise majeure.
Chapitre 10 - Où l'étalon-or séduit le monde
Le 10ème chapitre du livre "La véritable histoire de la monnaie" décrit l'attrait de l'étalon-or au 19ème siècle : une monnaie naturelle, objective, éternelle, libérée des aléas humains et étatiques.
10.1 - Les débuts du libre-échange
L’auteur y rappelle la pensée de David Hume qui, dès le 18ème , réfutait l'idée mercantiliste selon laquelle un pays s'enrichit en accumulant l'or. Pour Hume, les prix et les flux commerciaux s'équilibrent naturellement, comme l'eau d'un océan. Ces idées, reprises par Adam Smith, ont favorisé l'essor du libre-échange.
10.2 - L’adoption de l’étalon-or par les grandes économies mondiales
Jacob Goldstein relate aussi comment, en 1816, la Grande-Bretagne adopte l'étalon-or pour la livre sterling. Rapidement, les grandes économies l'imitent, facilitant le commerce international et la première grande vague de mondialisation. L'étalon-or apparaît alors comme une évidence.
Cependant, dans la seconde moitié du 19ème siècle, l'économie mondiale progresse plus vite que les réserves d'or, provoquant une baisse des prix. Cette déflation, cruelle pour les débiteurs, déclenche un conflit sur la nature de la monnaie.
10.3 - Le procès de l'or
Aux États-Unis, les agriculteurs endettés réclament un retour au bimétallisme or-argent pour augmenter la masse monétaire et les prix. William Jennings Bryan porte leur voix lors d'un célèbre discours dénonçant la "crucifixion" des travailleurs sur une "croix d'or". Mais le candidat républicain William McKinley, défenseur de l'étalon-or et du "dollar honnête", l'emporte.
En 1900, le Gold Standard Act officialise l'étalon-or.
10.4 - L'illusion monétaire
L'auteur présente ensuite les travaux d'Irving Fisher, économiste de Yale.
D'abord partisan de l'étalon-or, Irving Fisher réalise que, contrairement à sa théorie, les taux d'intérêt ne s'ajustent pas parfaitement à l'inflation ou la déflation. Il met en lumière "l'illusion monétaire" qui fait croire que le dollar est stable alors que son pouvoir d'achat fluctue, au détriment de l'économie.
Fisher propose de redéfinir le dollar non plus comme un poids fixe d'or, mais comme un panier de biens, afin de stabiliser son pouvoir d'achat. Malgré l'intense promotion de cette idée visionnaire, Irving Fisher reste inaudible à l'époque.
Ironie du sort, cet économiste avant-gardiste sur la monnaie reste surtout connu pour avoir annoncé, juste avant le krach de 1929, que la Bourse avait atteint un "plateau haut permanent". Pourtant, sur l'étalon-or et l'instabilité monétaire, Fisher avait vu juste.
Chapitre 11 - Où ceci n'est pas une "banque centrale"
Le chapitre 11 du livre "La véritable histoire de la monnaie" retrace l'histoire tourmentée de la création d'une banque centrale aux États-Unis.
Jacob Fisher explique d’abord qu'en 1929, au moment du krach boursier, la Réserve fédérale (Fed) a moins de 20 ans et que le pays a passé un siècle à débattre de la pertinence d'avoir ou non une telle institution. Ce débat, précise l’auteur, reflète la question fondamentale du rôle de l'État et du marché dans la création monétaire.
11.1 - Le président qui détestait les banques
L'auteur relate ensuite l'opposition, dans les années 1830, entre Nicholas Biddle, puissant banquier président de la Seconde banque des États-Unis, et le président américain Andrew Jackson :
"Difficile de surestimer le pouvoir de ce personnage à l’époque. Imaginons aujourd’hui un président de la Réserve fédérale qui serait également PDG de JP Morgan Chase (la première banque privée américaine) et que JP Morgan soit plus grosse qu’Apple, Google et ExxonMobil réunies (les trois premières capitalisations boursières des États-Unis). Présider la Seconde banque des États-Unis ressemblait un peu à ça. C’était le deuxième poste le plus puissant du pays. Heureusement pour l’Amérique, Biddle était un excellent professionnel."
Ainsi, Nicholas Biddle avait fait de sa banque une sorte de banque centrale avant l'heure, régulant les banques locales et les flux monétaires. Mais Jackson, méfiant envers ce pouvoir, met son veto au renouvellement des statuts de la banque. C’est ainsi que les États-Unis resteront sans banque centrale pendant plus de 70 ans.
11.2 - Le pays aux 8 370 monnaies
Dans les années 1840-1850, de nombreux États adoptent des lois de "banque libre" permettant à quiconque de créer une banque et d'imprimer sa propre monnaie, sous réserve de déposer des obligations auprès du régulateur.
Il en résulte une prolifération de billets (jusqu'à 8370 monnaies différentes !), source de confusion mais aussi de crédit abondant pour le développement de l'Ouest.
Pendant la Guerre de Sécession, l'État fédéral crée un système de banques nationales émettant un papier-monnaie adossé aux obligations fédérales. Une taxe élimine progressivement les monnaies locales, contribuant à l'émergence d'une identité nationale.
11.3 - Paniques bancaires
Deux phénomènes sont ensuite apparus, explique l'auteur de "La véritable histoire de la monnaie" :
Adosser la monnaie aux emprunts d'État l'a, en fait, rendu insuffisamment élastique et a provoqué des pénuries saisonnières.
Environ tous les 10 ans, on a assisté à des paniques bancaires qui ont déclenché des ruées aux guichets et des effondrements économiques.
Aussi, en Europe, on prenait conscience qu'une banque centrale pouvait réduire ces crises en prêtant sans limite aux banques solvables. Mais les Américains, quant à eux, restaient méfiants. Ils y voyaient un danger pour la démocratie.
Si la panique de 1907, stoppée in extremis par J.P. Morgan, fit réfléchir certains, comme le sénateur Aldric, la méfiance restait forte.
11.4 - Quand un sénateur et une bande de banquiers filent en douce sur une île privée pour créer une banque centrale
L'auteur relate ici comment, en 1910, le sénateur Aldrich réunit secrètement les trois banquiers les plus influents d'Amérique et un économiste d'Harvard au service du ministre des finances sur Jekyll Island pour concevoir une banque centrale sans en avoir l'air : un réseau de "banques de réserve" contrôlées par des intérêts privés.
Mais le Congrès, méfiant, modifie leur projet : les "banques de réserve fédérale" seront supervisées par un conseil des gouverneurs nommé par le président. Malgré ses limites, cette curieuse construction hybride fournit pendant 20 ans une monnaie pratique et stable, indique Jacob Goldstein.
C’est après le krach de 1929 que la Fed contribuera à transformer un retournement conjoncturel en la pire crise du 20ème siècle.
Chapitre 12 - Où la monnaie meurt et ressuscite
Dans le chapitre 12 du livre "La véritable histoire de la monnaie", Jacob Goldstein relate la pire panique bancaire de l'histoire des États-Unis en 1933.
L'étalon-or, qui permet à chacun d'échanger ses dollars contre de l'or, devient un boulet pour la Fed menacée d'en manquer. Partout, les États ferment les banques pour stopper la ruée.
C'est dans ce contexte apocalyptique que Franklin D. Roosevelt prête serment comme président.
12.1 - Comment le manque de monnaie a provoqué la dépression des années trente
L'auteur explique qu'en l'absence de garantie des dépôts, la moindre inquiétude pouvait déclencher une ruée aux guichets fatale même aux banques saines.
La Fed, créée pour prévenir ces paniques, a d'abord bien réagi au krach de 1929 en prêtant massivement aux banques. Mais en 1931, lorsque la Grande-Bretagne décroche de l'étalon-or, la Fed, craignant de perdre son or, augmente ses taux.
Cette décision catastrophique étrangle un pays déjà à genoux. Milton Friedman et Anna Schwartz démontreront que la Fed, en appliquant strictement les règles de l'étalon-or, a transformé une récession en dépression.
12.2 - "La fin de la civilisation occidentale"
Jacob Goldstein présente ensuite Irving Fisher et George Warren, deux économistes marginaux convaincus que seule une reflation des prix peut sortir le pays de la dépression, quitte à rompre avec l'étalon-or. Warren rencontre Roosevelt juste après son investiture.
Lors de sa première conférence de presse, Roosevelt ordonne la fermeture de toutes les banques. Puis, lors d'une causerie radiophonique, il explique pédagogiquement le fonctionnement de la monnaie pour rétablir la confiance. Les gens, rassurés, rapportent leur argent aux banques qui rouvrent.
Mais Roosevelt va plus loin. Par décret, il oblige les Américains à remettre leur or à l'État sous peine de prison. Puis, stupéfiant ses conseillers attachés à l'étalon-or, il soutient un amendement lui donnant le pouvoir de modifier la valeur en or du dollar, sacrilège absolu. Un conseiller y voit "la fin de la civilisation occidentale". Fisher, lui, est aux anges.
Cette politique empirique et iconoclaste fonctionne. Après que Roosevelt ait confisqué l'or et abandonné l'étalon-or, l'économie repart doucement. Les historiens confirmeront que l'étalon-or a enfermé les pays dans un cycle fatal, brisé lorsqu'ils l'ont abandonné.
Roosevelt a compris que l'étalon-or n'avait rien de naturel, contrairement à ce que ses adeptes proclamaient. C'était un choix, et il a osé en faire un autre, ouvrant la voie à notre conception actuelle de la monnaie.
Partie 5 | La monnaie au XXIe siècle
La 5ème et dernière partie du livre "La véritable histoire de la monnaie" met en évidence le fait que l'histoire de la monnaie est une lutte constante entre banques, États et individus pour définir les droits de chacun, comme l'illustrent les exemples de la finance parallèle, de l'euro et du bitcoin.
Chapitre 13 - Où deux types inventent une nouvelle monnaie dans un bureau
Dans le 13ème chapitre, l’auteur de "La véritable histoire de la monnaie" revient sur la crise financière de 2008. Il explique qu'au-delà des prêts hypothécaires toxiques, c'est l'émergence d'une nouvelle forme de monnaie dans un système bancaire parallèle qui a précipité et amplifié la crise.
13.1 - Deux types dans un bureau
C’est un certain Bruce Bent et son associé Harry Brown qui lancent, en 1970, le premier fonds monétaire :
"Bent a une femme, deux enfants et deux emprunts immobiliers sur le dos. Il s’est acheté une bicyclette d’occasion pour économiser le bus qui le conduit à la gare où il prend le train pour se rendre au travail, et retrouver Brown avec qui il échange des idées : "On essayait de trouver un truc pour gagner de l’argent." Après quelques années à vivoter, Bent et Brown voient enfin le bout du tunnel."
Leur idée : créer un fonds commun de placement qui ressemble à un compte bancaire rémunéré, en investissant dans des actifs sûrs et liquides et en maintenant une valeur stable de 1$ par part. Le succès est fulgurant. En quelques années, des centaines de milliards affluent dans ces fonds.
13.2 - Les grandes banques s'y mettent à leur tour
Pour profiter de cette manne, les grandes banques inventent le "papier commercial adossé à des actifs" (PCAA) . Celui-ci qui permet aux fonds monétaires de prêter à des entreprises plus risquées. Bent met en garde contre cette dérive, mais les fonds monétaires investissent massivement dans ces actifs.
13.3 - Le boom de la monnaie
Dopés par cet afflux massif de liquidités cherchant des placements sûrs à court terme, les fonds monétaires prêtent des sommes colossales aux banques d'investissement qui financent notamment les prêts hypothécaires. C'est cette nouvelle monnaie créée par le système bancaire parallèle qui alimente la bulle financière des années 2000.
Lorsqu'en 2006-2007 les prix immobiliers fléchissent et que les fonds monétaires réclament leur argent, le château de cartes s'effondre. Paul McCulley, économiste chez Pimco, y voit une ruée sur les guichets d'un système bancaire parallèle ou "shadow banking".
13.4 - La finance parallèle
Ce système bancaire de l'ombre reproduit le mécanisme fondamental des banques - emprunter à court terme pour prêter à long terme - sans les garde-fous (garantie des dépôts, accès à la banque centrale). En 2007, il brasse plus d'argent que les banques traditionnelles. Sa monnaie est considérée comme de la "trésorerie".
Lorsque la panique gagne Bear Stearns puis Lehman Brothers, la Fed doit intervenir en prêteur de dernier ressort. Même le Reserve Fund de Bent est touché : il "crève le plancher" du dollar et doit suspendre les retraits.
13.5 - Bruce Bent crève le plancher
Face à la panique, les autorités doivent admettre que la monnaie parallèle est devenue une vraie monnaie : la Fed fournit des liquidités aux fonds monétaires et le président américain actuel - George Bush - annonce leur garantie publique. Les grandes banques d'investissement deviennent des banques commerciales pour accéder au soutien de la Fed.
13.6 - La monnaie et la prochaine crise
Malgré les propositions de réguler les fonds monétaires comme des banques, le lobby du secteur a obtenu le statu quo.
En 2020, une nouvelle panique sur les fonds a contraint l'État à intervenir derechef.
Jacob Goldstein termine le chapitre 14 de "La véritable histoire de la monnaie" en nous invitant à guetter l'émergence des futures "quasi-monnaies" : lorsque tous voudront les vendre en même temps, elles déclencheront la prochaine crise.
Chapitre 14 - Où l'on crée l'euro (et pourquoi le dollar fonctionne mieux)
Dans le chapitre 14 du livre "La véritable histoire de la monnaie" , Jacob Goldstein nous explique qu'après la chute du mur de Berlin en 1989, les voisins européens, craignant la résurgence d'une Allemagne expansionniste, poussent à la création d'une monnaie unique pour arrimer le pays à l'Europe.
Malgré l'attachement des Allemands au deutsche mark, symbole de leur fierté nationale et de leur prospérité retrouvée, le chancelier Kohl accepte de l'abandonner en échange du soutien français à la réunification.
14.1 - Une expérience folle et sans filet
Les négociations sont ardues, tant les visions monétaires française et allemande divergent.
Les Allemands, hantés par l'hyperinflation des années 1920, veulent une banque centrale indépendante focalisée sur la stabilité des prix. Les Français voient la monnaie comme un outil politique.
Finalement, la nouvelle monnaie sera gérée par une banque centrale installée en Allemagne et dédiée à la lutte contre l'inflation. Mais il n'y aura pas d'État fédéral capable de redistribuer les richesses. Pöhl, le patron de la Bundesbank, avait pourtant prévenu qu'une monnaie unique ne pourrait fonctionner sans une "union politique globale".
14.2 - L'Euro est un miracle
Le lancement de l'euro en 2002 est un succès logistique et symbolique. Les taux d'intérêt des pays "périphériques" (Espagne, Italie, Grèce...) convergent vers ceux du "cœur" (Allemagne, France...), leurs dettes étant jugées aussi sûres. Certains rattrapent même leur retard économique. L'euro semble réaliser le rêve d'une Europe unie et prospère.
14.3 - L'Euro est un traquenard
Mais en 2009, quand la Grèce avoue avoir menti sur ses déficits, la panique gagne les marchés. Les taux des pays périphériques s'envolent, les piégeant dans un cercle vicieux : pour rembourser, ils doivent couper dans les dépenses, ce qui aggrave le chômage et réduit les recettes, rendant la dette encore moins soutenable.
Avant l'euro, la banque centrale aurait pu créer de la monnaie pour faire baisser les taux et déprécier la devise, stimulant croissance et exports. Mais les pays en crise n'ont plus cette option. Ils sont coincés.
L'analyse dominante, relayée par la presse populaire allemande, blâme l'incurie des cigales du sud, épargnant les fourmis vertueuses du nord. Mais elle oublie qu'en accumulant des excédents commerciaux face à ses partenaires et en leur prêtant ensuite cet argent pour qu'ils continuent d'acheter ses produits, l'Allemagne a rendu leurs dettes possibles et nécessaires.
14.4 - "C'est ma monnaie, j'en imprime autant que je veux"
L'auteur de "La véritable histoire de la monnaie" compare ici la situation européenne à celle des États-Unis.
Comme l'Europe, les USA sont constitués d'États hétérogènes. Certains subissant des crises immobilières et bancaires comme l'Espagne ou l'Irlande en Europe. Mais le budget fédéral et les stabilisateurs automatiques amortissent les chocs sans provoquer de polémiques. Surtout, empruntant en dollar, monnaie sur laquelle ses créanciers comme la Chine n'ont aucune prise, les États-Unis gardent une totale souveraineté monétaire.
En renonçant à ce pouvoir au profit d'une BCE réticente à jouer son rôle de prêteur en dernier ressort, les pays européens se sont mis à la merci des marchés. Il faudra attendre 2012 et la promesse de Mario Draghi, économiste italien et directeur de la BCE à l'époque, de faire "tout ce qui est nécessaire" (formule qui rendit Draghi grandement célèbre) pour sauver l'euro et éteindre la spéculation :
""Dans le cadre de son mandat, dit-il, la BCE fera tout ce qui est nécessaire pour préserver l’euro. (Silence) Et croyez-moi, ce sera suffisant." C’était dit ! Presque aussitôt, les coûts d’emprunts de l’Espagne et de l’Italie commencent à baisser et continuent de baisser. Peu après, Draghi exécute sa promesse. La BCE annonce un nouveau programme qui l’autorise à racheter les obligations des États en cas de vente massive. En réalité, elle n’a pas eu à le faire. La seule promesse a suffi pour éteindre l’incendie. Les coûts de financement ont continué de baisser. La crise était passée."
Un sauvetage salvateur, mais au prix d'un abandon de souveraineté démocratique.
Chapitre 15 - Où le rêve fou d'une monnaie digitale devient réalité
Jacob Goldstein débute le chapitre 15 de "La véritable histoire de la monnaie" en soulignant l'avantage unique de l'argent liquide : permettre des transactions anonymes et intraçables entre inconnus. Mais à l'ère numérique, la plupart des paiements laissent une trace dans les registres bancaires, menaçant la confidentialité des données personnelles.
15.1 - La prophétie de Chaum : cryptographie contre surveillance financière
Au début des années 1980, le chercheur en informatique David Chaum avait mis en garde contre cette dérive :
"Au début des années quatre-vingt, David Chaum, un chercheur en informatique, comprend que l’avènement des ordinateurs bon marché, puissants et connectés va provoquer un gigantesque transfert de l’argent liquide, anonyme et intraçable, à la monnaie scripturaire traçable. Très inquiet, il pense que tout le monde devrait l’être. « On jette les bases d’une société de dossiers où les ordinateurs pourraient déduire les modes de vie des individus, leurs habitudes, leurs déplacements et leurs associations à partir des données collectées lors de transactions ordinaires », écrit-il dans un article étonnement prémonitoire."
Pionnier de la cryptographie, il invente alors un système de monnaie électronique préservant l'anonymat des utilisateurs : la banque peut vérifier la validité des paiements sans en connaître les acteurs. L'auteur écrit :
"Chaum n’est pas qu’une Cassandre hippie pestant contre la technologie. Il en a certains traits, certes : il se balade en catogan et combi Volskwagen sur le campus de Berkeley. Mais il est aussi titulaire d’un doctorat en sciences informatiques de cette même université et est un expert réputé en cryptographie (la science des codes secrets) et sécurité informatique. Après plusieurs années de recherches, il pense avoir inventé un nouveau système qui permettrait aux gens d’habiter le monde numérique sans y sacrifier la confidentialité de leurs données. Il a trouvé le moyen d’échapper à la tyrannie des registres bancaires. (…) Chaum présente une façon inédite d’habiter l’univers digital, de communiquer, de s’identifier et surtout d’acheter. Il invente la monnaie numérique."
15.2 - La monnaie digitale et les techno-libertaires
En 1989, Chaum lance DigiCash pour concrétiser son concept. Malgré un certain engouement, son entreprise fait faillite en 1997 : les premiers acheteurs en ligne préfèrent la praticité des cartes bancaires à l'anonymat.
Mais un groupe de programmeurs libertaires, les "cypherpunks", s'empare des idées de Chaum pour créer une monnaie numérique sans État, terreau d'un paradis anarcho-capitaliste. Leur mentor Timothy May signe en 1988 un "Manifeste crypto-anarchiste" qui appelle à utiliser la cryptographie pour saper le pouvoir étatique :
"Ingénieur et physicien, Timothy May prend sa retraite d’Intel en 1986. Il a 34 ans. Il (…) passe ses journées à se balader en bord de mer et à lire (…) de la science-fiction, de la philosophie et beaucoup de revues spécialisées. Un jour, il tombe sur l’article de Chaum : "Systèmes de transactions pour désarmer Big Brother" ; sa vie en est changée à jamais, et peut-être aussi l’histoire de la monnaie. "Voilà l’avenir", se dit-il. May est prédisposé pour être soufflé par les promesses contenues dans la monnaie digitale de Chaum. Informaticien, libertarien, fan de science-fiction, il comprend la technologie et en saisit les enjeux pour les individus ; il entrevoit le potentiel d’une profonde transformation de la société. Sa vision est encore plus révolutionnaire que celle de Chaum. Il fait alors ce qu’on fait quand on vient de découvrir un truc qui va changer le monde, qu’on n’a pas de travail et qu’on vit seul avec un chat prénommé Nietzsche : il rédige un manifeste. (…) "Le Manifeste crypto-anarchique", loufoque, grandiloquent et un peu second degré, est un appel aux extrémistes affinitaires. Curieusement, le manifeste trouve un écho. Pas immédiatement, toutefois"
15.3 - Inventer l'argent liquide digital et anonyme est sacrément difficile
Les cypherpunks s'attellent à un défi technique : celui d'empêcher la duplication à l'infini d'une monnaie numérique, sans recourir à un tiers de confiance.
Ainsi, Adam Back crée, en 1997, le "hashcash". Avec ce concept, Back propose une solution : il introduit une forme de rareté en exigeant de la puissance de calcul pour générer la monnaie :
"La monnaie numérique de Chaum ressemblait à la monnaie fiduciaire contrôlée par une banque centrale. Celle de Back se rapproche davantage de l’or sur un point au moins : de même que toute personne qui en a la volonté et les ressources peut aller chercher de l’or, quiconque en a la volonté et les ressources peut créer du hashcash. Mais le hashcash se distingue de l’or sur un autre point essentiel, un point qui l’empêche de devenir la monnaie numérique dont rêvent les cypherpunks. Chaque empreinte de hashcash est accolée à un message unique ; elle ne peut donc être utilisée qu’une seule fois. Impossible par conséquent d’en faire une monnaie d’échange."
Wei Dai propose alors, en 1998, d'aller plus loin avec la "b-money" : un registre décentralisé de toutes les transactions serait tenu simultanément par tous les utilisateurs. Mais il juge lui-même son système irréalisable, faute d'incitation à y participer.
15.4 - Enfin, le Bitcoin !
En 2008, un mystérieux "Satoshi Nakamoto" contacte Wei Dai.
"À l’époque, et encore aujourd’hui à l’heure où j’écris ces lignes, personne ne savait qui se cachait ou se cache encore derrière Satoshi Nakamoto, que ce soit un individu seul ou plusieurs personnes. Ce pourrait tout aussi bien être un cypherpunk vivant dans un bunker souterrain en NouvelleZélande, qu’un dirigeant de banque à Londres, une prêtresse ou un criminel, ou encore un gang complotant pour prendre le contrôle de la planète. Mais la beauté du bitcoin et son génie, c’est que la véritable identité de Satoshi Nakamoto n’a aucune espèce d’importance."
Dans un article intitulé "Bitcoin : un système de cash électronique peer-to-peer", il décrit une monnaie combinant les idées de Back et Dai, avec un mécanisme astucieux : les ordinateurs validant les transactions sont rémunérés... en bitcoins. Sésame de la rareté retrouvée !
Fidèle à l'esprit cypherpunk, Satoshi publie le code source du bitcoin début 2009. Il intègre dans le "bloc de genèse" un titre du Times sur le sauvetage des banques, clin d'œil à la crise financière qui vient d'ébranler la confiance dans les monnaies traditionnelles.
15.5 - Combien vaut un bitcoin ?
Pas grand-chose au début.
En 2010, un développeur distribue gratuitement des bitcoins pour populariser le système.
Un certain Laszlo Hanyecz réussit à commander deux pizzas pour 10 000 bitcoins, une transaction historique, mais qui valorise le bitcoin à trois fois rien...
15.6 - Le bitcoin devient clandé
Le cours du bitcoin décolle quand un certain Dread Pirate Roberts lance, en 2011, Silk Road, une plateforme de vente de drogues qui l'utilise comme moyen de paiement anonyme.
Après l'arrestation de son fondateur en 2013, le bitcoin suscite l'intérêt de la Silicon Valley qui y voit l'occasion de réduire les coûts de transaction.
Le cours atteint 500$ lors d'auditions mielleuses au Sénat.
15.7 - L'anarcho-capitalisme, mais sans l'anarchie : le bitcoin se normalise
Des "fermes de minage" géantes surgissent alors pour extraire des bitcoins en résolvant les problèmes cryptographiques, au prix d'une consommation électrique considérable. Toutefois, le réseau peine à monter en charge.
Un débat houleux oppose partisans de l'accessibilité et de l'utilité monétaire du bitcoin, favorables à une augmentation de la taille des blocs, et défenseurs de la décentralisation du réseau, qui s'y opposent. Cette "guerre civile" débouche sur une scission entre bitcoin et bitcoin cash.
En parallèle, des centaines d'autres cryptomonnaies voient le jour sur le modèle du bitcoin. Certaines promettent un meilleur anonymat ou encore une meilleure stabilité, mais la plupart d’entre elles finissent par disparaitre. Même Facebook et la Chine planchent sur des monnaies numériques, loin de l'idéal libertaire originel.
15.8 - Le prix du bitcoin
Malgré ces soubresauts, le cours du bitcoin s'envole jusqu'à frôler les 20 000$, avant de retomber autour de 4000$, puis de remonter. Ces variations brutales minent l'usage du bitcoin comme monnaie : difficile d'emprunter ou d'être payé dans une devise aussi instable.
Les aficionados y voient une "réserve de valeur", mais il s'agit en réalité d'un actif spéculatif acheté dans l'espoir de le revendre plus cher, loin du rôle usuel de la monnaie.
Jacob Goldstein conclut le dernier chapitre du livre "La véritable histoire de la monnaie" en affirmant que là où les monnaies traditionnelles sont souvent devenues de la monnaie "sans qu'on s'en rende compte", le bitcoin, malgré sa conception explicite comme monnaie numérique alternative, n'y est pas encore vraiment parvenu.
Conclusion | L'avenir de la monnaie
Dans la conclusion de son livre "La véritable histoire de la monnaie", Jacob Goldstein souligne que la monnaie est, en réalité, le fruit de choix, même si celle-ci est souvent perçue comme un état de fait immuable.
Cependant, il est vrai, poursuit l’auteur, que lors de crises, d'innovations technologiques ou de changements politiques, des idées marginales et des systèmes monétaires radicalement nouveaux peuvent s'imposer.
Jacob Goldstein explore alors trois scénarios possibles pour l'avenir.
Scénario n°1 : Un monde sans argent liquide
L'auteur de "La véritable histoire de la monnaie" envisage d’abord la disparition du cash. Disparition déjà en marche avec l'essor des paiements mobiles.
Mais Jacob Goldstein observe alors que paradoxalement, malgré cette tendance, la quantité de billets en circulation augmente plus vite que l'économie, surtout en grosses coupures :
"Partout dans le monde ou presque, alors que les applis de paiements prolifèrent, il se passe un phénomène étrange. Année après année, la quantité de papier-monnaie en circulation augmente plus vite que l’économie dans son ensemble. En 2020, on comptait plus de 5 000 dollars en billets pour chaque Américain, enfants compris (sans les billets qui dorment dans les coffres des banques). Les chiffres sont identiques pour la zone euro et le Japon. Où est cet argent ? Qu’en font les gens ? Personne ne le sait ! Ce ne sont que des bouts de papier qui se promènent dans le monde. Il y a certainement des gens qui utilisent des billets de cent dollars pour des raisons parfaitement louables et légales. D’autres, dans les pays en voie de développement, conservent leur épargne en dollars ou en euros pour la protéger de monnaies peu fiables et de banques fragiles. Et puis, beaucoup, beaucoup d’autres ont recours à des montagnes de cash pour frauder le fisc et financer les trafics de drogues, d’êtres humains et de marchandises volées."
Selon l'économiste Kenneth Rogoff, cette masse de cash alimente surtout l'économie souterraine et la criminalité. Ce dernier préconise de supprimer les grosses coupures et de remplacer les petites coupures par des pièces afin de réduire ces activités illicites et faciliter des taux d'intérêt négatifs en cas de crise.
La Suède illustre cette transition vers une société quasiment sans cash, au point que des banques refusent les dépôts d'espèces. La banque centrale suédoise réfléchit même à une e-couronne, monnaie numérique de banque centrale. Si cette évolution semble anecdotique, elle pourrait cependant réduire la confidentialité des transactions et accroître la surveillance. Mais notre système monétaire, où la monnaie scripturale domine déjà largement, n'en serait pas fondamentalement changé.
Scénario n°2 : Un monde sans banques
L'auteur présente ensuite une proposition plus radicale : mettre fin à la possibilité pour les banques de créer de la monnaie par le crédit. Des économistes aussi divers qu'Irving Fisher ou Milton Friedman ont dénoncé l'instabilité inhérente à ce système de réserves fractionnaires et plaidé pour des "réserves à 100 %".
L'idée serait de séparer les fonctions de dépôt et de prêt. Les "entrepôts monétaires" se chargeraient des dépôts, intégralement placés à la banque centrale. Les "prêteurs" accorderaient des crédits sur fonds d'investisseurs, comme des fonds obligataires. Plus de panique bancaire ni de risque systémique, mais un pouvoir monétaire accru pour les banques centrales.
Scénario n°3 : Un monde où l'État émet de la monnaie et la distribue à quiconque a besoin d'un emploi
Enfin, l'auteur évoque la "théorie monétaire moderne" (TMM), courant hétérodoxe qui voit dans la dépense publique la source ultime de la monnaie.
Selon Warren Mosler, financier à l'origine de ces idées, un État qui émet sa propre monnaie peut dépenser sans risque de faillite. L'inflation ne surviendrait que si l'économie est déjà au plein-emploi.
La TMM inspire certains élus progressistes qui veulent garantir un emploi public pour tous. Mais peu osent assumer l'idée, impopulaire, qu'il faudrait alors augmenter les impôts si l'inflation s'emballe.
Notre système actuel, où les banquiers centraux contrôlent la monnaie sans rendre de comptes démocratiques, n'est pas gravé dans le marbre. Mais le rendre plus démocratique suppose que les citoyens se fassent confiance pour maîtriser l'inflation.
Jacob Goldstein termine son livre "La véritable histoire de la monnaie" en nous soulignant que les crises à venir, les innovations technologiques et les évolutions sociétales changeront forcément nos systèmes monétaires d'une manière qui étonnera nos descendants, comme nous-mêmes sommes étonnés par les billets privés d'antan.
Conclusion de "La véritable histoire de la monnaie | De l'âge de bronze à l'ère numérique" de Jacob Goldstein
- Les trois points clés à retenir du livre "La véritable histoire de la monnaie"
Point clé n°1 : Un éclairage captivant sur la nature profonde de la monnaie
Dans "La véritable histoire de la monnaie", Jacob Goldstein nous offre une perspective originale et éclairante sur cet objet si familier et pourtant si énigmatique qu'est la monnaie. En retraçant son évolution depuis les origines jusqu'à nos jours, l'auteur met en lumière le caractère fondamentalement social et conventionnel de la monnaie.
Loin d'être un simple intermédiaire des échanges apparu naturellement pour faciliter le troc, la monnaie est le fruit d'un long processus historique fait de tâtonnements, d'innovations et de rapports de forces. Des dons ritualisés des sociétés anciennes au bitcoin en passant par le papier-monnaie et l'étalon-or, Jacob Goldstein montre brillamment comment la définition de la monnaie résulte de choix collectifs qui engagent la répartition des richesses et du pouvoir au sein de la société.
Point clé n°2 : La monnaie, au cœur des grands bouleversements de l'histoire
Un des grands mérites de ce livre est de resituer l'histoire monétaire dans le contexte plus large des transformations économiques, politiques et technologiques.
Ainsi, la naissance des banques modernes au 17ème siècle, l'abandon de l'étalon-or dans les années 1930 ou l'avènement de l'euro apparaissent comme autant de moments charnières où l'innovation monétaire a accompagné et parfois précipité des changements sociétaux majeurs.
En s'attardant sur des figures souvent méconnues comme John Law ou Irving Fisher, véritables visionnaires incompris en leur temps, Jacob Goldstein souligne aussi le rôle crucial des idées et des individus dans ces grands basculements. À travers ces destins singuliers, c'est toute une histoire intellectuelle de la monnaie qui se dessine, avec ses avancées, ses impasses et ses intenses controverses.
Point clé n°3 : Les enjeux monétaires d'aujourd'hui et de demain
Au-delà du récit historique, "La véritable histoire de la monnaie" nous invite à porter un regard neuf sur les débats monétaires contemporains.
Qu'il s'agisse de l'essor d'un système bancaire parallèle avant la crise de 2008, des difficultés de la zone euro ou des promesses et limites du bitcoin, Jacob Goldstein décrypte ces enjeux d'actualité avec la hauteur de vue que lui confère son excursion dans le passé.
Il souligne ainsi les défis posés à nos systèmes monétaires par la financiarisation, la globalisation et la révolution numérique. Mais il rappelle aussi, à travers trois scénarios prospectifs, que l'avenir de la monnaie n'est pas écrit : comme par le passé, il dépendra de nos choix collectifs, de notre capacité à imaginer des alternatives et de notre volonté de les mettre en œuvre.
- Qu'est-ce que cette lecture va vous apporter ?
En refermant "La véritable histoire de la monnaie", vous aurez désormais une vision plus claire et plus critique de la monnaie, cet instrument central de nos vies que l'on interroge trop rarement.
Vous comprendrez mieux les ressorts historiques et anthropologiques de la monnaie, son rôle dans les grandes transformations du passé et du présent, et les enjeux des débats monétaires actuels.
Au-delà de la monnaie elle-même, c'est alors un formidable outil pour penser l'interaction entre l'économique, le politique et le social que ce livre vous aura transmis.
- Pourquoi lire "La véritable histoire de la monnaie"
Je recommande la lecture de "La véritable histoire de la monnaie" de Jacob Goldstein à tous ceux qui s'intéressent à l'économie, à l'histoire et plus largement au fonctionnement de nos sociétés.
Par son érudition et son sens de la narration, l'auteur réussit le tour de force de nous passionner pour un sujet a priori aride. C'est un livre éclairant et très intéressant qui, en replaçant la monnaie dans le temps long de l'histoire, en révèle la profondeur insoupçonnée.
Points forts :
Une approche originale et érudite qui retrace bien l'évolution de la monnaie sur plusieurs millénaires et nous permet de situer l'époque actuelle et ses défis.
La mise en lumière du caractère socialement construit et politiquement déterminé de la monnaie.
Les portraits hauts en couleur de personnages clés de l'histoire monétaire comme John Law ou Irving Fisher.
Le style narratif qui rend le contenu captivant et plus accessible.
Points faibles :
Certains concepts économiques complexes peuvent être ardus à saisir pour un public non initié.
Le livre se concentre sur l'Occident et n'aborde qu'à la marge l'histoire monétaire d'autres aires culturelles.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu " La véritable histoire de la monnaie | De l'âge de bronze à l'ère numérique "? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin d'acheter le livre de Jacob Goldstein "La véritable histoire de la monnaie | De l'âge de bronze à l'ère numérique"
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Jacob Goldstein "La véritable histoire de la monnaie | De l'âge de bronze à l'ère numérique"
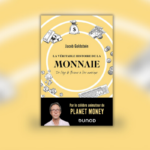 ]]>
]]>Résumé de "Seuls ensemble" de Sherry Turkle : une psychologue reconnue se demande si nous vivons dans un monde avec "de plus en plus de technologies" et de "moins en moins de relations humaines" et elle en vient à la conclusion qu'il faudrait peut-être repenser notre façon d'être ensemble en société — un livre événement par l'une des spécialistes de sciences humaines les plus en vue du moment.
Sherry Turkle, 2015, 523 pages.
Titre original : Alone together (2011).
Chronique et résumé de "Seuls ensemble" de Sherry Turkle
Préface — Trois tournants
Sherry Turkle a une longue expérience en tant que psychologue et anthropologue. Étudiante à Paris, elle est ensuite partie faire carrière au célèbre Massachussetts Institute of Technology (MIT) pour y étudier "les cultures informatiques". Plus précisément, elle s'intéresse aux rapports intimes que nous entretenons avec le monde numérique.
Au cours des 40 dernières années, elle a écrit trois livres importants :
The Second Self (1984) ;
Life on the Screen (1995) ;
Alone together (2011) (traduit par Seuls ensemble) ;
Reclaiming Conversation (2015) (traduit par Les yeux dans les yeux).
Introduction — Seuls ensemble
« La technologie se présente comme l'architecte de nos intimités. » (Seuls ensemble, Introduction)
Toute la technologie dite "numérique" — depuis l'utopie virtuelle de Second Life aux hamsters de compagnie Zhu Zhu — nous est présentée comme une série d'améliorations artificielles de la réalité. Mais ces "améliorations" sont-elles réelles ? Et sont-elles sans risque ?
Pour l'auteure, il y a un inconvénient majeur à cette promesse de l'hyperconnexion numérique, à savoir la possibilité de la perte des relations humaines directes. Elle le montre bien en citant l'histoire d'une jeune fille qui envoie des textos à son amie alors qu'elles sont dans la même maison !
Sur la base de ce constat, Sherry Turkle propose de demander :
« comment en sommes-nous arrivés là — et sommes-nous contents d'y être ? » (Seuls ensemble, Introduction)
Sherry Turkle utilise plusieurs anecdotes et arguments pour présenter son propos.
Par exemple, alors qu'elle emmène sa fille au New York Museum of Natural History, celle-ci lui dit que le musée aurait dû utiliser des robots à la place des tortues Galápagos, au lieu d'emprisonner des créatures vivantes. Selon l'autrice, beaucoup d'autres enfants réagissent de la même façon, et cela l'inquiète.
Elle critique également le livre d'un expert en intelligence artificielle, David Levy, qui promeut les relations romantiques avec les robots. Elle craint qu'une interaction avec un objet inanimé "comme s'il" était vivant puisse, d'une manière ou d'une autre, nous faire "perdre" une dimension essentielle de notre humanité.
La technologie moderne promet de nous rapprocher. Ce qui est sûr, c'est qu'elle s'appuie sur nos "vulnérabilités humaines" — à savoir, en premier lieu, le besoin d'intimité avec autrui et de connexion sociale. Mais nous aide-t-elle vraiment à combler ce besoin, ou nous fait-elle courir de nouveaux risques ? Telle est toute la question de cet ouvrage.
Première partie — Le moment robotique : nouvelles solitudes, nouvelles intimités
Chapitre 1 — Nos plus proches voisins
Quelles sont nos relations aux robots domestiques qui peuplent déjà nos quotidiens ? L'auteure a mené de nombreuses études pour tenter de répondre à cette interrogation.
Tout d'abord, en tant qu'étudiante du MIT dans les années 1970, elle a fait l'expérience d'ELIZA, un programme informatique de base qui avait pour propriété essentielle de mimer un dialogue avec un psychothérapeute.
En réalité, ELIZA se contentait souvent de reformuler (éventuellement sous forme de questions) ou de paraphraser les propos de l'utilisateur. Mais la plupart des personnes l'ayant utilisé étaient prises au jeu et lui révélaient leurs secrets.
Pour Sherry Turkle, les participants ne pensent en rien qu'ils parlent à une véritable intelligence, mais ils "jouent le jeu", en quelque sorte. Autrement dit, ils sont complices du programme et utilisent les capacités du programme pour provoquer ce qu'ils attendent, à savoir des réponses réalistes d'ELIZA.
Il en va sensiblement de même pour les enfants avec les Furbies, ces peluches animées qui peuvent interagir avec leurs propriétaires. À travers les interviews qu'elle a menées durant de longues années, Sherry Turkle découvre que les petits considèrent les Furbies comme vivants, tout en sachant qu'ils ne sont pas "biologiquement vivants".
En fait, les enfants n'ont pas peur de brouiller les catégories : ils voient leur Furby à la fois comme une machine et comme un être vivant. Wilson, un petit garçon interrogé par l'auteure, affirme qu'il peut "toujours entendre la machine à l'intérieur".
D'un autre côté, dans ses études sur l'usage des Tamagotchis par les enfants, Sherry Turkle a remarqué que certains d'entre eux pleurent la mort de leurs petits animaux de compagnie électroniques. Elle donne ainsi l'exemple d'une petite fille qui refuse d'appuyer sur reset après la "mort" de son Tamagotchi.
Selon l'auteure, la pensée de ces enfants est directement liée à leurs interactions — c'est une pensée pragmatique, orientée vers l'action. Ils se prennent au jeu, comme si les Tamagotchis étaient en vie, et se demandent : que veut-il ? Quelles sont les expériences significatives que j'ai eues avec lui ?
Chapitre 2 — Assez vivants
Sherry Turkle amène avec elle huit Furbies dans une école primaire au printemps 1999. Directement, les enfants essaient de se connecter avec les jouets en leur parlant. Ils remarquent que les Furbies ont beaucoup en commun avec eux :
Ils ont des besoins ;
Ils sont distincts les uns des autres ;
Enfin, ils ont besoin d'être nourris.
Étrangement, certains enfants utilisent le vocabulaire des êtres vivants pour parler des machines, et parfois s'appliquent à eux-mêmes le vocabulaire des machines pour parler d'eux-mêmes. Un flou se crée. Pour l'auteure :
« [Les Furbies] promettent la réciprocité parce que, contrairement aux poupées traditionnelles, elles ne sont pas passives. Ils font des exigences. Ils se présentent comme ayant leurs propres besoins et leur vie intérieure. » (Seuls ensemble, Chapitre 2)
Autre expérience : le « test à l'envers ». Ici, des adultes tiennent trois "choses" à l'envers :
Une Barbie ;
Une gerbille (sorte de hamster) ;
Et enfin un Furby.
Apparemment, les gens sont plus réticents à laisser le Furby à l'envers trop longtemps. Pourquoi ? Car celui-ci, contrairement aux deux autres, est capable de dire "J'ai peur" (langage programmé dans la machine). Ils savent que c'est un robot, et pourtant c'est plus fort qu'eux, ces paroles les touchent.
Sherry Turkle raconte encore les opinions de deux garçons sur les robots, à vingt-cinq ans d'intervalle.
En 1983, l'auteure parle à Bruce, un garçon qui pense que, bien qu'un robot puisse faire moins d'erreurs, les défauts des humains sont ce qui les rend spéciaux.
En 2008, elle s'entretient avec Howard, qui voit quant à lui l'infaillibilité d'un robot comme un avantage. Il pense qu'un robot est susceptible de donner de meilleurs conseils qu'un humain, car il a accumulé davantage de connaissances.
Dans le cas de Bruce, c'est l'humanité et sa singularité qui sont mises en avant. La réponse de Howard, quant à elle, est typique de l'optimisme qui caractérise les constructeurs de technologies numériques et de robots. Mais celle-ci, pour Sherry Turkle, comporte le risque de se satisfaire des relations robotiques.
En d'autres termes, l'auteure craint que nos interactions répétées avec des robots sociables ne mènent à une réduction de ce que nous considérons comme "la vie", et tout particulièrement la vie humaine, avec les liens sociaux complexes qui la caractérisent.
Chapitre 3 — De vrais compagnons
C'est ce qu'elle cherche à exemplifier à partir d'un autre cas : la relation entre les robots AIBO — les chiens robots — et leurs propriétaires. Est-ce un véritable animal de compagnie ? Et plus important : est-ce que le fait de faire "comme si" il s'agissait d'un vrai chien peut amener ces personnes à se suffire de ce type de relation, somme toute limitée ?
Que leur manquent-ils ? Pour Sherry Turkle, la réponse est claire : l'altérité, à savoir la capacité de voir le monde à travers les yeux d'un autre.
Pour l'auteure, comme le robot n'est pas vivant, il devient simplement une prothèse ou une extension de la personne qui le possède. Lorsque nous interagissons avec des êtres humains, nous avons l'habitude de considérer l'altérité. Ne pas le faire est même le signe certain d'un problème psychologique (personnalité narcissique, manipulatrice, etc.).
Dans leurs relations avec AIBO, les enfants sont à nouveau pragmatiques. Ils le considèrent "comme si" il était un animal de compagnie normal et agissent en fonction. Toutefois, une jeune fille interviewée par l'auteure dit que l'AIBO est plus facile que les animaux de compagnie à certains égards parce qu'elle peut l'éteindre, à la différence d'un "vrai" animal vivant.
Sherry Turkle appelle cela un « attachement sans responsabilité ». Selon elle, s'habituer à ce type d'interaction peut être risqué dès lors qu'il influence nos rapports avec les autres personnes.
Bien sûr, il y a des nuances à faire. Les personnes n'interagissent pas de la même manière avec ces robots et ces interactions ne disent pas la même chose de notre façon d'agir avec les autres. À la fin du chapitre, l'auteure présente plusieurs exemples qui permettent de nuancer le propos.
Chapitre 4 — Enchantement
My Real Baby est une poupée robotique sortie en 2000. C'est un robot sociable légèrement plus avancé que le Furby. Il mûrit et devient plus indépendant. Sa "personnalité" est peu à peu façonnée par la façon dont il est traité par son propriétaire.
Sherry Turkle étudie les interactions entre My Real Baby et les enfants âgés de 5 à 14 ans. Elle remarque tout d'abord qu'ils voient les robots sous un jour positif, à la manière dont ils sont présentés dans les blockbusters hollywoodiens (R2D2 dans Star Wars ou Wall-e, par exemple).
L'auteure s'intéresse à la question de savoir si les enfants pensent que les robots pourraient, à l'avenir, prendre soin d'eux ou de leurs proches (enfants ou personnes âgées). Elle récolte des réponses — et des questions — intéressantes.
Certains se demandent concrètement si les robots ont de l'empathie pour eux. Selon Sherry Turkle, c'est une idée particulièrement courante chez ceux qui ont des parents absents. Un enfant nommé Kevin, âgé de 12 ans et particulièrement précoce, demande à l'auteure :
« Si les robots ne ressentent pas de douleur, comment pourraient-ils vous réconforter ? »
Mais d'autre part, Sherry Turkle remarque aussi que le comportement pragmatiste de bon nombre d'entre eux ne change pas : ils se satisfont de l'action simulée du robot et s'inquiètent seulement du fait qu'il pourrait tomber en panne.
Lorsqu'elle les interroge sur l'utilisation des robots pour aider leurs grands-parents, certains enfants affirment qu'ils pourraient être utilisés pour intervenir en cas de problème (chute, mort, etc.) ou de les aider à se sentir moins seuls. Mais certains enfants craignent aussi que leurs grands-parents en viennent à aimer le robot plus qu'eux !
Sherry Turkle termine ce chapitre par deux autres illustrations intéressantes.
Elle donne d'abord l'exemple de Callie, une jeune fille de 10 ans qui a une relation forte avec son jouet My Real Baby. Comme son père est souvent absent, la présence du robot la réconforte et lui fait "se sentir plus aimée". Investie d'un sentiment de responsabilité, elle se considère même comme la mère du bébé.
Tucker, un enfant de sept ans, est atteint d'une maladie grave. Il utilise AIBO pour exprimer ses sentiments sur la mort, sur son corps et sa propre peur de mourir. Il compare AIBO à son chien, mais considère que l'AIBO "fait mieux". Selon Sherry Turkle, il identifie le robot à « un être qui peut résister à la mort par la technologie ».
Chapitre 5 — Complicités
Sherry Turkle fait la découverte du robot Cog pour la première fois en 1994, au MIT. Cog est un robot assez évolué qui apprend de son environnement et cherche à créer du lien social.
Lors de nouvelles expériences avec des enfants, Sherry Turkle présente deux robots — Cog et Kismet (un autre robot "sociable") — à un groupe d'enfants. Ceux-ci, naturellement curieux, interagissent avec les robots et cherchent à faire connaissance.
Ils essaient de plaire aux robots et se font les complices de l'effort des concepteurs pour rendre les robots plus humains qu'ils ne le sont vraiment. Ils parlent et ils dansent avec eux ; bref, ils cherchent à attirer leur attention et à créer du lien social.
Même lorsque les concepteurs expliquent à certains enfants le mécanisme qui se cache derrière ces robots, ou bien lorsque ceux-ci tombent en panne, les élèves interrogés continuent de trouver des justifications et des explications pour conserver cet aspect "vivant".
Pour aller plus loin, Sherry Turkle raconte notamment l'histoire d'une petite fille de 11 ans qui, en raison de ses origines indiennes, a quelques difficultés à s'intégrer dans le groupe.
Elle n'aime pas la façon dont les filles qu'elle fréquente font semblant d'être ses amies, puis se moquent de son accent. Par contraste, elle aime la "fiabilité" de Cog. Selon Sherry Turkle, la petite fille s'assure ainsi d'être aimée, sans risquer le rejet d'autrui.
Une autre petite fille, à l'inverse, considère que c'est de sa faute si le robot ne parle pas suffisamment. Elle se demande pourquoi il n'est pas très bavard et s'en impute la responsabilité. Ici, c'est un sentiment d'échec qui est fabriqué par la relation avec la machine.
L'auteure donne de nombreux autres exemples très parlants. À chaque fois, elle pose la question du sens de créer des robots sociables. Quelles sont les implications éthiques de ce type de technologie et sommes-nous capables de les assumer ?
"Voulons-nous vraiment être dans le business de la fabrication d'amis qui ne pourront jamais être des amis ?" (Seuls ensemble, Chapitre 5)
L'amitié avec les robots ne pourra jamais être réciproque. Ce sera toujours une projection de nos propres sentiments sur un être finalement indifférent. Autrement dit, l'amitié véritable nécessite l'altérité.
Chapitre 6 — L'amour au chômage
Connaissez-vous Paro ? C'est un robot thérapeutique introduit dans certaines cliniques à partir du printemps 2009. Sa cible : les personnes âgées et, avant tout, les résidents des maisons de retraite. C'est l'occasion, pour Sherry Turkle, de revenir sur ses réflexions et ses observations auprès de ce groupe d'individus.
Sherry Turkle raconte d'abord les expériences qu'elle a menées avec My Real Baby. Elle explique que le robot est bien accepté, même si, de façon générale, elle remarque que les personnes âgées cherchent surtout à interagir avec les personnes humaines réelles qui organisent l'étude ou prodiguent les soins.
L'auteure raconte ensuite son incursion auprès des chercheurs en robotique. En 2005, elle assiste à un symposium intitulé « Caring Machines [machines de soin] : l'intelligence artificielle dans les soins aux personnes âgées ». Elle questionne notamment les participants au sujet du titre du symposium lui-même : veut-on vraiment que les machines prennent soin de nos ainés ?
Selon elle, prendre soin est ce qu'elle nomme "le travail de l'amour". Il s'agit avant tout d'une activité fondamentalement humaine.
Plus tard, toutefois, elle parle avec Tim, un homme d'âge moyen qui affirme que le robot Paro améliore la vie de sa mère. Celle-ci, selon lui, semble plus vivante grâce à la compagnie du robot. Mais est-elle pour autant moins seule qu'auparavant ? Telle est l'inquiétude de l'auteure.
Voici quelques autres exemples donnés par Sherry Turkle :
Une personne âgée nommée Andy devient très attachée à un My Real Baby et en vient à lui parler comme à son ex-femme.
Johnathan, un autre résident, ancien ingénieur, est plus terre-à-terre. Il démonte My Real Baby et trouve une puce informatique dont il ignore la composition.
Une femme âgée nommée Edna préfère le jouet à sa véritable arrière-petite-fille de 2 ans parce qu'elle peut jouer avec elle sans aucun risque. Le robot la détend.
Les robots comme Paro ou encore Nursebot (un autre robot de ce genre) commencent à intégrer les maisons de repos. Ils peuvent aider dans certaines tâches, comme la prise de médicaments. Mais nous devons faire attention aux conséquences inattendues de ces technologies sur les liens sociaux et, en particulier, sur la façon dont nous prodiguons l'amour et les soins.
Chapitre 7 — Communion
Sherry Turkle relate une série d''études visant à tester les compétences du robot Kismet dans la conversation entre adultes. Rich, jeune homme de vingt-six ans, participe à cette expérience.
Il commence par activer ce que l'auteure a appelé dès le premier chapitre "l'effet ELIZA". C'est-à-dire qu'il cherche activement à faciliter la relation avec le robot afin de créer l'illusion de son caractère "vivant". Peu à peu, un rapport se crée et Rich se prend au jeu — au point d'oublier que le lien est factice !
Avec Domo, une version améliorée de Kismet pensée pour l'aide ménagère, les effets sont semblables. Selon son concepteur, peu importe de savoir que le robot n'as pas de sentiments ; ce qui compte, c'est ce que nous ressentons lorsqu'un robot, par exemple, nous tient la main.
Mais Sherry Turkle n'est pas d'accord avec ce point de vue. Elle considère que, derrière ce "fantasme de communion", se cache en réalité "l'indifférence ultime" du robot. Et que cette indifférence n'est pas sans conséquences.
Selon le psychologue Clifford Nass, les personnes tendent à éviter les conflits ou à blesser les "sentiments" de l'ordinateur, même s'ils savent, au fond d'eux, que l'ordinateur n'en a pas. C'est toute la thématique de l'"informatique affective", une discipline inventée par Rosalind Picart dont parle l'auteure à la fin de ce chapitre.
Deuxième partie — En réseau : dans l'intimité, de nouvelles solitudes
Chapitre 8 — Toujours connectés
Sherry Turkle se souvient d'un groupe de personnes surnommées « les cyborgs » au MIT, dans les années 90. "Errant dans et hors du réel physique", ils étaient les premiers passionnés des jeux en ligne.
Leur attachement à l'espace virtuel semblait bizarre et marginal dans ces années-là. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? L'auteure souligne que beaucoup d'entre nous vivent comme cela désormais, que ce soit par le biais des réseaux sociaux ou des jeux en ligne comme Second Life.
Pour Sherry Turkle, notre vrai moi, notre moi physique, se confond peu à peu avec notre moi virtuel. Ou, à tout le moins, l'un et l'autre se transforment mutuellement. La psychologue-anthropologue prend plusieurs exemples tirés de ses recherches plus récentes.
En voici un. Pete est un homme d'âge moyen qui vit un mariage malheureux. Mais il a une femme virtuelle dans Second Life. Selon lui, cette relation en ligne aide effectivement son mariage dans la vie réelle à perdurer.
Pourquoi ? Car elle lui donne un exutoire. Dans le jeu, il peut aborder des sujets que sa femme refuse d'entendre. Les moments où il se sent le plus "lui-même", c'est dans le jeu, dit-il encore.
Sherry Turkle s'intéresse aussi au multitâche et à ses implications. Elle rappelle des études ayant montré les effets plutôt négatifs, en terme d'efficacité d'apprentissage, notamment, de ce mode de travail.
Par ailleurs, l'auteure remarque que la patience des gens diminue à mesure que les technologies de communication nous offrent des services toujours plus rapides. Les nuances se perdent aussi. Dans un monde où les réponses instantanées deviennent la norme, il faut faire court et direct.
Sherry Turkle voit ainsi une « symétrie effrayante » émerger : à mesure que les robots sont promus au rang d'être (quasi-) vivants, les personnes qui communiquent en ligne sont rétrogradées au stade de « machines maximisantes », sommées d'être toujours plus efficaces.
Finalement, Sherry Turkle observe un lien fort entre la robotique et les réseaux sociaux. Nous sommes profondément séduits par les deux technologies.
Les robots sociaux attirent les utilisateurs avec leurs besoins artificiels et créent une réponse positive chez les utilisateurs, qui se mettent à "jouer le jeu".
Les réseaux sociaux exigent de nous un engagement de plus en plus intense. Nous nous sentons obligés, ici aussi, d'entrer dans le jeu et de répondre le plus rapidement possible aux notifications et aux messages qui nous sont envoyés.
Chapitre 9 — Grandir constamment reliés
Depuis l'apparition des smartphones, de nombreux adolescents (et adultes) sont "scotchés" à leurs écrans. Quitte, parfois, à les utiliser lorsqu'ils conduisent ou quand ils savent que cela est dangereux.
La génération native d'Internet pense que la connexion via les réseaux sociaux est quelque chose d'acquis, de déjà-là et de premier. Mais, selon l'auteure, cette attitude peut nuire à l'auto-réflexion, qui passe par l'intimité et la solitude.
Par ailleurs, le médium lui-même, à savoir la forme des messages que nous envoyons, encadre la façon dont nous pensons et réagissons. L'auteure craint que le caractère rapide, court et direct des messages déposés sur les réseaux sociaux empêche les adolescents d'exprimer et de ressentir complètement leurs sentiments.
Aujourd'hui, une étudiante qui envoie des messages 15 fois par jour n'est pas considérée comme "anormale". Mais pensez-y. Était-ce ainsi il y a dix ans ? Pas du tout. À cette époque, vous auriez sans doute trouvé cela "bizarre". Les codes sociaux et culturels changent.
Sherry Turkle utilise de nombreux entretiens qu'elle a elle-même réalisés afin de montrer comment les jeunes se "créent des identités" en ligne et comment celles-ci peuvent causer des troubles intérieurs ou participer à réparer (partiellement ou artificiellement) des blessures dans la vie réelle.
Trish, par exemple, est une jeune fille de 13 ans qui est maltraitée physiquement. Dans les Sims Online, elle se crée une famille respectueuse et aimante.
Katherine, 16 ans, expérimente diverses personnalités dans ce même jeu.
Mona et un autre lycéen s'inquiètent de la relation de conséquence entre la création de leur profil sur Facebook et les opportunités qu'ils peuvent avoir dans la vie réelle. Leur profil virtuel peut avoir des conséquences importantes sur leur bien-être et leur avenir.
Sherry Turkle montre qu'un certain nombre d'étudiants sont fatigués de cet "audit" constant et de cette simplification de soi-même qu'implique l'univers des réseaux sociaux.
En résumé :
« Les réseaux sociaux nous demandent de nous représenter sur un mode très simplifié. Et devant notre public, nous nous sentons ensuite tenus de nous conformer à ces représentations simplificatrices. » (Seuls ensemble, Chapitre 9)
Chapitre 10 — Plus la peine de passer un coup de fil
Dans ce chapitre, Sherry Turkle continue son investigation sur les réseaux sociaux et la communication en ligne de façon plus générale.
Elle donne l'exemple d'Elaine, 17 ans, qui préfère envoyer des textos plutôt qu'appeler. Pourquoi ? Car cela lui donne le temps de construire ses pensées sans pression et souvent pendant qu'elle est seule. Ici, le message écrit peut aider la réflexion.
Audrey, 16 ans, est quant à elle timide. Elle préfère envoyer des textos, plutôt que de parler. Mais c'est surtout parce qu'elle n'aime pas mettre fin aux appels. Ses parents sont divorcés et ses frères sont souvent occupés ; dès lors, elle ressent chaque fin d'appel comme un rejet. Avec les textos, c'est plus simple, dit-elle.
Cela dit, elle avoue que, lorsqu'elle a déménagé, elle aurait aimé dire au revoir à l'un de ses amis par téléphone ou en personne, plutôt que par message écrit.
D'ailleurs, les adolescents ne sont pas les seuls à préférer les textos. L'auteure cite une femme adulte qui cherche à convertir son mari à ce mode de communication. Lui qui préfère téléphoner se voit contraint d'écrire afin d'être "plus efficace".
Sherry Turkle utilise de nombreux autres exemples en relation aux textos. À chaque fois, elle montre bien l'ambiguïté de ce médium. En effet, celui-ci peut aider à l'expression. Mais il contraint également énormément les échanges.
Et — comme nous avons toujours le mobile à côté de nous — il ne permet plus que rarement les moments de solitude et de remise en question.
Chapitre 11 — Réduction et trahison
Sherry Turkle se prête ici au jeu et crée un personnage de Second Life nommé Rachel. Elle affirme que "quand nous jouons à recréer notre vie via un avatar, nous exprimons nos espoirs, nos forces et nos fragilités".
À nouveau, l'auteure n'est pas contre la technologie. Elle reconnaît même qu'un tel « jeu » peut avoir des effets thérapeutiques ou éducatifs sur la vie réelle d'une personne.
Les psychologues distinguent deux processus mentaux que Sherry Turkle propose d'utiliser pour penser les formes de vie en ligne :
Le « retour du refoulé » ;
Le « travail sur les problèmes ».
Le « retour du refoulé » désigne ici le fait de rester bloqué au sein des mêmes conflits intérieurs, sans pouvoir avancer et trouver une solution. Votre présence en ligne ne vous aide pas à grandir, mais plutôt à vous cacher.
Par contraste, en « travaillant sur les problèmes », vous utilisez l'univers virtuel pour explorer de nouveaux comportement et mettre un terme à vos soucis.
Par exemple, Joel, un programmeur informatique à succès, utilise Second Life pour « explorer son potentiel d'artiste et de leader ». Son avatar est un éléphant miniature nommé Rashi qui organise et construit de grands projets artistiques et bâtiments dans le jeu et qui est respecté pour cela.
La vie en ligne de Joel "rejaillit" de façon positive sur sa vie hors ligne.
En revanche, Adam a plutôt tendance à s'enfermer dans le virtuel et à "laisser tomber" sa vie réelle. Il est insatisfait de sa vie hors ligne et en particulier de son travail. Mais il aime sa vie virtuelle dans Quake, un jeu de tir à la première personne auquel il joue seul ou avec des amis. Il aime aussi Civilization, un jeu dans lequel il peut construire des univers entiers.
« Tel est le secret de la simulation : elle offre l'exaltation de la créativité sans la pression, l'excitation de l'exploration sans le risque. » (Seuls ensemble, Chapitre 11)
Cette caractéristique peut être mise à profit pour évoluer dans la vie, ou simplement nous divertir. Mais elle peut aussi susciter des phénomènes d'addiction et la perte des repères avec le monde réel.
Chapitre 12 — De vraies confessions
Sur un site appelé PostSecret, les gens envoient des cartes postales manuscrites confessant quelque chose, et ces confessions de cartes postales sont ensuite mises en ligne. Il existe plusieurs sites de ce genre où l'idée est, à chaque fois, de faire part aux autres internautes de ses questionnements les plus intimes.
Sherry Turkle remarque qu'il est plus facile de se confesser de cette façon. En effet, nous pouvons rester plus évasifs et nous nous dévoilons sous couvert d'anonymat. Mais c'est aussi moins efficace, car nous ne confrontons pas à une relation directe (avec un ami ou un membre de la famille, par exemple).
En fait, ces confessions en ligne sont, dans un sens, semblables à ces compagnons robots analysés dans la première partie. Comme avec eux, nous n'avons plus à traiter avec de vraies personnes ; nous pouvons juste nous satisfaire de faire "comme si" nous nous excusions vraiment, ou comme si nous réparions vraiment nos erreurs.
Par ailleurs, confesser ses problèmes en ligne augmente le nombre de réponses auxquelles nous pouvons nous attendre. Or, ce ne sont pas toujours des réponses bienveillantes ou justifiées, loin de là. La "cruauté" des internautes peut rendre l'expérience vraiment pénible.
Enfin, ces messages peuvent avoir pour effet de limiter l'empathie de ceux qui les lisent. Nous doutons de l'aspect "réel" et sincère de la confession. Et comme nous estimons qu'il pourrait s'agir d'une "performance", nous nous lassons des messages.
Chapitre 13 — Angoisses
Autre phénomène analysé par Sherry Turkle : le stress et l'anxiété. L'anxiété est monnaie courante à l'ère du numérique. Nous avons peur de manquer une information ou un bon plan (le fameux FOMO pour fear of missing out) et nous avons le sentiment simultané que tout est disponible et de devoir toujours être accessible.
Pour l'auteure, c'est d'ailleurs à partir des attentats du 11 septembre que les mobiles sont devenus "des symboles de sécurité physique et émotionnelle". En l'ayant toujours avec nous, nous nous sentons davantage protégés. Même si ceux-ci nous stressent aussi d'un autre côté.
À la fin du chapitre, Sherry Turkle aborde la question délicate du harcèlement sur Facebook et celle de la surveillance généralisée qu'impliquent les réseaux sociaux. Elle rappelle l'importance cruciale de la vie privée pour la démocratie.
Chapitre 14 — La nostalgie des jeunes
Finalement, Sherry Turkle note que de nombreux jeunes aspirent à une connexion plus profonde et en face à face. Ils se sentent enfermés dans le cercle vicieux créé par la technologie numérique. Envoyer des textos, par exemple, crée « une promesse qui génère sa propre demande ».
La promesse est que vous pouvez envoyer un SMS et demander à un ami de le recevoir en quelques secondes, ;
La demande est que l'ami soit obligé de répondre.
Robin, une jeune journaliste ambitieuse de 26 ans, se sent par exemple obligée de garder son BlackBerry avec elle à tout moment. Elle se sent même anxieuse et presque malade lorsqu'il n'est pas à bout de bras.
Pourquoi cet attachement si fort aux mobiles ? Parmi ses arguments, Sherry Turkle fait valoir que l'une des raisons pour lesquelles les enfants d'aujourd'hui souhaitent être connectés est qu'ils ont grandi en concurrence avec les téléphones pour attirer l'attention de leurs parents.
Conclusion — Des débats nécessaires
La psychologue et anthropologue démontre que les ordinateurs nous "utilisent" — et nous façonnent — autant que nous les façonnons. Nous inventons de nouvelles technologies pour nous aider à vivre et à travailler au quotidien, mais celles-ci nous transforment profondément !
L'un de ses amis et collègues handicapés, Richard, lui raconte comment il valorise l'aide que lui apportent les personnes humaines. Selon lui, un robot ne pourrait pas agir vis-à-vis de lui de cette façon. L'être humain, dit-il, surtout quand il est fragile, a besoin d'être raccroché à son histoire et à des liens concrets de fraternité. C'est ce qui lui donne sa dignité.
Non, la seule "performance du sentiment" ne suffit pas. Bien sûr, nous pouvons être tentés par cette solution, car nous contrôlons (ou pensons mieux contrôler) les rapports que nous entretenons avec les robots. Mais nous nous exposons moins à l'altérité.
Par ailleurs, nous risquons de ne plus supporter la solitude, pourtant essentielle à la création de nouvelles idées. Constamment aux prises avec cette performance du sentiment (aussi bien avec les robots qu'avec les autres virtuels), nous en oublions de nous retrouver avec nous-même pour nous poser ou réfléchir.
Au final, Sherry Turkle voit bien que certaines générations ressentent davantage le besoin de se mettre au vert et de concevoir d'autres formes de connectivité — c'est d'ailleurs tout l'objet du cyberminimalisme.
Que ce soit avec les robots ou les réseaux sociaux, nous pouvons créer des limites. Les robots, par exemple, peuvent très bien nous aider dans certaines tâches, mais nous ne devrions pas nous laisser avoir par l'illusion de l'amour robotique — dans le domaine des soins, surtout.
En somme, c'est à nous de reprendre le contrôle des usages acceptables et indésirables !
Épilogue — La lettre
Sherry Turkle raconte ici une anecdote personnelle. Elle envoie un texto à sa fille, qui prend une année sabbatique à Dublin avant l'université. Mais elle est insatisfaite : elle se souvient avec nostalgie des lettres qu'elle envoyait et recevait de sa propre mère alors qu'elle était à l'université.
Elle se rappelle que ces lettres étaient longues, sincères et pleines d'émotions. Bien qu'elle apprécie les échanges écrits et les visioconférences par Skype avec sa fille, quelque chose lui manque. Et elle remarque aussi que d'autres mères sont dans la même situation.
Alors, que faire ? Sherry Turkle évoque différentes méthodes pour « capturer la vie ». Il y a l'art et la science, bien sûr. Mais aussi la volonté, pour certaines personnes, d'archiver leur vie complète en écrivant des mémoires — ou en consignant chaque petit moment sur Instagram ou sur Facebook !
Pourtant, au quotidien, comment échanger de façon à la fois simple et plus profonde ? Sherry Turkle propose à sa fille de s'écrire des lettres, comme elle le faisait quand elle était elle-même plus jeune. Une correspondance à l'ancienne, pourquoi pas !
Conclusion sur "Seuls ensemble" de Sherry Turkle :
Ce qu'il faut retenir de "Seuls ensemble" de Sherry Turkle :
Ce livre se lit presque comme un roman. Pourtant, il repose sur un nombre impressionnants d'études et d'expériences réalisées par l'auteure et ses collègues pendant plus de quatre décennies. Grâce à sa force narrative et sa rigueur scientifique, l'ouvrage est devenu un classique à la fois dans les universités et en dehors.
Ses deux champs d'expérimentation sont :
La conception et la commercialisation de robots domestiques et en particulier de robots sociaux (jouets, robots domestiques, de compagnie, de soin, etc.) ;
L'apparition, grâce à Internet, de mondes en ligne divers (jeux, réseaux sociaux, etc.) et d'une connexion accrue (via les messageries, les textos, etc.).
Elle remarque une similitude entre ces deux domaines. En effet, à chaque fois, les êtres humains, jeunes ou vieux, se prêtent au jeu de la simulation et en oublient qu'ils deviennent, à leur tour, les jouets de réactions préprogrammées.
Or, ce qui l'intéresse plus que tout, c'est de voir comment ces relations à sens unique affectent notre sens de l'intimité, de la solitude et des relations humaines.
Et sa contribution principale consiste à documenter avec précision les difficultés auxquelles nous sommes confrontés avec les technologies actuelles issues de la robotique et d'Internet. À savoir :
Le risque de se couper de l'altérité et de l'imprévisibilité ;
La tentation de préférer des émotions artificielles aux joies et aux peines concrètes ;
Le manque de solitude nécessaire à la constitution du soi et des relations humaines.
Pour autant, Sherry Turkle, qui est une fine psychologue et anthropologue, ne considère pas qu'il faille — comme on dit — jeter le bébé avec l'eau du bain. Selon elle, il existe des usages positifs de la robotique ainsi que des réseaux sociaux et des jeux en ligne. Mais ce n'est qu'en les pratiquant avec conscience et réflexion que nous pouvons en tirer le meilleur.
Points forts :
Un style personnel qui permet d'entrer dans l'étude comme s'il s'agissait d'un roman ;
De très, très, très nombreux exemples issus de toutes ses études de terrain et entretiens ;
Un effort théorique solide ;
Une bibliographie et des annexes intéressantes.
Point faible :
C'est un livre peu ardu, mais qui en vaut la peine.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu le livre de Sherry Turkle, « Seuls ensemble » ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Sherry Turkle, « Seuls ensemble ».
Visitez Amazon afin d’acheter le livre de Sherry Turkle, « Seuls ensemble ».
 ]]>
]]>Résumé de "L’art des listes | Simplifier, organiser, enrichir sa vie" de Dominique Loreau : cet ouvrage nous invite à faire des listes pour nous reconnecter à l'essentiel, stimuler notre créativité, nous alléger et donner du sens à notre vie, en abordant tous les aspects de notre quotidien et de notre être intérieur.
Par Dominique Loreau, 2020, 288 pages.
Titre édition anglaise : "L'art de la Liste: Simplify, organise and enrich your life"
Chronique et résumé de "L’art des listes | Simplifier, organiser, enrichir sa vie" de Dominique Loreau
INTRODUCTION
En introduction du livre "L’art des listes | Simplifier, organiser, enrichir sa vie", l’auteure, Dominique Loreau, souligne l'omniprésence et les vertus des listes depuis toujours pour se connecter à soi et sublimer son existence.
Elle relate en effet comment, depuis la nuit des temps, l'homme éprouve le besoin de consigner les idées, événements et faits sous forme de listes : des monastères du Moyen-Âge aux inventaires asiatiques, cette quête de connaissance universelle et de soi a toujours perduré, explique-t-elle.
Aussi, pour Dominique Loreau, parce qu’elles sont concises et denses, les listes nous offrent une voie d'accès directe pour explorer notre vie en profondeur, affiner nos sens tout comme pour nous simplifier l'existence.
"De par sa concision et sa forme ramassée, de par la simplicité de sa présentation et l’immédiateté de son approche, de par le prisme des mots qu’elle concentre, la liste nous donne une voie d’accès directe à l’exploration illimitée de notre vie."
En notant souvenirs, rêves et aspirations, nous ramenons à la surface des pans entiers de notre être, lance l’auteure.
De plus, les listes s'adaptent parfaitement à notre époque, non seulement pour la prise de conscience qu'elles suscitent, mais aussi pour le renouveau spirituel qu'elles éveillent. Elles clarifient notre mental et, comme le préconise le zen, nous aident à nous libérer des formes pour atteindre la plénitude. "Qu’en reste-t-il ? Plus de lucidité, plus de légèreté au quotidien et un enrichissement immense sur tous les plans" termine Dominique Loreau.
Chapitre 1 - Pourquoi des listes ?
1.1 - Nous avons tous besoin des listes
Les listes font partie intégrante de notre quotidien et de notre mental.
Pour Dominique Loreau, nos listes représentent un "support indispensable" : elles nous aident à garder le contrôle, gagner du temps et éviter stress et oublis. En les systématisant, nous pouvons donc vivre plus simplement et intensément.
1.2 - Le développement personnel
Le monde dans lequel nous vivons aujourd’hui, avec ses pertes de repères, rend le développement personnel de plus en plus présent.
Souvent, nous accumulons donc des conseils et techniques de développement personnel que nous n’appliquons pas. L’auteure de "L’art des listes" nous invite alors à tenir des listes des idées marquantes que nous rencontrons sur le sujet. C’est un moyen, affirme-t-elle, de nous approprier ces enseignements. "Faire des listes, vous montrera ce livre, n’est ni fatigant ni vain, ni pour les écervelés" précise Dominique Loreau. "Au contraire, c’est systématiser un moyen de s’enrichir, seconder sa mémoire, la rafraîchir, et vivre plus intensément".
1.3 - Les listes, question de personnalité
Enfin, pour Dominique Loreau, faire des listes révèle aussi notre personnalité. Certains en font par nécessité, d'autres par passion, allant jusqu'à tout répertorier. C'est un phénomène culturel, notamment au Japon où la "listomania" est très présente.
L’auteure explique ce phénomène par "l’amour du multiple sous un tout : posséder des connaissances et garder des traces de tout sans s’encombrer de divers documents". C’est "l’art de posséder sans posséder, et de ne rien posséder en ayant tout".
Car finalement, faire des listes, c'est savourer la vie et en collectionner ses moments à l'infini, observe l’auteure.
1.4 - L’art du peu, un style sans syntaxe
"La liste est la forme d’expression la plus concise qui existe ; paradoxalement, son style elliptique revêt le caractère le plus exhaustif dans tous les domaines. Sa brièveté même nous mène à l’évidence. Et cela, avec bien plus de force parfois que des phrases encombrées de toute une syntaxe."
1.5 - Journaux intimes ou listes
"Faites le ménage dans vos écrits comme vous le feriez dans une maison si longtemps habitée que vous ne savez plus ce qu’elle recèle. Une maison qui contient tant de choses encombrantes, inutiles,stériles que vous n’avez même plus de place pour y vivre et y respirer."
Ainsi, "les listes permettent de restructurer ses idées, d’avoir un panorama global de son existence. Elles aèrent le texte, améliorent sa visibilité, font de sa relecture un plaisir."
1.6 - Un passe-temps créatif
"Écrire le livre de sa vie sous forme de listes peut constituer la plus parfaite des collections, le plus accessible des passe-temps et représente une activité idéale et constructive, aussi riche, sinon plus, que les mots croisés, que l’on ait sept ou cent dix-sept ans."
Se constituer des listes ne requiert aucun effort continu, aucun talent particulier, nulle contrainte d’avoir à suivre le fil de ses idées. Cela donne au contraire vie à ses pensées, à sa propre esthétique de l’existence. Cet ensemble de notes deviendra, jour après jour, notre propre bible de l’existence, le reflet de notre univers intérieur, un centre de repères qui pourront nous aider à retrouver cette unité, cette harmonie, ce sens tout simple de l’émerveillement que nous perdons peu à peu.
1.7 - Faire des listes ou se rendre maître d’un trésor inépuisable et secret
La passion qu’ont certains pour les listes peut aussi s’expliquer par le désir de tendre à l’exhaustivité. Ils ont cette impression qu’enfin listé, le monde est envisageable, un peu mieux limité et "taillé" à leurs besoins. Tout leur apparaît un peu moins immensément démesuré, complexe, étrange, en un mot angoissant. Le monde et la vie leur appartiennent mieux.
Partie 1 – Les listes pour … se simplifier les mécaniques de l’ordinaire
Chapitre 2 - Le temps, c’est de l’argent
Le deuxième chapitre de "L’art des listes" met en lumière l’intérêt des listes dans notre gestion du temps.
2.1 Les listes "Mes condensateurs de temps"
Les listes sont de véritables "condensateurs de temps" déclare Dominique Loreau. Elles nous aident à mieux organiser notre vie effrénée et sont très pratiques "quand nous nous sentons dépassés par tout ce que nous devons ou désirons faire". Elles soulagent notre mémoire en consignant idées et tâches à accomplir, apportant satisfaction à chaque case cochée.
Au travail, les listes permettent de hiérarchiser les priorités pour optimiser son efficacité. De fragmenter une tâche impressionnante en plusieurs petites de façon à ce qu’elle devienne moins angoissante.
2.2 - Faire des listes pour optimiser la qualité de son temps
Pour Dominique Loreau, quand nous faisons nos listes, nous devons suivre le principe suivant : planifier ses activités dans le but de maximiser ses expériences positives et sa qualité de vie.
L'auteure suggère ici plusieurs listes à faire pour prendre conscience de l'utilisation de son temps : ce qui nous en fait perdre ou gagner, les moments où l'on vit pleinement l'instant présent, la répartition entre travail, tâches ménagères, loisirs...
2.3 - Comment mieux profiter du temps qui passe
Pour mieux profiter de notre temps, l’auteure du livre "L’art des listes" liste ici plusieurs conseils comme : établir des priorités, se fixer des objectifs, déléguer les corvées, cultiver les petits plaisirs du quotidien, agir sans tarder, faire du sport, limiter les sollicitations...
Elle propose aussi des idées de listes pour gagner du temps : lister les raccourcis de clavier, nos sites préférés, nos adresses email, nos mots de passe, les coordonnées de services utiles à contacter…
Dominique Loreau souligne que la maîtrise de son temps est indissociable d'un travail sur soi. Le but est de contrôler son emploi du temps plutôt que de le subir, en s'autorisant aussi des moments d'oisiveté et de déconnexion salutaires.
2.4 - Comment se déstresser face aux fêtes de fin d'année
Pour Dominique Loreau, novembre est idéal pour anticiper sereinement les fêtes. C’est, assure-t-elle, le moment d’utiliser les listes. En plus de nous aider à organiser les fêtes de fin d’année, elles permettent de ne pas avoir à se rappeler chaque année des choses à faire.
L'auteure de "L’art des listes" prodigue ici de nombreux conseils d'organisation : dresser des listes d'idées cadeaux originales ou immatérielles, fixer un budget, faire ses achats en avance, impliquer toute la famille dans la décoration, cuisiner simple, avoir une réserve de cadeaux d'appoint, une boite de correspondance prête...
Plusieurs suggestions de listes sont également proposées :
Des choses à faire : cartes de vœux, budget, résolutions de nouvelle année...
Des cadeaux : cadeaux reçus, offerts, à faire, à se faire offrir, idées d’emballages originaux et personnalisés…
Pour mieux et moins dépenser : mes rentrées et sorties d’argent (le kakebo : à faire en une phrase avec Claude : mettre faire tenir ses comptes à jour à Claude), dépenses à envisager cette année, achats extravagants mémorables, mes envies shopping, mes besoins en matière d’achats…
Chapitre 3 - La cuisine, l’alimentation
Le chapitre 3 du livre "L’art des listes" met en exergue les multiples façons de sublimer son quotidien gastronomique grâce aux listes.
3.1 - Les recettes et "trucs" de cuisine
Plutôt que d'accumuler des livres de cuisine, Dominique Loreau conseille de compiler ses recettes favorites dans un carnet pratique.
On peut alors les :
Classer par catégories, comme par exemple "plats préférés", "recettes reçues de ma mère, de ma sœur, de mes amis", "recettes que j’ai inventées", ou "plats de consistance", "amuse-gueule", "desserts", etc.
Agrémenter d'anecdotes personnelles, "trucs de cuisine" et autres informations utiles : dans le sien, l’auteure confie y ajouter des astuces, équivalences de poids et mesures, une charte de calories…
Accompagner d’idées de repas selon les occasions : repas en solitaire, repas TV, repas en amoureux, de famille, entre amis, de réception, dînatoires, du dimanche soir, préparés en 10 minutes, pique-niques, dans le jardin, o’clock tea, boîte repas, repas diététiques, du malade, des jours de pluie…
3.2 - L’Almanach du gourmet
L'auteure suggère également de tenir un "Almanach du gourmet" répertoriant mois par mois les produits de saison et les plats qui s'accordent à la météo.
Elle évoque, à ce propos, une liste qui l’a marquée : celle d’une épouse japonaise qui avait noté, repas après repas, année après année, 60 ans de menus adaptés à l'âge et la santé de son mari. Lors d’une émission à la télévision japonaise, cette liste avait été présentée comme une véritable preuve d'amour et un modèle diététique.
3.3 - Mes carnets gastronomiques
Dominique Loreau fait ensuite d’autres suggestions, comme lister dans un carnet :
Nos accords mets-boissons préférés, tel un mariage parfait de saveurs à ne pas gâcher. L’auteure les appelle ses "Duos du plaisir".
Nos souvenirs de repas d'exception : "Quel dommage de laisser perdre le souvenir de certains repas…" écrit ici l’auteure. "Nous ne notons généralement pas ce que nous avons mangé même si nous tenons un journal, et pourtant certains repas font partie des grands moments de la vie. Noter le lieu, les mets et les vins, les personnes présentes peut, des années plus tard, raviver un de ces moments exceptionnels de notre vie."
Les menus de nos réceptions.
Nos restaurants coups de cœur et même les promenades qui s’en suivent.
Les cafés, bars, clubs, salons de thé et caves de dégustation où nous sommes allés : "Ces endroits portent souvent des noms amusants ou élégants. Ils font partie de vous, maintenant que vous les avez visités. Bistrots de Paris, bars de grands et luxueux hôtels de New York, buvettes de plages tropicales… cette liste peut constituer une collection de souvenirs très originale et moins agaçante que celle de ces petites boîtes d’allumettes qui ont perdu tout leur charme, une fois sorties de leur décor."
Nos produits gastronomiques fétiches : les meilleures huiles d’olive trouvées sur le marché, le meilleur jambon goûté chez des amis, les commerces spécialisés, boulangeries renommées dont il est fait éloge dans un magazine (des adresses notamment fort utiles le jour où l’on veut offrir un cadeau).
Nos vins préférés : l’auteure nous confie qu’un de ses amis notait ses impressions sur chaque vin en les comparant à des femmes célèbres ou connues de lui.
Autant d'aide-mémoire gourmands et de sources d'inspiration culinaire, à l'image des menus calligraphiés précédant les cérémonies du thé japonaises, summum de la prévenance.
Chapitre 4 - Les listes "Santé, régimes, beauté"
Dans le chapitre 4 du livre "L’art des listes", Dominique Loreau partage des astuces "bien-être" au quotidien et des exemples concrets de listes, du suivi des maladies aux secrets beauté.
Pour l’auteure, ces listes vont nous aider à mieux comprendre les signaux de notre corps, à atteindre nos objectifs minceur ou encore à associer beauté et santé de façon personnalisée...
4.1 - Le "carnet de santé"
Au même titre qu'un carnet de recettes, Dominique Loreau préconise de tenir un "carnet de santé" pour traquer et noter nos petits maux.
La tenue de ce "carnet de santé" va permettre de déceler l'apparition d’éventuels symptômes, d'indiquer précisément son état à un médecin et d'avoir ses propres remèdes.
L'auteure de "L’art des listes" suggère ici encore de multiples listes de suivi intéressantes : les maladies dont nous avons souffert, les opérations que nous avons subies, nos traitements, les causes de nos problèmes de santé, ce que nous pourrions faire pour améliorer notre santé, les vertus des aliments, nos biorythmes (heures de faim, de sommeil, de coups de fatigue...), les abus que nous avons commis avec notre corps, des principes à nous fixer pour être en meilleure forme, etc.
4.2 - Listes de dialogues entre moi et mon corps
Des "listes-dialogues" avec son corps aident aussi à comprendre les messages qu'il nous envoie et à sortir de la passivité.
Ainsi, entreprendre par écrit une conversation avec son moi en surpoids, fatigué ou dépendant, est un premier pas vers la guérison, observe l’auteure.
"Vous pouvez par exemple, dans une liste à deux colonnes, entreprendre un dialogue avec le moi mince qui est en vous, lui demander les raisons pour lesquelles il s’est ainsi laissé piéger par la graisse. Demandez-lui de vous aider à le libérer, à le faire sortir de sa prison. Essayez de rester en contact avec lui aussi souvent que possible. (…) Vous pouvez aussi faire ce type de "listes-dialogues" pour mieux comprendre vos problèmes avec l’alcool, le tabac, la drogue, ou toute autre forme de dépendance, même la fatigue."
4.3 - Le carnet "Minceur"
De même, tenir un "carnet minceur" avec son poids, ses menus, ses motivations, notre image idéale s'avère le meilleur des coachs.
On peut aussi y noter nos plats diététiques préférés, les régimes dangereux pour la santé, nos erreurs alimentaires, la charte des calories, les inconvénients des kilos en trop, les raisons pour lesquelles je mange sans faim, ma façon de me nourrir enfant, mes obsessions, mes angoisses liées à la nourriture, etc.
"Tout ce que vous aurez écrit de votre main, dans votre propre carnet, aura beaucoup plus de poids que n’importe quel écrit imprimé. Faire des listes est le premier pas pour se prendre réellement en charge."
L'essentiel, indique l’auteure, est de se fixer des objectifs précis, mesurables, réalistes et d'y associer des actions concrètes.
4.4 - Les "exercices physiques sous forme de croquis" et "mes secrets de beauté"
Enfin, Dominique Loreau conseille de :
Réaliser des planches de croquis récapitulant ses exercices physiques : enchaînements de yoga, mouvements kinesthésiques à faire dans les transports, devant son ordinateur, etc., massages à se faire en regardant la télévision, exercices de maintien, ceux faisables en téléphonant, en étendant le linge…
Consigner ses secrets de beauté maison : soins de la peau, des cheveux, des ongles, du corps, aliments et boissons "spécial beauté", masques de beauté faits maison, mini-jeûnes de désintoxication par saison, conseils de proches, de mon professeur de danse
Autant d'outils sur mesure pour se prendre en main et associer minceur et bien-être au quotidien.
Chapitre 5 - Les listes de la Fée du logis
Le chapitre 5 de "L’art des listes" partage de nombreuses idées de listes pratiques pour nous faciliter la vie au quotidien et rendre notre intérieur "impeccable" en un "jeu".
5.1 - La routine domestique
Tenir sa maison devient un jeu grâce à une routine ménagère bien rodée.
L'auteure conseille de répartir les tâches en séquences quotidiennes de 15 minutes, de la vaisselle au linge en passant par l'aspirateur.
5.2 - Liste de la routine domestique annuelle "grand blanc"
Des listes récapitulent aussi les corvées hebdomadaires, mensuelles et annuelles pour un intérieur toujours impeccable.
5.3 - Les numéros de téléphone à avoir sous la main
Avoir ses propres "trucs et astuces" et numéros utiles sous la main facilite la vie. De l'urgence médicale au plombier en passant par le pressing, regrouper ces renseignements évite de perdre un temps précieux.
5.4 - Les listes fixes et provisoires
Enfin, certaines listes méritent d'être conservées et perfectionnées, comme celle des indispensables à glisser dans sa valise avant de partir en voyage. Un bon moyen d'optimiser son quotidien !
Chapitre 6 - Les listes "Escapades"
Le sixième chapitre de "L’art des listes" décrit l'art et la manière de préparer sereinement ses escapades grâce aux listes, de la conception du projet aux valises. L’auteure y partage là encore des astuces très concrètes à mettre en pratique pour partir l'esprit léger vers de nouvelles aventures.
6.1 - Prévoir pour mieux voyager
Rien de tel qu'une escapade bien préparée pour se ressourcer.
Pour cela, Dominique Loreau conseille de se constituer, avant de partir, des listes "escapades". Cela peut être une liste :
De week-ends ou de voyages escapades "tout prêts" : à l’intérieur, on y regroupera toutes les informations pratiques : hôtels, itinéraires, activités, budget...
D’amis qui nous ont invités à aller les voir
De recherches à entreprendre pour aller à tel ou tel endroit.
De quoi partir sur un coup de tête si on le souhaite en toute sérénité.
6.2 - Tous mes préparatifs de voyage
Une fois le séjour calé, place aux listes de préparatifs. Dominique Loreau détaille ici tout ce à quoi penser côté logistique avant un grand voyage pour nous aider à faire des listes type selon les types de voyage et saisons : week-end à la mer, à la montagne, en été, en hiver, pays chauds/ froids, etc.
Ainsi, du passeport au système d'alarme en passant par les cadeaux à rapporter, nous pouvons lister :
Ce à quoi il nous faut penser à faire chez nous : fermeture de l’électricité, gaz, débrancher le frigo, mettre l’alarme…
Les formalités de départ : copie des passeports, vérifier nos billets de transport, avoir de l’espèce…
Ce qu’il faut anticiper sur le voyage : budget cadeaux à rapporter, valise, dentiste…
Les personnes à contacter avant de partir : double des clés à donner, garde d’animaux, arrosage des plantes, prévenir nos proches de notre absence…
Les choses à régler avant le départ : factures, argent, voiture…
Pour l’auteure, "une bonne liste, fiable, donne une tranquillité d’esprit et une sérénité qui laissent toute la place aux joies du départ".
Côté valise, l'organisation est reine. L'auteure recommande notamment le "système poupées russes" : une pochette par catégorie (médicaments, devises...) à glisser dans un grand sac, le tout dans la valise. On plie chaque vêtement avec soin et on opte pour des tenues légères et polyvalentes. Sans oublier sa trousse de secours et ses indispensables beauté.
6.3 - Mon kit de kits
Dominique Loreau partage enfin tout un tas d’astuces mémo à garder sous la main pour voyager l'esprit libre.
Elle suggère de nous constituer une liste de kits : kits de soins, de secours, de toilette, de douche, cheveux, maquillage, électronique, documents importants et argent, pochettes, sacs, sac-à-main.
Une fois les préparatifs bouclés, il ne reste plus qu'à savourer l'idée du départ... Et la destination !
Chapitre 7 - Les listes pour éliminer
7.1 - Posséder moins pour avoir assez
Faire l'inventaire exhaustif de ses possessions est la méthode la plus efficace pour réaliser ce dont on a vraiment besoin et se débarrasser du superflu, soutient l’auteure de "L’art des listes".
Elle suggère d’avoir une "liste anti-encombrement" sous forme de liste de "kits de nos choses essentielles". Cette liste regroupe, par catégorie, les indispensables du quotidien : produits d’entretien, ustensiles de cuisine, si invités, pour correspondance, tea time, ambiances, soins, papiers...
En parallèle, nous pouvons lister aussi ce que nous possédons en excès, ce que nous avons de plus précieux, les choses sans valeur sentimentale que nous gardons, ce que nous pourrions vendre, donner, nous débarrasser, les vêtements que nous ne portons jamais, etc.
Cela permet de visualiser ce qui est en excès.
7.2 - Comment se séparer de certains objets du passé
Pour se séparer des objets du passé plus facilement, Dominique Loreau conseille d'écrire un poème d'adieu. Pour l’auteure, ce poème résumera ce que ces objets représentaient avant de s'en défaire.
Par ailleurs, des listes à intituler "Adieu objets du passé" aident à faire le tri parmi les cadeaux encombrants, les souvenirs d'ex, les objets qui rappellent une dispute ou une personne à oublier, les articles qui ne correspondent plus à nos goûts ou à notre intérieur actuel...
7.3 - Photos, articles de presse et scrapbooks
Même discipline pour les photos. L’auteure nous invite à :
Ne garder que celles qui évoquent des moments uniques,
En éliminer les doubles,
Les classer et les légender dans des albums de voyage ou scrapbooks.
L'essentiel est d'être sélectif.
7.4 - Listes que l’on pourrait faire précéder du chiffre "1"
Enfin, l'auteure propose des listes minimalistes.
Elle partage de nombreuses idées, comme dans les listes avec "1" :
Nos possessions matérielles : 1 parfum, 1 bague…
Des activités "zen" : 1 voyage en solo, 1 soin de beauté par jour…
Nos engagements : 1 jour par semaine sans rendez-vous, 1 seule banque…
La nourriture et cuisine : 1 journée de monodiète par mois, 1 bol...
Ou encore les listes avec "trop" : trop de choix, trop de choses inutiles, trop de laisser-aller, trop de kilos, etc.
L’idée est de posséder moins mais mieux, pour nous simplifier l'existence. D’adopter un art de vivre épuré et zen.
Chapitre 8 - Une vie bien ordonnée
8.1 - Leçons tirées du livre "Getting Things Done"
Dans ce chapitre de "L’art des listes", Dominique Loreau nous invite à tenir des listes fiables selon la méthode du livre "Getting Things Done".
Il s'agit de rassembler ses tâches en suspens, les traiter, les organiser par contexte, les réviser et surtout agir concrètement.
Pour cela, chacune de nos actions doit être définie précisément. Les petites choses réglées en 2 minutes, le reste classé selon des échéances.
8.2 - Noter même ses problèmes
Dominique Loreau nous propose également de noter nos problèmes pour mieux les cerner :
"Faire des listes, ce n’est pas seulement noter ce qu’il y a à faire sur une feuille de papier, mais transcrire ce qui se passe dans sa tête pour mieux voir ce que l’on peut faire immédiatement ou laisser en attente. On peut ainsi mieux cerner certaines priorités afin de les accomplir. On ressent un sentiment remarquable de soulagement une fois que tout ce que l’on voulait décharger de sa tête est transféré sur le papier !
Si vous avez des problèmes auxquels réfléchir ou à résoudre, qu’ils soient d’ordre professionnel, relationnel, privé ou physique, notez-les aussi. Ils n’auront plus l’ampleur que vos émotions leur donnent. Ils seront focalisés, concrets et limités, plus contrôlables, moins envahissants ; ils seront comme le reste : quelque chose à régler, de toute façon."
8.3 Les listes "Questionnaires"
Enfin, l'auteure de "L’art des listes" conseille des "listes-questionnaires" que l’on utilisera avant tout engagement important : un achat immobilier, une opération, un emploi, un gros achat, une adhésion à une association, etc...
Partie 2 - Les listes pour … apprendre à mieux se connaître
Chapitre 9 - Qui suis-je ?
9.1 - Pourquoi chercher à mieux se connaître
Pour composer son autoportrait, l'auteure nous invite à rassembler dans des listes tout ce qui nous concerne : notre histoire, nos rêves, nos goûts, nos traits de caractère... Car nous ne voyons souvent de nous que ce que nous voulons bien voir, oubliant qui nous sommes vraiment dans le tourbillon de la vie.
"C’est comme si l’ensemble de vos listes traçait de vous le plus fidèle des autoportraits. Carnets culinaires, listes de lectures, cauchemars, amours…, c’est tout cela, vous."
Aussi, se remémorer et révéler le plus profond de soi permet de mieux se connaître et de savoir ce que l'on veut. L'écriture est un chemin vers notre vérité intérieure, assure Dominique Loreau. Certes, nous sommes un et plusieurs à la fois, mais entamer ce puzzle de l'autoportrait est essentiel pour prendre conscience de ce que nous sommes, termine-t-elle.
9.2 - Se poser à côté de soi et regarder
En fait, poursuit l’auteure, il s'agit d'être le témoin de notre propre vie, en nous observant à distance. Que faisons-nous ? Qu'aimons-nous ? Nos expériences et réflexions, une fois listées, nous renverront une image plus fidèle que le miroir. De quoi vivre de façon plus intense et authentique.
"Faire des listes nous force à réfléchir, à questionner, à explorer, à assembler et organiser tout ce que nous avons collectionné d’histoire personnelle, de savoir-faire, de savoir et de sagesse au cours de notre existence. Tous les détails, même infimes, que nous pouvons noter nous renverront une image de nous plus fidèle que celle que nous contemplons dans le miroir ; ils nous amèneront à considérer la vie dans une perspective nouvelle. Puis quelque chose de magique se mettra en œuvre : nous commencerons à vivre de manière plus intense, plus riche, plus personnelle. Le pouvoir révélateur des listes est immense."
Dominique Loreau donne un exemple :
"Si la plupart des personnes que vous fréquentez sont des artistes, par exemple, n’est-ce pas que vous avez vous-même, au fond de vous, une âme d’artiste ? Pourquoi ne pas vous engager dans une activité artistique ? Qui sait, c’est peut-être là votre véritable vocation, même si vous n’en avez jamais pris conscience auparavant…"
Chapitre 10 - Monographie de mon moi
10.1 - Mes moi, un être unique
Nos multiples facettes et contradictions internes peuvent ralentir notre progression, souligne Dominique Loreau .
C’est donc en dressant un éventail exhaustif de tous ces "moi" qui nous composent, que nous prendrons mieux conscience de leur existence pour mieux les réconcilier et développer un "moi" global capable de les contenir.
Des questions précises sur nos préférences, notre passé, nos rêves, notre éthique... révèlent notre identité profonde. Cet autoportrait doit être le plus complet possible, incluant l'irrationnel, pour faire émerger qui nous sommes vraiment.
Ainsi, pour nous aider, cette partie de "L’art des listes" partage de multiples idées de listes comme : celle de ce que nous aimons faire, de notre héritage familial et culturel, notre tempérament, notre éducation, nos aspirations, les personnes que nous aimerions être, celles qui nous ont influencé, les endroits où nous aimerions vivre, où nous avons vécu, notre CV, etc ...
10.2 - Mes goûts
Nombre de personnes ignorent leurs véritables goûts. Nos achats compulsifs reflètent bien cette méconnaissance de soi.
Pourtant, choisir en sachant exactement ce qu'on aime rend la vie plus belle. Connaître sa couleur préférée, par exemple, et l'intégrer à son quotidien favorise l'harmonie intérieure et la réussite.
C’est pourquoi, pour l'auteure, certaines listes sont importantes. Elle en propose ici en les appelant "listes de ces choses qui sont moi"". On y retrouve, parmi tant d’autres choses, les contextes, styles, conversations, personnes, vêtements... dans lesquels nous nous sentons vraiment nous-même.
10.3 - Ce que je ne voudrais jamais faire ou refaire
Savoir ce que nous n’aimons pas est tout aussi important que ce que nous aimons, affirme Dominique Loreau.
Ainsi, lister les choses que nous ne voudrions plus refaire est un bon exercice. Car nous les faisons souvent par habitude, et cette liste nous aidera alors à changer nos comportements. Éliminer même qu’une petite partie de ces choses nous apportera plus de bonheur dans notre vie.
Autre idée : nous pouvons aussi confronter ce qu'on regrette d'avoir fait et comment on agirait aujourd'hui, tirant ainsi les leçons de nos erreurs.
10.4 - Les "pas japonais"
"Imaginez, dans un jardin parfaitement obscur, un chemin de pierres fluorescentes, de ces gros galets appelés "pas japonais", sur lesquels on marche pour ne pas se salir les pieds. Imaginez que ces "pas japonais" représentent différentes étapes de votre vie", écrit l’auteure.
C’est le concept décrit par Ira Progoff dans son livre "Intensive Journal". Celle-ci y recommande alors, de représenter les évènements principaux/ étapes clés de notre parcours de vie par une douzaine de "pas japonais".
Pour l’auteure, cette chronologie révèle la cohérence, la corrélation entre des événements en apparence disparates. De cette façon, nous percevrons mieux la progression de notre vie. Par exemple : petite enfance, accident de moto, premier grand amour, mariage, divorce…
Il est aussi possible de décliner ces "pas" par domaines : amours, carrière, succès...
Enfin, visualiser nos prochains "pas" aide aussi à nous projeter dans un futur réaliste et motivant.
10.5 - Mes listes portraits
Lister les qualités qu'on admire chez quelqu'un met en lumière ce qu'on voudrait être, affirme ici Dominique Loreau. Et nos choix relationnels reflètent souvent divers aspects de nous-mêmes. Ainsi, faire le portrait de personnes qui nous fascinent et en notant ce qui nous intrigue chez elles peut faire "entrer ces qualités dans notre désir conscient de les acquérir". En faire le portrait d'êtres chers, en notant ce qu'ils nous ont apporté révèle comment chacun a façonné notre regard.
Pour cela, voici des listes suggérées par l’auteure : nos meilleurs amis, nos amis d’adolescence, les amours de notre vie, nos professeurs préférés, les membres de notre famille avec qui nous sommes le plus attachés, des inconnus avec qui nous avons eu un contact profond même que quelques heures ou minutes, les personnages de fiction qui nous ont marqué, les personnes qui nous ont influencé par leur personnalité.
10.6 - Mes listes archétypes
Pour l’auteure de "L’art des listes", les archétypes sont de puissants guides. Et reconnaître ceux qui sommeillent en nous permet de vivre pleinement notre vraie nature. C’est pourquoi, il est intéressant, nous dit Dominique Loreau, de lister nos héros d'enfance, les personnages qui ont marqué notre vie, nos idoles, nos films et romans préférés, nos scénarios de vie idéale, ce que pensent mes archétypes…
Ces listes montrent comment ces symboles nous ont construits, inspirés, transformés.
10.7 - Autres listes pour mieux se connaître
Mes rêves et mes cauchemars : noter le contenu de nos rêves, et imaginer une fin positive aux cauchemars, ordonne ce chaos nocturne et transforme ces énergies en création poétique, indique l’auteure.
Mes désirs et mes rêves les plus fous : lister ses désirs les plus fous, lâcher la bride de la raison, inviter tous ses "moi", même les plus enfouis, à s'exprimer, voilà le meilleur moyen de découvrir qui on est vraiment. Ces rêves irrationnels sont le moteur de notre élan vital, confie l’auteure.
Mon moi et le monde de l'irrationnel : consigner les coïncidences, prémonitions, phénomènes étranges dont on est témoin, etc. ajoute une dimension fascinante à notre identité.
Dominique Loreau termine en soulignant que certaines listes peuvent avoir, écrit-elle, des retombées magiques. En effet, selon elle, notre inconscient se mobilise pour réaliser ce qui est couché sur le papier. Ainsi, mettre nos rêves par écrit, croire aux mystères, peut avoir un véritable pouvoir créateur
Chapitre 11 - Sur le chemin des temps
11.1 - Parler de ses souvenirs pour ne pas les perdre
La mémoire ordonne nos pensées et nous relie à notre environnement. Ainsi, faire des listes de nos souvenirs, les rechercher quand ils ont été oubliés, se rappeler de petites choses, d’un nom, d’une date, selon Dominique Loreau, renforce cette faculté tel un muscle qu'on exerce. Plus on entretient son savoir, plus on assimile de nouvelles connaissances. D’ailleurs, en cela, le simple fait de faire des listes, quelle qu’elle soit, est bénéfique.
Par ailleurs, poursuit l’auteure, échanger sur son passé est essentiel pour ne pas laisser mourir une partie de soi. Les listes ravivent les souvenirs à la manière d'un film qu'on peut visionner à son gré. Et "nous laissent le choix de "revisionner" ces souvenirs tels que nous le souhaitons à des moments divers de notre vie".
11.2 - Des souvenirs sous forme de listes, analogies et regroupements
Enfin, Dominique Loreau explique qu’en associant noms et personnes à nos souvenirs, des liens inconscients se révèlent. En effet, notre mémoire n'est pas linéaire mais fonctionne par regroupements.
"Des personnes connues dans mon enfance, comme la voisine Mme Légaret, ou la tante Louise, Huguette, puis, plus tard, la lecture des Papiers de Henry Rye de George Gissing me firent réaliser mon amour des petits intérieurs soignés, tranquilles, où tout est à sa place, minutieusement et méthodiquement rangé, nettoyé, respecté. D’où mon attirance pour ce type de vie frugale, simple, sans questionnements métaphysiques, mais néanmoins paisible et "zen". Tant d’éléments de notre enfance et de nos expériences sont les faits déclenchants de notre vie actuelle, de nos tendances, de notre manière de penser…"
Pour cette raison, mieux vaut donc noter un thème central et le développer en ramifications puis en liste, plutôt que de faire de longues descriptions.
"Si vous décrivez un repas en disant : "En entrée, il y avait des fruits excellents venant directement de la mer, puis un rôti accompagné de petits légumes du jardin préparé par grand-tante, ensuite…", la personne qui écoute cette description n’aura pas une idée aussi claire du menu que si vous lui dites simplement : "fruits de mer, rôti pommes de terre, salade, fromage et tarte au citron". Quatre-vingt-dix pour cent des mots sont inutiles à la mémorisation et s’immiscent de plusieurs secondes entre les mots clés qu’ils isolent, affaiblissant ainsi notre faculté de faire la connexion entre les idées pour les associer les unes aux autres."
11.3 - Je me souviens, de Georges Perec
Dans un ouvrage intitulé "Je me souviens", Georges Perec liste 480 minuscules souvenirs d'une génération, fragments du quotidien oubliés qui soudain ressurgissent et suscitent une douce nostalgie. Les listes prouvent que "nulle vie n'est vaine" et peuvent transmettre un peu de lumière aux générations futures.
Partie 3 – Les listes pour… prendre soin de soi
Chapitre 12 - Les listes, de merveilleux outils d’autoanalyse
12.1 - Écrire pour corriger sa propre myopie
L'écriture connecte à soi-même. Elle permet alors de s'approfondir, de détecter ses défauts et manques, commence par nous dire Dominique Loreau. Elle aide à sortir de sa myopie et paresse intellectuelle pour prendre conscience de ce qui se passe en soi et autour de soi.
12.2 - Écrire, c'est réfléchir deux fois
L’auteure de "L’art des listes" développe ces idées principales :
Prendre des notes de nos lectures permet de faire siennes les idées qui nous ont marqué : "elles vous resteront en profondeur, bien plus que si vous vous étiez contenté de reposer le livre après sa lecture. Cette prise de notes vous obligera à vous poser, à prendre le temps de réfléchir", observe l’auteure.
Réorganiser ses écrits sous forme de listes en fait d’excellents objets d'analyse, un feedback de notre identité et ainsi un premier pas vers le changement :
"Supports hybrides de nos pensées où s’accumulent, au fil du temps, sentiments, réflexions, notes, notations, ébauches de projets, poésies…, nos écrits emmagasinent une réserve de matériaux mobiles et provisoires, et constituent, bien qu’incomplets et lacunaires, toute une panoplie de "brouillons de soi". Si vous reprenez ces "brouillons" et que vous les réorganisez sous forme de listes (liste de mes peurs, de mes colères, de mes responsabilités…), ils deviendront de véritables objets d’analyse.
Vous rassemblerez, emmagasinerez des informations plus faciles à analyser qu’un texte en écriture libre, au fil de vos pensées. Vous ferez l’acte d’organiser concrètement votre mental, de prendre conscience de votre propre identité, et, en vous voyant sur le papier, vous prendrez du recul. C’est alors que vous pourrez commencer à changer pour éviter de retomber, une fois de plus, dans les mêmes erreurs destructrices. Le feedback aura fait son effet."
12.3 - Écrire pour se fixer des repères
Faire le bilan écrit de sa vie donne une vision panoramique qui révèle comment nous en avons été l'auteur, au-delà du hasard.
Dans un monde qui cherche à nous formater, écrire permet ainsi de se reconnecter à soi et de rester centré malgré les circonstances extérieures.
Ces notes deviennent une bible personnelle, reflet de notre univers intérieur, base de notre équilibre.
12.4 - Écrire pour se prendre en charge
L’auteure explique ici que faire le bilan de sa vie rend plus responsable, plus adulte. Cela nous incite à trouver en nous les ressources pour résoudre nos problèmes. Un réajustement constant des priorités fait partie intégrante de l'existence.
"Écrire, se poser, s’imposer un travail de réflexion, et toujours avoir présent à l’esprit que ce n’est qu’en faisant un effort sur soi que l’on obtient davantage de paix intérieure et de joie de vivre, voilà ce dont nous avons besoin. C’est par soi que l’on peut et que l’on doit trouver son propre équilibre et donc sa santé, se prendre en main et apprendre comment utiliser les ressources qui sont déjà là, en nous. (…) Écrire est un des meilleurs moyens pour chercher à résoudre ses problèmes par soi-même."
Pour illustrer ses propos, Dominique Loreau partage des idées de listes :
"Mes responsabilités" : ce dont je suis/ je ne suis pas responsable dans la vie, ce pour quoi je choisis de dégager ma responsabilité.
"Mes fardeaux" : ce dont je peux me passer pour me sentir plus vivant, plus léger, ce que je transporte sans cesse dans ma tête, dans mon cœur…
12.5 - Écrire pour mieux énoncer les choses
Autre bénéfice du fait d’écrire, encore plus particulièrement des listes : les listes forcent à définir et clarifier, à nommer les choses pour mieux les posséder. Même l'indicible peut être approché : "On ne peut plus se mentir, se cacher les choses telles qu’elles sont, en les enrobant d’interprétations".
12.6 - Écrire pour être lucide
En étant précis avec soi-même, on génère plus de lumière intérieure, observe enfin l’auteure. Clarifier son passé libère de sa tyrannie et permet de mieux construire son avenir (à condition toutefois d'être parfaitement honnête).
Des listes à deux colonnes du type "faits et ressentis", "pour ou contre" sont pour cela intéressantes, comme les listes "Lucidités" : nos manques et limites, nos peurs, appréhensions, images qui nous reviennent régulièrement en tête, "je ne suis pas prêt mais un jour, je…", "si cela n’était pas trop dangereux, je dirais que…", etc.
Ainsi, "mettre les faits sur le papier, noir sur blanc, c’est comme tendre une torche dans le gris de son flou mental".
Chapitre 13 - Ne plus être victime de ses émotions
13.1 - Dresser l'inventaire de nos émotions
Les émotions négatives (peurs, frustrations, colères, angoisses) sont des énergies mentales pouvant être dominées si on les identifie, note l’auteure. Pour cela, continue-t-elle, acceptons alors de prendre conscience de nos ressentiments, jalousies, énervements... sans chercher à les anéantir.
Pour Dominique Loreau, lister ce qui nous rend trop émotif et nous fatigue (certaines relations, conflit, alcool, parler de soi, essayer de changer les autres, ou des choses sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle, manque de sommeil...) apaise et détache. Une fois listées, voir ces émotions comme de simples énergies dissipe leur emprise.
Sur le même sujet, il est intéressant de lister aussi : ce qui nous cause le plus du souci, nous dérange et ce que cela provoque en nous, les émotions qui contrôlent notre vie, les solutions idéales ou compensatoires.
13.2 - Le bilan de nos pensées
Selon Tristine Rainer, célèbre thérapeute de l’écriture, auteure du livre "The New Diary", écrire librement ses peurs et chagrins permet un rééquilibrage émotionnel.
Julia Cameron, auteure du livre "Libérez votre créativité" conseille, elle, d’écrire 3 pages tous les matins pour "purger et purifier notre ego de ses pollutions inconscientes".
Pour Dominique Loreau, synthétiser et métaboliser ensuite en liste les idées qui apparaissent dans ces écrits va clarifier le fonctionnement de notre mental et révéler nos schémas.
Nous pourrons alors dresser la liste claire des pensées qui nous traversent l’esprit dans la journée, avant le sommeil, lors de nos insomnies, lorsque nous sommes en colère, frustré ou angoissé, ou au contraire au meilleur de nous-même, ou dans des endroits que nous aimons particulièrement.
13.3 - Écrire, exutoire du trop-plein émotionnel
"Les listes sont un moyen idéal de "vider son sac", comme d’autres le font sur le divan, de regrouper le multiple sous un tout, de combiner, d’accumuler les informations, indices, détails, pour prendre conscience et évoluer, c’est-à-dire se vider du superflu, jusqu’à ce qu’il ne reste que l’essentiel : savoir surfer sur les vagues de la vie, non seulement sans se noyer, mais en y trouvant équilibre et plaisir."
Ainsi, écrire délivre de ce qui fait mal, sans déverser sur l'entourage. Consigner ses angoisses, lister les émotions qui nous contrôlent, dont nous sommes le plus souvent victime ou encore les personnes et évènements qui nous ont fait du mal par exemple, permet de s'en vider. Car en observant les émotions incontrôlables, nous nous en détachons. Et moins d'attachement émotionnel signifie plus de solutions.
13.4 - Quant à l'amour...
Revivre son histoire affective par écrit aide à comprendre ce qui nous a construits, soutient l’auteure. Plutôt que ruminer, dialoguons avec nous-mêmes. Pour cela, listons ce que la relation nous a appris. Ou réalisons ce que Dominique Loreau appelle une "déclaration d'indépendance" afin d’affirmer nos limites : nous y noterons exactement ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas dans une relation amoureuse.
"L’art des listes" suggère aussi de lister notamment : les raisons pour laquelle nous avons aimé des amours de notre vie, et pourquoi nous nous sommes quittés, les situations problématiques jamais résolues, les enseignements de ces expériences, les non-dits…
Si nous ne pouvons détacher notre pensée d’une personne, notons nos pensées pour les maîtriser et nous recentrer, un peu comme une lettre non envoyée. Lister les insatisfactions aide à retrouver nos valeurs, à clarifier nos attentes.
Enfin, l’auteure nous encourage à bannir un vocabulaire victimaire. Nous avons le choix de nos émotions. Tenons la liste détaillée de ce qui nous rebute chez l'autre pour tenir bon dans une séparation. Externalisés, les griefs perdent leur emprise, tel un mal nommé par le médecin, donc plus traitable.
Chapitre 14 – Quand rien ne va plus dans votre vie
14.1 - Des mots sur nos maux
Écrire et lister ce qui nous stresse ou nous irrite a un effet apaisant immédiat. Car une fois posé sur le papier, le problème perd de son emprise, indique Dominique Loreau.
"Une fois le carnet refermé, le problème est loin, emprisonné, nommé, donc plus facile à cerner. Il perd alors de son intérêt. Couchez les colères ou les raisons de votre stress sur le papier : elles n’auront plus d’emprise sur vous. Se décharger ainsi est le meilleur des somnifères. Essayez !..."
Les listes sont plus faciles pour ceux qui se sentent bloqué pour écrire. Ainsi :
"En faisant la liste de tous les sujets importants sur une page, on peut les "épingler" un à un et se concentrer sur ce qui nous tracasse le plus."
Sinon, il existe aussi une liste idéale en cas de colère ou de stress, celle dite "Baumes à l’âme" : on peut y mettre, par exemple, passer la nuit dans un petit hôtel, aller chez le coiffeur ou la manucure, marcher, prendre un bain parfumé à la rose, boire un gin, jeter tout ce qui est moche et inutile…
Autres listes à faire comme précieux outils de relaxation : les listes dites "Corbeille" : ce qui nous met en colère, ce que nous dirions à la personne qui nous fait du mal en ce moment, nos insultes préférées, nos revanches, rancunes, colères datées, ce qui nous calme, etc.
14.2 - Noter nos peurs et nos angoisses pour nous en éloigner
Trois points sont ici développés :
Noter ses peurs, même anodines, révèle qu'elles sont moins effrayantes une fois couchées sur le papier.
En parallèle, lister des solutions positives, même à posteriori, permet de les dompter.
Pour les angoisses, plus diffuses, décrire les sensations éprouvées et le contexte aide à mieux les cerner.
D’autres listes comme celles à relire quand nous nous sentons angoissé sont aussi suggérées.
14.3 - Dans les moments de vague à l'âme...
Rien n'est permanent ni inutile, chaque épreuve perfectionne, affirme ici Dominique Loreau.
Si pour certains, les listes figent trop la réalité, reste qu’elles servent aussi de repères concrets quand un "support abstrait ne suffit pas". Dans ces moments souvent cafardeux, nos listes nous ramènent à la réalité. Elles nous rappellent, par la même occasion, que la grisaille n'est que passagère.
Lister ce qui doit être fait puis accomplir une tâche à sa portée aide à se remettre en mouvement, à se reconnecter au flux de la vie. Feuilleter son "trésor" de moments heureux et de projets est aussi un excellent stimulant :
"Toutes ces accumulations de moments merveilleux déjà vécus, de choses aimées passées et présentes, de projets apparemment impossibles aujourd’hui mais qui se réaliseront probablement un jour à condition que… vous les notiez noir sur blanc, sont autant d’étincelles éphémères de secours, pareilles à celles qui jaillissent lorsque l’on veut remettre en marche une batterie déchargée."
C'est, en somme, une véritable "pharmacopée psychologique de secours" écrit l’auteure.
Cette partie se termine par une suggestion de listes "anti-vague à l’âme" : liste de choses douces, choses ou personnes qui me procurent de l’énergie, des projets pour le futur (voyages, vacances,, changement de situation…), des activités qui m’aident à aller mieux…
14.4 - Le principe des opposés
Comme à toute pensée correspond un opposé, toute dépression contient son antidote.
Selon l’auteure, le type de liste qu’elle appelle "Principe des opposés" (ce qu'on aime/déteste, nos meilleurs/pires souvenirs, personnes qui m’aiment/qui ne m’aiment pas, ce qui m’amuse/ce qui m’ennuie...) rappelle cet équilibre. Et nous aide quand la vie nous semble fade : se demander ce qui nous ennuie et ce qu'on désire vraiment,par exemple, éclaire la voie à suivre, comme le fit l'écrivaine Katherine Mansfield dans son journal.
14.5 - Faire le deuil de certaines choses
Pour Dominique Loreau, vivre, c'est choisir entre immobilisme et renouveau permanent.
Regarder lucidement ses rêves pour ne garder que les plus constructifs est douloureux mais libérateur. Lister ses attachements aide alors à y renoncer. Et ce, qu’il s’agisse d’idées, de dépendances ou d’un être cher disparu. Tout comme le fait de consigner ce qu'on aimerait dire au défunt et imaginer ses réponses réconforte.
14.6 - Donner un sens à nos souffrances
Répertorier les épreuves déjà endurées constitue, selon l’auteure de "L'art des listes" un trésor de sagesse qui donne du sens aux souffrances présentes. Chaque défi relevé renforce le courage d'affronter l'avenir. Et pour l’auteure, plus la qualité d'expression de ces listes sera belle, plus elle sublimera la douleur et nous réconciliera avec nous-même.
Nous pouvons alors lister : les difficultés que nous avons surmontées, nos souffrances et ce qu’elles nous ont appris, nos actes de courage, tout ce qui peut apaiser ma douleur (poèmes, mots, musiques, paysages…), mes deuils.
14.7 - S'aimer, se respecter, se valoriser
Nos listes rappellent notre unicité et notre potentiel quand le monde extérieur nous compresse.
Un "Manifeste de soi" listant qualités, talents, fiertés et promesses à soi-même renforce l'estime personnelle. Comptabiliser chaque succès, même infime, attire la réussite. Cultiver sa singularité, simplement "être" sans "avoir", voilà la clé de l'épanouissement.
14.8 - Rire
L’auteure rappelle ici que l'humour est essentiel : il dédramatise, allège, guérit. Rire libère des soucis, détend, préserve la jeunesse, explique-t-elle.
Ainsi, lister blagues, films, situations comiques et les personnes avec lesquelles nous rions le mieux, insuffle plus de légèreté dans notre quotidien.
Chapitre 15 - Prendre conscience de ses pensées
15.1 - Ce sont nos pensées qui font la qualité de notre vie
Pour Dominique Loreau, observer, dans un lieu public, ses jugements et émotions face aux inconnus révèle l'impact de nos pensées parasites sur nos actes.
Et chacune de ces pensées génère une subtile réaction émotionnelle qui altère notre vécu. Selon l’auteure, lister ces pensées aide alors à s'en libérer. Par exemple : dans un café, lister les personnes que je regarde et dans une colonne en face, noter ce que chacune d’entre elles m’inspire.
15.2 - Rejetez les pensées négatives
Dans son célèbre livre "Transformez votre vie", Louise Hay préconise de toujours aller vers ce qui est positif.
Car selon elle, les mots que nous nous répétons deviennent réalité. En somme, l'attention nourrit nos pensées pour qu'elles se concrétisent.
Aussi, plutôt que de nous poser en victime, nous devrions voir nos erreurs comme des leçons pour mieux vivre demain, et pour chasser la négativité, dresser des listes d'énoncés positifs, de choses agréables dans notre esprit, d'activités, de personnes ou encore d’endroits gais.
15.3 - Comment nous entraîner à stopper le flux de nos pensées
Notre esprit est un outil dont nous sommes maîtres, pas esclaves, rappelle Dominique Loreau.
En notant brièvement chaque pensée comme un caillou jeté dans l'eau, puis en écoutant le silence avant la suivante, nous nous entraînons à contrôler leur flux incessant et épuisant.
15.4 - Concentrons-nous sur les solutions, pas sur les problèmes
Nos convictions profondes façonnent notre réalité. Dès lors, en nourrissant des images positives, nous attirerons des circonstances heureuses, affirme l’auteure. Pour cette raison, cette dernière nous encourage aussi à focaliser sur les solutions, et non pas sur les problèmes.
Renforcer nos attitudes positives par des listes peut alors passer par le fait de nous fixer des buts concrets ou des plans d’avenir.
15.5 - En choisissant nos mots, nous choisissons les termes de notre bonheur
En retranscrivant nos moments de bonheur sur papier, nous recréons la réalité selon notre perception et nos valeurs.
Nous approprier les idées d'autres qui trouvent écho en nous forge aussi notre vision du monde.
En fait, pour l’auteure, le simple fait de mettre des mots justes sur nos ressentis est un trésor. C’est un art qui s'apprend très satisfaisant.
Chapitre 16 - Nous sommes les partisans de notre propre vie
16.1 - Comment se constituer une liste de "Questions phares" ?
Pour Dominique Loreau, faire des listes renforce notre identité et nous rend acteurs de notre vie. Plus que les réponses, ce sont les questions qui importent. Issues de lectures inspirantes, elles deviennent des sujets d'introspection pour donner du sens à notre existence.
Selon elle, il est bon, par exemple, de lister nos rôles, valeurs, influences, principes, injustices révoltantes ou raisons de vivre. Ces listes éclairent notre cheminement.
16.2 - Pour que les choses changent, il faut d'abord les visualiser
Planifier sa vie comme un voyage en listant ambitions, rêves et convictions permet d'atteindre ses sommets, déclare Dominique Loreau. Notamment, parce que selon elle noter précisément ce qu'on veut nous amène à le visualiser, et attire les situations pour s'accomplir.
Cela peut passer par différentes listes : livres à lire, musiciens à découvrir, œuvres d’art à voir, pays à visiter, hobbies à maitriser, endroits où vivre, comment nous nous voyons dans 5, 10 ou 20 ans.
Chapitre 17 – Faire des listes pour évoluer
17.1 - Le sens c’est d’abord une direction
L'évolution exige de se questionner sans cesse pour trouver le sens de sa vie. Cette quête solitaire vise à créer l'harmonie en soi par ses choix. Visualiser son but et le chemin pour l'atteindre donne force et clarté. Des listes de réflexions guident ce cheminement vers un moi profond, nous ancrant dans une direction plutôt que prisonniers du passé ou de l'avenir. Agir selon sa conscience, voilà l'essentiel.
17.2 - Quelle contribution puis-je apporter au monde
Que garderons-nous au seuil de la mort : nos biens ou nos relations, notre honnêteté, notre contribution à la vie des autres ? Lister les travers de notre système nous incite à consommer différemment. Il existe mille façons d'apporter sa pierre à l'édifice d'un monde meilleur.
17.3 - Le bonheur vient à ceux qui sont prêts à le recevoir
Le vrai bonheur est spirituel, au-delà du confort matériel. Il naît de l'harmonie avec notre part la plus élevée. Plutôt que des listes moralisatrices, décrivons nos désirs et joies pour nous enseigner le bonheur. Le pratiquer, s'en souvenir, en parler, contrôler ses envies nous en rapproche. Relire ses listes de petits plaisirs éveille notre conscience.
17.4 - La mort
Tabou mais omniprésente, la mort donne son sens à la vie. L'accepter comme naturelle, se poser des questions existentielles construit notre philosophie personnelle. Maintenir le fil avec soi, espérer une vie après la mort, tout en se fixant des repères de vie éthiques, voilà l'essentiel.
Partie 4 – Les listes de mes mille et un plaisirs
Chapitre 18 - Imagination et créativité
18.1 - Nous pouvons choisir les couleurs de notre vie
Tout comme Emily Carr qui, à 61 ans, choisit de vivre dans un mobile-home et de faire des listes-journaux poétiques, nous avons, nous aussi, le pouvoir de "peindre le tableau de notre vie".
En dressant l'inventaire de ce que nous désirons voir, écouter, sentir, faire... nous changeons notre perception du monde.
Noter les mille merveilles du quotidien dans des listes (appelées "listes couleurs de ma vie" par l’auteure), crée un réservoir de bonheur et aiguise notre sensibilité créatrice. Finalement, comme les artistes, chacun peut, avec de simples mots, devenir l'auteur de son existence, écrit Dominique Loreau. On peut décrire, par exemple, les charmes des saisons, des étapes de la vie, des modes de vie que nous aimerions expérimenter, des petites choses qu’on aime à l’endroit où nous vivons…
18.2 - Les listes "Évasion et imagination"
"Les listes des autres font toujours rêver. Elles nous stimulent, nous inspirent". Elles nous font rêver et, en nous faisant devenir un autre, nous amènent à devenir encore plus nous-même, s’étonne l’auteure.
Les listes des autres nous poussent alors à explorer nos propres rêves. Nous entrons dans une zone de créativité infinie. Le monde s'efface, on voyage au-delà des frontières du quotidien.
Écrire ces folies, ces vies rêvées, ces routines fantasmées ouvre des portes. Créer, c'est jouer. Une idée peut devenir projet de vie ou œuvre d'art. L'auteure cite l'exemple inspirant de la liste d'effets personnels du voyageur-écrivain William Least Heat-Moon lors de son périple en van. De quoi nous donner envie de lister ce qu'on emporterait pour un tour du monde !
18.3 - Des listes de "Petits riens"
Sur le modèle du livre "Les Miscellanées de Mr Schott", merveilleuse collection de petits riens essentiels, l'auteure nous invite à recenser mille sujets amusants et excentriques. Du nom des thés oolong aux scènes de films romantiques sous la neige new-yorkaise, en passant par les nuances de gris ou ce qu'on ferait en étant invisible... Juste pour le plaisir !
18.4 - Des listes pour embellir sa vie : découvrir sa propre esthétique
Nous avons tous le pouvoir d'embellir notre vie en affinant notre sens esthétique. Les listes nous forment à l'écoute des détails du monde. Qu'on se promène en voiture, à vélo ou à pied, qu'on explore sa ville ou un village, l'essentiel est de se laisser submerger par le flot d'images. Lister ses "coups de cœur" (un film, un biscuit, un nom de rue...) avec des détails concrets contribue à façonner une vie à son image. L'élégance se cherche dans cette quête de la beauté pure et harmonieuse.
18.5 - Instants uniques
Chaque instant recèle une parcelle d'éternité, pour peu qu'on lui accorde de l'attention. Le luxe des émotions raffinées se cultive. L'auteure suggère de lister les activités d'une journée idéale, d'y glisser des rituels, des plaisirs simples qui cassent la routine. Tenir un agenda de sorties, des carnets de voyages ou de vacances immortalise ces moments uniques.
18.6 - Les plaisirs de la lecture
Dans cette partie du livre "L'art des listes", Dominique Loreau partage sa propre liste de plaisirs de lecture : lire un livre avec son amoureux, découvrir qu'on peut aussi lire à l'envers, recopier des citations savoureuses, attendre avant de tourner la dernière page... Puis elle dévoile des extraits de sa bibliographie intime, chaque livre étant associé à un lieu et un souvenir.
Selon elle, lire est un voyage qui nous transforme. Prendre des notes de lecture est donc indissociable de la lecture, pour réviser ce qu'on a ressenti avec nos propres mots. Relire les livres qui ont compté est aussi une très bonne idée.
18.7 - La culture
Comme pour la lecture, se constituer une liste de films vus, d'expos visitées, de pièces de théâtre... permet de retenir artistes et créations marquantes. Les impressions couchées sur le papier valent mieux qu'un tas de tickets d'entrée qui s'empilent.
18.8 - Les listes sous forme de haïkus
À la manière des haïkus composés d'une seule phrase, l'auteure nous encourage à transcrire nos expériences en phrases-listes. Car pour elle, tout est source de poésie.
Elle nous suggère de nous entraîner à exprimer beaucoup en peu de mots, par associations d'idées et descriptions de détails. Elle illustre avec ses "Esquisses du Japon", de délicats instantanés de vie.
18.9 - Les recettes du bonheur
Pour les Chinois, le but de la vie est simple : c’est le plaisir, dans ses dimensions matérielles et spirituelles.
Faire l'inventaire de moments choisis peut résumer une vie heureuse. Ces petits riens savourés - un éclat de rire, un beau rêve... - rappellent que même en temps difficiles, chaque instant recèle une étincelle positive. Relire ces listes de petits bonheurs enseigne à son moi futur comment être heureux. De vraies recettes de joie à portée de main !
Chapitre 19 - Le plaisir des sens
19.1 - Mettons-nous véritablement nos sens à profit ?
Avant même la pensée, ce sont les sens qui nous relient au monde. Les affiner, les aiguiser apporte plus de vie, signale l’auteure. Nommer précisément ses sensations est la clé de leur qualité. Notre corps filtre l'univers, sa quête sensorielle méticuleuse mérite d'être célébrée en listes.
19.2 - Le visuel : couleurs, formes, volumes, lumières...
Regarder s'apprend. Un vocabulaire chromatique étendu, comme les 110 mots des teinturiers japonais pour le noir, élargit notre palette visuelle. Lister ce qu'on aime contempler, les nuances de couleurs, d'ombres et de formes affine notre perception.
19.3 - L'olfactif
Plus que les images, les odeurs ravivent instantanément des souvenirs enfouis. Sensuelles ou thérapeutiques, elles influencent notre humeur. Enrichir son odorat par des listes olfactives est une clé du bonheur.
19.4 - Le goût
Déguster lentement révèle les saveurs. Plus on a de mots pour les décrire, plus on les apprécie, telle la framboise d'un champagne. Chaque nouveau plaisir gustatif nous métamorphose.
19.5 - Le toucher, le sentir
Toucher nous connecte au monde, il exprime nos émotions. La conscience de soi passe par ce contact tactile vital, à affiner en le listant.
19.6 - Les sons
La pollution sonore agresse notre système nerveux. Prêter attention aux sons néfastes ou bénéfiques, en dresser l'inventaire, améliore notre environnement et notre qualité de vie.
19.7 - Se nourrir de musique
Vecteur puissant d'émotions profondes, la musique structure notre esprit. Son plaisir charnel caresse le corps et monte à l'âme. Composer des listes de morceaux adaptées à nos humeurs et activités décuple son pouvoir.
19.8 - Les listes de conjugaisons des sens
C'est de l'addition des sens que naît la vie. S'amuser à lister des "trios plaisir" - massage, encens, musique douce... - parfait nos petits bonheurs.
19.9 - Le plaisir de se relire
Nos listes sensorielles et réflexives sont notre trésor. Les relire à distance, comme un atlas intime, procure une joie inégalée.
Partie 5 – Les listes, mode d’emploi
Chapitre 20 - Les listes et leurs supports
20.1 - Le carnet, notre compagnon le plus intime
"Le carnet, assemblage d’images mentales, de gribouillages, de textes personnels, chipés ou copiés, de rêves, de recherche, de notes de voyage… est notre compagnon le plus intime" commence Dominique Loreau.
Il nous permet d’y noter nos idées fulgurantes. Attention alors, de toujours l'avoir sur soi et d’être discipliné.
Réceptacle de notre personnalité, le carnet peut constituer une véritable passion et devenir un véritable objet fétiche qu'on aime voir s'user, se patiner, se remplir. Il peut aussi représenter une extension de soi, "une partie de soi sans laquelle on se sent vide", poursuit l’auteure. Enfin, le carnet met en lumière le plaisir charnel de l’écriture selon un rituel qui passe par le papier, le stylo, l’encre...
Plusieurs conseils sont prodigués par l’auteure à ce sujet, comme par exemple : soigner sa présentation pour garder l’envie de poursuivre, éviter les ratures, tenir un carnet unique pour chaque type de listes afin de renforcer leur cohérence.
20.2 - Quel support choisir pour ses listes ?
L'essentiel, pour l’auteure, est d'opter pour un support extensible où regrouper ses listes par thème. Dès lors, les cahiers sont à proscrire.
L'idéal : un petit organizer de poche pour noter à la volée, et un carnet à anneaux ou ordinateur pour une mise au propre ordonnée. Garder une "liste des listes" en début de carnet facilite les recherches. Un classement par grandes catégories puis sous-catégories, avec des lettres plutôt que des chiffres, s'avère très pratique.
En version numérique, Dominique Loreau conseille de créer des dossiers thématiques : vie professionnelle, références à garder, comptes, voyages, codes secrets...
Pour les minimalistes, une simple feuille pliée peut faire office de pense-bête.
Le carnet, à garder toujours à portée de main, sert de confident en toute occasion. Le mettre à jour régulièrement procure une sérénité incomparable. Les passages intimes sont à protéger des regards.
Chapitre 21 - Comment faire ses listes
21.1 - Comment commencer ?
Le plus dur est de structurer ses listes, prévient l’auteure.
Pour rendre la tâche plus facile, nous pouvons partir de là où on en est, ou des thèmes que nous trouvons les plus inspirants. Chaque événement (un cadeau reçu par exemple) est prétexte à une nouvelle liste.
Et le classement s'affinera ensuite avec le temps.
21.2 - Les différentes formes de listes
Diverses idées sont ici développées :
Les notes de lecture évitent d'accumuler trop de livres.
Papiers colorés et listes à double colonne facilitent le repérage.
Place à la créativité avec les listes "œuvres d'art" suggérées par l’auteure : dessins, couleurs, formes originales... Nous pouvons aussi les calligraphier, les orner d'enluminures médiévales ou de croquis façon carnets de voyage japonais. Les collages de photos d'auteurs peuvent personnaliser les résumés de lecture.
Certaines listes se composent à plusieurs : un "livre portrait" de couple, une collecte de souvenirs familiaux...
D'autres s'offrent, telles des recettes ou citations sur un joli papier.
Les listes par chiffres (3, 7, 100...) revêtent une dimension symbolique, se référant au sacré.
21.3 - Donner un titre spécifique à chacune de ses listes
Un thème précis indique où noter chaque élément.
Hors sujet, mieux vaut éliminer ou déplacer pour préserver la clarté. Un bon titre conditionne toute la liste.
21.4 - Quand faire ses listes ?
À tout moment ! En s'accordant juste un temps calme pour se remémorer l'essentiel, comme le faisait Anaïs Nin pour son journal.
Dans un café, un embouteillage, une salle d'attente... Quelques notes chaque jour et le trésor s'étoffe.
Chapitre 22 - Quelques livres de listes qui peuvent vous inspirer
En guide de dernier chapitre, Dominique Loreau partage plusieurs listes de livres susceptibles de nous inspirer.
22.1 - Les listes de Jonathan
Un ami new-yorkais de l'auteure a dressé une liste de 10 listes perdues qui lui étaient chères, des noms de chats de Frida Kahlo aux repas partagés avec son amoureuse, en passant par ses trajets à vélo ou sa discographie de jazz. Autant de traces d'une vie riche en souvenirs et en émotions.
22.2 - Le Grand Almanach poétique japonais
Cet ouvrage fondamental recense en 4 volumes plus de 4900 expressions sur les saisons, servant de répertoire poétique. Divisé en 7 parties (saisons, ciel, nature, hommes, fêtes, bestiaire, plantes...), il puise dans le trésor de la sensibilité nippone.
22.3 - Le Dao de jing de Lao-tseu
Traité taoïste composé de sentences sur le "Principe et son action", ce livre est une longue liste de préceptes de vie inspirés de l'observation de la nature, à appliquer à soi et aux autres pour une existence harmonieuse.
22.4 - Notes de Li Yi-chan
Les "listes-répertoires" de ce poète chinois du VIIIe siècle, surnommé "la loutre" pour son goût des références, dressent un miroir éclectique de son époque, des mets rares aux rituels du thé, suggérant richesse ou pauvreté. Elles ont inspiré les listes japonaises médiévales.
22.5 - Sages écrits de jadis
Cette anthologie de maximes, poèmes et proverbes chinois, issue de sources antiques variées, offre un condensé de philosophies complémentaires. Centrées sur la patience et la maîtrise de soi, ces pensées guident l'homme en quête de sagesse au fil de l'existence.
CONCLUSION
En dressant des listes sur tous les aspects de notre vie, nous captons et savourons chaque instant. Telle une respiration ou une pensée, chaque liste crée notre réalité. Noter, voilà la clé pour ne rien laisser échapper et vivre pleinement.
Conclusion de "L'art des listes | Simplifier, organiser, enrichir sa vie" de Dominique Loreau
- Trois idées clés à retenir de "L’art des listes"
Idée n°1 : Les listes, un art de vivre qui donne du sens
Le livre "L'art des listes" de Dominique Loreau nous révèle la richesse insoupçonnée de cette pratique ancestrale que sont les listes. Loin d'être une manie futile, dresser des listes s'avère être un véritable art de vivre qui nous reconnecte à nous-mêmes et à l'essentiel.
En listant nos tâches, nos rêves, nos souvenirs, nos désirs, nous devenons les acteurs de notre vie et lui donnons un sens nouveau.
Idée n°2 : Explorer toutes les facettes de notre vie par les listes
L'auteure explore de façon approfondie toutes les facettes de notre existence qui peuvent être sublimées par les listes. De la simplification de notre quotidien à l'exploration de notre vie intérieure, en passant par le développement de notre créativité et la célébration des petits plaisirs, les listes se révèlent être des alliées inestimables pour vivre mieux et plus intensément.
Chaque chapitre regorge d'idées inspirantes et d'exemples concrets pour nous aider à démarrer notre propre pratique.
Idée n°3 : Les listes, miroir de notre identité et boussole de vie
Au-delà d'un simple mode d'emploi, "L'art des listes" est une véritable invitation à porter un regard neuf sur notre vie. En prenant le temps de coucher sur le papier ce qui compte vraiment pour nous, nous clarifions nos priorités et nos aspirations. Les listes deviennent alors le reflet de ce que nous sommes et de ce que nous voulons devenir. Elles nous aident à cultiver la gratitude, l'émerveillement et la pleine conscience, pour savourer chaque instant et ne rien laisser échapper de ce cadeau précieux qu'est l'existence.
- Ce que vous apportera cette lecture
En refermant ce livre, vous aurez acquis une multitude d'outils concrets et puissants pour métamorphoser votre vie du tout au tout. Que vous souhaitiez gagner en sérénité, en efficacité, en créativité ou simplement en joie de vivre, les listes seront vos précieuses alliées.
Vous apprendrez à utiliser leur pouvoir clarificateur pour faire le tri dans vos pensées, vos émotions et vos objectifs. Vous découvrirez comment elles peuvent réenchanter votre quotidien en attirant votre attention sur les petites merveilles qui vous entourent.
Enfin, vous réaliserez qu'en noircissant ces pages, c'est le livre de votre vie que vous écrivez, celui qui vous ressemble et qui trace votre chemin unique vers l'épanouissement.
- Pourquoi lire "L’art des listes | Simplifier, organiser, enrichir sa vie"
Je recommande la lecture de "L'art des listes" à tous ceux qui aspirent à une vie plus riche, plus consciente et plus authentique.
Avec son ton bienveillant, sa sagesse inspirante et ses conseils accessibles, ce livre est un véritable trésor qui transformera durablement votre rapport à vous-même et à l'existence. Nul doute qu'après l'avoir refermé, vos listes n'auront plus jamais la même saveur et deviendront les témoins enchantés de votre métamorphose intérieure !
Points forts :
Un livre inspirant qui nous révèle la puissance insoupçonnée des listes pour transformer notre vie.
Une multitude d'idées et d'exemples concrets pour démarrer facilement notre propre pratique des listes.
Une exploration approfondie de tous les domaines de notre vie qui peuvent être enrichis par les listes : organisation, créativité, développement personnel...
Une approche bienveillante et accessible qui nous guide pas à pas vers une vie plus épanouie.
Points faibles :
Certains lecteurs très cartésiens pourraient trouver certaines suggestions un peu trop "poétiques" ou abstraites.
À l’heure où nous pouvons établir des playlists sur nos appareils téléphone, internet, TV, lecteurs de musique, réseaux sociaux (exercices physiques, recettes, musique, vidéos, films, chaines TV, photos…), certaines idées peuvent paraitre obsolètes. Encore faut-il s’être mis à la page de toute cette technologie. Car dans ce cas les listes resteront appréciées.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu "L’art des listes | Simplifier, organiser, enrichir sa vie" ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Dominique Loreau " L’art des listes | Simplifier, organiser, enrichir sa vie"
Visitez Amazon afin d'acheter le livre de Dominique Loreau "L’art des listes | Simplifier, organiser, enrichir sa vie"
 ]]>
]]>Résumé de "Comment réussir une négociation" de Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton : un classique absolu de la littérature sur la négociation (politique, business, famille) vendu à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde — une approche simple et pragmatique qui fait l'unanimité (ou presque) depuis 1981 !
Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton (pour les nouvelles éditions), 267 pages, 2002.
Titre original : Getting to Yes (1981).
Chronique et résumé de « Comment réussir une négociation » de Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton :
Partie I. Le différend
1 — Pas de négociations sur des positions
Pour les auteurs, une négociation réussie est une négociation qui aboutit à un accord :
Judicieux ;
Efficace ;
Qui ne compromet pas les relations existantes.
Or, la façon dont nous négocions habituellement répond rarement à ces trois exigences. Souvent, en effet, nous négocions « à la dure » en partant de positions déterminées, puis en allant vers le compromis.
C’est comme cela, par exemple, que nous marchandons dans une brocante (un exemple pris par les auteurs, p. 31-32). Parfois, cela fonctionne. Mais pas toujours. Et pas souvent de la meilleure manière possible.
Étudions les failles de cette « négociation sur des positions » un peu plus en détail.
La discussion sur des positions ne permet pas d’aboutir à un accord judicieux
Premier point : l’accord judicieux est difficile à atteindre car l’amour-propre entre souvent en jeu. Comme nous avons pris une position de départ, nous ne voulons pas en sortir, car ce serait risquer de « perdre la face ».
Au final, quand l’accord est trouvé, c’est souvent de guerre lasse. Nous coupons la poire en deux « pour arrêter les frais ». Mais en réalité, nous restons souvent sur notre faim et l’accord n’est pas aussi avantageux qu’il aurait pu l’être.
La discussion sur des positions est dépourvue d’efficacité
Logiquement, ce type de négociation qui n’en finit pas n’est pas très efficace. Les négociations sur les positions traînent en longueur et s’enlisent. Pourquoi ? Car, pour être sûrs de parvenir à nos fins, nous partons de positions extrêmes, afin de nous donner une marge d’évolution.
À chaque instant, nous devons décider que faire. L’autre partie est dans la même situation. Il y a trop de décisions à prendre. Les concessions sont lentes à se former et chacun cherche à gagner le plus de temps. Bref, ce n’est pas très efficace !
La discussion sur des positions compromet les relations existantes
En affrontant ainsi leurs volontés, les négociateurs en finissent par abîmer leurs relations. Nous nous fâchons, nous nous frustrons. Nous avons le sentiment de n’avoir pas été profondément entendus.
« La colère et la rancœur suscitées par une aventure de ce genre durent parfois toute une vie. » (Comment réussir une négociation, Chapitre 1)
Quand les parties en présence sont nombreuses, la négociation sur des positions est pire encore
C’est déjà compliqué à deux, mais lorsqu’il y a encore plus de parties en présence, ce type de négociation aboutit encore plus souvent à des blocages et à des tensions extrêmes.
La gentillesse ne constitue pas une réponse
« Face à ce mode de négociation « dure », il existe un mode de négociation « doux » qualifié par le terme de « gentillesse ». Dans ce cas, nous cherchons à satisfaire nos amis en évitant le conflit. Dès lors, nous changeons facilement d’avis et nous faisons des offres en vue d’arriver à un accord le plus rapidement possible.
Le problème avec cette manière de faire, c’est que nous pouvons facilement nous faire abuser. Tout d’abord, l’accord risque de ne pas être à notre avantage. Mais surtout, nous nous mettons « à la merci » du négociateur « dur ».
La solution de rechange
Toutes les négociations comportent deux niveaux :
Le fond, ce qui doit être décidé ;
La forme, c’est-à-dire la partie procédurale, la façon dont la négociation sera menée.
Sans toujours nous en rendre compte, nous négocions sur la forme aussi bien que sur le fond. En fait, il s’agit d’un jeu (ou d’une négociation) sur les règles du jeu elles-mêmes (faut-il être doux ou dur ?).
C’est au niveau de ce « méta-jeu » qu’il faut se placer. Au lieu d’utiliser des techniques de négociation douces ou dures, il est préférable d’utiliser le système appelé « négociation raisonnée » ou « négociation sur le fond » inventé par les auteurs.
Celui-ci, selon Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton, peut être utilisé dans presque toutes les situations.
Il contient quatre éléments :
Hommes : séparer les gens du problème.
Intérêts : se concentrer sur les intérêts, pas sur les positions.
Solutions : inventer plusieurs options avant de se décider.
Critères : insister sur l’établissement de critères objectifs.
Démêler les gens et leurs émotions du problème en question permet aux deux parties de travailler ensemble en équipe, plutôt que l’un contre l’autre. L’accent mis sur les intérêts porte quant à lui à privilégier les besoins réels des personnes plutôt que leur égo. Penser à de nombreuses solutions aide à soulager la pression et à accroître la coopération, tandis que l’utilisation d’une norme externe et équitable au lieu d’en rester à la seule volonté des négociateurs.
Ces éléments peuvent et devraient être utilisés aux trois étapes de la négociation :
L’analyse. ;
La mise au point d’un plan ;
La discussion.
Si vous suivez cette façon de négocier raisonnablement, le résultat sera probablement un règlement du conflit judicieux, efficace et à l’amiable.
Partie II. La méthode
2 — Traiter séparément les questions de personnes et le différend
Les négociateurs sont avant tout des personnes
« Une donnée fondamentale que l’on a tendance à oublier au cours de négociations, en particulier au sein de grosses entreprises ou de conférences internationales, c’est que les autres, ceux de la partie adverse, ne sont pas des représentants abstraits mais des êtres humains. » (Comment réussir une négociation, Chapitre 2)
Eh oui, les négociateurs sont des gens ; ils ont des désirs, des besoins et des préjugés. C’est encore plus vrai — ou encore plus visible — lorsque nous nous disputons avec notre conjoint ou conjointe, par exemple.
Parfois, ces relations humaines concourent à la réussite de la négociation : lorsque l’amitié prime. Mais souvent, nous comprenons mal les bonnes intentions d’autrui et nous nous sentons rapidement menacés. Notre égo prend le dessus.
Résultat : une réaction en chaîne de récriminations qui aboutit à l’échec de la négociation.
L’intérêt du négociateur est double : le différend ET la relation avec l’adversaire
Les négociateurs ont en général deux objectifs :
Obtenir ce qu’ils veulent (c’est-à-dire servir leur propre intérêt) ;
Maintenir une bonne relation avec l’autre partie.
Il est rare, en effet, que nous nous moquions complètement de la pérennité de la relation avec autrui. Même dans le commerce, nous souhaitons fidéliser le client pour qu’il revienne. Il faut donc se montrer conciliant pour que celui-ci accepte de faire de nouveau appel à nous.
Le problème, c’est que les deux objectifs s’embrouillent très souvent lorsque nous négocions à partir de positions « dures ». Par exemple, nous profitons des défauts personnels d’autrui pour l’emporter et cela crée une rupture qui peut être définitive.
Traiter séparément les questions de relation et celles de fond : il faut aborder sans détour les problèmes humains
Les différences personnelles devraient être résolues, non pas en faisant des concessions (et encore moins en se laissant manipuler), mais en changeant la façon dont nous traitons l’autre partie.
Autrement dit, nous devons apprendre à traiter nos partenaires avec psychologie. Or, les psychologues utilisent une classification des problèmes humains en 3 grandes catégories :
Perception ;
Affectivité ;
Communication.
Nous devons appliquer les conseils qui suivent aussi bien à nous-mêmes qu’aux autres personnes qui entrent dans la négociation.
La perception
Les personnes ou les pays se disputent autour de possessions ou d’événements. Mais le plus souvent, peu importe les faits. Vous pouvez chercher à apporter des preuves, celles-ci ne sont qu’un argument parmi d’autres.
Ce qui importe avant tout, c’est la perception qu’a l’autre du problème. Le conflit naît et se situe au niveau des idées différentes que les deux parties ont formées. Il faut donc être capable de se mettre dans la peau de l’adversaire. C’est capital.
« Le pouvoir de se mettre dans la peau de son adversaire n’est pas donné à tout le monde ; c’est pourtant un des talents les plus essentiels qu’un négociateur devrait posséder. » (Comment réussir une négociation, Chapitre 2)
Il n’est pas nécessaire d’être en accord avec le point de vue d’autrui, ; simplement de prendre le temps de le comprendre. Ce faisant, nous éliminons certains préjugés et nous améliorons notre capacité à négocier et à résoudre le conflit.
Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton donnent plusieurs autres conseils pour améliorer la perception réciproque des négociateurs :
Ne supposez pas que vos peurs décrivent leurs intentions.
Ne prétendez pas que votre problème est de leur faute.
Discutez et reconnaissez leurs perceptions, y compris celles qui vous semblent sans importance.
Surprenez-les en allant à l’encontre de leurs préjugés négatifs à votre égard.
Incluez-les dans tous les aspects d’une décision.
Assurez-vous qu’ils considèrent l’accord comme juste et non comme une concession humiliante.
L’affectivité
Les auteurs commencent par mettre en avant le fait que nous devrions, en tant que négociateurs, constamment faire attention aux émotions qui nous traversent et qui traversent la partie adverse. Ces émotions peuvent être la colère, la peur ou la distraction, par exemple.
Il est toujours bon de « prendre la température » et de chercher à modifier le curseur pour atteindre un état de calme et de confiance.
Pour ce faire, concentrez-vous sur les cinq « préoccupations essentielles » des individus ou des groupes. À savoir le besoin d’/de :
Autonomie ;
Appréciation ;
Affiliation ;
Rôle ou de but ;
Statut.
Par ailleurs, veillez à :
Respecter l’identité, c’est-à-dire l’image de soi de l’autre partie.
Reconnaitre les émotions et inviter autrui à partager les siennes.
Permettre à chacun de se « défouler » pendant un moment.
Éviter de répondre aux accès de colère.
Proposer des gestes symboliques (une poignée de main, un repas partagé, de courtes excuses).
De cette façon, nous pouvons garder les relations sur des bases affectives saines.
La communication
« Sans communication, point de négociation », disent les auteurs. En effet, la négociation suppose la communication pour arriver à une décision commune. Mais ce n’est pas aussi facile que ça en a l’air !
Trois problèmes principaux bloquent régulièrement la communication.
Lorsque celle-ci n’a pas pour fin de se comprendre mutuellement mais plutôt de manipuler des tiers (spectateurs au débat, par exemple) ;
Quand les négociateurs cessent tout simplement d’écouter la partie adverse, le plus souvent afin de préparer leur propre réplique ;
Quand il y a malentendu véritable, en raison d’une barrière linguistique ou culturelle.
Pour chercher à tempérer ou résoudre ces trois enjeux, Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton proposent les alternatives suivantes :
Se placer dans une attitude d’écoute active et montrer que l’on comprend :
S’exprimer de manière claire pour être compris ;
Parler de soi, et non des autres ;
S’exprimer dans un but précis.
Mieux vaut prévenir
« Il est toujours préférable de traiter les questions de personnes avant qu’elles ne deviennent des problèmes. » (Comment réussir une négociation, Chapitre 2)
Pour ce faire, vous veillerez à établir une relation constructive avec votre interlocuteur, c’est-à-dire ne pas avoir peur de se montrer comme une personne à part entière. Cela dit, vous ferez attention, dans la négociation elle-même, à ne pas attaquer la personne elle-même, mais toujours l’objet du différend lui-même — en prenant soin de laisser la personne (son identité, ses besoins légitimes, etc.) en sécurité.
3 — Se concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les positions
Pour trouver une solution judicieuse, il faut concilier les intérêts, pas les positions
« Faire la distinction entre positions et intérêts, voilà ce qui compte vraiment dans une négociation. » (Comment réussir une négociation, Chapitre 3)
Mais comment faire ? En fait, les intérêts sont « les moteurs silencieux de l’action ». Ce sont nos besoins, nos craintes, nos désirs et nos soucis réels. Par contraste, les positions en sont « les bruyantes manifestations ». D’où l’importance de savoir bien écouter.
Selon Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton, l’avantage de partir des intérêts est que ceux-ci offrent plusieurs voies de règlement du conflit. Par ailleurs, la conciliation d’intérêts vaut mieux que le compromis sur les positions parce qu’il est toujours possible de trouver davantage de points communs au niveau des intérêts.
En effet, « sous » chaque position, il y a plusieurs intérêts qui peuvent se révéler conciliables ou antagoniques. Et c’est parce que nos intérêts divergents que nous pouvons nous entendre.
« Le cas du marchand de chaussures et de son client en est l’illustration la plus simple : ils ont besoin d’argent et de chaussures l’un et l’autre, mais inversement : le chausseur préfère gagner 50 dollars et vendre ses chaussures, le client préfère prendre les chaussures et donner ses 50 dollars. Ils sont faits pour s’entendre ! » (Comment réussir une négociation, Chapitre 3)
Comment déterminer les intérêts en jeu
Il existe au moins deux techniques pour faire surgir les intérêts des parties en cause.
La première est de poser la question « Pourquoi ? » en se mettant à la place de l’adversaire.
La deuxième consiste à se poser la question « Pourquoi pas ? » en se demandant pourquoi l’adversaire refuserait la première proposition qu’il pense que nous lui ferions.
Vous devez également prendre en compte le fait qu’il existe plusieurs intérêts en jeu. Souvent, les négociateurs parlent pour des mandants (des personnes qui l’ont chargé de négocier). Il faut retrouver toute la palette des intérêts qui s’expriment plus ou moins clairement dans les négociations.
Le plus souvent, ce sont les exigences fondamentales de l’être humain qui jouent le rôle le plus important. À savoir :
La sécurité ;
Le bien-être économique ;
L’appartenance à une communauté ;
L’identification ;
La maîtrise de sa destinée.
Les auteurs conseillent de dresser la liste des intérêts en jeu afin de les garder en mémoire tout au long de la procédure de conciliation.
Chacun doit aborder la question de ses préoccupations
Lorsque nous nous engageons dans une négociation raisonnée, nous souhaitons parler de façon constructive des intérêts en jeu. Bien. Mais quelle est la marche à suivre pour que ce soit efficace ?
Voici les derniers conseils des auteurs :
Soyez concret dans vos explications ;
Admettez les intérêts d’autrui dans la discussion ;
Commencez par une question et non une solution ;
Soyez orienté vers l’avenir ;
Expliquez ce que vous voudriez faire au lieu de vous justifier ;
Soyez résolu mais conciliant, ouvert aux idées d’autrui ;
Restez ferme sur la question débattue et conciliant avec les participants.
4 — Imaginer des solutions procurant un bénéfice mutuel
Diagnostic
Souvent, les négociations sont centrées sur des questions uniques — une somme d’argent à recevoir ou un territoire à garder, la garde des enfants dans un divorce, etc. — où nous pensons qu’il y aura toujours un gagnant et un perdant. Ou, si nous ne sommes pas perdants, nous éprouvons à tout le moins une insatisfaction.
Finalement, une solution optimale est souvent négligée et il en résulte beaucoup de « pertes ». C’est l’exemple du partage de l’orange : si je veux manger la chair et que l’autre veut la peau pour faire un gâteau, pourquoi s’obstiner à la couper en deux et à donner à chacun une partie ? Il aurait été plus judicieux de donner toute la pelure à l’un et toute la chair à l’autre.
« Nous devons donc nous efforcer de trouver des options qui élargissent la ressource contestée au lieu de simplement la diviser. Mais pourquoi les négociateurs négligent-ils la plupart du temps cette approche raisonnée ou « sur le fond » ?
Pour quatre raisons selon Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton :
Les jugements hâtifs (vouloir aller trop vite) ;
La recherche de la seule et unique réponse (croire qu'il n'y a qu'une bonne solution) ;
L'hypothèse selon laquelle les limites du gâteau sont fixées une fois pour toutes ;
L'idée que les difficultés de l'adversaire ne regardent que lui.
Au contraire, toute la méthode de la négociation raisonnée passe, comme nous allons le voir, par l'empathie et la recherche concertée de solutions variées.
Ordonnance
Quatre lignes directrices pourront vous aider à améliorer la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes :
Dissocier l'invention et la décision ;
Élargir le champ des possibles (carte en rond) ;
Rechercher un bénéfice mutuel ;
Faciliter la tâche de l'adversaire quand il devra se prononcer.
La première consiste à séparer le processus créatif du processus de décision : « Inventez d'abord, décidez plus tard ». Pour ce faire, les auteurs conseillent de mettre sur pied des sessions informelles de brainstorming en petits groupes.
Une autre façon de faire (complémentaire) est d'élargir le champ des possibles. Les auteurs proposent une carte "en rond" qui vous aidera à inventer des solutions (p. 115) :
Questions à résoudre ;
Analyse et diagnostic de la situation ;
Angles d'attaque ;
Solutions.
Une troisième proposition consiste à rechercher un bénéfice mutuel qui élargit les ressources. Le secret est de trouver des choses qui coûtent très peu à une partie, mais que l'autre partie souhaite vraiment.
La quatrième ligne directrice est de faire en sorte qu'il soit facile pour l'autre partie de dire oui. Penser à dessiner votre solution de telle manière à ce qu'elle soit facile à mettre en œuvre et que chaque partie se sente honorée.
5 — Exiger l'utilisation de critères objectifs
Les décisions fondées sur la seule volonté sont coûteuses
Nous l'avons vu tout au long des précédents chapitres, les compromis issus des négociations dures ou douces ne sont pas souvent optimaux. Ils prennent du temps et, lorsqu'ils aboutissent, laissent souvent une partie insatisfaite. La ressource en jeu aurait pu être allouée de manière plus juste et plus efficace.
L'un des critères de la méthode de la négociation raisonnée consiste à exiger l'utilisation de critères objectifs.
En quelles circonstances utiliser un critère objectif ?
Parfois, aucune des parties ne peut trouver une solution à un conflit. Dans cette situation, une partie extérieure et neutre peut être amenée pour décider de la question.
Par exemple, si un entrepreneur et un acheteur ne peuvent pas se mettre d'accord sur la profondeur minimale de la fondation d'un bâtiment, ils peuvent se référer aux normes des régulateurs locaux ou à la pratique courante de la région.
De cette façon, la décision est établie sur des bases objectives plutôt que sur la volonté des négociateurs. De tels accords sont plus stables, car ils reposent sur des règles éprouvées ; ils sont également plus efficaces, car des normes communes résolvent automatiquement de nombreux problèmes.
La mise au point d'un critère objectif
"Si l'on décide d'adopter la méthode de négociation raisonnée, deux questions se posent : comment mettre au point des critères objectifs, comment les utiliser dans la discussion." (Comment réussir une négociation, Chapitre 4)
Les auteurs passent en revue différents types de critères et de procédures à utiliser dans les négociations. Concernant le critère d'équité (qui signifie "justice"), il doit "être indépendant de la volonté des parties en présence" et "acceptable pour les deux parties en présence". Dans la réalité, il existe une diversité de critères objectifs possibles et il faudra donc prioritairement tomber d'accord sur celui (ou ceux) à utiliser.
Au sujet des procédures équitables, les auteurs évoquent l'importance de mettre en place des systèmes qui minimisent l'injustice (ou le sentiment d'injustice). Par exemple :
La procédure "l'un coupe, l'autre choisit" ;
Le tirage au sort ;
Le choix à tour de rôle ;
L'arbitrage d'un tiers ;
Etc.
Fonder les discussions sur un critère objectif
Il faut se mettre d'accord sur les procédures et les critères à utiliser. Mais comment faire ? Comment convaincre l'adversaire ? Trois principes fondamentaux doivent guider les discussions :
Présenter chaque question comme la recherche commune d'un critère objectif ;
Être disposé à raisonner et rester ouvert à la recherche de critères mieux adaptés ;
Demeurer impassible face aux pressions, mais s'incliner devant les principes.
Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton développent ces trois aspects en donnant de nombreux exemples. Retenons ici que l'établissement de principes objectifs permet de résister aux pressions (chantages, pots de vin, etc.) d'une partie ou de l'autre et d'obtenir justice plus aisément.
Partie III. Oui mais…
6 — Que se passe-t-il quand la partie adverse est manifestement plus puissante ?
Se protéger
"Quand on se précipite à l'aéroport parce qu'on craint de rater le départ d'un avion, on agit comme si c'était une question de vie ou de mort. En y réfléchissant à tête reposée, on se rend compte qu'on aurait fort bien pu prendre le suivant sans que cela constitue une catastrophe." (Comment réussir une négociation, Chapitre 6)
Il en va de même avec les négociations. Nous avons tendance à nous précipiter quand nous avons investi beaucoup de temps dans les discussions. Nous risquons alors de nous montrer trop "doux" et de laisser l'adversaire prendre le dessus.
Pour éviter de tomber dans cet écueil, vous pouvez fixer un seul non négociable, au-delà duquel vous refuserez d'aller. Mais c'est revenir à une forme de négociation "dure" qui limite l'imagination. À la place de cette stratégie classique, les auteurs privilégient la MEilleure SOlution de REchange — ou MESORE.
La MESORE est un "moyen d'évaluer tout accord pour savoir si l'on a intérêt ou non à le signer". Elle repose sur l'hypothèse de ce qui serait réalisé si l'accord n'aboutissait pas au bout d'un certain temps.
Il convient d'y penser sérieusement, et non de façon vague. Autrement dit, vous devez savoir clairement quelles sont les options réalistes de remplacement qui s'offrent à vous si l'accord n'aboutit pas ou ne prend pas la direction initialement souhaitée.
Tirer le meilleur parti de ses atouts
La MESORE se révèle plus importante que l'argent, l'influence sociale ou le poids politique respectif de chaque partie. Mais comment l'élaborer ? Vous devrez agir en trois temps :
Imaginer plusieurs solutions de repli qui vous conviendraient si l'accord devait échouer ;
Approfondir les idées les plus intéressantes et concevoir leur mise en application pratique ;
Opter pour la meilleure d'entre elles.
Vous devriez également faire de même avec l'adversaire — c'est-à-dire étudier quelle est sa MESORE probable. Si vous la trouvez, vous serez davantage en mesure de trouver un accord judicieux, efficace et amical.
Quand l'adversaire est tout-puissant
Lorsque l'autre est vraiment plus fort, il faut chercher à s'appuyer autant que possible sur les principes objectifs décidés en amont, aussi bien les critères d'équité que les procédures équitables.
Avoir une bonne MESORE vous permettra également de gagner en force, puisque vous vous sentirez capable de quitter la table des négociations lorsque l'adversaire cherchera à vous intimider.
"Un négociateur qui possède une MESORE est donc plus apte non seulement à déterminer l'accord minimum qu'il peut accepter mais encore à l'obtenir. Rechercher sa MESORE est certainement la ligne de conduite la plus efficace qu'il puisse adopter quand il affronte un négociateur apparemment plus puissant." (Comment réussir une négociation, Chapitre 6)
7 — Que se passe-t-il quand la partie adverse refuse de jouer le jeu ?
Nous pouvons nous retrouver dans des situations où l'adversaire refuse de jouer le jeu de la négociation raisonnée. Dans ce cas, il se placera le plus souvent dans une posture de position "dure" et cherchera par tous les moyens à nous faire plier. Que faire, dans ce cas ?
Trois angles de réponses sont à envisager :
Ce qu'il convient de faire personnellement, à savoir suivre la méthode raisonnée afin de créer une dynamique positive ;
Ce que l'adversaire peut faire et à quoi nous pouvons l'amener par la "négociation jiu-jitsu".
L'utilisation d'une tierce personne "pour orienter la discussion sur les intérêts, les propositions et les critères".
La première tactique fait, d'une certaine manière, l'objet de tout le livre, puisqu'elle consiste simplement à mettre en œuvre la négociation raisonnée de façon résolue dans l'espoir que l'autre y reconnaitra également son intérêt. Concentrons-nous donc sur les deux autres.
La négociation jiu-jitsu
La bonne tactique consiste à ne pas répondre aux critiques qui nous poussent dans nos retranchements. Pourquoi ? Pour éviter le cercle vicieux des contre-critiques qui nous ferait revenir à une négociation "dure" classique.
L'enjeu consiste plutôt à l'esquiver et à "la faire dévier dans le sens de la question en cours"
"Au lieu de résister à ses efforts, il faut les canaliser pour qu'ils participent à la recherche des intérêts communs, à l'invention de solutions avantageuses fondées sur des critères objectifs." (Comment réussir une négociation, Chapitre 7)
Pour maîtriser cet art de la négociation, il vous faudra (p. 168-171) :
"Découvrir sur quoi repose la position de l'adversaire au lieu de l'attaquer."
"Rechercher la critique et les conseils de la partie adverse, sans défendre ses propres idées."
"Savoir ramener les attaques personnelles vers les questions de fond."
"Poser des questions et attendre."
La procédure à texte unique
Au lieu de partir de positions et de faire des concessions qui nous laissent fatigués et aigris, mieux vaut parfois avoir directement recours à une personne tierce — un médiateur. Celui-ci peut utiliser la procédure à texte unique pour agir efficacement, amicalement et judicieusement.
Prenons l'exemple d'un couple avec deux projets de maison différents (donné par les auteurs). Ils font un appel à un architecte. Celui-ci décide de s'enquérir des intérêts de chacun (et non de leurs positions), puis réalise une liste de desiderata qu'il soumet à leurs critiques.
À partir de là, il peut créer un avant-projet. De nouveau, ronde de critiques de la part du mari comme de la femme (il est plus facile de critiquer que de faire des concessions, rappellent les auteurs). Deuxième projet et même dynamique, jusqu'à aboutir à un accord.
Le cercle, ici, est vertueux. Pourquoi ? Car :
Il n'a pas engagé l'amour propre des époux, ni le sien.
Il a fait au mieux à partir des intérêts (désirs, besoins, craintes, etc.) de chacune des parties, et les a invités à construire ensemble un projet unique.
En outre, il a pris en compte une série de contraintes (légales, physiques, etc.) objectives. Les époux savent ce qui les attend et peuvent se décider ensemble.
Dans la suite du chapitre, Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton proposent une étude détaillée d'un autre cas issu de la vie réelle : une négociation entre un propriétaire et son locataire : l'affaire Agence Jones/Frank Turnbull (p. 178-193).
8 — Que se passe-t-il quand la partie adverse triche ou recourt à des moyens déloyaux ?
Parfois, les négociateurs sont particulièrement coriaces et n'hésitent pas à employer des méthodes douteuses pour "gagner" coûte que coûte la négociation. C'est ce que les auteurs nomment la négociation truquée.
Le plus souvent, nous nous irritons tout en "laissant passer" et en nous promettant que nous ne ferons plus jamais affaire avec cette personne (ou ce groupe). Ou bien alors nous rétorquons en rendant coup pour coup.
Comment y répondre plus sainement ? En prenant conscience que :
"La négociation truquée n'est jamais qu'une manière de tirer la couverture à soi sur la forme. On réagira donc en faisant une question de procédure — quelle est la méthode de négociation choisie par les parties ? Et l'on entamera donc une négociation raisonnée sur la procédure." (Comment réussir une négociation, Chapitre 8)
Comment discuter des règles de négociation
Il faut nécessairement :
Comprendre ce qu'il se passe et mettre le doigt sur les tactiques employées) ;
Exprimer à l'autre ce que nous avons compris ;
Lui proposer de discuter de la forme de la négociation.
Autrement dit, il faut appliquer la négociation raisonnée à la forme elle-même en cherchant à comprendre les intérêts qui poussent l'adversaire à tricher et en l'amenant à un accord sur les règles à suivre.
Pour vous aider à identifier ce qui se passe, les trois sections suivantes sont consacrées à trois catégories de tactiques déloyales :
Le mensonge délibéré ;
La guerre psychologique ;
Les pressions.
Les mensonges délibérés
Dans cette section, les auteurs abordent les types de mensonges délibérés :
Faux renseignements (un classique pour tromper l'adversaire) ;
Autorité mal définie (identification claire du mandant et des marges de manœuvre du négociateur) ;
Intentions sujettes à caution (incertitude sur le respect de la parole donnée).
Cela dit, ne considérez pas que cacher une partie de son jeu équivaut à l'une de ces formes de triche. Vous pouvez garder certaines informations pour vous, même dans la négociation raisonnée. L'important est de suivre la méthode et, le cas échéant, de faire appel à une personne tierce pour aider à la construction d'une solution.
La guerre psychologique
Une autre façon de colorer négativement la procédure de la négociation consiste à s'en prendre aux sentiments des personnes en les mettant mal à l'aise. Les auteurs abordent les cas des/de :
Situations angoissantes ;
Attaques personnelles ;
Tactique du bon et du méchant ;
Menaces.
Au lieu de menaces, vous pouvez opter pour des avertissements. Ceux-ci ne visent pas à réclamer et à annoncer une punition pour la partie adversaire, mais plutôt à montrer que vous protégerez vos intérêts.
De façon générale, le négociateur raisonné refusera de répondre à ces intimidations et cherchera toujours à remettre la discussion sur des rails constructifs.
La stratégie de la pression dans la négociation de position
"Cette stratégie consiste à placer d'emblée l'adversaire dans une position où lui et lui seul sera en mesure de faire des concessions." (Comment réussir une négociation, Chapitre 8)
Voici quelques "mauvaises manières" utilisées par les négociateurs coriaces :
Refus de négocier ;
Exigences extrêmes ;
Exigences sans cesse croissantes ;
Stratégie de blocage ;
Le coup du partenaire têtu ;
La temporisation ;
Le choix décisif ("c'est à prendre ou à laisser").
Chacune de ces tactiques est exposée en détail par Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton.
Refuser d'être une victime
Refuser d'être une victime, cela signifie qu'il est possible de déclarer ouvertement que nous souhaitons voir advenir une négociation en bonne et due forme. Nous pouvons nous montrer fermes sur ce point et nous devrions l'être.
Par ailleurs, nous ne devrions pas nous laisser aller à être un "bourreau". Pour ce faire, nous pouvons nous demander ce que nous sommes en train de faire ou prêt à faire. Certaines questions peuvent nous aider à maintenir le curseur vers l'équité, l'efficacité et l'amabilité. Par exemple :
"Est-ce une démarche que j'adopterais en face d'un ami ou d'un membre de ma propre famille ?"
"Si la totalité de ce que j'ai dit et fait était rendue publique, est-ce que j'en éprouverais de la gêne ?"
Etc.
En conclusion : trois remarques
"Je le sais depuis toujours."
Les préceptes et idées développées ici forment "ce que le bon sens et l'expérience commune mettent à la portée de chacun de nous". Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton ne prétendent donc pas avoir inventé de toutes pièces une nouvelle méthode, mais plutôt s'être inspirés de pratiques déjà existantes.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
La négociation se pratique… Sans cela, vous ne deviendrez pas un négociateur expert. Et tous les livres que vous lirez — même les meilleurs — n'y changeront rien.
"Gagner."
"Demander à un négociateur "alors, qui a gagné ?" est à peu près aussi déplacé que de poser la même question aux deux conjoints d'un ménage." (Comment réussir une négociation, Conclusion)
L'objectif de la négociation n'est pas de "gagner" mais d'"entrer dans une collaboration constructive destinée à élaborer une solution judicieuse à tel ou tel problème commun"
Conclusion sur "Comment réussir une négociation" de Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton :
Ce qu'il faut retenir de "Comment réussir une négociation" de Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton :
Comment réussir une négociation est un livre qui mêle politique, affaires et développement personnel avec beaucoup de perspicacité et de pertinence. Roger Fisher et William Ury ont tous deux présidé le Harvard Negociation Project, rebaptisé Global Negociation Initiative.
Ce livre a été s'est vendu à 15 millions d'exemplaires et a été traduit en 35 langues. il est l'un des ouvrages les plus fréquemment cités sur les listes des meilleurs livres de négociation.
Bref, c'est un classique ! Et dans un sens, il pourra vous rappeler des autres livres comme Cessez d'être gentil, soyez vrai sur la communication non-violente.
Rappelez-vous que la négociation raisonnée a pour but de construire une solution judicieuse (équitable), efficace et à l'amiable entre les parties, en insistant sur trois points :
La focalisation sur les intérêts et non sur les personnes ou les positions ;
L'invention de solutions partagées qui procurent des bénéfices mutuels ;
L'utilisation de critères objectifs et de procédures équitables.
Points forts :
Un manuel très clair et instructif ;
De très nombreux exemples venus des affaires, de la politique et de la vie privée ;
10 questions supplémentaires en fin d'ouvrage pour y voir encore plus clair ;
Une préface à la nouvelle édition, ainsi que les préfaces antérieures ;
Un classique absolu de la négociation à avoir dans sa bibliothèque.
Points faibles :
Je n’en ai pas trouvé.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu le livre de Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton « Comment réussir une négociation » ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton « Comment réussir une négociation ».
Visitez Amazon afin d’acheter le livre de Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton « Comment réussir une négociation ».
 ]]>
]]>Résumé de "Le Guide du rêve lucide | 65 exercices et 15 programmes pour prendre les commandes de vos rêves" du Pr. Clare Johnson : dans ce guide ultra-pratique, la pionnière du rêve lucide Clare Johnson nous livre ses meilleures techniques et programmes pour apprendre à devenir un rêveur lucide, explorer en pleine conscience le fascinant monde des rêves. Et en faire une opportunité de créativité, de connaissance de soi et même de guérison.
Par Pr. Clare Johnson, 2022, 264 pages.
Titre original : "The Art of Lucid Dreaming: Over 60 Powerful Practices to Help You Wake Up in Your Dreams"
Chronique et résumé de "Le Guide du rêve lucide | 65 exercices et 15 programmes pour prendre les commandes de vos rêves" du Pr. Clare Johnson
À Propos de l’auteure
La Pr Clare R. Johnson, présidente de l'International Association for the Study of Dreams, est une pionnière dans l'étude et la pratique du rêve lucide depuis plus de 40 ans.
Première à avoir consacré une thèse au rêve lucide comme force créatrice, elle enseigne depuis 15 ans comment exploiter le potentiel de l'inconscient à travers cette pratique.
Auteure de nombreux ouvrages sur le sujet, dont le remarqué "Llewellyn's Complete Book of Lucid Dreaming", elle partage son expertise lors de conférences internationales et à travers son site web.
Introduction
Dans l’introduction de son livre intitulé "Le Guide du rêve lucide", l’auteure, la Pr. Clare Johnson, commence par nous révéler les incroyables possibilités que nous offre le rêve lucide.
En effet, le rêve lucide est cet état fascinant où l'on est conscient de rêver pendant son sommeil. Il nous offre alors la chance d’interagir avec notre monde onirique, de vivre des expériences extraordinaires (comme voler, nous transformer, explorer l'univers...), de développer notre créativité et même de nous soigner.
Le rêve lucide n’a pourtant rien de mystérieux ou d'élitiste, souligne l’auteure. Et tout le monde peut y accéder, enfant comme adulte, novice ou expérimenté.
C'est en tout cas ce que nous démontre ici la Pr. Clare Johnson, pionnière dans l'étude et la pratique du rêve lucide depuis plus de 40 ans.
Après avoir relaté sa propre découverte, enfant, de la lucidité, puis son parcours d'universitaire ayant fait du rêve lucide son sujet de thèse et de vie, elle nous invite à la suivre dans l'exploration de cet état de conscience aux mille potentiels.
Elle explique avoir conçu "Le Guide du rêve lucide" comme un livre ultra pratique. Et y avoir condensé les meilleures techniques, exercices et programmes issus de ses recherches, expériences et enseignements.
Que nous soyons débutant ou rêveur lucide chevronné, nous y trouverons, assure l’auteure, de précieux outils pour déclencher la lucidité, la maintenir, et piloter nos rêves. Avec en prime un questionnaire pour identifier notre profil de dormeur/rêveur et adapter au mieux notre pratique.
PARTIE 1 – Devenez rêveur lucide : réveillez-vous dans vos rêves
Chapitre 1 : Qu'est-ce que le rêve lucide ?
"Le rêve lucide est un rêve dans lequel nous savons que nous rêvons, pendant que nous rêvons." commence par écrire Clare Johnson.
Autrement dit, le rêve lucide est un état où l'on prend conscience que l'on rêve pendant le rêve lui-même.
Cette prise de conscience nous amène alors à explorer en pleine lucidité notre univers onirique et ses manifestations étonnantes. Il nous permet aussi de réagir sans peur aux situations effrayantes, et même d'influer sur le cours du rêve.
1.1 - Que pouvons-nous faire dans un rêve lucide ?
Les possibilités sont infinies. "Il n’existe aucune limite !" lance l’auteure.
- Vivre des expériences incroyables
Le rêve lucide permet de vivre des expériences extraordinaires, transcendantes et ultra-réalistes, comme voler, se métamorphoser en goutte de pluie, respirer sous l'eau, changer de forme, explorer l'univers, transcender l'espace-temps...
L’état de conscience qu’il induit n’a pas d’équivalent. Le Pr. Clare Johnson écrit à ce propos : :
"Je me suis transformée en dauphin et j’ai senti la formidable puissance de mon corps sous la mer, le bref éclair de soleil en jaillissant à la surface des vagues et l’impact de l’eau en replongeant dans les flots. C’était si réel. Un homme m’a raconté son rêve lucide où il devenait une femme enceinte et caressait son ventre arrondi."
Elle poursuit :
"Dans les rêves lucides, nous pouvons étendre notre expérience : changer de genre ou ne pas en avoir ; respirer sous l’eau, se muer en fourmi ou prendre une ombre dans ses bras ; et, pour les plus courageux, accoucher. Nous pouvons interroger le songe sur la nature de la réalité, de la vie, de la mort et de la conscience… et recevoir des réponses de notre inconscient. Nous pouvons étreindre un proche décédé ou sentir de nouveau son parfum si familier. Nous pouvons améliorer des capacités physiques, vaincre des phobies, avoir des expériences sexuelles incroyables ou apprendre à mieux nous connaître. Bref, il n’existe aucune limite !"
- Stimuler la création, l’introspection, la guérison, l’évolution
Selon l’auteure, le rêve lucide stimule aussi intensément la créativité en donnant accès à un flux d'images mentales d'une incroyable vivacité.
Nous pouvons alors nous en inspirer à des fins artistiques, littéraires ou pour mener à bien un projet.
Il est aussi possible de méditer au cours d’un rêve lucide et de vivre l’unicité et l’interconnexion. C'est enfin, affirme l’auteure, un formidable outil d'introspection, de guérison émotionnelle et physique, d'apprentissage et d'évolution spirituelle.
1.2 - Sept questions classiques sur le rêve lucide
L'auteure du "Guide du rêve lucide" répond ici aux interrogations les plus fréquentes au sujet des rêves lucides.
Résumons ses réponses :
Oui, tout le monde peut rêver lucide.
Oui, cela s'apprend.
Le contrôle du rêve n'est pas un impératif, il existe de multiples façons d'interagir avec.
Non, ce n'est pas dangereux mais une préparation est conseillée en cas de fragilité psychologique.
Oui, il aide face aux cauchemars.
Oui, son existence est prouvée scientifiquement.
Se rappeler ses rêves est important mais pas indispensable pour devenir rêveur lucide.
1.3 - Développer un état d’esprit de rêveur lucide
"Le Guide du rêve lucide" décrit ensuite les 3 clés essentielles à développer pour induire et stabiliser le rêve lucide :
L'intention, qui est la volonté et le désir de devenir rêveur lucide.
La clarté, qui permet de rester concentré malgré les distractions oniriques.
L'expectative qui est la conviction que l'on va y arriver.
1.4 - Astuces pour mieux se souvenir de ses rêves et mieux s’y connecter
L’auteur du "Guide du rêve lucide" continue en nous fournissant diverses astuces concrètes pour :
Mieux nous rappeler de nos rêves (exercice 1) : l'auteure conseille un réveil en douceur, de rester immobile au réveil en s'interrogeant sur son rêve, de s'engager à les noter, d'y penser la nuit et de faire des siestes.
Tenir un journal de rêves afin de mieux se connecter à notre esprit rêveur (exercice 2) : l'auteure suggère d'y noter ou dessiner ses rêves chaque matin, même de façon brouillonne, en privilégiant le présent, les mots-clés et émotions. Relire ce journal aide à repérer les thèmes récurrents, déclics de lucidité.
Créer un objectif de rêve lucide et ainsi renforcer son intention de devenir un rêveur lucide (exercice 3) : clarifier ses motivations pour le rêve lucide (plaisir, créativité, spiritualité, guérison...) renforce l'intention. L'auteure propose alors d'écrire ses 3 motivations principales, de visualiser son rêve lucide idéal, de l'utiliser pour cultiver son intention, sans toutefois en faire une fixation contraignante pendant le rêve.
1.5 - Les phases de sommeil
Clare Johnson explique ici que le sommeil se compose de 4 phases qui se répètent par cycles de 90 minutes :
1ère phase : sommeil léger,
2ème phase : sommeil un peu plus profond,
3ème phase : sommeil profond et récupérateur,
4ème phase : sommeil paradoxal avec mouvements oculaires rapides.
Les rêves lucides surviennent surtout en phase 4 (sommeil paradoxal), mais pas uniquement. Les périodes oniriques les plus propices ont lieu en fin de nuit, quand la chimie cérébrale favorise la lucidité.
Le chapitre 1 se termine avec un exercice (exercice 4) de méditation matinale pour faire naître un rêve lucide lors de cette la période la plus propice.
1.6 - Comment vaincre les doutes, les peurs et les blocages mentaux qui nous empêchent de devenir un rêveur lucide
Clare Johnson passe ensuite en revue les freins psychologiques courants qui peuvent nous empêcher de faire des rêves lucides. On peut, en effet :
Douter quant à la possibilité même du rêve lucide,
Avoir peur de ce qui pourrait surgir,
Manquer de motivation pour appliquer les techniques,
Penser ne pas avoir assez d’imagination, ne pas être assez créatif pour y arriver,
Ne pas vouloir sacrifier du temps de sommeil,
Ressentir un certain malaise à devenir rêveur lucide.
L’auteure répond point par point à ces résistances, en démontant nos idées limitantes.
En résumé, son message est le suivant : avoir l'esprit ouvert, la conscience que nous rêvons chaque nuit, et la certitude que le potentiel du rêve lucide est accessible à tous.
Chapitre 2 - Exercices efficaces pour se réveiller dans ses rêves
Même si la lucidité fascine, il n'existe pas de recette miracle pour y accéder du jour au lendemain. Il s’agit d’un état d'esprit que nous devons cultiver patiemment. Et pour cela, nous nous appuierons sur l'Intention, la Clarté et l'Expectative, et pratiquerons régulièrement pour élever notre niveau de conscience global.
Aussi, l’auteure conseille de rester au moins une semaine sur une même technique d'induction avant d'en changer, pour donner le temps au cerveau d'intégrer le message.
L'essentiel, ajoute-t-elle, est de garder sa motivation en éveil, sans se mettre la pression.
Chaque petit progrès est bon à prendre, que ce soit se rappeler un rêve, se poser la question de son état ou voler en rêve. L'indulgence et la persévérance sont de mise !
"Jouez avec votre objectif de rêve lucide avec enthousiasme et légèreté, tandis que vous essayez les procédés présentés dans ce chapitre et surtout restez curieux et motivé !"
2.1 - Les cinq tests de réalité les plus efficaces
Dans le deuxième chapitre du "Guide du rêve lucide", Clare Johnson commence par nous indiquer quels sont les tests de réalité qui permettent de développer notre esprit critique au cœur même du rêve, en nous interrogeant sur notre état de conscience.
Elle détaille alors 5 tests particulièrement efficaces, à pratiquer plusieurs fois par jour :
Le test du flottement : sentir le poids et la solidité de son corps. "Êtes-vous léger ? Suffisamment pour flotter dans l’air ? Votre corps est-il tangible ? Lorsque vous appuyez votre épaule contre un mur, pénétrez-vous dedans ? Si vous tapez d’une main sur une table, la traverse-t-elle ? Sautez en l’air : atterrissez-vous d’un coup sec ou planez-vous un peu ?".
Le test du doigt : essayer de faire passer son doigt à travers sa paume, le tirer pour voir s’il devient élastique ou s’arrache.
Le pincement de nez : se pincer le nez et tenter de respirer.
Dire l'heure ou lire : les chiffres et lettres se comportent bizarrement en rêve.
L'astuce des mains : examiner en détail ses mains et leur aspect : "observez attentivement vos paumes. Examinez les lignes qui courent entre les doigts, puis inspectez le dos. Détaillez vos bagues, si vous en portez, scrutez ces étonnants tourbillons de chair situés au niveau des articulations ou la longueur de vos ongles. N’oubliez pas vos veines. Voyez-vous des taches de rousseur ?"
Un exercice (exercice 6) encourage ici à inventer ses propres tests, ancrés dans ses sensations corporelles et ses fonctionnements mentaux pour plus d'efficacité.
2.2 - Comment utiliser sa mémoire pour se réveiller au cours d'un rêve
Notre mémoire prospective, qui nous permet de nous rappeler d'effectuer une action prévue, est un formidable outil pour déclencher la lucidité.
Trois exercices sont ici proposés par l’auteure :
L'exercice 7 du "Guide du rêve lucide" détaille comment utiliser notre mémoire prospective : se répéter dans la journée son intention de rêver lucide, créer des rappels visuels, se donner des tâches insolites à accomplir en cas de situation précise... En reliant l'intention à nos déclics personnels, on ancre le réflexe du test de réalité.
L'exercice 8 propose de nous entraîner à renforcer notre intention le jour pour la déclencher la nuit. Pour cela, l’auteure nous invite à réagir différemment à nos facteurs de stress, ceci dans le but de renforcer notre capacité à nous souvenir d'une résolution.
L’exercice 9 partage la Technique IMRL ou MILD en anglais (Mnémonic Induction of Lucid Dreams) du Dr Stephen LaBerge, chercheur spécialiste du rêve lucide. Cette technique s'appuie sur la mémoire prospective : le matin, on mémorise son rêve, on se dit qu'on le reconnaîtra, on se visualise lucide, le tout jusqu'à se rendormir.
2.3 - Compléments alimentaires, masques de rêves lucides et stimuli sonores lucidogènes
Il y existe, nous apprend ici l'auteure, des compléments alimentaires et masques émettant des flashs ou stimuli sonores qui peuvent aider certains à devenir rêveur lucide, avec prudence et patience.
2.4 - Techniques d’induction nocturnes pour devenir rêveur lucide
Plusieurs techniques d'induction nocturnes du rêve lucide sont alors présentées :
La technique "Se Réveiller Se Recoucher" ou "Wake Up, Back to Bed" (WBTB) en anglais (exercice 10) qui mise sur le rebond de sommeil paradoxal après une interruption de sommeil. Autrement dit : le fait de se lever brièvement favorise les rêves lucides en rallongeant le sommeil paradoxal.
L'identification de nos déclics de lucidité personnels liés à nos besoins corporels ou à nos thèmes oniriques récurrents (exercice 11).
La technique du bout des doigts, à pratiquer en s'endormant (exercice 12).
La création d'une compilation musicale avec des chansons déclics (exercice 13).
La technique du bras coincé pour associer une position à l'intention (exercice 14).
La saisie des micro-réveils nocturnes pour réaffirmer son intention (exercice 15).
En somme, le chapitre 2 du "Guide du rêve lucide" fournit une belle boîte à outils pour stimuler sa lucidité, en alliant techniques diurnes et nocturnes.
Place désormais à un moment clé de la pratique : l'endormissement.
Chapitre 3 – Détendez-vous pour rêver lucide
Clare Johnson est claire : si le rêve lucide demande de l'entraînement, ce ne doit pas être au détriment du sommeil. En fait, l'enjeu, selon elle, est de réussir à cultiver une relaxation profonde tout en restant vigilant.
C’est cet équilibre subtil que nous enseigne le troisième chapitre du "Guide du rêve lucide". Pour cela, il nous faut miser, notamment, sur l'état hypnagogique, ce moment de basculement fascinant entre veille et sommeil.
3.1 - Voyage lucide dans le sommeil
Ce passage du "Guide du rêve lucide" relate une expérience hypnagogique complète.
Elle démarre par les premières sensations de flottement (brume lumineuse) et visions lumineuses jusqu'à l'immersion totale dans un rêve, en passant par toutes les étapes : images statiques 2D, images 3D évolutives, scènes filmiques...
Le rêveur parvient à rester conscient tout au long et à influencer les événements, jusqu'à prendre son envol, dans un pur moment de joie et de lucidité.
3.2 - De l'imagerie hypnagogique au rêve lucide
Clare Johnson détaille ici son modèle de l'hypnagogie visuelle, "véritable porte d'entrée vers le rêve lucide", souligne-t-elle.
Elle décrit ensuite le rêve lucide induit pendant l'éveil (WILD). Autrement dit, lorsqu'on parvient à passer de l'éveil au rêve sans perdre conscience, en restant vigilant aux images et sensations étranges.
L’auteure partage enfin son souvenir d'enfant lorsqu'elle observait son double endormi flottant vers la lumière, au seuil du sommeil.
Pour finir cette partie, un exercice (exercice 16) nous apprend à pratiquer la technique WILD de manière détaillée : position, détente, observation des images, gestion des sensations surprenantes, test de réalité, visualisation d'une scène... jusqu'à l'entrée en rêve lucide. Y est abordé aussi le "vide lucide", cet interstice noir entre deux rêves, propice à la méditation.
3.3 - Jouer avec son corps onirique lucide
Dans cette partie du "Guide du rêve lucide", Clare Johnson explique que le corps onirique, extension plastique de notre conscience, nous permet les métamorphoses et expériences physiques les plus incroyables.
Elle évoque, en guise d’illustration, son expérience enfantine de "Grande Clare", une dilatation de son corps et de sa conscience qui la fascinait et qu'elle associait au rêve lucide.
Un exercice (exercice 17) nous invite à nous entraîner, à notre tour, à ce type d’expérience par la visualisation : étirements, rétrécissements, rajeunissement, lévitation, transformation en animal ou élément...
3.4 - L'état de demi-sommeil comme élixir créatif
Clare Johnson affirme ici que le demi-sommeil, en tant qu’état de conscience "entre-deux", s'avère être un formidable stimulant créatif, et encore plus lorsqu'on parvient à rester lucide : "dans les états de relaxation profonde qui marquent l’assoupissement (ou l’éveil), la créativité infinie du rêve se mêle à notre cerveau d’éveil pour former un cocktail détonant" écrit-t-elle.
L’auteure rapporte, en guise d’exemple, la fameuse histoire du chimiste Kekulé qui découvrit la structure en anneau du benzène lors d'un état hypnagogique. Elle relate aussi celle de l'artiste Salvador Dali qui s'assoupissait régulièrement dans son fauteuil une clé à la main. Lorsque, avec la somnolence, la clé glissait et tombait, elle le réveillait. Selon l’auteure, son imagination puisait souvent dans cette imagerie onirique.
Dans un exercice (exercice 18), est alors détaillé la technique pour "surfer à la lisière du sommeil" : posture détendue, focalisation sur un rêve, observation décontractée des images, maintien de la vigilance par des mouvements subtils, questionnement ciblé sur un projet artistique... Un entraînement exigeant mais gratifiant.
3.5 - Transitions vers l'éveil : faux réveils et imagerie hypnopompique
En miroir de l'état hypnagogique, l'auteure décrit deux phénomènes au seuil du réveil :
Les faux réveils, ces moments trompeurs où l'on croit se réveiller et vaquer à ses occupations alors que l'on rêve encore. L'occasion idéale pour un test de réalité !
L'état hypnopompique, avec son imagerie qui semble se matérialiser dans la chambre du dormeur. Une chance à saisir pour prolonger l'état de conscience onirique.
3.6 - Techniques de base pour renforcer l'intention et multiplier ses chances de lucidité
Cette dernière partie regroupe 7 techniques simples à expérimenter pour démultiplier ses chances de déclencher sa lucidité :
Dormir ailleurs que dans son lit (exercice 19),
Développer la rêverie diurne (exercice 20),
Revivre ses rêves en visualisation (exercice 21),
Pratiquer une activité corporelle consciente comme le yoga (exercice 22),
Affûter son sens de l'inhabituel, "son radar à bizarrerie" et tester sa réalité (exercice 23),
Créer un rituel du coucher dédié aux rêves lucides (exercice 24),
S'endormir en écoutant une visualisation personnalisée de son rêve (exercice 25).
Le chapitre 3 du "Guide du rêve lucide" nous a fourni une boîte à outils variés et ciblés pour accompagner le glissement vers le sommeil, ce moment privilégié pour incuber ses rêves lucides.
Passons à présent au prochain objectif : identifier son profil de dormeur et de rêveur pour personnaliser au mieux sa pratique.
Chapitre 4 - Créez votre programme personnel de lucidité
Après avoir présenté les techniques de base pour devenir rêveur lucide, le Pr. Clare Johnson nous invite à mieux nous connaître en tant que rêveur et dormeur unique, grâce au questionnaire de lucidité qu'elle a créé.
L'objectif : identifier notre profil pour sélectionner les méthodes d'induction de rêve lucide les plus adaptées et créer un programme sur-mesure.
4.1 - À quel genre de rêveur et de dormeur appartenez-vous ?
L'auteure souligne que malgré l'universalité du sommeil et du rêve, nous avons tous des habitudes, des facilités et des blocages différents dans ces domaines.
Certains se souviennent beaucoup de leurs rêves, d'autres pas du tout. Certains s'endorment facilement, d'autres souffrent d'insomnie. D'où l'intérêt du questionnaire de lucidité pour nous aider à mieux cerner notre fonctionnement (exercice 19).
Ce questionnaire se compose de 9 rubriques avec des questions à choix multiples ou ouvertes.
Voici ces rubriques :
La profondeur et qualité de notre sommeil,
Nous et notre vie onirique,
Nos rêves d'enfance,
Notre imagination et notre pensée visuelle,
Nos cauchemars,
L’insomnie et troubles du sommeil,
La dépression et anxiété,
La conscience,
Le rêve lucide.
Nous pouvons y consacrer une vingtaine de minutes, seul ou aidé par un ami. L'essentiel est de répondre le plus sincèrement et précisément possible. Il est aussi intéressant de compléter le questionnaire une seconde fois en notant nos réponses "idéales", pour visualiser là où on veut aller.
4.2 - Appliquer les meilleures techniques selon son profil de rêveur
Après analyse du questionnaire, nous pouvons nous identifier à un ou plusieurs des 15 profils type listés par l'auteure : petit/ gros dormeur, dormeur léger/ agité/ insomniaque, grand/petit rêveur, rêveur anxieux, hautement conscient, rêveur heureux, rêveur lucide, penseur visuel et imaginatif, lucide, victime de cauchemars, insomniaque rêveur contrarié, rêveur enfant prodige...
Pour chaque profil, "Le Guide du rêve lucide" partage un "programme de lucidité" avec des recommandations personnalisées parmi les nombreux exercices présentés. Il peut s'agir de techniques de relaxation, de visualisation, de travail sur les cauchemars, les paralysies du sommeil, le lâcher-prise émotionnel, le retour dans le rêve, les tests de réalité, le renforcement de l'intention, etc.
L'idée est de combiner les programmes correspondant à nos différentes facettes de dormeur/rêveur pour construire une routine adaptée. Des exemples de programmes type pour certaines associations courantes de profils sont fournis en annexe.
4.3 - Créer son programme de lucidité personnalisé
Une synthèse en 9 étapes pour appliquer concrètement la démarche est énoncée dans l’exercice 27 :
Répondre au questionnaire de lucidité.
Choisir parmi les 15 profils ceux qui nous correspondent.
Explorer les programmes associés et sélectionner 3 exercices de base.
Choisir un exercice de renforcement de l'intention.
Définir 3 tests de réalité à pratiquer.
Compléter le modèle de programme personnalisé fourni en annexe.
S'inspirer des exemples de l'annexe si besoin.
Définir sa routine de sommeil et ses objectifs de journal de rêve.
Démarrer le programme dès le soir et l'ajuster au fil du temps.
Ainsi, avec ce chapitre très concret et le questionnaire comme point d'appui, l'auteure nous aide à nous orienter parmi les nombreuses techniques d'induction des rêves lucides et trouver celles qui résonneront le mieux avec notre nature profonde.
Une approche résolument personnalisée pour cheminer vers la lucidité à notre propre rythme. Place désormais aux méthodes pour prolonger nos rêves lucides une fois dedans !
PARTIE 2 – Restez lucide : faites des rêves lucides plus longs et plus satisfaisants
Chapitre 5 - Exercices pratiques pour des rêves lucides plus longs
5.1 - Cultiver la sérénité
Une fois devenu lucide en rêve, le défi est de le rester.
Souvent, le débutant perd sa lucidité par excès d'excitation ou de distraction. L'enjeu est donc d'apprendre à stabiliser cet état de conscience si spécial, en cultivant le calme et la vigilance. La clé : s'entraîner le jour à remarquer et apaiser ses émotions pour mieux y parvenir la nuit.
Pour cela, "Le Guide du rêve lucide" nous invite à réaliser un exercice (exercice 28). Ce dernier consiste à observer le flux de nos émotions, les nommer, trouver des moyens de nous apaiser (respiration, visualisation de notre corps onirique). L’auteure suggère même d'utiliser la télé comme support de test de réalité, en pleine montagne russe émotionnelle ! Il s'agit d'ancrer une affirmation positive ("Je suis paisible et détendu") et un geste associé pour les réutiliser en rêve lucide.
5.2 - Les niveaux de lucidité
Ce passage détaille le spectre de la lucidité. Car :
"Le rêve lucide n’est pas une phase unique de vigilance mentale : il en existe plusieurs niveaux. En d’autres termes, la lucidité implique la vigilance et celle-ci connaît différents degrés d’intensité. Pensez au moment où vous êtes concentré. Quand vous terminez une tâche en un éclair. Quand vous jouez comme un dieu au tennis. Et pourtant, à d’autres instants, vous vous trouvez lent, vous rêvassez. Parfois, on commet des erreurs, par manque de vigilance. C’est la même chose dans l’état onirique."
L’auteure examine donc ces niveaux de lucidité : depuis la non lucidité totale jusqu'à la conscience transcendante du "vide lumineux", en passant par des états intermédiaires comme la pré-lucidité (on se questionne sans comprendre qu'on rêve), la lucidité brouillée par les émotions, instable ou au contraire limpide et prolongée.
Ainsi, notre degré de vigilance fluctue. Toutefois, nous pouvons apprendre à le rehausser volontairement, affirme Clare Johnson.
5.3 - Que ressent-on quand on perd sa lucidité ?
À travers un exemple de rêve lucide dans un champ de neige, l'auteure nous fait vivre de l'intérieur la dissolution progressive du rêve par excès de distraction ou d'émotion.
On comprend alors l'importance des techniques de stabilisation pour prolonger l'expérience. Pour l’auteure, s’il nous arrive de perdre sa lucidité très tôt au milieu d’un rêve, au lieu de se sentir frustré, mieux vaut prendre un temps pour noter son rêve, et le rejouer en visualisation en y insérant les techniques de stabilisation nécessaires.
5.4 - Les techniques de stabilisation pour rester lucide
"Perdre sa lucidité n’est pas forcément un combat – parfois on se réveille naturellement et c’est merveilleux. De temps à autre, notamment à la fin d’un long songe, on le laisse nous échapper. D’ailleurs, on ne s’en rend même pas compte, absorbé par l’action et les émotions oniriques au point d’en oublier sa lucidité. C’est seulement au réveil, en y repensant, qu’on réalise : "Tiens, je crois que j’ai perdu ma lucidité juste après que le bateau pirate s’est mis à couler." Bonne nouvelle, il existe des méthodes pour façonner l’état d’esprit attentif et lucide dont nous avons besoin pour naviguer dans ce monde des rêves halluciné et envoûtant."
- La technique CLEAR
Pour stabiliser notre lucidité, l’auteure nous propose d’essayer la technique CLEAR. Elle se réalise en 5 étapes (l'acronyme aide à mémoriser) :
Calmez-vous,
Lorgnez autour de vous,
Expérimentez dans le rêve,
Affirmez que vous rêvez,
Rappelez-vous vos objectifs oniriques.
- 8 nouvelles méthodes pour rester lucide
"Le Guide du rêve lucide" partage 8 exercices comme 8 autres façons de rester lucide :
1/ Le jeu des différences (exercice 30)
Le but est d’aiguiser notre sens de l'observation en listant les différences entre rêves lucides et non lucides (couleurs, logique, thèmes, sensations...). Un esprit de détective pour mieux repérer les indices de rêve.
2/ Faire de nos personnages oniriques des alliés (exercice 31)
Au lieu de nous laisser duper, apprenons à repérer les indices de lucidité de nos personnages oniriques (clins d'œil, pouvoirs étranges, regards perçants). Nous pouvons leur demander, avant de dormir, de nous aider à devenir rêveur lucide.
3/ Changer de point de vue (exercice 32)
Si la scène devient floue, évitons de fixer du regard et promenons plutôt notre attention d'un détail à l'autre pour stabiliser le rêve.
4/ Tourner comme un derviche (exercice 33)
Pivoter sur soi-même permet à certains de créer une "nouvelle scène stable". L’auteure confie qu’avec elle, cette méthode ne fonctionne pas et qu’elle peut donc ne pas marcher avec tout le monde. Toutefois, ajoute-t-elle, nous pouvons atterrir dans le "vide lucide" qui reste une vaste opportunité de création.
5/ Nous donner la main (exercice 34)
L’auteure décrit 5 façons d'utiliser ses mains pour rester lucide (les frotter, applaudir, teste de réalité, toucher le décor, les lever devant soi). Un grand classique !
6/ Activer notre cerveau grâce à l'arithmétique (exercice 35)
Des petits calculs simples suffisent à stimuler la vigilance et éclaircir le rêve.
7/ Parler aux personnes, objets et animaux qui peuplent notre rêve (exercice 36)
Dialoguer avec les éléments du rêve, même inanimés, renforce la lucidité et apporte de surprenantes révélations. Sinon, on peut aussi les lécher pour se reconnecter aux sensations !
8/ Se rappeler qu’on est dans un rêve lucide (exercice 37)
Un mantra chantonné ("je suis lucide"), un objet symbolique ou un pense-bête permettent de ne pas oublier qu'on rêve, malgré la force d'envoûtement du scénario.
En résumé, le chapitre 5 du "Guide du rêve lucide", riche en conseils pratiques, nous apprend à prolonger les rêves lucides, avec en filigrane l'idée d'un entraînement à la vigilance et au calme qui se poursuit le jour comme la nuit.
Place, à présent, aux techniques de transe éveillée et de méditation pour muscler encore notre lucidité.
Chapitre 6 - Entraînez votre esprit à prolonger le rêve lucide
Le sixième chapitre du "Guide du rêve lucide" nous fait observer que la lucidité onirique est comme un muscle qui se renforce avec la pratique. Ainsi, plus nous l'utilisons, plus il devient facile de rester conscient et concentré, même au cœur des rêves les plus fous.
Ce chapitre explore alors 3 approches pour consolider notre vigilance : les transes créatives, la méditation/ musique/ mantras et le yoga du rêve.
6.1 - Les 3 forces vitales du rêve lucide
Avant d’aborder ces 3 façons de nous entraîner à être lucide, l'auteure rappelle le trio gagnant pour ancrer la lucidité (ICE) :
L'Intention => la volonté de devenir rêveur lucide,
La Clarté => rester concentré malgré les distractions oniriques,
L'Expectative => s'attendre à réussir.
En exerçant ces 3 forces dans notre vie éveillée, on bâtit un état d'esprit robuste pour affronter sereinement les rêves.
6.2 - Trois façons de développer et d’ancrer notre lucidité
1/ Les transes créatives lucides
La transe lucide est un état de conscience qui mêle éveil et rêve, concentration et imagerie débridée. S'y entraîner permet d'apprendre à maintenir cet équilibre subtil si précieux pour les rêves lucides. De nombreux créatifs l'utilisent pour libérer leurs idées.
L'exercice 38 détaille la technique d'écriture lucide pour y parvenir : dans un état de relaxation, on revisite un rêve en le laissant se déployer puis on écrit sans s'arrêter, en restant dans le flux des images. Plus qu'un outil de créativité, c'est aussi un puissant processus de guérison, qui permet d'interagir avec nos rêves sans peur.
2/ La méditation, la musique et les mantras
Méditer en se focalisant sur son intention de rêver lucide a un double effet : cela augmente nos chances d'en faire, tout en développant une clarté d'esprit propice à les prolonger.
L'exercice 39 propose une méditation guidée complète, avec respiration consciente, mantra personnalisé ("je suis lucide"), visualisation, ancrage du calme et de la vigilance. Une variante : méditer à la bougie en observant la flamme pour induire une transe lucide.
Comme nos pensées influent sur nos rêves, la musique est également un bon support pour induire des vibrations de joie et de lucidité. Que ce soit avec des instruments, des chants ou des mantras mélodieux martelant notre intention, elle nous aide à rester concentrés et sereins.
L'exercice 40 nous invite alors à une transe musicale allongée, pour voyager dans nos rêves en pleine conscience, l'exercice 41 à créer une ritournelle entêtante de lucidité, et l'exercice 42 à utiliser notre voix chantée pour stabiliser le rêve de l'intérieur.
3/ Devenir un yogi du rêve lucide
Yoga, taichi, qi gong... Toute discipline corporelle qui allie souplesse physique et mentale est une alliée précieuse des rêves lucides. La posture de la montagne (exercice 43 : Tadasana) et celles d'équilibre comme le bateau (exercice 44 : Paripurna Navasana) ou l'arbre (exercice 45 : Vrksasana) sont particulièrement recommandées pour leur effet apaisant et fortifiant. Les pratiquer en rêve est jouissif !
6.3 - Trois exercices de stabilisation supplémentaires
"Le Guide du rêve lucide" partage 3 autres astuces sans tapis de yoga cette fois :
Raconter son rêve à voix haute à mesure qu'il se déroule en mentionnant souvent les mots "rêve" et "onirique" (exercice 46).
Se remémorer son objectif de rêve pour raviver sa détermination si la lucidité vacille (exercice 47).
Voler dans son rêve, pour se réancrer par les sensations et les changements de perspective (exercice 48).
Le chapitre 6 du "Guide du rêve lucide" nous enseigne une belle palette d'entraînements pour fortifier notre mental, du plus créatif au plus méditatif. De quoi prolonger sereinement nos escapades oniriques.
Notre prochaine étape est désormais d’apprendre à les piloter avec doigté. Tout un art !
PARTIE 3 – Dirigez vos rêves lucides : découvrez les meilleures techniques
Chapitre 7 - Dirigez vos rêves lucides grâce au pouvoir de la pensée et de l'intention
Une fois lucide en rêve, que faire ? "Tout ce que vous voulez !" s’exclame le Pr Clare Johnson.
Le rêve lucide ouvre un champ infini de possibles, des plus fantastiques aux plus introspectifs. Mais comment procéder ?
Le 7ème chapitre du "Guide du rêve lucide" partage les différentes manières d'orienter le cours de nos aventures oniriques.
7.1 - Être lucide ne veut pas forcément dire contrôler ses rêves
L’auteure commence par déconstruire un mythe: être lucide, assure-t-elle, ne signifie pas forcément contrôler le rêve. Nous pouvons très bien l'observer ou y participer passivement sans rien diriger.
Elle distingue alors 4 niveaux d'implication, de l'observation à la maîtrise continue :
"L’ observation passive" : lorsqu’ "on observe le rêve comme un film en taisant nos pensées".
"La participation passive" : quand "nous entrons dans le cours des événements en devenant lucide, sans vouloir consciemment les modifier".
"Le contrôle sporadique" : qui "nous permet de pousser le rêve dans une certaine direction ou d’interroger notre environnement onirique et d’en attendre une réponse".
"Le contrôle continu" : dans ce cas, "le rêveur s’efforce de guider et de diriger les événements tout au long du rêve".
7.2 - Les rêves réagissent à nos pensées et à nos émotions
L’auteure décrit également ici comment nos pensées, émotions, croyances influent constamment sur le rêve, lucide ou non, sans qu'on puisse tout contrôler. En fait, le rêve est comme un miroir qui reflète et amplifie notre monde intérieur. Il répond instantanément par des images à nos attentes, peurs et désirs.
Prendre conscience de cet écho permanent est alors la meilleure leçon de pleine conscience !
C’est pourquoi, note Clare Johnson, pour bien piloter nos rêves lucides, mieux vaut identifier au préalable nos croyances sur le rêve, l'éveil et la nature de la réalité. Elles peuvent en effet faciliter ou limiter nos expériences.
Pour nous y aider, l’auteure fournit un exercice (exercice 49 : "Testez votre système de croyance"). Celui-ci propose un questionnaire détaillé pour faire le point sur notre vision : du contrôle du rêve, du lien pensée-matière, des lois de la physique, de la nature des rêves, de notre identité et notre attitude en rêve...
7.3 - Les peurs liées à la maîtrise du rêve
Certains craignent qu'en contrôlant trop le rêve, on rate ses messages inconscients. Mais l'auteure nous rassure sur ce point : un rêve important reviendra de toute façon sous une autre forme tant qu'on n'aura pas saisi le message. Et la conscience lucide offre justement une opportunité d'introspection et de dialogue direct avec notre psyché, en plus des rêves non lucides qui continuent en parallèle.
Autre point soulevé par Clare Johnson : celle-ci nous invite à interagir avec souplesse et respect avec le rêve, comme une conversation où spontanéité et fantaisie gardent leur place. Pas de contrôle rigide mais une coopération ludique et curieuse. Comme dans la vie, l'important est de suivre son ressenti et d'expérimenter avec un esprit ouvert.
7.4 - Pourquoi les rêves lucides érotiques sont-ils parfois si difficiles à obtenir ?
Le sexe est un sujet brûlant en rêve lucide ! L'auteure explique que si le scénario prévu ne se déroule pas comme prévu (partenaire qui disparaît, etc), c'est souvent un problème de lucidité insuffisante plus que de contrôle.
Elle partage alors un exercice à réaliser (exercice 50 : "guide du rêve lucide réussi") qui fournit des conseils pour réussir ses rêves érotiques : bien visualiser son fantasme à l'avance, stabiliser d'abord la lucidité, faire apparaître son partenaire idéal par une incantation ou un rituel, explorer des sources de plaisir inattendues...
7.5 - Je n'arrive pas à voler dans mes rêves lucides ! Que se passe-t-il ?
Autre classique frustrant : l'échec à s'envoler. Là encore, c'est souvent un manque de lucidité stable couplé à des croyances limitantes sur ce qui est possible ou non. Il faut aussi savoir lâcher-prise et y mettre de la légèreté, informe Clare Johnson.
L'exercice 51 ("guide du vol en rêve lucide") prodigue de nombreuses astuces pour un décollage facile : s'attendre à voler sans effort, se rappeler que la gravité n'existe pas en rêve, sauter avec l'intention de s'envoler, utiliser son souffle, adopter la position de Superman... Le vol est une des expériences les plus grisantes et libératrices en rêve lucide.
7.6 - Se servir des personnes et des images que nous rencontrons dans nos rêves
Pour Clare Johnson, les personnages de rêves, humains, animaux ou entités sont de précieux alliés. Et en affinant notre perception, nous découvrons que ces derniers peuvent avoir des niveaux de conscience très variables, des zombies aux êtres "supraconscients". L'exercice (exercice 52) proposé dans cette partie du "Guide du rêve lucide" nous aide alors à les repérer.
Aussi, pour l’auteure, il est important de traiter ces personnages avec respect et bienveillance. De cette façon, nous favorisons des échanges riches et surprenants qui nourrissent autant la créativité que la quête de sens. Et parfois, souligne l’auteure, c'est le rêve lui-même qui semble nous répondre, par télépathie, au-delà des mots.
L'exercice 53 nous encourage à soigner ces relations pour stimuler et favoriser notre lucidité : ces amis oniriques nous laissent, en effet, des indices, nous guident, nous éveillent.
Au terme de ce chapitre 7 du "Guide du rêve lucide", nous possédons de nombreuses pistes et réflexions pour déployer tout le potentiel du rêve lucide, avec souplesse, curiosité et discernement. En bonus, des conseils ciblés pour réussir les rêves érotiques et s'envoler en toute liberté.
L’auteure propose, à présent, de nous apprendre à apprivoiser les cauchemars...
Chapitre 8 - Affrontez et accueillez vos cauchemars
Pour l’auteure du "Guide du rêve lucide", les cauchemars sont une occasion en or de pratiquer la lucidité. En effet, que l'on en prenne conscience en plein rêve ou au réveil, ils nous invitent à transformer la peur en amour et en curiosité pour en faire une expérience réparatrice.
Ce 8ème chapitre explore alors diverses techniques pour y parvenir.
8.1 - Pourquoi modifier un cauchemar ?
Clare Johnson nous fait d’abord observer que changer le scénario d'un cauchemar peut avoir un effet thérapeutique puissant, comme chez les victimes de stress post-traumatique qui revivent l'événement en boucle. En modifiant les images mentales de la scène, nous créons, en effet, un nouveau câblage neuronal qui remplace peu à peu l'ancien.
Cette "thérapie par imagerie mentale" fonctionne aussi pour des cauchemars plus anodins du quotidien (parler en public, déménager...). L'auteure la pratique avec succès dans ses ateliers d'écriture lucide, où les participants découvrent souvent des clés pour résoudre leurs mauvais rêves.
La technique qu’elle utilise pour changer ses cauchemars avec l’écriture lucide (exercice 54) consiste à :
Entrer dans une transe lucide en visualisant le cauchemar sans crainte,
Laisser les images se transformer en notant les associations d'idées,
Écrire ce nouveau scénario sans s'arrêter, comme s'il se déroulait en direct,
Consigner les enseignements et questionnements qui émergent,
Relire en soulignant les passages importants.
Clare Johnson souligne que nous pouvons adapter cette technique en "dessin lucide" ou "conversation lucide" enregistrée. L'important est de dialoguer avec l'inconscient en toute liberté pour dénouer le cauchemar de l'intérieur.
8.2 - Des solutions aux cauchemars
- L’imagerie lucide
L’auteure partage ici une technique qu’elle a elle-même développé pour solutionner les problèmes de cauchemars. Elle l’a nommé "la solution aux cauchemars par l'imagerie lucide" (LINS).
Celle-ci doit intervenir juste après un cauchemar. Elle utilise la visualisation :
"L’imagerie lucide, c’est comme le rêve lucide… mais éveillé. Ou comme l’écriture lucide, mais sans stylo. Il suffit d’observer et de guider les images visualisées."
Attention toutefois, l’auteure déconseille cette technique aux personnes anxieuses, dépressives, souffrant de psychose ou trouble de la personnalité, ou encore en cas de traumatisme ou de deuil.
Voici cette technique (exercice 55 : "la solution aux cauchemars par l'imagerie lucide") synthétisée en 5 étapes :
Prendre soin de notre corps : respiration, hydratation, confort.
Retourner dans notre cauchemar jusqu'au point de bascule émotionnelle, c’est-à-dire le moment où le rêve est devenu déplaisant, se rappeler qu’on est en sécurité, laisser les images émerger et faire des associations.
Identifier ce moment critique où la peur, l’angoisse, la culpabilité s'installe, et restaurer l’équilibre : "décidez de l’instant où vous souhaitez que les événements ou votre attitude changent" (choisir le moment juste avant le point de bascule fonctionne généralement assez bien, indique l’auteure).
S'imaginer lucide pour réécrire la suite : demander au personnage effrayant pourquoi il nous suit, faire en sorte qu’une scène sereine ou amusante se produise, faire intervenir des secours (ami puissant, objet magique, mantra de soin), changer d'attitude, jouer un autre rôle débarrassé de notre peur…
Se rendormir avec l'intention de rêver lucide.
- Dix actions utiles pour faire face aux cauchemars
Pour l’auteure, en répétant la technique de "l'imagerie lucide" , nous réagirons de manière plus créative la prochaine fois et induirons un rêve lucide réparateur. L'auteure partage comment, en listant 10 façons créatives d'agir dans un cauchemar lucide ou une visualisation (exercice 56) :
Demander de l'aide au rêve, calmement : "Envoie-moi de l’aide, s’il te plaît."
Offrir un cadeau inattendu : "Tout le monde aime les cadeaux. Les personnages les plus sinistres et les bêtes les plus féroces ne font pas exception".
Affronter le problème avec force : "Parfois, la priorité n’est pas de répondre avec amour et compassion. Dans certains cas, il peut être psychologiquement valorisant de réagir avec force, notamment, dans le cas de rêves rejouant des moments de notre vie où nous avons été victime de traumatisme, de maltraitance ou de harcèlement. C’est un rêve, après tout."
Capituler et observer ce qui se passe (souvent rien).
User de pouvoirs magiques.
Demander un présent au "monstre".
Se réveiller (en retenant son souffle ou remuant ses doigts de pied) ou fuir "malin" comme dans un film (par une trappe, en réalisant une série de saltos…).
Invoquer un bouclier protecteur.
Chercher le message caché : "Au milieu de la peur et de la confusion qui règnent dans le cauchemar, demandez au personnage, animal ou événement onirique, s’il a un message à vous transmettre. Vous assisterez peut-être à une transformation. Un terrifiant tsunami s’arrête tout à coup et vous montre un gros plan du patron qui vous harcèle : votre situation professionnelle vous submerge, mais de grands changements ne vont pas tarder."
Embrasser ce qui nous menace avec amour.
8.3 - Anxiété, malaise et peur en tant que déclics de lucidité
Dans un autre exercice (exercice 57), l’auteure partage un dernier conseil simple mais efficace pour mieux gérer les cauchemars : dès qu'on ressent un malaise éveillé, s'interroger "Est-ce que je rêve ?" et faire un test de réalité. Ceci permet d’en faire un réflexe salvateur en cas de cauchemar.
Et dans le cauchemar, le fait d’avoir conscience qu’on est en train de rêver, chassera la peur et nous permettra de creuser le message du rêve.
8.4 - La paralysie du sommeil
"Connaissez-vous cette sensation affreuse d’être paralysé au cours d’un rêve ? Vous fuyez un agresseur, mais vos membres se figent ; vous tentez d’avancer, mais c’est impossible et il se rapproche… vous sentez son souffle sur votre cou… Et vous vous réveillez. Votre cœur bat la chamade et vous avez encore les jambes lourdes tandis que vous essayez d’émerger de ce cauchemar."
Voilà ce qu’on appelle la paralysie du sommeil. Cela survient quand nous devenons conscient pendant l'atonie musculaire du sommeil paradoxal (impossibilité de bouger, sensations bizarres, hallucinations...).
C'est désagréable, concède l’auteure. Il n’en reste pas moins que c'est une porte d'entrée vers le rêve lucide et de fantastiques aventures lucides ! Mieux vaut donc l'accueillir sans résistance.
Voici alors quelques astuces clés pour mieux gérer la paralysie du sommeil (exercice 58) :
Ce phénomène intervient quand nous nous réveillons mentalement tandis que notre corps reste atone et notre esprit rêveur. Se rappeler alors qu’à ce moment-là, nous sommes déjà lucide et très proche du rêve.
Ne pas lutter contre les événements effrayants mais respirer, relâcher la peur et s'apaiser.
Tout observer en scientifique curieux.
Essayer d’activer son corps onirique (se frotter les mains par exemple) et d’entrer dans un rêve agréable.
Appliquer la méthode de l’imagerie lucide (expliqué dans ce chapitre, exercice 56) aux visions cauchemardesques.
Pour tout cela, il faut du courage, termine Clare Johnson, mais c'est un formidable tremplin vers l'aventure lucide.
8.5 - Comment se détendre auprès de personnages oniriques effrayants
Pour l’auteure du "Guide du rêve lucide", plutôt que d'avoir peur des apparitions, mieux vaut les voir comme des parts de nous, porteuses d'un enseignement.
L’exercice 59 nous explique alors comment se détendre face à des personnages oniriques effrayants
Retenons ici qu’en les accueillant avec amour, elles se transforment souvent en précieux alliés. Et que déconstruire ses croyances aide aussi à dédramatiser ces rencontres.
En résumé, le chapitre 8 du "Guide du rêve lucide" nous apprend à transmuter l'énergie des cauchemars en lucidité bienveillante, que ce soit par l'écriture, l'imagerie mentale ou directement dans le rêve. De quoi aborder nos peurs nocturnes comme une opportunité de nous libérer, de guérir et de grandir. Un travail exigeant mais ô combien gratifiant.
Chapitre 9 - Créativité, soin et expériences spirituelles lucides
Ce 9ème et dernier chapitre du "Guide du rêve lucide" explore les immenses potentiels du rêve lucide une fois qu'on a acquis une certaine maîtrise.
En effet, selon le Pr Clare Johnson, le rêve lucide peut stimuler la créativité, enclencher un processus de guérison physique ou émotionnelle, et même ouvrir sur des expériences spirituelles transcendantes.
De quoi aller encore plus loin dans l'aventure !
9.1 - Se connecter avec son artiste intérieur avec le rêve lucide créatif
Clare Johnson commence par rappeler combien nos rêves sont, avec leurs images fantastiques qui se déploient spontanément, un puits de créativité formidable. Dès lors, devenir rêveur lucide, c’est la possibilité d’interagir consciemment avec cette source d'inspiration inépuisable pour nourrir n’importe quelle démarche artistique.
L'auteure raconte, par exemple, comment un de ses rêves lucides lui a donné l'idée de rendre l'un de ses personnages de roman synesthète.
Par ailleurs, vivre des expériences oniriques extraordinaires (voler, respirer sous l'eau...) enrichit considérablement l'imaginaire. Sans compter le côté très immersif et multisensoriel propice à une créativité débridée.
L’auteure encourage ici (exercice 60 : "le rêve lucide pour une créativité débordante") à profiter de cet état si particulier pour :
Sortir de sa zone de confort en testant de nouveaux arts sans crainte.
Demander de l'aide au rêve qui répond en images.
S’ouvrir : "laissez le flux vous entraîner" écrit l'auteure.
Observer le processus créatif du rêve en direct : "soyez attentif aux éclats de pure créativité, tandis que le rêve insuffle la vie dans les plus minuscules détails".
Donner une impulsion initiale vers un projet puis se laisser guider.
Utiliser l'énergie puissante des cauchemars comme tremplin créatif.
9.2 - Comment fonctionne le potentiel réparateur physique et émotionnel du rêve lucide ?
Les rêves reflètent souvent nos traumatismes et problèmes émotionnels.
Pour l’auteure du "Guide du rêve lucide", devenir rêveur lucide nous donne la possibilité d'interagir avec ces images pour amorcer un processus de guérison, l'environnement onirique réagissant directement à nos pensées et intentions.
L'auteure partage l'exemple d'un homme surmontant sa peur du noir en affrontant en rêve lucide un placard menaçant qui finit par se déchirer. Quand on choisit d'envoyer de l'amour aux personnages effrayants, la transformation réparatrice opère, même inconsciemment.
De plus en plus de témoignages suggèrent que le rêve lucide aiderait aussi à traiter des problèmes physiques (acouphènes, tumeurs, douleurs...) grâce au pouvoir de l'esprit sur le corps. Des études montrent que nos actions oniriques ont des effets mesurables (rythme cardiaque, activité cérébrale...).
L'exercice 61 détaille alors comment induire cette guérison émotionnelle. Ainsi, face à une image effrayante ou malsaine :
Créer un cocon protecteur de lumière et réciter un mantra.
Stabiliser la lucidité pour favoriser l'état réceptif en utilisant la méthode CLEAR exposée dans le chapitre 5, exercice 29.
Envoyer de l'amour à l'imagerie négative sans chercher à la refouler.
Demander au rêve un signe ou un message réparateur.
S'attendre à recevoir de l'aide si besoin.
Un autre exercice (exercice 62) applique ces principes aux maux physiques. Ainsi, pour traiter une douleur physique, l’auteure nous invite, pendant notre rêve lucide à :
Diriger notre intention de soin vers la zone de notre corps concernée.
Former une boule de lumière de soin avec nos mains : frotter nos paumes, générer ainsi de une énergie de guérison et l’irradier sur notre corps.
Visualiser notre corps en parfaite santé.
Chanter ou réciter un mantra de soin.
9.3 - Le rêve lucide spirituel
Le rêve lucide, nous dit l’auteure, ouvre aussi des portes vers des visions mystiques, des rencontres avec des guides ou des divinités, et des fulgurances de conscience pure.
Clare Johnson a appelé "lumière lucide" cette clarté immanente, imprégnée de béatitude et de sentiment d'unité, qu'elle voit comme notre nature essentielle. Accessible dans de nombreux états modifiés de conscience, elle serait la source primordiale dont nous émanons. La contacter régénère en profondeur.
À ce propos, elle relate une expérience personnelle :
"Un jour, juste après une échéance éditoriale stressante, je me suis écroulée sur mon lit, totalement épuisée au point de me sentir physiquement malade. Soudain, ma chambre s’est remplie de lumière : une lueur chaude et dorée qui baignait mon corps et me semblait accueillante et bienveillante. Je flottais dans un bonheur lucide. Je me suis abandonnée à l’incroyable sensation de m’immerger dans une lumière pure et curative. J’ai fini par ouvrir les yeux : une heure et demie avait passé. Pas de rêve, seule la lumière lucide. Je me suis assise, étonnée par l’énergie qui me parcourait. J’ai sauté du lit, enfourché mon VTT pour une longue balade et j’ai roulé le long de la rivière, aux anges. Une sieste puissance 10 : j’avais rechargé mes batteries directement à la source. Je brillais comme une ampoule de 100 watts ! On se réveille de ces rêves lucides spirituels, comme illuminé de l’intérieur."
9.4 - Invoquer des expériences spirituelles
"Que nous soyons athées ou croyants, le rêve lucide peut mener à des expériences transcendantales dont nous nous souviendrons longtemps" écrit Clare Johnson.
L'exercice 63 propose plusieurs façons de susciter ces expériences spirituelles.
Pour y parvenir, voici ses conseils. Durant un rêve lucide ou n’importe quel autre état de conscience modifié :
Se visualiser en train de rencontrer une divinité de notre choix ou vivre l’expérience d’une lumière lucide, formuler une intention claire et répéter un mantra.
Suivre toute lumière inhabituelle (lune très lumineuse, arbre particulièrement vivant…) et s’y connecter sans crainte : "c’est peut-être un portail ouvrant sur une expérience spirituelle".
Méditer pour une connexion express au divin.
Flotter en l’air et faire un salto arrière avec la ferme résolution d'accéder à des sphères sacrées.
Poser des questions existentielles et métaphysiques au rêve.
9.5 - Le vide lucide
Si au cours de ces explorations, nous atterrissons dans un espace infini et sombre entre deux rêves, pas de panique !
Ce "vide lucide" n'est qu'une autre forme de lumière, soutient l’auteure. "Il s’agit juste d’une lumière noire (ou blanche ou multicolore) : l’espace entre les rêves, l’étoffe dont sont faits les rêves !" précise-t-elle. C’est un état extraordinaire qui recèle un potentiel créatif infini.
Pour ne plus en avoir peur et, au contraire, en savourer ses trésors, Clare Johnson nous conseille d'y amener un état d'esprit serein et méditatif (exercice 64).
"Rappelez-vous l’histoire du chiot qui arrive dans une caverne aux parois recouvertes de miroirs. Il découvre de nombreux chiots qui l’observent. Terrifié, il jappe… et les autres se mettent également à aboyer ! Il se précipite dehors, la queue entre les pattes. Le silence retombe dans la caverne. La curiosité l’emporte et il y retourne. Il se sent plus serein, plus courageux. Alors, à son grand ravissement, il croise cette fois une petite troupe très calme. Il agite la queue et ils lui répondent tous en agitant la leur ! Le vide lucide fonctionne de la même façon. Si vous avez connu des expériences oniriques effrayantes, apaisez vos craintes. Travaillez votre respiration, entourez-vous d’un œuf de lumière protecteur et rappelez-vous que vous êtes en sécurité. Apportez cette sérénité dans le vide lucide et votre expérience n’en deviendra que plus positive."
9.6 - L’expérience hors du corps
De même, si on a l'impression de se retrouver hors de son corps, il est important de dépasser sa peur pour profiter de cette prodigieuse liberté de mouvement et de perception. Ce n'est pas une véritable sortie définitive de son enveloppe charnelle (sinon on ne se réveillerait pas) mais plutôt une extension de sa conscience (exercice 65 : "comment déclencher une expérience hors du corps dans un rêve lucide et à l'éveil").
Au terme du chapitre 9 du "Guide du rêve lucide", nous sommes désormais capable de plonger plus loin dans la vaste mer du rêve lucide, en confiance, avec en plus la possibilité de créer davantage, de guérir et de s'éveiller à sa nature profonde. Comme un grand voyage initiatique qui ne fait que commencer, pour peu qu'on ose en franchir les portes... Car "ceci n’est que le sommet de l’iceberg des possibles du rêve lucide ! Le rêve lucide est un océan, un univers qui reste encore à explorer !" termine l’auteure.
Conclusion
"La lucidité, c'est la conscience" déclare Clare Johnson pour démarrer sa conclusion. En prêtant attention à nos rêves d’une façon générale, et en nous montrant curieux face aux rêves lucides, nous devenons plus éveillés et connectés, poursuit-elle.
Partageons donc cette richesse autour de nous ! Car, pour le Pr Clare Johnson, le rêve est un langage universel qui nous relie dans notre monde fracturé :
"Lorsque nous écoutons les songes d’autrui, c’est leur âme qui nous parle. Et que se passe-t-il quand deux âmes se parlent ? On s’éclaire ! On brille ! Ainsi, en partageant nos rêves, on ajoute un peu de lumière au monde."
Dans sa conclusion, l'auteure nous encourage à adapter les exercices à notre goût, à entretenir notre curiosité et à pratiquer régulièrement. Elle évoque des témoignages bouleversants de personnes ayant surmonté un deuil, des cauchemars traumatiques ou la maladie grâce au rêve lucide.
Comme une plongeuse explorant un monde sous-marin merveilleux, elle espère nous avoir transmis cet enthousiasme pour découvrir par nous-même tous les trésors du rêve lucide. Un voyage intérieur passionnant qui ne fait que commencer... Un "autre monde" à explorer.
Annexes
Les annexes comprennent un modèle pour créer son propre programme de lucidité personnalisé, en combinant les exercices les plus adaptés à son profil de dormeur/rêveur.
L'auteure fournit également trois exemples de programmes types pour nous guider dans cette démarche sur mesure.
Conclusion de "Le Guide du rêve lucide | 65 exercices et 15 programmes pour prendre les commandes de vos rêves" du Pr. Clare Johnson
Dans "Le Guide du rêve lucide", la Pr. Clare Johnson, pionnière dans l'étude et la pratique du rêve lucide depuis plus de 40 ans, partage un condensé ultra-pratique de ses recherches, expériences et enseignements sur cet état de conscience fascinant où l'on est conscient de rêver pendant son sommeil.
Trois points clés pour résumer ce qu’est "Le Guide du rêve lucide"
- Un mode d'emploi complet du rêve lucide
Véritable mode d'emploi pour cheminer vers la lucidité, ce guide fourmille de conseils, techniques et programmes pour apprendre à déclencher, prolonger et diriger nos rêves lucides.
Les 65 exercices proposés couvrent toutes les étapes clés : de l'entraînement diurne aux techniques du cycle du sommeil en passant par la gestion des peurs et la personnalisation de sa pratique.
Un parcours progressif et adapté à chacun pour devenir un véritable explorateur de sa vie onirique.
- Une boîte à outils pour déployer le potentiel des rêves lucides
Au-delà des techniques d'induction, Clare Johnson nous montre comment interagir avec nos rêves pour en faire de formidables outils de développement personnel.
Stimulation de la créativité, résolution des cauchemars, guérison émotionnelle et physique, expériences mystiques... : la lucidité ouvre un champ infini de possibles que "Le Guide du rêve lucide" nous apprend à cultiver, avec des exercices ciblés et des retours d'expérience édifiants.
- Une invitation à la connaissance de soi et à l'éveil
En filigrane, cet ouvrage est une véritable invitation à mieux se connaître et à s'éveiller à notre potentiel illimité.
En prêtant attention à nos rêves et en les explorant de façon consciente, c'est un voyage intérieur que nous entamons, riche en révélations sur nous-mêmes et en opportunités de transformation. Le rêve lucide devient alors un chemin vers plus de conscience, de liberté et de sagesse.
Pourquoi lire "Le Guide du rêve lucide" ?
Vous aurez entre les mains un mine d'or pour développer votre lucidité
"Le Guide du rêve lucide" s'adresse à tous : des néophytes aux rêveurs lucides confirmés en quête d'approfondissement. Chacun y trouvera des clés pour progresser à son rythme et selon ses aspirations.
Nourri par les dernières découvertes scientifiques et des décennies d'expérience, mais toujours avec un style clair et inspirant, ce guide est une mine d'or pour qui veut développer sa lucidité au quotidien comme dans ses rêves. Il donne vraiment envie de se lancer dans l'aventure.
C’est un incontournable sur le sujet, à conseiller à tous les explorateurs de la conscience !
Je recommande la lecture de cet ouvrage pour son exhaustivité et son côté très concret.
"Le Guide du rêve lucide" vous apportera d’innombrables clés pour expérimenter par vous-même cet état de conscience modifié si particulier et en goûter ses multiples bénéfices. C’est un livre qui intéressera tous ceux qui souhaitent élargir leur conscience et explorer le vaste potentiel de leur esprit !
Il ne vous reste plus qu'à vous glisser sous la couette et mettre en pratique les précieux conseils du Pr Clare Johnson pour des nuits riches en aventures et en découvertes !
Points forts :
Un guide ultra complet qui aborde tous les aspects du rêve lucide et propose 65 exercices pratiques et 15 programmes personnalisables.
Écrit par une pionnière dans l'étude et la pratique du rêve lucide depuis 40 ans.
L’approche axé développement et l’étude de tous les bénéfices du rêve lucide : créativité, guérison, connaissance de soi, expériences mystiques...
Points faibles :
Bien que scientifiques, certains termes - qui appartiennent au monde onirique et au domaine des états de conscience modifiés - peuvent sembler ésotériques.
Certains exercices demandent beaucoup d'entraînement et de persévérance avant d'être maîtrisés.
Ma note :
★★★★☆
Avez-vous lu "Le Guide du rêve lucide | 65 exercices et 15 programmes pour prendre les commandes de vos rêves"? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Clare Johnson "Le Guide du rêve lucide | 65 exercices et 15 programmes pour prendre les commandes de vos rêves"
Visitez Amazon afin d'acheter le livre de Clare Johnson "Le Guide du rêve lucide | 65 exercices et 15 programmes pour prendre les commandes de vos rêves"
 ]]>
]]>Résumé de "Réparer le futur : du numérique à l'écologie" de Inès Leonarduzzi : un essai audacieux sur les conséquences négatives du numérique et sur les moyens d'y faire face, par la fondatrice de Digital For the Planet, spécialiste en développement durable et en stratégie numérique.
De Inès Leonarduzzi, 2021, 222 pages.
Chronique et résumé de "Réparer le futur : du numérique à l'écologie" de Inès Leonarduzzi
Introduction
Inès Leonarduzzi est une entrepreneure digitale dans l'âme. Dès son enfance, elle se passionne pour Internet, qui vient d'apparaître au grand public. Elle est directement fascinée par les univers numériques. Jeune adulte, elle fonde avec deux amis Rouge Moon, une entreprise combinant art et numérique installée à Hong Kong.
Ensuite, elle entreprend une carrière nomade, travaillant à travers le monde en tant que consultante en numérique. Mais l'auteure réalise alors que les technologies, bien que porteuses de progrès, ne sont pas toujours utilisées de manière responsable.
Cette prise de conscience la mène à fonder Digital For The Planet, un mouvement prônant l'écologie numérique. Son objectif est de promouvoir un usage raisonné et juste des technologies, au service du bien commun.
L'écologie numérique
Contrairement à l'approche occidentale traditionnelle, qui traite les problèmes de manière isolée, Inès Leonarduzzi prône une vision globale, inspirée de la pensée orientale. Selon ce point de vue, l'écologie numérique ne s'adresse pas seulement à la question de la protection de l'environnement. Elle implique aussi des actions sociales, économiques et législatives pour protéger l'humain.
Inspirée par plusieurs penseurs de l'écologie, l'auteur cherche à souligner les liens entre pollutions numériques environnementale, intellectuelle et sociale. Son but est de reprogrammer les imaginaires et inventer de nouveaux langages pour faire face à ces enjeux.
"Je définis l’écologie numérique (ou digital ecology) comme l’étude des interrelations entre l’humain, la machine et l’environnement. Elle [l'écologie numérique] préconise des actions à la fois sociales, économiques et législatives, avec pour objectif la protection de l’humain et de l’environnement. Mais il s’agit aussi et avant tout d’un état d’esprit, nécessaire à la bascule d’une société numérique impondérée à un numérique résilient." (Réparer le futur, Introduction)
Digital For the Planet, la grande aventure
En quatre ans, le mouvement Digital For The Planet a accompli de grandes choses. Ce livre en est le témoignage ; il compile des études sur les impacts du numérique et rend hommage à tous ceux et celles qui œuvrent pour un monde numérique plus responsable.
Désormais dans la trentaine et devenue mère, Inès Leonarduzzi dit aussi avoir écrit ce livre pour son fils et pour tous ceux qui sont les plus vulnérables. Elle cherche moins à convaincre qu'à inspirer et à défendre la liberté et la beauté du monde.
Partie 1 — La pollution numérique environnementale
Autrefois perçu comme une solution propre et écoresponsable, le numérique révèle aujourd'hui sa face sombre et polluante. Il a en réalité un impact environnemental considérable. Loin de dépolluer, il contribue aux problèmes environnementaux de façon croissante.
En 2018, le numérique représente plus de 10 % de la consommation électrique mondiale, avec une croissance de 9 % par an. Les centres de données, essentiels au numérique, pourraient devenir plus énergivores que les autres secteurs industriels d'ici 2035.
Chapitre 1 — La fabrication des appareils
1 — Les coulisses du smartphone
En 2020, plus de 14 milliards de smartphones sont en circulation dans le monde, soit plus que le nombre d'humains. À Noida, en Inde, en 2018, Samsung inaugure une usine produisant 330 000 smartphones par jour. Cela montre l'énorme croissance de la production de ces appareils.
Cependant, cette expansion a un coût environnemental élevé. La fabrication d'un smartphone nécessite une grande quantité de matériaux rares et précieux, dont l'extraction contribue à la déforestation, à la pollution et à la dégradation des écosystèmes.
En effet, l'extraction de ces métaux rares requiert des procédés polluants et énergivores. L'auteure donne l'exemple de Baotou en Chine, un site dont la contamination radioactive est très préoccupante.
Il importe de se rendre compte que le numérique, malgré toutes ses qualités, repose sur l'exploitation de ressources limitées. Ce qui menace l'équilibre de la planète.
2 — Le lithium bolivien, au détriment du sel et des lamas
Le lithium, surnommé « or blanc », est un métal rare essentiel à la fabrication de batteries, notamment pour les voitures électriques. En Bolivie, dans le Salar de Uyuni, une vaste réserve de lithium est exploitée au détriment de l'écosystème local et au mépris des droits des travailleurs.
Ainsi, l'usage du lithium est ambigu. D'un côté, il offre des avantages environnementaux, notamment via la production de véhicules électriques sans émission de carbone. D'un autre côté, il pose des problèmes écologiques graves liés à son extraction (contamination des eaux et de la terre, déforestation, etc.).
L'auteure montre ensuite comment les ambitions économiques d'un pays, comme celles du président Evo Morales en Bolivie, intensifient la dégradation des terres et l'exploitation des personnes. Les communautés locales se sentent dépourvues face à des promesses politiques non tenues.
3 — Quelques grammes de Congo
En 2018, au Mali, Inès Leonarduzzi rencontre un homme engagé dans la protection des enfants travaillant dans les mines en République démocratique du Congo (RDC). Le Congo, qui abrite 60 % des réserves mondiales de coltan, est au cœur de l'industrie électronique mondiale.
L'exploitation des minerais est souvent réalisée par des enfants, dans des conditions de travail épouvantables et sans protection sanitaire.
Par ailleurs, les conflits armés autour de ces métaux entraînent une tension et des violences extrêmes, qui touchent aussi bien les humains que la faune et la flore. Les législations, bien qu'existantes, sont souvent insuffisantes pour protéger les travailleurs et l'environnement.
Elle plaide pour plus de transparence dans la chaîne d'approvisionnement des appareils électroniques. Selon elle, des lois plus rigoureuses sont nécessaires afin de minimiser les dommages humains et écologiques liés à l'industrie numérique.
La fabrication de nos appareils électroniques — et en premier lieu des smartphones — représente une part importante de la pollution numérique. Toutefois, d'autres défis se posent une fois ces appareils en circulation. C'est l'objet des chapitres suivants.
Chapitre 2 — Nos usages quotidiens
1 — L'Homo digitalis est un nouveau riche
Notre consommation numérique a explosé en une décennie. Le trafic internet mondial a triplé en cinq ans. Chaque jour, six personnes sur dix se connectent à Internet, ce qui génère 2,5 trillions d'octets de données, avec un impact environnemental équivalent à celui du transport aérien.
Cette dépendance au numérique illustre ce que l'auteure appelle le « syndrome du nouveau riche numérique ». Chaque action en ligne, comme l'envoi d'un selfie, consomme une quantité significative d'énergie. Nous utilisons quotidiennement Internet pour des tâches banales et souvent futiles, sans nous préoccuper des conséquences de nos actes.
Cela dit, la consultante en numérique rappelle que les technologies ne sont pas le problème en soi. En réalité, c'est plutôt l'absence d'alternatives énergétiques durables et l'utilisation excessive et mal informée des ressources qui doivent être mises en cause.
Elle plaide notamment pour une prise de conscience collective de la valeur de l'énergie. De la même manière que l'on apprend à gérer l'argent, nous devons apprendre à gérer nos usages numériques, gourmands en énergie.
Nous devons réfléchir aux sacrifices écologiques qui permettent notre confort numérique afin de chercher des moyens plus durables d'agir.
2 — Internet : une pieuvre de métal gourmande en électricité
Internet repose sur un réseau complexe de câbles en fibre optique — principalement enterrés sous les sols marins — qui assurent 95 % des communications mondiales. Ces câbles, longs de plus de 1,2 million de kilomètres, permettent le flux constant de données nécessaires pour maintenir la connectivité mondiale.
Le "cloud" n'a donc rien d'un espace virtuel au-dessus de nos têtes ! Il est en réalité constitué de centres de données physiques, dont la plupart se trouvent sur terre, et de câbles sous-marins enterrés dans les océans.
Historiquement, ces câbles suivent les mêmes routes que celles utilisées par le télégraphe et le téléphone. Aujourd'hui, ce sont les géants du numérique, comme Google et le reste des GAFAM, qui possèdent, gèrent et transforment à leur avantage ces infrastructures.
Les centres de données, où sont stockées toutes les informations numériques, consomment des quantités massives d'énergie. En 2020, leur consommation mondiale était estimée à 650 térawattheures, principalement pour alimenter les serveurs et refroidir les équipements.
Ces centres, nous dit-on, fonctionnent de plus en plus avec des énergies renouvelables. Mais c'est très insuffisant, selon Inès Leonarduzzi. Ils restent de grands consommateurs d'électricité et nécessitent également d'énormes quantités d'eau pour les besoins de refroidissement.
3 — Internet ne consomme pas que de l'électricité
En effet, Internet consomme une énorme quantité d'eau pour fonctionner, principalement pour refroidir les serveurs dans les centres de données. Ces centres utilisent de l'eau traitée dans des systèmes de climatisation pour éviter la surchauffe des machines.
Par exemple, les 800 data centers de Californie consomment autant d'eau que 158 000 piscines olympiques chaque année. L'eau est souvent évacuée après usage, ce qui contribue au gaspillage de ressources précieuses.
Bien sûr, des ingénieurs cherchent à réduire cette consommation. Le système de "free cooling" utilise l'air frais naturel pour refroidir les machines. D'autres techniques permettent de refroidir les serveurs par immersion dans l'huile ou l'eau.
Des entreprises comme Microsoft avec le projet Natick — qui vise à immerger des serveurs sous l'océan pour les refroidir naturellement— cherchent des alternatives. Cependant, même ces méthodes suscitent des questions quant à leur impact environnemental à long terme.
Par exemple, l'implantation de centres de données dans des régions froides comme la Norvège ou le cercle polaire soulève des questions sur l'équilibre thermique de ces régions. En effet, la chaleur des machines pourrait contribuer au réchauffement de ces zones géographiques.
En réalité, ces stratégies sont souvent motivées avant tout par des considérations financières, même si elles se présentent comme "écologiques".
4 — Les énergies vertes parfois grises
Les énergies renouvelables, comme le photovoltaïque et l'éolien, sont souvent considérées comme des solutions écologiques.
Cependant, leur production et leur infrastructure nécessitent des ressources non renouvelables, notamment des métaux rares, dont l'extraction et le traitement ont un impact environnemental significatif. Le transport, l'installation et le recyclage de ces technologies émettent également des gaz à effet de serre.
De plus, ces installations peuvent perturber les écosystèmes. La faune, comme les oiseaux et les poissons, sont touchés. Par ailleurs, l'auteure constate également des problèmes d'érosion des sols et d'inondation des vallées. Bien que ces énergies émettent peu de CO2, elles ne sont donc pas sans conséquences écologiques.
Nous voyons donc, grâce à ces exemples, que l'engouement pour les technologies "vertes" comme les voitures électriques et les énergies renouvelables doit être accompagné d'une réflexion sur leur véritable impact environnemental tout au long de leur cycle de vie.
En fait, nous devons non seulement améliorer ces techniques, mais aussi repenser nos modes de vie. Comment les rendre plus respectueux de l'environnement ?
5 — Réduire notre impact
Pour traiter cet aspect, Inès Leonarduzzi se remémore une jeune fille solitaire qu'elle croisait chaque matin dans le car scolaire. La disparition soudaine de cette jeune fille, qui souffrait de boulimie, l'a amenée à réfléchir sur la surconsommation numérique, qu'elle compare à un comportement compulsif similaire.
Elle souligne que la surconsommation est l'un des maux les plus préoccupants de notre époque. Le numérique représente 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce n'est pas rien. Pouvons-nous nous désintoxiquer ?
L'auteure prône un changement de comportement progressif et adapté, plutôt qu'une approche radicale. Parmi les actions simples à adopter, elle recommande à minima de :
Conserver ses appareils le plus longtemps possible ;
Privilégier le wifi plutôt que la 4G pour économiser de l'énergie ;
Éteindre sa box internet lorsqu'elle n'est pas utilisée.
Ces gestes simples permettent de réduire l'empreinte numérique tout en réalisant des économies financières et en conservant le confort technologique auquel nous sommes habitués.
Chapitre 3 — Le recyclage
1 — Agbogbloshie
Le bidonville d’Agbogbloshie au Ghana est devenu un cimetière pour les déchets électroniques, principalement expédiés illégalement depuis l'Europe et les États-Unis. Bien que la Convention de Bâle interdise l'exportation de ces déchets vers des pays en développement, ces appareils sont souvent déclarés comme "destinés à la réutilisation".
Sur place, des enfants et adolescents brûlent les appareils pour en extraire des métaux précieux, ce qui est à la fois nocif pour leur santé et l'environnement. Les substances dangereuses comme le plomb, le cadmium et le mercure contaminent les sols, les cours d'eau et l'air, avant de pénétrer dans les organismes vivants.
Malgré quelques initiatives positives — comme la création d'objets d'art à partir de déchets électroniques et des projets de recyclage respectueux de l'environnement —, la situation reste critique.
Alors, que faire ? La consultante en numérique aborde surtout la question de la responsabilité financière des fabricants concernant le recyclage, l'écoconception des appareils et l'amélioration du taux de recyclage.
Pour endiguer ce problème, il est également nécessaire, pour l'auteure, de mesurer et gérer plus efficacement la quantité de déchets électroniques, en promouvant une économie circulaire et en protégeant les travailleurs vulnérables.
2 — Des déchets ou des rejets ?
L'auteure considère que le langage influence notre perception du monde et notre responsabilité,-. Des termes comme "crise" et "déchet", par exemple, portent à confusion. Avec le mot "déchet", par exemple, nous avons l'impression que certains objets sont hors d'usage, alors qu'ils ont encore de la valeur.
Or, dans certaines cultures, rien ne se jette, tout se réemploie. Contrairement à la mentalité occidentale basée sur l'économie de la consommation, ces cultures font preuve d'imagination et d'humilité. Contre notre propension à extraire toujours plus de matériaux, Inès Leonarduzzi plaide ici pour une revalorisation des matériaux existants.
3 — L'économie des flux : et si les déchets créaient de la richesse ?
Notre société continue de valoriser la production de flux, comme en témoigne notre usage du plastique. En France, 5,5 milliards de bouteilles d'eau en plastique sont vendues chaque année. Ce phénomène enrichit les industries pétrochimiques tout en dégradant l'environnement.
Concernant les appareils électroniques, leur durée de vie peut être prolongée par des gestes simples. Nous pouvons, par exemple, remplacer les batteries de nos appareils plutôt que de les jeter.
Trop souvent, les consommateurs changent de téléphone ou d'ordinateur pour des raisons de performance ou sous l'influence de la mode, alors que la plupart de ces appareils fonctionnent encore bien.
La réparation et le recyclage sont des alternatives essentielles pour réduire l'impact environnemental. Consommer avec mesure, en étant conscient de l'impact sur la planète, devient aujourd'hui un signe de modernité.
4 — Le manque d'imagination et de volonté
Pour moins polluer, il faut non seulement réduire notre consommation d’appareils connectés, mais aussi mieux les produire. Cela implique de lutter contre l’obsolescence programmée et de prolonger la durée de vie des appareils en reconditionnant ou en réutilisant leurs composants.
Des initiatives comme les médailles des Jeux Olympiques de Tokyo, fabriquées à partir de déchets électroniques, montrent qu’il est possible de valoriser nos déchets.
Cependant, l'auteure considère que l’obstacle principal à cette transition reste notre manque d’imagination et notre excès d'ego, qui nous poussent à croire que l'économie et l'écologie sont incompatibles.
L'avenir, selon elle, dépendra de notre capacité à adopter une économie circulaire et à mobiliser les citoyens dans ce changement.
5 — S'inspirer des anciens
Pour avancer vers un futur plus durable, il est essentiel de s'inspirer de la nature. Après tout, cette "ingénieure" a bien fait les choses et a des milliards d'années d'expérience !
Le biomimétisme, c'est-à-dire l'innovation inspirée des écosystèmes naturels, offre des solutions ingénieuses qui s'appliquent à tous les domaines industriels, de la construction à l'aéronautique.
Cette approche est encore trop peu explorée. Pourtant, elle montre que la nature fonctionne en cycles sans produire de déchets ni consommer excessivement. L'exemple de la thermorégulation des ours en hibernation illustre comment nous pourrions repenser nos technologies pour qu'elles respectent ces principes naturels d'efficacité énergétique.
Inès Leonarduzzi raconte l'histoire de son grand-père, un homme analphabète mais doté d'une grande sagesse. Il lui avait enseigné que tout ce dont l'humanité a besoin pour résoudre ses problèmes existe déjà, si l'on a les yeux pour le voir et le cœur pour le partager.
Cette leçon rejoint les réflexions des chercheurs modernes qui affirment que nous disposons déjà des ressources nécessaires pour résoudre les grandes crises mondiales, à condition que nous apprenions à mieux les utiliser et les répartir.
Finalement, le biomimétisme n'est pas simplement une approche scientifique, c'est aussi une philosophie de vie qui nous invite à revoir notre rapport au monde et à utiliser les solutions que la nature nous offre tous les jours.
Partie 2 — La pollution numérique intellectuelle
Au-delà de l'impact environnemental du numérique, il existe des formes de "pollutions" numériques moins visibles mais tout aussi préoccupantes. L'illectronisme, ou l'incapacité à utiliser les outils numériques, par exemple, engendre de nouvelles inégalités dans une société de plus en plus dépendante du numérique.
Par ailleurs, l'usage excessif des technologies peut perturber nos capacités cognitives, altérer notre sommeil ou conduire à des dépendances préoccupantes. Ces formes de pollution intellectuelle sont subtiles mais omniprésentes, et elles affectent les individus sans qu'ils en soient toujours conscients.
Pour un numérique véritablement durable, il est crucial de prendre conscience de ces dangers et de développer des stratégies pour s'en prémunir. Comment ? En optimisant l'usage des technologies plutôt qu'en les rejetant.
Pour Inès Leonarduzzi, le défi est d'apprendre à utiliser ces outils de manière intelligente, en renforçant nos capacités cognitives plutôt qu'en les affaiblissant.
Chapitre 1 — L'illectronisme, l'illettrisme électronique
1 — Les laissés-pour-compte du numérique
L’illectronisme, ou l’incapacité à utiliser les outils numériques, touche un nombre croissant de personnes en France, jeunes et personnes âgées. Bien que la majorité des Français possèdent un équipement informatique, beaucoup rencontrent des difficultés avec des tâches simples comme envoyer un e-mail ou remplir des démarches administratives en ligne.
Cette situation est exacerbée par la fermeture progressive des centres administratifs, laissant des milliers de personnes dans l'incapacité d'exercer leurs droits fondamentaux.
Les personnes vulnérables, comme les allocataires de minima sociaux et les demandeurs d’asile, sont particulièrement touchées, car elles peinent à naviguer dans un monde de plus en plus dématérialisé.
L’illectronisme met en lumière une fracture numérique qui transforme le numérique en un outil discriminatoire. Parce qu'ils sont dans l'incapacité d'acquérir ou de se servir des outils numériques, certaines personnes sont privées de leurs droits.
2 — Pourquoi est-ce essentiel de lutter contre l'illectronisme ?
Selon Inès Leonarduzzi, délaisser une partie de la population face à la transition numérique n’est pas seulement une question sociale, c'est aussi une question économique.
En effet, lutter contre l’illectronisme pourrait générer un bénéfice annuel de 1,6 milliard d’euros, notamment via l'optimisation des téléprocédures. Selon l'auteure, l'administration publique pourrait économiser jusqu'à 450 millions d'euros par an.
De plus, les citoyens gagneraient un temps précieux au quotidien, par exemple en simplifiant la prise de rendez-vous médicaux ou les courses en ligne.
Mais pour l'auteure, le véritable problème va au-delà des aspects économiques. Les illectronés, souvent désireux d’apprendre, voient dans le numérique un moyen de rester connectés avec leurs proches.
Mais le déploiement des outils et des formations reste insuffisant. Il faudrait aussi convaincre les réfractaires des avantages qu'ils peuvent tirer de ces outils.
Inès Leonarduzzi souligne enfin que le numérique semble privilégier les populations urbanisées et actives. Pour ceux qui ne souhaitent pas s'équiper d'ordinateurs ou de smartphones, accéder à leurs droits devient un véritable parcours du combattant, ce qui exacerbe le sentiment d'exclusion et de frustration.
Une fracture numérique se creuse, créant ce que la consultante en numérique nomme une "France sans contact", divisée entre les privilégiés et ceux qui sont laissés pour compte dans cette révolution technologique.
Chapitre 2 — L'intelligence humaine à l'épreuve du quotidien
1 — Les enfants : la chair à canon numérique
En tant que mère, Inès Leonarduzzi s'est rapidement interrogée sur l'impact des écrans sur les enfants. Elle souligne que cette question n'a cessé de la préoccuper, même avant sa grossesse.
Lors de ses recherches, elle a découvert que les enfants sont naturellement attirés par les écrans en raison de leur lumière et de leur mouvement. Mais est-ce sans risque ?
Selon Leonarduzzi, les écrans peuvent être à la fois bénéfiques et dangereux pour les enfants.
D'un côté, ils peuvent servir d'outils d'apprentissage, aider les enfants souffrant de troubles d'apprentissage, et même développer certaines compétences cognitives.
Cependant, une exposition excessive peut entraîner des retards de langage, des troubles de l'attention et des difficultés à établir des relations sociales.
Il importe donc d'encadrer strictement l'utilisation des écrans chez les enfants, en adoptant une approche équilibrée qui alterne entre expériences réelles et virtuelles.
Pour aider les parents, Inès Leonarduzzi propose la méthode « EQE » basée sur trois valeurs :
L'équilibre, ;
La qualité ;
L'échange.
Cette méthode encourage les parents à alterner les activités numériques et non numériques, à veiller à la qualité des contenus visionnés par les enfants et à discuter avec eux de leurs expériences en ligne.
Inès Leonarduzzi critique également la réticence des autorités françaises à adopter des mesures de protection plus strictes. À Taïwan, par exemple, l'exposition excessive des jeunes enfants aux écrans est considérée comme une forme de maltraitance.
En France, des efforts sont réalisés pour sensibiliser les parents, mais il reste encore beaucoup à faire pour protéger les plus petits des effets potentiellement nocifs des écrans.
2 — Dors, tu n'es pas un robot !
Une enquête menée en 2016 révèle que plus de 90 % des personnes dormant près de leur téléphone consultent leurs messages la nuit, et 79 % y répondent immédiatement. Ces habitudes, courantes chez les adolescents, ont des effets préoccupants sur la santé.
En activant les récepteurs photosensibles de la rétine, la lumière bleue perturbe le rythme circadien et entraîne des troubles du sommeil, voire des maladies comme l’obésité ou le diabète.
Pour l'auteure, le sommeil devrait être un moment de déconnexion totale. Les adolescents sont particulièrement vulnérables, car le sommeil est crucial pour leur croissance. Des études montrent que les enfants possédant un smartphone dorment moins que ceux qui n'en ont pas, ce qui contribue à un phénomène inquiétant de « dette de sommeil ».
Inès Leonarduzzi souligne l'importance de sensibiliser davantage sur ce sujet, en particulier auprès des jeunes. Elle plaide pour une utilisation plus exigeante et consciente du numérique.
Elle insiste tout particulièrement sur la nécessité d'éduquer les jeunes aux effets néfastes des écrans sur le sommeil et rappelle que peu d'initiatives institutionnelles ou technologiques existent actuellement pour protéger les utilisateurs.
3 — L'hyperconnexion, cette amie toxique
Dans ce chapitre, Inès Leonarduzzi partage son expérience personnelle de stress numérique. Elle raconte comment la surcharge de travail et l'usage intensif de ses smartphones l'ont conduit à une fatigue extrême à un âge précoce.
À 26 ans, la pression constante d'être connectée et disponible en permanence l'a conduit à un épuisement professionnel ou "blurring" — un état où les frontières entre vie personnelle et professionnelle s'effacent complètement.
Pour l'auteure, cette pression est exacerbée par la culture actuelle de l'e-mail, qui est passée d'un mode de communication asynchrone à une exigence de réponse immédiate.
Les employés passent désormais une part significative de leur journée à gérer leurs e-mails, ce qui entraîne non seulement une augmentation du stress, mais aussi une baisse de la productivité.
Cette hyper-connectivité a donné naissance à de nouvelles formes de stress, comme la nomophobie et l'hypovibrochondrie. Ces termes neufs sont révélateurs de l'impact du numérique sur la santé mentale.
Inès Leonarduzzi propose finalement des stratégies concrètes pour réduire le stress numérique, telles que :
Fixer des créneaux horaires pour vérifier les e-mails ;
Désactiver les notifications et organiser ses messages ;
Limiter l'usage du téléphone le soir.
Chapitre 3 — Les algorithmes de l'addiction
1 — L'économie de l'attention
En 2014, Banksy, connu pour ses œuvres politiquement engagées, se détourne brièvement de la politique pour aborder l'addiction aux écrans à travers sa peinture murale Mobile Lovers. L'œuvre montre un couple enlacé, mais chacun est absorbé par son smartphone, ignorant l'autre.
Plus tard cette même année, une autre œuvre de Banksy représente un smartphone prenant racine dans une main, symbolisant son intégration profonde dans nos vies.
Ces deux œuvres illustrent la difficulté de réguler l'utilisation des écrans : nous serions "addicts" ou presque. Pourquoi ?
Selon Inès Leonarduzzi, il est essentiel de comprendre son origine. Elle se réfère, pour cela, à plusieurs chercheurs en sciences sociales. Tout d'abord, elle se réfère à Herbet Simon pour affirmer que nous vivons désormais dans des sociétés riches en information.
Par ailleurs, elle se tourne vers Yves Citton qui explique que l'attention des individus est devenue un enjeu économique crucial.
L'auteure illustre ce dernier point en affirmant que TF1 et Facebook sont avant tout des régies publicitaires, avant même d'être des chaînes de télévision ou des réseaux sociaux ! En effet, ces entreprises captent notre attention pour vendre des espaces publicitaires.
Pour l'auteure, cette course à l'attention mène une forme de pollution numérique intellectuelle. L'omniprésence des écrans, alimentée par ces modèles économiques, conduit à un déclin intellectuel marqué par l'augmentation des troubles de l'attention et de la concentration.
2 — Ceux qui nous piègent depuis la Silicon Valley
Dans la Silicon Valley, l'objectif principal des entreprises technologiques est de créer des applications qui captent le plus grand nombre d'utilisateurs. Comment ? En utilisant des stratégies qui exploitent les biais cognitifs pour encourager l'addiction aux écrans.
Notre attachement aux outils numériques n'est donc pas un simple effet secondaire. C'est une stratégie délibérée conçue par des experts en « expérience utilisateur » (UX designers), souvent formés en sciences cognitives.
Leur mission ? Concevoir des interfaces qui incitent les utilisateurs à réaliser des actions malgré eux, à travers des techniques appelées dark patterns.
Ces dark patterns incluent des mécanismes comme le fil d'actualité infini sur les réseaux sociaux ou les notifications répétitives. Ces techniques créent des habitudes addictives similaires à celles des machines à sous.
L'université de Stanford, par exemple, a été pionnière dans l'enseignement de ces techniques à travers son Persuasive Tech Lab, où des étudiants apprennent à manipuler les comportements des utilisateurs.
Mais l'avenir n'est pas si sombre. Heureusement, Inès Leonarduzzi souligne qu'une nouvelle génération de « designers éthiques » émerge. Ceux-ci cherchent à créer des interfaces qui respectent et aident les utilisateurs et non à les manipuler.
Encore une fois, pour elle, l'enjeu n'est pas de rejeter le numérique, mais de participer à la construction d'un futur numérique plus responsable.
]]>Résumé de « Faire plus avec moins » de Vicky Payeur : la créatrice du blog Vivre avec moins nous propose ici un condensé de son savoir et de ses conseils pour « redécouvrir l’abondance grâce à la frugalité » et apprendre à vivre mieux au jour le jour.
Vicky Payeur, 2022, 204 pages.
Chronique et résumé de "Faire plus avec moins" de Vicky Payeur
Avant-propos
Connaissez-vous le frugalisme ? Il s'agit de cette tendance à rechercher l'indépendance financière hors travail le plus tôt possible dans son existence. Autrement dit, prendre sa retraite dès 30 ou 40 ans ! Mais est-ce vraiment réalisable ?
Au Québec — pays de Vicky Payeur — comme ailleurs, la réponse est oui. À condition, bien sûr, de respecter certains principes de vie et d'avoir mis suffisamment d'argent de côté pendant les années de labeur.
Le mouvement FIRE, pour Financial Independence Retire Early est pionnier et particulièrement représentatif de cette tendance de fond des sociétés contemporaines. Il a émergé aux États-Unis dans les années 2010, quand des blogueurs ont publié leurs idées concernant l'épargne et la retraite précoce.
Vicky Payeur dit s'inspirer de tous ces auteurs du mouvement FIRE. Mais elle voudrait répondre à une question restée selon elle largement sans réponse : "comment vivre la frugalité au quotidien ?" C'est-à-dire concrètement (p. 8-9) :
« Comment faire augmenter la valeur de ses placements ?
Quelles stratégies utiliser pour réduire les impôts à payer ?
Comment travailler davantage ou gagner plus d'argent ?
Quelles dépenses est-il nécessaire d'enlever de son budget pour peut-être espérer vivre librement un jour ?
Comment épargner un peu plus chaque mois ? » (Faire plus avec moins, Avant-propos)
L'autrice s'est posé ces questions dans sa propre existence : en 2015, elle est passée d'un mode de vie hyperconsommateur à une existence frugale, principalement pour rembourser ses dettes. Aujourd'hui, elle est très heureuse de son choix et veut partager ses bons plans avec vous. Sympa, non ?
Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur son blog Vivre Avec Moins.
Introduction
"Frugalité est un mot que j'entends bien rarement. Probablement parce qu'il est souvent associé péjorativement à l'avarice ou, comme on dit, au fait d'être cheap. Personne ne souhaite être perçu ainsi dans une société où l'étalage des richesses et la démonstration d'exploits professionnels sont valorisés ! Cependant, il y a une nuance importante entre frugalité et avarice."
Quelle est-elle ?
L'avare ne veut pas se séparer de son argent ; il veut même en accumuler toujours plus, sans raison.
La personne frugale (ou le "frugaliste") est sobre, oui, économe, encore, mais elle n'est pas attachée à l'argent et pourra se montrer généreuse ou s'octroyer des plaisirs de temps à autre.
La frugalité ne date pas d'hier
En un sens, la frugalité est une habitude de grand-mère. Rappelez-vous ses petits plats et sa manie à "tout" réparer ou à tout garder. Eh bien, c'est l'inverse de notre mode de vie actuel et, pourtant, c'est vers cela que nous pouvons aller si nous le voulons.
Oui, penser sa consommation est (re)devenu essentiel ! Oui, penser, réfléchir à ce qui est utile et à ce qui ne l'est pas. Commençons petit à petit et voyons comment amplifier peu à peu cette attitude dans notre existence de tous les jours. L'enjeu est économique, mais aussi environnemental.
Oser devenir libre
"En consommant moins, mais mieux, on peut transformer notre budget en entier", dit l'auteur. Épargner : voilà la clé. Et ce livre est justement conçu pour vous aider à le faire de manière efficace. Certaines propositions peuvent paraître "extrêmes", mais c'est parce qu'elles visent à "atteindre des objectifs ambitieux".
C'est possible. Par ailleurs, être frugal ne veut pas dire arrêter complètement de travailler. Vous pouvez vous consacrer à des projets qui ont du sens pour vous, mais vous ne dépendez plus d'un emploi qui ne vous plaît pas.
À vous de définir exactement votre idée de la liberté financière. À vous, aussi, de laisser de côté les conseils qui vous plairont le moins pour adapter la méthode en fonction de vos aspirations profondes.
Partie 1 — L'heure des bilans
- Analyse
Au Québec, un tiers de la population environ vit d'une paie à l'autre sans pouvoir épargner ou en épargnant très peu. Pour Vicky Payeur, c'était la même chose. Jusqu'au jour où elle s'est mise en tête d'étudier les dépenses de son compte bancaire.
Elle donne ce premier conseil :
"Prenez le temps d'analyser votre situation financière en toute franchise et posez-vous la question suivante : "où va mon argent ?"." (Faire plus avec moins, Chapitre 1)
Posez-vous des questions telles que :
Combien est-ce que je dépense en… (restaurant, vêtements, etc.) ?
Quand ai-je réalisé ma dernière grosse dépense ?
Combien est-ce que j'épargne par mois ?
Jusqu'à quand pourrais-je survivre si je perdais mon travail demain ?
En fait, nous pensons souvent agir plus vertueusement que nous ne le faisons en réalité. Lorsque nous nous imposons cette petite analyse, nous voyons mieux où le bât blesse et ce que nous pouvons faire pour corriger le tir. Et cela vaut à 20 ans comme à 50 !
- Quotidien
Nous ne sommes pas les victimes. L'état de nos finances dépend de nous. Bien sûr, nous avons diverses obligations, mais il est toujours possible de revenir à la question : "qui a choisi de contracter ce prêt ?", etc.
Commençons donc par nous dire que c'est possible. Et que nous avons la responsabilité de gérer correctement notre argent. Chacun, en fonction de sa situation propre, peut faire un premier pas.
Quels sont les postes de dépenses que vous pouvez revoir ?
Les déplacements
Si vous avez besoin d'une voiture, interrogez-vous sur l'utilité réelle (et non symbolique) d'avoir une voiture neuve, en location (leasing) ou achetée avec un prêt, par exemple. Ne vaut-il pas mieux opter pour une voiture d'occasion ?
Et si vous ne possédiez pas de voiture ? Le quotidien deviendrait-il impossible ? Si la réponse est non, alors interrogez-vous sur le caractère nécessaire de cet achat et envisagez les autres options en comparant l'aspect financier (autobus, train, etc.).
L'hypothèque
Les prix des logements montent, grimpent, volent ! Vous voulez acheter ? Avez-vous les reins assez solides pour vous embarquer dans une hypothèque à long terme ?
Vicky Payeur met surtout en garde au niveau de la tentation de voir trop grand. Pensez votre logement en fonctions, ici encore, de vos besoins réels. Selon le nombre de personnes dans votre famille, vous aurez certes besoin d'une maison ou d'un appartement plus petit ou plus grand, mais à quoi bon vouloir un palace difficile à chauffer ?
Le ratio des dépenses mensuelles liées au logement devrait être d'un tiers (30 %) et idéalement d'un cinquième (20 %). Dans beaucoup d'endroits, il est difficile de tenir ce ratio, mais vous pouvez agir à d'autres endroits.
"En réduisant le coût obligatoire associé à votre habitation, vous aurez plus de marge de manœuvre pour les autres postes de dépenses et, par le fait même, pourrez épargner davantage." (Faire plus avec moins, Chapitre 2)
Les sorties au restaurant
Nous aimons tous aller au restaurant. Mais nous avons aussi tendance à y aller… beaucoup. Surtout lorsque nous travaillons à l'extérieur. Petit-déjeuner, déjeuner et dîner : parfois les trois repas y passent !
Faites le compte. Cela revient vite cher, vous verrez. Nous verrons dans la suite de l'ouvrage (partie 2) comment mettre en place une alimentation plus frugale et plus saine — sans pour autant nous priver du restaurant lors des occasions spéciales !
Les achats impulsifs
Les trois postes de dépenses précédents (voiture, logement, nourriture) sont souvent les plus gourmands et ceux qui nous empêchent d'épargner. Il faut y ajouter tous ces achats impulsifs qui allègent grandement notre portefeuille.
À quoi pensez-vous ? À la télévision que vous venez d'acheter ? Au cafe latte de 16 h ou à cette dernière paire de chaussures commandée en ligne ? Pas besoin de vous faire un dessin ; vous voyez certainement de quoi Vicky Payeur veut parler !
"Tous ces achats que vous faites parfois sans réfléchir ont un effet direct sur votre liberté. Plus vous dépensez, plus vous devrez travailler pour payer ces abonnements mensuels et ces achats spontanés. Chaque fois que vous utilisez votre carte bancaire, vous venez de retarder l'heure, le jour et l'année de l'atteinte de votre liberté." (Faire plus avec moins, Chapitre 2)
Cette dernière phrase peut faire réfléchir, pas vrai ? Gardez-la à l'esprit au moment de sortir votre carte bleue plus vite que Zorro.
Choisir sa vie
Bien entendu, personne ne vous demande de vivre une vie qui ne vous conviendrait pas. Vous avez le contrôle. Si, pour vous, cette vie plus dépensière vous satisfait et que vous pouvez vous l'offrir (même si c'est à crédit sur votre retraite anticipée), alors pourquoi pas !
Mais si vous avez l'ambition de moins travailler et/ou de vous consacrer davantage à ce que vous aimez vraiment, bref si votre vie ne vous convient pas en l'état, alors pensez-y…"Prenez quelques minutes pour analyser votre mode de vie actuel et les frais occasionnés", dit l'autrice. "Où aimeriez-vous habiter ? Quelle vie aimeriez-vous mener ?".
- Changement
Le changement est aussi psychologique et social. Nous avons l'habitude d'écouter certains discours qui nous poussent à la consommation. Mais correspondent-ils à nos valeurs et à nos aspirations ? Pas vraiment, ou rarement.
Changer dans le sens du frugalisme, c'est donc aussi ouvrir son esprit à d'autres manières de voir le monde et d'agir en son sein.
Par ailleurs, la motivation à vous limiter aujourd'hui peut être boostée par votre volonté à atteindre un objectif précis. C'est aujourd'hui que commence ce projet, et pas demain ! Établissez dès que possible votre pourquoi (votre objectif) et votre comment (les moyens pour y parvenir).
Progressez à votre rythme
"Ne vous inquiétez pas, je ne vous suggère pas de devenir un ermite dans le fond des bois, loin de la consommation de notre société capitaliste (bien que je trouve ce mode de vie inspirant !). Il suffit de modifier quelques-uns des gestes que vous accomplissez quotidiennement au profit d'une option plus économique." (Faire plus avec moins, Chapitre 3)
Autre point central qui est même la "règle d'or" selon Vicky Payeur : y aller à son rythme. Sans quoi, vous risquez fort bien d'abandonner rapidement.
Par ailleurs, utilisez ce que vous avez déjà. Prenons un exemple. Terminez tous vos produits de ménage habituels afin de penser à en acheter d'autres qui seront plus économiques et écologiques (par exemple en vrac).
Selon Vicky Payeur, la durée de "mise en route" d'un mode de vie frugal peut fortement varier selon les personnes. Dans son cas, cela lui a pris un an et demi pour "atteindre un niveau satisfaisant". "Il ne faut pas devenir fou et rechercher la perfection", dit-elle encore pour nous rassurer.
L'important, c'est d'être curieux et de tester les astuces. D'en faire de petites habitudes à intégrer dans votre quotidien progressivement. Laissez de côté celles qui ne vous correspondent pas et adoptez les autres !
Cherchez l'inspiration
Vous trouverez sur Internet différentes inspirations, des plus radicales (comme Mark Boyle et son livre L'homme sans argent) au plus softs.
Vous pouvez aussi trouver l'inspiration plus directement autour de vous. Nous avons parlé plus tôt de la grand-mère, mais cela peut être un cousin ou un oncle. Qui sait ! Demandez-leur comment ils font et ils partageront certainement leurs astuces frugales avec vous.
Mais Vicky Payeur ne veut pas s'arrêter là. Selon elle, vous pouvez devenir votre propre source d'inspiration. Comment ça ?
En fait, vous pouvez rapidement devenir "accro" à ce petit jeu de l'épargne. Dès que notre focale se concentre sur la liberté financière, vous avez envie d'éliminer les dépenses superflues. cela devient un jeu !
Persévérez
Comment tenir bon, même dans les moments difficiles ? L'autrice rapporte ici sa propre expérience et donne des dates précises :
2015-2016 : elle freine sa surconsommation et met de l'ordre dans ses finances.
2016-2018 : elle commence à voir son endettement se réduire peu à peu. En un peu moins de deux ans, elle rembourse 16 000 $.
2018-2019 : elle se constitue un fonds d'urgence pour "assurer sa sécurité financière". Elle décide de quitter son emploi au bout d'un an d'épargne.
2019-2020 : ce n'est pas toujours facile d'être complètement à son compte. Mais elle a réussi à ne pas s'endetter à nouveau et à vivre modestement, mais correctement.
2020-2021 : elle achète un bien immobilier avec son compagnon, beaucoup de dépenses en une fois, mais un investissement rendu possible par les efforts réalisés jusque-là !
"Parfois, il faut mettre la main à la pâte pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pour changer son quotidien." (...) Le chemin le plus facile pour y arriver, c'est celui de la frugalité." (Faire plus avec moins, Chapitre 3)
Petit à petit, vous pouvez voir le ciel s'éclaircir et penser non seulement à l'épargne, mais aux investissements financiers tels que la bourse ou l'immobilier.
- Doutes
"Êtes-vous obligé de parler de vos nouvelles motivations, de votre changement de vie ou de vos prises de conscience ? La réponse est non." (Faire plus avec moins, Chapitre 4)
Parfois, nous pouvons percevoir notre entourage comme un frein dans la réalisation de nos objectifs. À d'autres moments, ils sont une grande source d'inspiration et de motivation. À vous, donc, de voir quand et avec qui vous voulez partager votre nouveau goût pour la simplicité.
Vicky Payeur, pour sa part, a décidé d'ouvrir complètement les vannes, puisqu'elle a créé un blog dans lequel elle s'est mise à raconter son parcours, depuis ses erreurs jusqu'à ses réussites. Elle partage au quotidien avec son audience des trucs et astuces et répond aux questions qui lui sont adressées.
☀️ En véritable infopreneuse, elle propose aujourd'hui des ateliers et des formations pour aider celles et ceux qui le souhaitent à prendre le chemin de la frugalité. Bref, à sa manière, elle suit la méthode des rebelles intelligents proposée dans votre livre gratuit Vivez la vie de vos rêves grâce à votre blog !
Le jugement des autres
Le jugement des autres peut avoir une influence négative sur vous. Certaines personnes peuvent être fermées à ce mode de vie. D'autres peuvent (parfois même les mêmes) ressentir de la jalousie. Savoir s'y préparer permet de mieux affronter ce problème.
Comment faire ? En ne parlant pas quand vous n'en sentez pas le désir et en ignorant ceux et celles qui vous critiquent ou vous envient. Malgré ses activités de blogueuse, Vicky Payeur prône plutôt la voie du "en dire moins, c'est souvent mieux'.
Surtout lorsqu'il s'agit de parler de ce que vous arrivez à mettre de côté ! En effet, ce n'est pas la même chose de parler de ses difficultés et de trucs et astuces pour les surmonter que d'exposer ses objectifs et ses revenus réels.
La prudence est donc de mise. Mais dans tous les cas, vous restez maître de vos prises de parole.
Une histoire de collègues
Au travail, vous pourrez faire face à des collègues qui sont eux aussi dans des situations d'endettement ou de difficultés financières, mais qui refuseront (voire se moqueront) de vos objectifs frugaux. C'est ce qu'a vécu Vicky Payeur. Comme elle, laissez vos chemins se séparer.
Focalisez-vous sur votre propre réussite et adoptez la pensée positive.
"Aujourd'hui, je sais pertinemment qu'adopter la pensée positive dans mes différentes actions du quotidien a été la clef de ma réussite." (Faire plus avec moins, Chapitre 4)
La force des amitiés
À côté des personnes qui vous tirent vers le bas, il y — aussi ! — toutes celles qui vous aident dans votre parcours. Les vrais amis sont ceux qui accepteront de ne plus sortir au restaurant comme avant mais vous aimeront toujours autant.
Redécouvrez ensemble des activités que vous aviez perdues de vue, par exemple. Pourquoi ne pas se retrouver chez soi plutôt que d'aller dans un bar ? Aller se promener ou jouer aux cartes… Ce ne sont que quelques illustrations.
Vous pouvez également adapter certaines activités pour les rendre plus frugales. Par exemple : les vacances. Vous pouvez épargner tout au long de l'année dans l'optique de ces vacances entre amis que vous avez l'habitude de faire.
"Croire qu'on ne peut pas adopter de nouvelles habitudes par crainte de l'avis de ses amis ou d'autrui, c'est s'enfermer dans une cage sans même avoir essayé d'en sortir. Essayez de nouvelles choses, osez, puis vous verrez ce qui en découlera !" (Faire moins avec plus, Chapitre 4)
Partie 2 — Comment se vit la frugalité ?
- Avant
Revenons encore une fois à nos grands-parents. Non pas pour nier les progrès dont nous profitons aujourd'hui, mais pour éclairer de leur perspective notre tendance à l'hyperconsommation.
Ils avaient l'habitude de recycler et d'entretenir les choses ; nous jetons sans même prendre le temps de réparer. Qui a raison ? Prenons-les en exemple, soutient Vicky Payeur.
S'inspirer de la Grande Dépression
La grande crise qui fit suite au Krash boursier de 1929 intéresse beaucoup l'autrice. Selon elle, il y a même "7 astuces économes" à retenir en particulier :
« Cuisiner à partir de rien ;
Réparer avant de remplacer ;
Se divertir dans le confort de son foyer ;
Faire soi-même ;
Faire du troc ;
Dépenser seulement l'argent qu'on a ;
Réutiliser. » (Faire plus avec moins, Chapitre 5)
Retourner à la base
Nos ancêtres avaient beaucoup d'imagination pour vivre de peu ! En allant fouiller pour nous dans les savoirs de nos aïeux, la blogueuse retrouve plein de trucs et astuces qu'elle partage dans cet ouvrage.
Parmi les conseils supplémentaires, très pratico-pratiques, qu'elle donne à la suite du chapitre pour concrétiser les "7 astuces économes", vous trouverez :
Faire son bouillon (alimentation) ;
Sécher les poches de thé (alimentation) ;
Entretenir un potager (alimentation) ;
Réutiliser les vieux tissus (textile) ;
Raccommoder les vêtements (textile) ;
Revaloriser les emballages alimentaires (organisation) ;
Prendre des notes sur des vieilles enveloppes (organisation) ;
Etc.
À vous de consulter l'ouvrage afin de voir quels sont les trucs qui vous plaisent et vous paraissent réalisables chez vous ;). Maintenant, entrons dans le détail des propositions de Vicky Payeur.
- Alimentation
"Il faut arrêter de consommer en mode automatique et commencer à se poser les bonnes questions qui nous rapprocheront un peu plus de notre liberté financière. L'argent qu'on évite de gaspiller aujourd'hui est peut-être ce qui fera la différence entre une retraite à 45, 50 ou 55 ans, plutôt qu'à la mi-soixantaine !" (Faire plus avec moins, Chapitre 6)
La cuisine est sans doute l'un des endroits où nous pouvons agir le plus efficacement pour réduire nos dépenses et mettre en pratique le frugalisme. Voyons comment.
L'évolution de mon panier
Vicky Payeur raconte comment elle est passée d'un panier d'achat de 120 $ à 50 $ par semaine (et même à 20 $ lorsqu'elle remboursait ses dettes !). Plusieurs actions sont à mettre en place, comme utiliser ce que vous avez dans vos tiroirs et n'acheter que ce dont vous avez besoin.
Progressivement, vous pouvez également changer durablement vos habitudes alimentaires. Manger moins de viande est économique et écologique, sans compter que c'est également bon pour votre santé.
Autre astuce : être attentif aux aubaines : réductions en tout genre dans les magasins ou via des applications dédiées, par exemple.
Viser l'équilibre, pas les extrêmes
Il est important de continuer à s'alimenter correctement. Manger des pâtes au beurre tous les jours n'est pas la solution… Votre santé est plus précieuse que vos économies !
Manger frugal
Manger frugal, c'est donc manger des produits frais et variés. Bref, c'est manger sainement et économiquement en suivant ces 9 règles d'or de l'alimentation frugale (p. 83) :
« Ne rien gaspiller ;
Cuisiner ce que l'on a ;
Utiliser des techniques de conservation adaptées ;
Planifier ses repas ;
Connaître les prix ;
Adopter la semaine sans épicerie ;
Mettre en place un système anti-gaspillage ;
Faire pousser des aliments ;
Manger principalement des repas maison." (Faire plus avec moins, Chapitre 6)
L'autrice présente en détail ces 9 points et vous donne encore plus de conseils dans les pages qui suivent. Mais passons à la suite.
Les fameux gadgets de cuisine
Minimalisme et frugalisme vont de pair. Pas besoin d'avoir les nouveaux robots ménagers à la mode ou les ustensiles hyperspécialisés qui vous serviront trois fois dans l'année. Débarrassez-vous de tous ces gadgets inutiles, encombrants. Et surtout : ne les achetez pas ! Ou bien si vraiment c'est indispensable, achetez en promotion…
N'oubliez pas : les produits dits "révolutionnaires" censés vous "simplifier la vie" ne sont souvent que des machins compliqués qui, au final, ne vous font pas gagner une seule minute — et encore moins un centime.
Économiser un dollar à la fois
En apprenant la simplicité et le recyclage en matière d'alimentation, vous pouvez vraiment commencer à voir la différence dans votre portemonnaie et votre compte en banque. C'est l'un des domaines où vous pouvez être le plus créatif et le plus rapidement efficace.
- Logement
"Imaginez : chaque jour, le tiers de votre temps passé au travail ne sert qu'à mettre un toit sur votre tête. Réduire sa mensualité pour se loger est donc, sans surprise, une piste de solution majeure pour réduire vos dépenses de manière générale et alléger votre budget." (Faire plus avec moins, Chapitre 7)
Ne partons pas du principe que c'est impossible ; se loger à coût raisonnable est parfaitement faisable. Il y a des solutions plus radicales, telles que vivre en yourte ou sur un bateau, par exemple, et d'autres qui le sont moins. Explorons-les ensemble.
Les pièges à éviter
La première erreur est peut-être… de choisir une propriété "qui utilise le maximum de notre capacité d'emprunt pour l'hypothèque". À quoi bon ? Le plus important n'est-il pas de bien vivre au quotidien, sans se créer (trop) de stress supplémentaire ?
La modestie peut ici vous éviter de gros ennuis plus tard, lorsque vous devrez rembourser mensuellement votre prêt.
Autre écueil (lié au premier) : éviter de faire le "voisin gonflable", c'est-à-dire celui qui a tendance à gonfler son importance de biens trop chers pour lui, jusqu'à l'endettement insupportable.
Nous avons toujours tous tendance à nous comparer aux autres et à vouloir ce qu'ils ont (voire mieux). C'est la base sociologique de ce phénomène problématique.
Mais nous pouvons y résister. Au lieu d'agir de façon impulsive, attendez deux semaines ou un mois avant d'agir. "Il y a de fortes chances que vous ayez déjà oublié ce désir et que vous soyez rendu à autre chose", prédit Vicky Payeur !
Les autres frais
Il existe des dépenses plus essentielles que d'autres. Parmi celles-ci, bien sûr, le paiement de l'hypothèque ou du loyer, ainsi que les assurances diverses et les frais fixes (abonnements à l'électricité, internet, eau, gaz) qui nous permettent de vivre confortablement et en sécurité au jour le jour.
Par contre, réfléchissez aux dépenses qui sont accessoires. Cela dépend de chacun, mais voici quelques exemples :
Femme de ménage ;
Entretien paysager ;
Télévision câblée (ou abonnement Netflix) ;
Etc.
Se loger à petit prix
Dans cette section, l'autrice vous donne quelques idées pour vivre de façon moins conventionnelle et plus économique — voire plus rentable :
Opter pour un petit logement (genre tiny house, yourte, etc.) ;
Vivre en colocation ;
Habiter avec ses parents ;
Déménager dans une autre région ;
Louer une partie de son bien immobilier ;
Vivre en van ;
Faire du "home sitting" (gardiennage de maison) ou du WWOOFing (travail contre logement) ;
Etc.
Les solutions sont nombreuses et très variées !
Vivre de façon alternative, même avec des enfants
Peut-être pensez-vous que ces solutions sont réservées à des jeunes gens. Impossible d'agir de la sorte quand on a une famille ! Et pourquoi pas ? L'autrice rapporte plusieurs anecdotes de parents vivant frugalement et différemment en ayant un ou plusieurs enfants.
Hypothèque ou location ?
Impossible à dire de façon générale. "Pour savoir si vous gagnez à louer ou à acheter une propriété, il vous faudra sortir la calculatrice", prévient Vicky Payeur. Toutefois, il est possible de mettre en évidence quelques avantages et inconvénients de chaque situation.
Pour la location :
Prix fixe chaque mois (+) ;
Mais possibilité de hausse du prix du loyer au renouvellement du contrat, voire d'expulsion (-) ;
Moins de frais liés à l'entretien (+) ;
Mais moins de liberté d'action (-).
Pour l'achat/hypothèque :
Marge de manœuvre accrue (+) ;
Mais frais "surprises" (-) ;
Épargne "forcée" qui nous permet de constituer un capital (+).
- Loisirs
"Plutôt que de dépenser votre argent en biens matériels, dépensez-le en nouveaux apprentissages. Le savoir est la seule chose que personne ne pourra jamais vous retirer." (Dominique Loreau, L'art de la simplicité, Cité dans Faire plus avec moins, Chapitre 8)
Nous avons plus de loisirs aujourd'hui qu'avant, mais souvent nous passons notre temps libre à passer d'une activité payante à une autre. Pourtant, il est tout à fait possible de profiter du quotidien sans en faire des tonnes.
Vivre plutôt que consommer
Les émotions que nous ressentons lorsque nous achetons quelque chose (bien ou service) ne durent généralement pas. En revanche, celles qui nous prennent lorsque nous vivons quelque chose de fort, fortuit et gratuit, celles la restent ancrées en nous.
Ces expériences peuvent être de différentes natures : bénévolat ou simple jardinage, il y a le choix ! L'idée consiste à se détourner des possessions et du matériel pour insister sur le moment passé ensemble.
Le coût des loisirs
Vous pouvez limiter les dépenses et mieux profiter de l'existence. Comment ? En réfléchissant à vos achats de "gadgets". Encore une fois, il tient à vous seul de savoir ce qu'est, pour vous, une dépense légitime et une dépense superflue.
Si vous faites un sport, par exemple, certaines dépenses seront nécessaires. Mais comment les gérer ? Vicky Payeur vous propose de mettre tout cela par écrit et de faire le point.
Quelle est l'enveloppe budgétaire que vous avez consacrée en un an à votre loisir principal (sport, activité culturelle) ? Êtes-vous heureux du résultat et souhaitez-vous continuer ainsi ?
Et les autres activités ?
Lesquelles vous semblent pertinentes et satisfaisantes ? Lesquelles pourraient être supprimées ou limitées ?
Les modes
Les stigmatisations vont bon train. Pour les sports, on vous reprochera de ne pas avoir le matériel dernier cri. Pour la musique, par exemple, certains vous demanderont pourquoi vous n'avez "que" la version freemium…
Nous l'avons déjà dit : nous sommes influencés par nos pairs. Cela vaut dans le domaine de l'alimentation et du logement comme du loisir. Mais vivre sobrement, c'est penser différemment et c'est donc "arrêter de faire… comme tout le monde" !
Les activités déjà payées à même les taxes
Eh oui, chaque année, nous payons en impôts et en taxes des infrastructures et des institutions de loisirs dont nous aurions bien tort de nous priver. Par exemple ?
Au niveau du sport :
Chemins de randonnée publics et gratuits ;
Parcs municipaux et infrastructures sportives qui y sont installés ;
Sentiers, trottoirs et pistes cyclables pour courir ou faire du vélo ;
Groupes d'entraide et de création d'événements gratuits ;
Piscines municipales (moins chères) ;
Etc.
Au niveau culturel :
Musées (parfois gratuits) ;
Festivals et spectacles gratuits l'été ;
Bibliothèques ;
Conférences et cours gratuits ;
Quartiers et villages proches ;
Groupes et associations locales ;
Etc.
En outre, vous pouvez vous divertir en restant chez vous. Recréez, par exemple, l'ambiance cinéma à la maison… Ou profitez de votre temps libre pour écrire sur des thématiques qui vous intéressent ou jouer de la musique en autodidacte…
Des loisirs modestes
Vicky Payeur a plein d'idées ! Elle propose de noter les activités en fonction de leur coût ($$$, $$, $ ou 0) et à voir ce que vous pouvez changer par des loisirs gratuits et "modestes". Il y en a pour tous les goûts :
Au niveau du sport (utiliser les infrastructures gratuites pour courir, faire du vélo, jouer au ping-pong, etc.) ;
Ou des activités culturelles (depuis les visites gratuites, jusqu'aux conférences citées plus haut, etc.) ;
Et des activités domestiques (comme le jardinage, la construction/restauration de meubles, etc.) ;
Ou sociales (bénévolat, organisation de dîner partagé ou de pique-nique, chez soi ou dans la nature) ;
Etc.
L'autrice donne une foule d'idées impossible à reproduire ici. Consultez l'ouvrage pour vous faire une meilleure idée !
Voyager léger
Faire le tour du monde sans argent ? C’est ce qu’ont fait Muammer Yilmaz et Milan Bihlmann pour démontrer que c’était possible. Vous ne souhaitez pas aller jusque là ? C’est compréhensible.
Voyons donc les solutions qui s’offrent à vous. :
Être flexible (si vous travaillez de chez vous en freelance, par exemple, c'est plus facile de voyager les jours "creux") ;
Faire du couchsurfing ;
Prendre le bus de ville et acheter vos propres aliments au lieu d'aller au resto tous les jours ;
Aller dans des pays où vous avez un meilleur pouvoir d'achat (en Asie, notamment).
La frugalité et les loisirs dans la vraie vie
Il y a un équilibre à trouver entre le souhait d'épargner et l'envie de vivre le moment présent. L'important consiste à ne pas devenir avare. Sachez dépenser votre argent, mais dépensez-le sagement !
"La frugalité n'est pas la privation", répète Vicky Payeur. "C'est économiser là où d'autres dépensent tout leur argent et le faire de manière intelligente et réfléchie", conclut-elle.
- Apparence
Combien dépensez-vous par mois en vêtements et soins personnels ? Pour un Canadien, c'était en moyenne 400 $ par mois en 2019. Si cela vous semble beaucoup, faites votre propre compte. Vous aurez peut-être des surprises !
La différence entre besoin — quelque chose de nécessaire à notre bien-être — et désir — plus proche du caprice inutile — est ici importante.
Moins, c'est mieux !
Vicky Payeur prête beaucoup d'attention à son physique, mais elle le fait de façon minimaliste et frugaliste.
Elle a fait le vide et n'a gardé que 20 % de sa garde-robe ; ce qu'elle porte vraiment. Elle a aussi modifié son style pour qu'il soit plus simple et que ses vêtements soient plus faciles à assembler au quotidien.
"La confiance en soi est probablement le plus bel accessoire", dit encore Vicky Payeur. Plus besoin de chercher le dernier sac à la mode, contentez-vous d'être bien dans vos baskets !
Les vêtements
Réduire ses achats vestimentaires passe par :
Un tri de sa garde-robe et par l'appréciation de ce qu'on a déjà ;
De petites retouches par-ci par-là pour garder ses vêtements plus longtemps ;
Des achats de seconde main, des friperies ou des échanges, etc. ;
Via de petites (e-)boutiques ou des sites/applications de petites annonces ;
Des achats de qualité !
L’autrice recommande d’éviter certains tissus qui se dégradent plus rapidement comme l’acrylique et la viscose et privilégier des matières organiques comme le lin ou le coton.
Les cheveux
Parfois, nous dépensons des sommes folles chez le coiffeur. Et nous pensons qu'avoir du shampoing chez soi est tout simplement évident. Mais il y a des alternatives…
Au menu de cette section :
La méthode no-poo à base de bicarbonate de soude et de vinaigre de cidre de pomme ;
Du savon ;
La réduction des produits utilisés (surtout pour mesdames).
Pour le coiffeur ? À vous de voir. Vous pouvez aussi apprendre à couper les cheveux de vos proches.
Le corps
Vicky Payeur relate avoir ressenti un mal-être physique très jeune, alors qu'elle avait à peine 24-25 ans. Elle s'est rendu compte qu'elle bougeait peu et ne mangeait pas toujours bien. Pas besoin pour autant de dépenser une centaine de dollars en abonnement à la salle de gym ou en équipement.
Vous pouvez suivre les conseils déjà donnés plus haut (chapitre 8 sur les loisirs). Quant à l'autrice, voici sa routine santé quotidienne :
Faire une balade dehors de 30 minutes au moins ou faire une activité sportive ;
Boire de l'eau tout au long de la journée ;
Soupe et salade au moins une fois par jour ;
Bien dormir !
J'achète, donc je suis
La pression sociale peut être forte : nous voulons être beaux et belles pour apparaître parmi nos collègues et nos amis. Alors, nous recourons aux moyens les plus aisés… mais souvent les plus coûteux.
Et pourquoi ne pas se simplifier la vie ? Cela ne signifie certainement pas arrêter de prendre soin de soi. Au contraire ! En consommant de façon réfléchie, vous vous sentirez mieux et cela se verra.
- Famille
"Avoir des enfants, ça coûte de l'argent." (Faire plus avec moins, Chapitre 10)
Certes. Et même beaucoup. Et pourtant, là encore, il est possible d'économiser. Il n'est pas question de parler ici de l'éducation proprement dite. Simplement de faire un petit arrêt sur image pour se demander ce que nous faisons et se rappeler ce que nous aimions quand nous étions enfants.
Êtes-vous influençable ?
Nous voulons être de bons parents. Alors, nous écoutons les publicitaires nous raconter que ce produit est essentiel au bien-être de notre bambin (ou de nous-mêmes). Nous capitulons devant leurs arguments. Bref, nous nous montrons influençables.
Si vous remarquez ce ciblage marketing, prenez vos distances. Interrogez toujours le caractère "nécessaire" et "essentiel" de ce produit ou de ce service. Cache-t-il un vrai besoin ou seulement un désir ?
Réduire le rythme
Autre point : voulons-nous que nos enfants aient des horaires de ministres ? Pas nécessairement. Ralentir le rythme est à la fois sain pour eux et pour la vie financière de la famille.
Leur créativité n'en sera pas abîmée, détrompez-vous ! Un peu de temps, un peu d'ennui est plus que nécessaire au développement des aptitudes créatrices des petits comme des grands.
Les objets de seconde main
Vos familles et vos amis vous donnent de vieux vêtements et des objets de leurs précédents enfants ? Quel bonheur ! Si ce n'est pas le cas, tournez-vous vers du seconde main dès que c'est possible. Surtout pour les vêtements, qui ont souvent la vie courte.
Bien sûr, la sécurité doit avoir votre priorité : un siège-auto ou ce genre de choses devront être adaptés à votre environnement et devront donc peut-être être achetés neufs.
Emprunter et échanger plutôt qu'acheter ?
Aujourd'hui, il existe de nombreux groupes, notamment sur Facebook, pour s'échanger des objets en tout genre ou emprunter ce dont nous avons besoin. Cela vaut aussi pour les jouets et autres objets infantiles. Pourquoi ne pas essayer ?
La nature comme terrain de jeux
Nous l'avons dit plus haut : le monde autour de nous recèle d'espaces où découvrir le monde et où faire ses premiers pas et ses premières expériences. Il suffit souvent de quelques kilomètres pour trouver un parc ou un espace naturel où faire évoluer son enfant en toute liberté.
"Laisser à un enfant du temps de jeu libre et actif en nature lui apporte de nombreux avantages qui lui rendront service tout au long de sa vie." (Faire plus avec moins, Chapitre 10)
Les trois cadeaux
La frugalité en famille repose également sur l'apprentissage d'autres voies possibles à côté de la surconsommation. Les cadeaux sont souvent l'occasion d'un excès. Mais pourquoi ne pas en faire un rituel vertueux ?
Vicky Payeur propose d'offrir 3 cadeaux (à se répartir entre parents et grands-parents, par exemple) :
Quelque chose que l'enfant veut vraiment ;
Une chose dont il a vraiment besoin ;
Un livre.
Voici une autre idée : offrir quelque chose de commun pour la famille. Par exemple : une activité à pratiquer tous ensemble.
Conclusion sur "Faire plus avec moins" de Vicky Payeur :
Ce qu'il faut retenir de "Faire plus avec moins" de Vicky Payeur :
"Adopter des habitudes frugales au quotidien est LA façon viable pour atteindre ses objectifs de devenir libre financièrement et de prendre sa retraire hâtivement." (Faire plus avec moins, Conclusion)
Selon Vicky Payeur, il est souvent difficile de faire jouer son salaire. Nous ne savons pas avec certitude si nous gagnerons plus dans 5 ou 10 ans. Il est donc préférable de commencer dès maintenant à épargner, petit à petit.
Certes, cela demande du travail et quelques efforts. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Tant d'un point de vue économique qu'éthique. Finalement, c'est la porte d'entrée vers vos objectifs de vie !
Points forts :
Un manuel très clairement présenté ;
Plein de conseils pour commencer à épargner tout de suite ;
Une belle mise en page ;
Une annexe avec des recommandations de lectures utiles ;
Des résumés à la fin de chaque chapitre.
Point faible :
L'aspect blogging (qui permet d'augmenter ses revenus en faisant quelque chose qu'on aime) est peu abordé, ainsi que les façons plus proactives (placements en bourse, investissements) de développer son capital financier.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu le livre de Vicky Payeur « Faire plus avec moins » ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Vicky Payeur « Faire plus avec moins ».
Visitez Amazon afin d’acheter le livre de Vicky Payeur « Faire plus avec moins ».
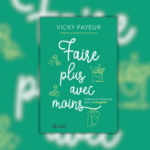 ]]>
]]>Résumé du livre de « 10 % plus heureux. Un candide au pays de la méditation » de Dan Harris : un livre en forme de biographie et de manuel de développement personnel où l’auteur partage son expérience du stress et nous montre comment en sortir grâce à la méditation.
Dan Harris, 2019 (2014), 324 pages.
Titre original : 10 % Happier.
Chronique et résumé de "10 % plus heureux" de Dan Harris
Chapitre 1 - Ça tourne !
En 2004, alors qu’il est en plein direct de la célèbre émission de télévision Good Morning America, le journaliste Dan Harris est victime d’une crise de panique. Il éprouve alors ce que les médecins appellent la « faim d’air », une sensation physiologique qui donne à une personne l’impression que ses poumons ne peuvent pas absorber suffisamment d’air.
C'est cet événement traumatisant qui a donné le point de départ au voyage entrepris par l'auteur pour découvrir l'origine de cette panique, ainsi que les moyens pour éviter que cela ne se reproduise.
Mais justement : d'où vient-il exactement ? Telle est la première question à se poser. En fait, Dan Harris raconte comment il en est arrivé à travailler pour ABC News, une grande chaîne nationale aux États-Unis.
Âgé d’une vingtaine d’années, Dan Harris était ambitieux. Lorsqu’il commence à travailler à ABC, à 29 ans, le jeune journaliste correspondant veut plaire à son chef de rédaction, Peter Jennings. Il en fait beaucoup. Trop sans doute. Le burn-out n’est pas loin.
Surviennent ensuite les attentats du 11 septembre 2001. Dan Harris et son équipe couvrent le désastre. Plus tard, alors qu’il est correspondant au Moyen-Orient, l’auteur raconte qu’il ressent très fortement ce qu’il appelle « l’héroïne journalistique ».
Qu’est-ce ? Le fait de devenir accro à la montée d’adrénaline qui accompagne le travail de journaliste. Lors des reportages dans des zones « chaudes », il peut à tout moment se faire tirer dessus. Ce danger est à la fois source de peur et d’excitation. Peu à peu, Dan Harris s’habitue aux horreurs dont il est le témoin.
À son retour aux États-Unis, il paraît plus solide qu’auparavant. Mais en réalité, il a contracté une maladie invisible : une forme d’anxiété croissante liée à ses expériences traumatisantes dans les zones de conflit.
Pour pallier ces soucis, l’auteur utilise des drogues (cocaïne, extazy). Mais celles-ci ont un effet encore plus délétère sur lui. Malgré le fait qu’il aille voir un psychiatre, l’auteur refuse de prendre sérieusement en considération son état. Jusqu’au jour où il fait cette crise de panique sur le plateau de Good Morning America.
C’est un autre psychiatre qui lui révélera qu’il est atteint de stress post-traumatique. Dan Harris est alors à la fois soulagé et inquiet pour son avenir professionnel. Il sait que c’est l’insouciance et le travail qui l’ont mené là. Mais comment modifier son comportement, maintenant que le problème est déjà bien ancré ?
Chapitre 2 - Brebis égarées
En 2004, Peter Jennings assigne au journaliste une nouvelle mission : s'occuper du traitement des affaires religieuses pour ABC News. Dan Harris et son producteur, Wonbo Woo, voyagent aux États-Unis pour couvrir des histoires sur l'essor des mouvements chrétiens et parler de thématiques diverses telles que le mariage homosexuel ou l'avortement.
Au départ, le journaliste n’est pas vraiment emballé. Pour lui, ces histoires de religion sont sans intérêt et il les dédaigne même un peu. Pourtant, son avis va changer lorsqu’il va rencontrer un évangéliste nommé Ted Haggard, qui devient l’une de ses sources privilégiées dans ses investigations.
Peu à peu, Dan Harris crée des reportages plus profonds sur les thématiques religieuses et s’intéresse davantage à ce qu’il fait. Grâce à la gentillesse et au sérieux de personnes comme Ted Haggard (qui, néanmoins, sera pris dans un scandale peu de temps après), il se prend de passion pour ces nouveaux sujets.
En 2005, son mentor Peter Jennings meurt et le journaliste doit changer de poste : il devient reporter pour le magazine Nightline. C’est aussi l’époque où il rencontre sa future femme, Bianca, qui l’incite à trouver une solution à ses problèmes d’anxiété.
Chapitre 3 - Génial ou givré ?
Dan Harris considère qu'il va mieux. Il est désormais fiancé à Biance et a un nouveau travail. Toutefois, il est encore pris de temps à autre par des attaques de panique. Il anime l'édition du dimanche de World News Tonight, mais se sent stressé, notamment vis-à-vis de ses collègues.
Lorsqu'une amie lui demande s'il a lu l'ouvrage de Eckhart Tolle, Une Nouvelle Terre, le journaliste s'en moque. Pour lui, cet auteur de développement personnel ne mérite pas vraiment qu'on s'y arrête. Pourtant, une fois qu'il le lit, quelque chose l'interpelle et il décide de lui consacrer un entretien dans son show.
Ce qu’il fait. Pourtant, le jour J, il n’est toujours pas totalement convaincu par la présentation de l’auteur. Selon lui, Eckhart Tolle ne donne pas de solution satisfaisante pour calmer la voix intérieure négative de l’égo :
"C'était comme si j'avais rencontré un homme qui me disait que mes cheveux avaient pris feu, mais refusait de me fournir un extincteur." (10 % plus heureux, Chapitre 3)
Chapitre 4 - L'industrie du bonheur
Étape suivante dans sa réflexion : une interview avec Deepak Chopra, un gourou spirituel très populaire outre-Atlantique ayant écrit plusieurs best-sellers. Dan Harris l’interroge sur l’égo et les thèses d’Eckart Tolle. Ici encore, l’auteur est déçu par la réponse et le comportement du guide spirituel indien.
Et il en va de même lorsqu'il rencontre d'autres "gourous" venus du New Age et du développement personnel.
Mais alors, que faire ? Pour lui, il est nécessaire de s’appuyer sur des preuves scientifiques solides ; il ne peut s’en remettre à des « traitements » potentiellement dangereux n’ayant pas fait leurs preuves et aux discours d’experts autoproclamés.
Chapitre 5 — Le Jew-Bu
Sa femme Bianca lui suggère de lire un autre livre : celui de Mark Epstein, un psychologue pratiquant la méditation bouddhiste. C’est grâce à cette lecture que l’auteur se rend compte de ce qui restait « caché » ou implicite chez Eckart Tolle. En fait, la théorie qu’il développait trouvait ses racines dans le bouddhisme.
Plus que ce qu’il avait lu avant, le livre de Mark Epstein lui ouvrait la voie vers une compréhension à la fois plus profonde et plus modeste que ce que prétendaient offrir ceux et celles qu’il avait rencontrés jusqu’à présent.
Par ailleurs, Dan Harris se sent proche du côté « pragmatique » et concret du bouddhisme, qui propose des solutions concrètes pour mettre un terme aux pensées négatives et au flux destructeur de l’égo. Trois expressions sont souvent utilisées par les bouddhistes pour qualifier cette intranquillité de l’esprit :
Esprit se comparant (comparing mind) : l'esprit se mesure sans cesse aux autres ;
Esprit voulant (wanting mind) : l'esprit désirant les choses ;
Et enfin l'esprit agité (monkey mind) : l'esprit insatiable et en besoin de nouveauté constante.
Reconnaître cela est essentiel à la croissance. Tout comme prendre conscience de notre tendance à "terribiliser" et, plus fondamentalement encore, l'impermanence des choses.
La seule façon d'atteindre le bonheur consiste alors à accepter complètement — et activement — ce caractère fini et provisoire des événements et des choses. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, bien sûr !
Emballé par ces idées, Dan Harris contacte Mark Epstein pour lui proposer une interview. Le contact passe bien et le psychologue lui propose de participer à un groupe de spiritualité nommé le "bus juif", en référence à l'origine commune des participants. Mieux encore, c'est lui qui finit par le convaincre de se mettre à la méditation.
Chapitre 6 - Le pouvoir de la pensée négative
Dan Harris se réconcilie avec la méditation après avoir lu plusieurs études scientifiques qui montrent les avantages physiologiques de cette pratique. Il ne la voit plus comme une activité de hippies en mal de découvertes orientales.
Quelques instructions simples permettent de commencer une session :
Asseyez-vous dans une position confortable ;
Suivez votre respiration ;
Lorsque l’attention s’égare, revenez à votre respiration.
L’auteur se rend compte qu’il s’agit d’un « exercice cérébral rigoureux » qui cherche à « apprivoiser le train en fugue de l’esprit ». Et cela n’a rien de facile ! Mais pour lui, cela valait vraiment la peine de persévérer.
Il a donc créé une routine quotidienne. Peu à peu, il a pris l’habitude de suivre son souffle pour soulager son anxiété et se concentrer sur les moments présents. Les résultats ne se sont pas fait attendre très longtemps.
Il a commencé à ressentir une ouverture de sa conscience. Il devenait capable de reconnaître ce qui se passe dans l'esprit moment par moment, en acceptant la nature transitoire de toute pensée.
Lors d’une retraite, Dan Harris écoute la conférencière Tara Brach, qui a créé une méthode intitulée RAIN, pour :
Reconnaître ce qui se passe (ressource) ;
Accepter l'expérience entièrement (allow) ;
Investiguer avec soin et curiosité (investigate) ;
Nourrir avec auto-compassion (nurture)
RAIN est une technique de pleine conscience en quatre étapes qui intègre :
La reconnaissance de vos pensées ;
Le fait de les laisser exister ;
L’étude de ce qu’elles provoquent dans le corps ;
Les identifier comme des états d'être transitoires, qui passent.
Pour Dan Harris, cette technique fonctionne bien. Mais son nouvel ami et mentor, Mark Epstein, lui conseille de participer à une autre retraite dirigée par Joseph Goldstein, un professeur de méditation de renom faisant partie du groupe du « bus juif ».
Chapitre 7 - Retraite
Dan Harris se rend donc au Spirit Rock Meditation Center de Californie pour assister à la retraite silencieuse de 10 jours dirigée par Joseph Goldstein. Cette fois, le niveau est plus exigeant. Le temps de méditation prévu est d’environ 10 heures par jour.
Le journaliste craint de ne pas réussir à tenir sur la longueur. Et, de fait, il pense abandonner après quelques jours, malgré les discours du soir enjoués et motivants de Joseph Goldstein.
Mais Dan Harris décide de raconter ses difficultés à quelqu’un qui lui conseille de faire baisser la pression et de ne pas essayer aussi fort. En effet, les personnes comme lui cherchent à tout prix à atteindre des objectifs et à réussir. C’est cela qui « bloque ».
L’expérience de la méditation va dans le sens inverse et beaucoup de personnes ont du mal avec cet aspect de la pratique.
Cette discussion l'aide et, peu de temps après, il fait l'expérience d'une méditation particulièrement intense qui le laisse dans un état de bien-être profond qu'il décrit comme des "vagues de bonheur".
Cet état se poursuit pendant plusieurs jours puis cesse. Lors d’une conversation avec Joseph Goldstein, celui-ci lui affirme que cette pleine conscience joyeuse augmentera avec la pratique.
Chapitre 8 - 10 % plus heureux
De retour de la retraite, Dan Harris retombe rapidement dans ses habitudes quotidiennes. Au travail, les négociations ne se passent pas comme prévu. En plus, la plupart des gens voient son nouveau goût pour la méditation avec scepticisme.
À chaque fois, les personnes qui l’interrogeaient semblaient lui dire : « Vous avez donc rejoint un culte, n’est-ce pas ? ». Afin de mieux faire comprendre cette pratique, il décide de déclarer, à chaque fois que quelqu’un le questionne, que :
« Je le fais parce que cela me rend 10 % plus heureux »…
Et c’est à partir de là qu’il a commencé à penser à écrire un livre sur le sujet ! Pour lui, cette phrase, « Cela me rend 10 % plus heureux », est à la fois accrocheuse et vraie.
En effet, Dan Harris considère qu’il est plus heureux dans son ménage et plus sympathique avec ses collègues. Finalement, il signe un contrat et commence à travailler sur Good Morning America en tant que présentateur du week-end.
C’est un changement difficile au départ, pour le journaliste, mais il s’y fait. Il doit aussi faire face à des critiques venues des réseaux sociaux à cette époque. Certes, la vie reprend son cours et le stress est toujours là. Mais la méditation fait pourtant son œuvre ! Le journaliste affirme qu’il a résolu ses problèmes plus rapidement grâce à elle.
C’est également à cette époque que Dan Harris décide également de réaliser une interview avec Joseph Goldstein. Il lui demande comment il a commencé la méditation et pourquoi organiser des retraites si intenses, comme celle de Spirit Rock.
Joseph Goldstein dit que le fait d’être dans l’environnement d’une retraite de ce type permet aux participants de se familiariser avec leurs schémas de pensée et, ainsi, de mieux comprendre ce qui est important pour eux.
Chapitre 9 - La "nouvelle caféine"
Pour lui, désormais, la méditation a tout d’un superpouvoir ! Mais, qui plus est, les scientifiques démontrent l’efficacité de la méditation grâce à de nombreuses études scientifiques, ce qui l’encourage encore davantage.
Il cite plusieurs études, notamment sur les bienfaits de la méditation sur la dépression, la toxicomanie et l’asthme (entre autres !).
Il relate également une expérience célèbre de Harvard démontrant que les personnes ayant suivi un cours de huit semaines de réduction du stress basé sur la pleine conscience voient leur matière grise :
"S'épaissir" dans les zones du cerveau associées à la conscience de soi et à la compassion ;
"Diminuer" dans les régions associées au stress".
Pour l'auteur, ces découvertes scientifiques peuvent aider à convaincre même les personnes les plus sceptiques des effets bénéfiques, tant psychologiques que physiologiques, de la méditation.
Dan Harris décide de présenter une série d’histoires sur la méditation sur la chaîne ABC. Sa première histoire porte sur la façon dont la méditation est utilisée avec succès dans les bureaux de l’entreprise du producteur alimentaire General Mills.
Sa directrice, Janice Maturano, voit la méditation comme une pratique positive et non seulement de "réduction de stress". Elle insiste tout particulièrement sur l'importance de se concentrer sur une tâche, puis de la laisser tomber et de faire une pause. Dans cet espace de repos, une solution ou une percée peut se produire plus aisément.
Lorsqu’il travaille sur les autres histoires de sa série, Dan Harris se convainc de l’utilité et de la vérité de son nouveau crédo : « 10 % plus heureux grâce à la méditation ». Il utilise toutes les sources qu’il peut pour démontrer son propos et obtient un certain succès.
Chapitre 10 - Plaidoyer intéressé pour ne pas être un con
Dan Harris finit par interviewer le Dalaï Lama. Au début, il est plutôt sceptique, mais se rassure quelque peu lorsqu'il apprend que le leader des bouddhistes s'intéresse de très près aux études scientifiques démontrant les effets bénéfiques de la méditation.
Lorsque le journaliste lui fait part de ses questionnements autour de la question de la compassion, celui-ci lui répond :
"La pratique de la compassion est finalement bénéfique à toi-même. Je la décris habituellement comme cela : nous sommes égoïstes, mais nous sommes des égoïstes sages plutôt que des égoïstes fous".
Ce propos donne à réfléchir, car il nous apprend que la pratique de la compassion est une bonne chose également pour sa propre santé. D’ailleurs, des études scientifiques citées par l’auteur dans l'ouvrage le démontrent.
Mais la compassion est plus facile à comprendre qu’à entreprendre ! L’une de ses grandes erreurs professionnelles est justement liée à un manque de compassion. Malgré ce nouveau savoir, Dan Harris reconnaît avoir été incorrect lors de l’interview qu’il réalisa avec Paris Hilton et qui poussa celle-ci à quitter le plateau de télévision.
Chapitre 11 - De la dissimulation du zen
Petit à petit, Dan Harris se désengage de la compétition sans pitié. Plutôt que de briguer inlassablement de nouvelles fonctions, il préfère se concentrer sur la méditation. Finie, la « course de rats » !
Le journaliste décide de participer à une autre retraite sur le thème de la compassion — son point le plus délicat. Sharon Salzberg, une autre professeur, y discute de la mudita, le concept bouddhiste de "joie sympathique" ou de "joie ouverte aux succès des autres". Un concept quelque peu difficile à accepter pour l'auteur !
En fait, Dan Harris ne parvient pas très bien à associer son ambition avec sa pratique de la méditation. Il se rend compte qu’il devient trop passif et qu’il met en péril sa carrière, à laquelle il a pourtant travaillé une bonne partie de sa vie. Comment rester calme sans pour autant devenir mou et sans objectifs ?
Plusieurs personnes l’ont aidé à trouver une réponse à cette question. Joseph Epstein, d’abord, qui lui explique :
«Les gens vont profiter de toi s'ils te voient comme quelqu'un de vraiment zen. Dans le comportement organisationnel, il y a un certain type d'agression qui n'y attache aucune valeur — qui verra le zen comme une marque de faiblesse. Si ça ressort trop chez toi, les gens ne te prendront pas au sérieux. Donc je pense que c'est important de garder le zen pour toi, et de les laisser voir en toi une menace potentielle. » (10 % plus heureux, Chapitre 11)
Bianca, sa femme, lui permet aussi de rééquilibrer les choses. Elle l'aide en lui faisant comprendre qu’il essaye de tout diriger, en particulier lorsqu’il se trouve sur un plateau de télévision. Or, maintenant qu’il travaille en équipe, il doit apprendre à se détendre et à suivre le courant !
Dan Harris cherche avant tout à atteindre une forme de « non-attachement aux résultats ». En fait, la vie ne va pas toujours dans le sens que nous nous attendons et nous devons l’accepter. C’est ça, selon lui, le chaînon manquant entre la pleine conscience et l’ambition.
Conclusion sur « 10 % plus heureux » de Dan Harris :
Ce qu’il faut retenir de « 10 % plus heureux » de Dan Harris :
Dan Harris termine avec 10 conseils qui récapitulent ce qu'il a appris au long de son parcours et qu'il nomme "la voie de l'inquiet" :
Ne soyez pas un sale con ;
(Et/mais…) Si nécessaire, planquez le Zen ;
Méditez ;
Le prix de la sécurité est un sentiment d'insécurité (ça vous servira un temps) ;
Le sang-froid n’est pas l’ennemi de la créativité ;
Ne forcez rien ;
L'humilité empêche l'humiliation ;
Allez-y mollo avec l'auto-flagellation ;
Ne vous attachez pas aux résultats ;
Pensez-y : qu'est-ce qui compte le plus ?
Ce livre est utile pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore la méditation et voudraient s'y initier. Mais il ne s'agit pas d'un manuel ; plutôt d'une biographie qui intègre des conseils pour apprendre à intégrer la pratique de la méditation à sa vie de tous les jours.
Le dernier chapitre est particulièrement intéressant puisqu'il montre comment associer un certain degré d'ambition avec les principes de la méditation de pleine conscience. Au final, l'objectif est d'être plus heureux dans sa vie quotidienne.
Grâce à la pratique méditative, nous devenons capables de dégonfler notre égo et d’accepter notre existence dans toutes ses imperfections. Nous sommes plus simples et justes avec nous-mêmes et avec les autres. Nous vivons davantage au présent.
]]>Résumé de « Quand la machine apprend : la révolution des neurones artificiels et de l’apprentissage profond » de Yann Le Cun : l’expert en intelligence artificielle français a séduit la Silicon Valley en contribuant de façon essentielle au développement du machine learning et du deep learning — il partage ici le récit de cette fascinante histoire !
Par Yann Le Cun, 2019, 394 pages.
Chronique et résumé de "Quand la machine apprend : la révolution des neurones artificiels et de l'apprentissage profond" de Yann Le Cun
Qui est Yann Le Cun ?
Yann Le Cun est un expert en intelligence artificielle. Récipiendaire du prestigieux prix Turing, il enseigne à l'université de New York. Il a été l'un des grands initiateurs de l'apprentissage machine et en particulier de l'apprentissage profond lié à la reconnaissance d'images.
Ses travaux ont fait de lui l'un des spécialistes les plus reconnus du domaine et l'ont amené à exercer des fonctions importantes pour la compagnie Facebook.
Dans ce livre de vulgarisation, comme vous allez le voir, Yann Le Cun revient en détail sur son parcours biographique, tout en expliquant sa démarche scientifique. Rien ne sert donc d'en dire trop ici. Lisez la suite !
NB. Si les principaux chapitres ont été conservés tels quels, l'intérieur de chaque chapitre a été résumé et certaines sections ont été fusionnées ou supprimées pour faciliter la compréhension d'ensemble ;).
Chapitre 1 — La révolution de l'IA
"Beaucoup d'observateurs ne parlent plus d'une évolution technologique, mais d'une révolution." (Quand la machine apprend, Chapitre 1)
Et si nous étions au début d'une nouvelle ère technologique ? Sans aucun doute, l'IA est d'ores et déjà omniprésente dans notre quotidien, depuis les logiciels de reconnaissance vocale jusqu'aux logiciels de création d'images, nous avons pris l'habitude de rencontrer l'intelligence artificielle dans notre vie de tous les jours.
Mais ce monde de l'IA n'en est qu'à ses débuts. En fait, "ses limites sans sans cesse repoussées", dit avec enthousiasme Yann Le Cun. De la good old fashioned IA (GOFAI), nous sommes passés à de nouvelles manières de construire et de penser l'intelligence des machines et leur apprentissage.
C'est notamment le passage de ces GOFAI au machine learning, puis au deep learning, dont l'auteur est justement l'un des chefs de file et des pionniers.
Essai de définition
"Je dirais que l'intelligence artificielle est la capacité, pour une machine, d'accomplir des tâches généralement assumées par les animaux et les humains : percevoir, raisonner et agir. Elle est inséparable de la capacité à apprendre, telle qu'on l'observe chez les êtres vivants. Les systèmes d'intelligence artificielle ne sont que des circuits électroniques et des programmes informatiques très sophistiqués. Mais les capacités de stockage et d'accès mémoire, la vitesse de calcul et les capacités d'apprentissage leur permettent d'"abstraire" les informations contenues dans des quantités énormes de données." (Quand la machine apprend, Chapitre 1)
Yann Le Cun est ambitieux et croit en l'innovation qui l'a fait connaître : le deep learning — et en particulier ces réseaux de neurones convolutifs dont nous reparlerons dans la suite de cette chronique. C'est un outil très puissant, mais qui demeure encore limité, car très spécialisé.
Un algorithme est une "séquence d'instructions", une "recette de cuisine" de mathématiciens, rien de plus. Facebook et Google, par exemple, n'en ont pas qu'un (supposé omnipotent ou presque), mais plutôt une "collection", chacun travaillant à une tâche précise.
Commençons par dire un mot du développement de l'IA depuis le milieu du XXe siècle, tout en faisant davantage connaissance avec l'auteur.
Chapitre 2 — Brève histoire de l'IA… et de ma carrière
L'éternelle quête et les premiers sursauts de l'IA
La volonté de donner la vie à des automates n'est pas neuve. Que vous pensiez aux projets du docteur Frankenstein ou à d'autres ouvrages de science-fiction (et même à des mythes anciens), cette idée est présente en l'homme. Faire émerger la vie et la pensée de ses propres mains : voilà l'idée de base.
Mais c'est autour des années 1950, et aux États-Unis, que s'initient les premières grandes manœuvres qui aboutiront à la création du champ d'études nommé "intelligence artificielle.
L'auteur reprend à son compte la notion d'"hiver" de l'IA. Tout se passe en effet en plusieurs étapes. Les premiers engouements des années 1950 et 1960 sont freinés à partir des années 1970. Les institutions états-uniennes et occidentales coupent les fonds à leurs chercheurs.
✅ À noter : pour compléter ce teaser et avoir un aperçu plus général de cette histoire, vous pouvez lire, par exemple, la chronique de L'intelligence artificielle pour les nuls.
Entrée en scène
Penchons-nous plus attentivement sur l'histoire de Yann Le Cun. Il commence à faire ses études dans une école d'ingénieur en électronique à Paris en 1978. En passionné, il lit beaucoup et croise les disciplines. Depuis la linguistique jusqu'à la cybernétique, en passant bien sûr par les mathématiques et l'informatique, tout ce qui se rapproche de l'IA l'intéresse.
Il est encore étudiant à l'IESIEE (son école d'ingénieurs) lorsqu'il a sa première intuition d'algorithme d'apprentissage qui donnera, des années plus tard, les algorithmes dits de "rétropropagation du gradient".
Entré en doctorat en 1984, il travaille beaucoup avec une maîtresse de conférence nommée Françoise Soulié-Fogelman. Grâce à cette collaboration, il va pouvoir réaliser un stage d'un mois en Californie au sein du laboratoire Xerox PARC.
Mais c’est en 1985 que sa vie professionnelle « bascule », lors d’un symposium aux Houches (Alpes françaises). Yann Le Cun y tisse des liens qui le mèneront à travailler au Bell Lab trois ans plus tard. Durant cette année, il dévoile à ses pairs ses recherches. Ceux-ci sont impressionnés.
Durant la seconde moitié des années 1980 (pourtant qualifiées d’hiver de l’IA), Yann Le Cun va patiemment contribuer à l’émergence du champ d’études dit « connexionniste » en IA.
Il termine son doctorat en 1987 et rejoint Geoff Hinton (grand spécialiste et co-inventeur de la "rétropropagation", qui recevra plus tard le prix Turing avec Yann Le Cun) à l'université de Toronto.
Les années Bell Labs
Les travaux du chercheur y sont appréciés. Pourtant, les projets en cours n'arrivent pas à se vendre. Malgré le développement d'un système de compression des données plus efficace que JPEG et PDF (nommé DjVu), c'est l'échec commercial. En cause, pour l'auteur, l'incapacité à commercialiser correctement le logiciel.
Un tabou ?
En fait, au milieu des années 1990, les recherches de Yann Le Cun et de ses quelques collègues deviennent l'objet d'une sorte de rejet ou de tabou par le reste de la communauté du machine learning. Pourtant, bon nombre de chercheurs travaillent ensemble et s'influencent l'un l'autre.
Au début des années 2000, il décide de relancer dans la recherche fondamentale (qu'il avait plus ou moins laissé tomber au Bell Labs pour le projet plus appliqué de DjVu). Il refuse, pour cela, un poste de direction dans la toute jeune entreprise… Google !
Il est embauché en tant que professeur à la New York University en 2003. Avec la "ferme intention de redémarrer un programme de recherche sur les réseaux de neurones et de démontrer qu'ils marchent".
Mais toujours pas facile de se faire accepter… Le reste de la communauté boude cette bande de scientifiques qui refusent le courant majoritaire du machine learning. Pour rendre leurs travaux plus sexys, Yann Le Cun et ses amis renomment leur projet en deep learning. Au début, rien.
Il faut attendre 2006 et surtout 2007 pour que la notion commence à circuler largement et soit peu à peu acceptée dans la communauté scientifique.
]]>Résumé de « Information : l’indigestion » de Benoît Raphaël : un manuel « pour penser soi-même dans le chaos de l’info », tel est le sous-titre et la promesse de cet ouvrage complet et très pédagogique, qui cherche à nous donner des outils pour apprendre à consommer plus raisonnablement l’information.
Par Benoît Raphaël, 2023, 317 pages.
Chronique et résumé de "Information : l'indigestion" de Benoît Raphaël
Qui est Benoît Raphaël ?
Benoît Raphaël est un journaliste français. Il a créé plusieurs médias web et contribué à la rédaction du journal Nice Matin en se focalisant sur le journalisme de solution (un type d'investigation journalistique guidé par la recherche de solutions plutôt que par des enquêtes portant uniquement sur la mise en évidence de problèmes).
Benoît Raphaël est aussi entrepreneur. Il est par exemple à l'origine du média Flint, un site qui permet de faire une veille d'info "anti fake-news et anti fatigue informationnelle" en s'associant à l'intelligence artificielle !
Information : l'indigestion est son premier livre. Il y dévoile, justement, toutes ces idées sur les dangers de notre fatigue face au flot constant des (mauvaises/fausses) informations.
Commençons tout de suite par le chapitre 1 (NB. Les sous-parties de chapitre étant très nombreuses, nous en avons élagué la plupart pour simplifier la présentation de la chronique).
1 — Grosse fatigue
L’auteur part de son expérience personnelle : en tant que journaliste et citoyen accoutumé aux réseaux sociaux et aux médias en ligne, il a lui-même souffert de la fatigue informationnelle. Un beau jour, il décide donc de partir à Bali pour se mettre au vert et prendre le temps de réfléchir aux prochaines étapes de sa vie. C’est là qu’est né Information : l’indigestion.
Ceux qui n’en peuvent plus
Il remarque en effet qu'il est loin d'être le seul à être touché par cette vague de stress liée à la surconsommation des médias en ligne. Il veut à la fois témoigner et livrer une analyse journalistique sérieuse, appuyée sur des ouvrages et des articles scientifiques.
À ce propos, il met également en garde. Selon lui, il faut prendre les effets d'annonces des articles de journaux avec des pincettes. Il le sait bien, puisqu'il est lui-même du métier ! Souvent, les titres et manchettes amplifient une réalité en la simplifiant. Surtout quand il s'agit de manipulation de chiffres…
Au-delà, ce sont les sondages eux-mêmes (sur lesquels s'appuient les articles) qu'il faut relativiser, car ils se contredisent souvent l'un l'autre. En fait, même quand il s'agit de s'informer sur la fatigue informationnelle, les choses ne sont pas très claires !
"Ainsi va l'info. Une sorte de brouillard construit de vagues successives qui nous envoient des "impressions" d'info. Lesquelles jouent le rôle premier qu'ont toujours eu les médias depuis que les humains se racontent des histoires au coin du feu ou qu'ils se saluent en pestant sur le temps qu'il fait : alimenter les conversations quotidiennes pour nous aider à nous sentir moins seuls." (Information : l'indigestion, Chapitre 1)
Trouvez-moi le coupable !
Finalement, aurions-nous toujours été stressés ? Est-ce que la technologie joue un rôle si important dans ce processus ? Telles sont les questions également posées dans ce chapitre. Et Benoît Raphaël y répond en s'intéressant avant tout au cerveau et aux neurosciences, ainsi qu'à la sociologie.
Côté sociologie, il cite en particulier l’ouvrage du sociologue français Pascal Bronner, Apocalypse cognitive, dans lequel celui-ci montre comment les technologies ont « libéré du temps de cerveau disponible » sans pour autant orienter correctement l’usage que nous faisons de notre matière grise !
Côté neurosciences, le journaliste s’intéresse à plusieurs travaux montrant comment notre cerveau « fatigue » en raison de son insatiable appétit pour les informations nouvelles, qui sont comme des « bonbons » auxquels il a beaucoup de mal à résister.
2 — Pourquoi nous aimons tant l'information
Notre cerveau veut nous protéger en s’informant. Le problème, c’est qu’il prend de nombreux raccourcis (les fameux biais mis en évidence par Daniel Kahneman dans Système 1/Système 2) et agit parfois de façon… quelque peu excessive.
Assoiffés d'informations
En fait, bien souvent et malgré le fait qu'elles nous déplaisent, "nous consommons les informations négatives jusqu'à l'indigestion". Oui, mais pourquoi ?
"Globalement, notre cerveau nous motive à rechercher des informations à propos de tout ce qui pourrait contribuer à notre survie : identifier le danger bien sûr, trouver de la nourriture, obtenir une reconnaissance sociale, et enfin nous reproduire. Le tout en faisant le moins d'efforts possible." (Information : l'indigestion, Chapitre 2)
➡️ Pour plus d’informations à ce sujet, lisez la chronique de l’ouvrage de Sébastien Bohler, Le bug humain, cité par Benoît Raphaël tout au long de ce chapitre.
L’info, c’est la vie !
Bref, l’information nous est vitale. Reste à savoir comment nous la traitons ou, plutôt, comment cet organe complexe et étrange qu’est le cerveau se charge de cette fonction. Comme nous allons le voir, il récupère, trie, calcule, retient et efface. En somme, il organise toutes nos perceptions et autres informations. Et il en crée une « version » du monde, la nôtre !
Heureusement, toutes ces tâches peuvent être travaillées, éduquées. Nous pouvons soit laisser aller notre cerveau à vau-l’eau, soit entreprendre une forme de « régime attentionnel » et de musculation du néocortex (la partie la plus sollicitée dans le traitement raisonné de l’information).
"Chercher la bonne information est essentiel dans le processus décisionnel. Si ce système est déséquilibré, nous risquons de nous perdre dans une quête sans fin d'informations nouvelles et variées, ou de nous concentrer sur les informations les plus anxiogènes, avec pour conséquence de nous faire prendre des décisions néfastes pour notre bien-être, de surconsommer des informations divertissantes et inutiles pour combler ce mal-être ou pour calmer nos angoisses… ou de nous empêcher de prendre des décisions tout court." (Information : l'indigestion, Chapitre 2)
3 — Ce que le trop-plein d'informations fait à notre cerveau
Agir est donc possible et — surtout — souhaitable ! Mais avant d'envisager de possibles modes opératoires, regardons de plus près les effets de la surinformation sous notre boîte crânienne.
Un système peu sympathique
Mal consommer l'information peut nous rendre malades. Ce qui se matérialise d'abord par la fatigue.
En fait, l'information provoque du stress. Et trop d'information en provoque… encore plus. Or, si le stress est un phénomène corporel normal, il peut néanmoins devenir (très) problématique lorsqu'il devient chronique ou excessif.
Dans ce cas, il peut faire beaucoup de torts à différentes parties de notre organisme. Selon les chercheurs, c'est au sein du système dit "sympathique" que se régule une bonne partie du stress. En pompant de l'énergie pour assurer l'état de veille attentive qu'est le stress, il met à mal d'autres organes ou fonctions corporelles. C'est là que le danger apparaît.
Trop d'infos tue l'info
Par ailleurs, Benoît Raphaël met en évidence un autre point intéressant dans ce chapitre. C'est le phénomène du "paradoxe du choix" mis en évidence par Barry Schwartz dans son livre The Paradox of Choice: Why More is Less (2009).
En fait, la surcharge d’informations rend le processus de décision plus compliqué à traiter pour le cerveau, donc plus stressant et fatiguant. En outre, le trop-plein de possibilités nous laisse insatisfaits, car nous ne sommes jamais sûrs à 100 % d’avoir fait le bon choix !
Résultat : nous vivons, perdus et anxieux, dans un "brouillard informationnel". Aussi bien individuellement que collectivement, trouver du sens — un élément essentiel au bien-être et au développement — devient une tâche beaucoup, beaucoup plus difficile à mener à bien…
✅ Sur la dimension collective du rapport entre information, réalité et création de sens, vous pouvez lire la chronique du livre Sapiens de Yuval Noah Harari, dont s'inspire d'ailleurs le travail de Benoît Raphaël.
4 — De la malbouffe à la malinformation
Continuons notre enquête en filant la métaphore de la nourriture. Nous "consommons" des informations. Trop. Et ce trop-plein nous procure une sorte d'"indigestion".
Mais le problème, également, est celui de la mauvaise qualité : nous ingérons des informations mal formées. Nous sommes désormais familiers des scandales sanitaires et du terme « malbouffe ». Il va falloir nous habituer à vivre dans l’ère de la « malinformation ».
Matière première et transformation
À l’instar de la nourriture, l’information passe par toute une chaine industrielle, une « chaine de valeurs » qui contient des processus de production, de transformation, de distribution et de consommation. Google, par exemple, distribue des informations qu’il ne produit pas, tout en générant ainsi des profits publicitaires.
Les producteurs d’informations sont les journalistes de terrain, mais aussi les scientifiques et autres experts qui produisent des études sur tel ou tel état du monde.
Les transformateurs sont les vulgarisateurs, les chaines de radio ou de télé qui reprennent les propos des premiers en les adaptant à leurs programmes et à leurs lignes éditoriales. Notons que les influenceurs font également partie des transformateurs, le plus souvent.
Les distributeurs, aujourd’hui, sont Alphabet (Google, YouTube) ou Méta (Facebook, WhatsApp), pour ne citer que deux noms bien connus.
Puis, nous consommons. Nous qui avons besoin d’information, nous dépendons de la « valeur nutritive » de ces « contenus ». Parfois, il n’y a pas de risque à consommer ce qui nous est proposé. Mais à d’autres moments, mieux vaut prendre ses précautions !
« C’est pour ça qu’il est nécessaire de bien comprendre la valeur des informations que nous recevons, comment elles se fabriquent, et comment notre cerveau apprend à les trier, si nous voulons éviter l’indigestion et vivre plus heureux. » (Information : l'indigestion, Chapitre 4)
Baisse de la matière première, hausse de la transformation ?
Nous pensons spontanément qu'il y a plus d'information. Et c'est partiellement vrai. Mais en réalité, nous ne nous rendons pas compte qu'il y a peu de "matière première" de l'information.
Par exemple, les mêmes dépêches de l'AFP (Association française de presse) sont reprises, parfois telles quelles, par la majorité des transformateurs que sont des rédactions des chaînes d'info ou de la presse papier.
En fait, avoue l'auteur, il est même difficile d'avoir des chiffres sur le niveau exact de cette "explosion d'informations" dont tout le monde parle. Ce qui va dans son sens ! Il est compliqué d'avoir des chiffres fiables et de première main sur un sujet qui, pourtant, est important.
Pompier pyromane
Les algorithmes des moteurs de recherche nous aident à trouver l’information. Ils la cherchent, la trient pour nous, la classe selon différentes catégories même. Mais pensez-y une minute : Google a aussi tout intérêt à voir les sites web et autres contenus exploser sur Internet. Pourquoi ? Car il peut ainsi proposer davantage de publicités en ligne — le cœur de son business model.
D'un côté, donc, Google (et les réseaux sociaux) nous aide à y voir plus clair dans l'océan d'informations (pompier), mais, de l'autre, il incite tout un chacun, grâce à ces produits gratuits notamment, à participer à la création du flux lui-même, principalement en ajoutant du contenu "secondaire", c'est-à-dire des commentaires et autres ajouts plus ou moins intéressants à des informations de base.
Tous les jours, du bruit s’ajoute au bruit et il devient plus difficile de trier ; ce qui nous rend peut-être encore plus dépendants aux médias sociaux et aux algorithmes. Dans cette course, les médias traditionnels ont des difficultés à suivre et participent eux aussi, finalement, à la détérioration du paysage informationnel.
L'information sans additifs ni journalistes élevés en batterie
D'autres tendances émergent. Vous pouvez en effet souscrire à des abonnements pour obtenir une information de meilleure qualité, sorte d'information "bio", dit l'auteur. Mais cela revient cher : si vous voulez de la diversité, vous devrez payer plusieurs fois et cela représente une somme importante au bout du mois.
En outre, d'autres dangers guettent. Les "monocultures" d'information sont sensibles à un virus : les fake news. Quand tout le monde reprend sans grand jugement la même matière première, la fausse information peut se propager, très, très vite !
Parfois, la fausse information cache une réelle volonté de nuire. C’est le cas de la « fabrique de l’ignorance » de certaines industries, comme celle du tabac, par exemple.
À un niveau plus léger, mais parfois problématique, Benoît Raphaël note que certaines techniques de marketing peuvent ajouter à la difficulté de notre cerveau de gérer correctement l'information.
5 — Les robots sont cons
Aujourd'hui, de nombreux acteurs du web cherchent à obtenir nos données pour faire tourner leurs algorithmes d'intelligence artificielle et nous les resservir sous forme d'aide à la décision, recommandations diverses, etc.
Mais l'utilisation de ces "robots" est-elle bien contrôlée ? Et que se passe-t-il lorsque ces algorithmes ne sont pas si intelligents qu'ils en ont l'air… ?
Facebook guidant le peuple
Il est exagéré de dire que Facebook a été l'origine du Printemps arabe. Il y a certes contribué, mais le mouvement est bien plus large et s'est constitué, amplifié et construit conceptuellement en dehors des réseaux sociaux.
Si la plateforme peut indubitablement aider certains groupes à se réunir politiquement, il faut se rappeler que ce n'est pas son but premier. Pour Facebook, l'enjeu est d'abord financier. Le réseau social veut vous garder connecté le plus longtemps possible.
La notion d’engagement renvoie à cet objectif : pour Facebook et d’autres réseaux sociaux, un post « engageant » est un post qui donne envie de commenter, de reposter ou de liker. Vous êtes « engagé » lorsque vous « likez » (ou commentez ou repostez) et continuez à faire défiler votre fil.
À quoi servent alors les algorithmes ? À maximiser votre engagement (en fait, celui de chaque utilisateur, de façon personnalisée en fonction des contenus qu’il a, justement, likés ou commentés au préalable).
Or, Benoît Raphaël rapporte un fait inquiétant : les algorithmes orientés vers l'engagement ont tendance à faire dériver les contenus des fils des utilisateurs vers plus de radicalisme, afin d'amplifier l'engagement.
Sans nous en rendre compte, nous pouvons donc être amenés à lire des contenus de plus en plus "orientés". Pire, nous influençons par nos propres actions le contenu des fils de nos proches, participant ainsi à la diffusion en chaîne de contenus problématiques.
Cela dit, il y a des parades. Dans Information : l’indigestion, Benoît Raphaël explique aussi comment il est possible d’« assagir son Facebook » (p. 125-126).
Réparer Facebook
Le journaliste explique encore qu'il a réalisé un entretien avec l'un des anciens ingénieurs en intelligence artificielle de Facebook. Celui-ci avait été embauché par la firme états-unienne pour perfectionner les algorithmes dans le sens d'un surplus d'engagement.
Toutefois, après plusieurs années et plusieurs scandales, Facebook lui a demandé une autre tâche : améliorer les algorithmes pour les rendre moins sujets aux dérives extrémistes. Pour l’ingénieur, la mission est particulièrement complexe. En réalité, ce ne sont pas seulement les robots de Facebook qui doivent être modifiés, mais aussi les humains qui les utilisent et se laissent « attraper » par eux.
Un algorithme du bien-être ?
Dans IA 2042, Kai-Fu Lee propose de modifier les algorithmes pour qu’ils ne soient plus (uniquement) mus par l’engagement. Cela signifierait que les compagnies telles que les GAFAM acceptent de changer de business model, ce qui n’a rien de certain.
Néanmoins, l’idée est là : concevoir autrement les algorithmes pour qu’ils nous aident vraiment. Aujourd’hui, l’IA (sous la forme de ces algorithmes) est surtout un facteur de dérèglement social. Mais elle peut se transformer en autre chose.
Quant à cet ingénieur de Facebook… Eh bien Benoît Raphaël raconte qu'il a démissionné et trouvé une place sur un réseau social qu'il considère plus favorablement : LinkedIn.
]]>Résumé de "La magie du j’en ai rien à foutre" de Sarah Knight : ce livre libérateur partage, avec humour et pragmatisme, une méthode simple mais radicale pour nous débarrasser des prises de tête inutiles et sources de contrariétés dans nos vies. Fini le temps, l'énergie et l'argent gaspillés pour ce qui ne compte pas, place à une vie plus épanouie dans laquelle il est enfin possible de suivre uniquement nos envies profondes !
Par Sarah Knight, 2015, 219 pages.
Titre original : "The Life-Changing Magic of Not Giving a Fuck".
Chronique et résumé de "La magie du j’en ai rien à foutre" de Sarah Knight
Introduction de "La magie du j'en ai rien à foutre" de Sarah Knight
Dans l'introduction de son livre "La magie du j'en ai rien à foutre", l’auteure, Sarah Knight confie avoir longtemps été écartelée et stressée par le poids des obligations du quotidien, avant de réaliser qu'il était possible de "se foutre" de bien des choses.
Ce livre, "La magie du j'en ai rien à foutre", est alors le condensé de tout ce qu'elle a appris pour se libérer des prises de tête paralysantes et pour mener une vie plus épanouie.
La prise de conscience de l’auteure Sarah Knight
S'inspirant du best-seller "La magie du rangement" de Marie Kondo sur le désencombrement de son intérieur, Sarah Knight propose ici, par analogie, de faire le tri dans son "tiroir à prises de tête".
"J’admire Marie Kondo. Sa façon de ranger est une révolution, surtout quand on pense que le but est d’apporter plus de joie aux gens. Ça a marché pour moi, et il ne fait pas de doute que ça fonctionne aussi pour des millions de personnes partout dans le monde. Mais comme elle l’écrit dans son livre : "la vie commence après avoir fait du tri." Eh bien, j’ai fait du tri. La vraie vie a commencé quand je me suis concentrée sur ce qui me pourrissait la vie."
Après avoir démissionné pour devenir auteure freelance, elle a pu expérimenter tous les bienfaits de ne plus se soucier des réunions, des codes vestimentaires, de plaire à tout prix ou encore de ses jours de congés comptés "comme un prisonnier grave sur les murs de sa cellule ceux qu'il a passés derrière les barreaux".
Et en rangeant sa maison à la manière de Marie Kondo, elle a, un jour, réalisé où se situait le vrai problème. Celui-ci se trouvait dans le fatras cérébral et les trop nombreuses obligations qui l'empêchaient de se consacrer aux gens et activités qui la rendaient heureuse.
"Je me sentais apaisée, confiante, rien qu’à contempler ma maison nickel chrome. J’aime les surfaces nettes et les meubles de cuisine bien organisés. Mais ce qui me mettait réellement en joie, c’était ce sentiment de liberté après avoir quitté un boulot dans lequel je n’étais pas heureuse – et de refaire de la place dans ma vie pour des gens, des choses, des événements et des activités qui, eux, me rendaient heureuse. Tout cela, je l’avais perdu de vue, non pas à cause de vingt-deux paires de chaussettes en boule, mais de trop nombreuses obligations et d’un fatras cérébral trop important."
La méthode "MêmePasDésolé" de Sarah Knight
Sarah Knight a développé une méthode en deux étapes baptisée "MêmePasDésolé". Celle-ci vise à identifier et éliminer les sources de contrariété :
D'abord décider de ce dont on n'a rien à foutre,
Puis ne plus rien avoir à foutre de ces choses, sans culpabilité.
L'objectif est de dépenser moins de temps, d'énergie et d'argent pour ce qui nous ennuie. Et d'en avoir plus pour ce qui nous fait vibrer.
Une philosophie de vie libératrice
Avec humour et franchise, ce livre promet d'apprendre à ne plus se soucier de l'opinion des autres, à prioriser ses centres d'intérêt, à dire non poliment mais fermement sans se comporter comme un "trouduc"...
Bref, à atteindre cet état d'esprit libérateur où l'on n'a enfin plus "rien à foutre" de ce qui nous pollue la vie.
Partie 1 - En avoir quelque chose à foutre ou pas
Dans la première partie de "La magie du j'en ai rien à foutre", l’auteure, Sarah Knight aborde les fondements de sa méthode pour cesser de se préoccuper de choses inutiles.
Si nous nous sentons stressé, surbooké ou fatigué de la vie, c'est probablement parce que nous accordons trop d'importance à des choses qui ne le méritent pas, suppose-t-elle.
Aussi, sa méthode intitulée "MêmePasDésolé" vise justement à réduire au minimum le temps, l'énergie et l'argent consacrés à des personnes et activités qui nous ennuient, pour les redéployer vers ce qui nous rend heureux.
"Ce qui compte, si vous suivez ma méthode MêmePasDésolé, c’est que vous aurez l’esprit plus léger, votre agenda sera moins chargé et vous consacrerez votre temps et votre énergie uniquement à des choses et à des gens que vous appréciez. Ça change la vie. Promis. Juré."
Voici 7 points clés que Sarah Knight développe dans la partie 1 de "La magie du j'en ai rien à foutre" pour nous éclairer à ce sujet.
1.1 - N'en avoir rien à foutre : les fondamentaux
Notre intérêt et notre attention sont des ressources limitées et précieuses, souligne Sarah Knight. Et les gaspiller en s'intéressant à tout conduit à l'anxiété et au stress.
Avant de dire "oui" à quelque chose, nous devrions donc nous demander : est-ce que ça m'intéresse vraiment ? Est-ce digne de figurer dans mon "putain de budget" en temps, énergie et argent ?
"Plutôt que de toujours répondre aveuglément Oui, OUI, OUI !!! à toutes les personnes et choses qui pompent votre temps, votre énergie et/ou votre argent (y compris acheter et lire ce livre), la première question à laquelle vous devriez répondre avant de proférer ce sale petit mot de trois lettres est : est-ce que ça m’intéresse vraiment ? (...) Montrez-vous intéressé si quelque chose – que cela soit un être humain, un objet ou un concept – ne vous prend pas la tête et vous rend heureux."
Se poser ces questions avant de se lancer, d’accepter, de faire quelque chose aide à se concentrer sur ce qui nous impacte positivement.
En fait, n'en avoir rien à foutre, poursuit l'auteure, c'est penser à soi d'abord, oser dire non, s'affranchir de la culpabilité associée et arrêter de faire des choses par obligation.
Cela libère du temps et de l'espace mental pour apprécier ce qui compte. C'est à la fois égoïste et bénéfique pour l'entourage, car on devient plus épanoui et agréable.
1.2 - Qui sont ces personnes légendaires qui n'en ont rien à foutre ?
Selon Sarah Knight, il existe 3 catégories de personnes qui n'en ont rien à foutre :
Les enfants, car ils n'ont pas encore intégré les contraintes du monde. Leur esprit est libre.
Les "trouducs", qui sont génétiquement programmés pour faire passer leurs désirs avant tout, peu importe les dégâts. Mais ils ne sont ni respectés ni aimés.
Les "esprits éclairés" qui ont retrouvé la légèreté de l'enfance avec la conscience de l'âge adulte. Ils savent choisir leurs priorités.
1.3 - Comment entrer dans l'une de ces catégories de personnes ?
L'auteure de "La magie du j'en ai rien à foutre" explique vouloir nous aider à atteindre l'éveil dans l'art d'en avoir quelque chose à foutre (ou pas), en évitant les propres erreurs qu’elle a elle-même commises.
Ainsi, sa méthode s'appuie sur un mélange de franchise et de politesse. De cette façon, nous nous libérons sans pour autant devenir un "trouduc". Cette démarche, précise-t-elle, demande aussi d'apprendre à nous foutre de l'opinion des autres.
1.4 - Arrêter d'en avoir quelque chose à foutre de ce que pensent les autres
Pour Sarah Knight, ne pas se soucier du regard des autres concernant nos choix est la clé pour décider d'en avoir rien à foutre (étape 1) et passer à l'acte (étape 2).
Nous n’avons aucun contrôle sur les pensées d'autrui, rappelle l’auteure.
"Quand il s’agit de la façon dont vos centres d’intérêt impactent les autres, la seule chose que vous pouvez maîtriser, c’est votre comportement face à leurs sentiments et non leur opinion."
Elle raconte ici que lorsqu’elle a elle-même démissionné pour devenir freelance, elle s'inquiétait des jugements des autres quant à sa décision. C’est alors qu’elle a réalisé qu’en fait, seul comptait ce qu'elle pouvait maîtriser. À savoir : son bonheur et son nouvel équilibre de vie.
1.5 - Sentiments vs Opinions
En fait, ajoute Sarah Knight, nous nous préoccupons de l'avis des autres parce que nous ne voulons pas être ou paraître comme quelqu'un de mauvais.
Or, dans le fait de ne pas se soucier de ce que vont penser les autres, il faut bien faire la différence entre deux conséquences et agir en conséquence :
Blesser les sentiments d'autrui : qu’il faut éviter,
Diverger d'opinion : qui est légitime et défendable.
À ce propos, Sarah Knight donne l'exemple d'une amie qui vendrait du beurre de cacahuète bio. Si elle n'aime pas ça, dit-elle, elle peut poliment décliner d'en acheter sans attaquer les valeurs de son amie. C'est juste une question de goûts personnels.
De même, avec des parents par exemple, nous pouvons très bien invoquer le concept d'opinion pour clore un débat houleux sur la parentalité. Et cela sans vexer : se contenter de dire calmement, en haussant les épaules : "Je sais, je sais, chacun son opinion". Puis "changer de sujet pour glisser sur un terrain neutre". L'important est d'être franc et poli.
1.6 - Établissez un "Putain de Budget"
Sarah Knight recommande d'établir un "budget de son intérêt" comme nous le ferions avec notre argent.
Ainsi, avant de dire "oui" à une activité, nous devrions évaluer son "coût" en temps, énergie et argent vs le bénéfice en bonheur. Il vaut mieux, par exemple, refuser une invitation à un weekend ennuyeux que de s'en rendre compte trop tard.
L’auteure de "La magie du j'en ai rien à foutre" conseille d'appliquer ce filtre budgétaire à toute demande. En s’interrogeant à chaque fois : vaut-elle vraiment la dépense d'intérêt ?
1.7 - Résumé de la partie 1 du livre "La magie du j'en ai rien à foutre"
Résumons les fondamentaux à intégrer pour décider si on en a à foutre de quelque chose dans les termes de Sarah Knight :
Déterminer l'impact qu’il aura sur soi et sur les autres.
Différencier opinions et sentiments.
Consulter son "Putain de Budget" en temps, énergie, argent.
Être franc et poli.
Ne pas être un "trouduc".
C'est un processus qui demande de la pratique, prévient l’auteure, mais qui permet d'atteindre plus de légèreté et de bonheur.
Aussi, Sarah Knight propose de nous guider, pas à pas, dans les étapes pour y parvenir.
Partie 2 - Décider de n’en avoir rien à foutre
Dans la deuxième partie de son livre "La magie du j'en ai rien à foutre", Sarah Knight nous invite à faire le tri dans notre "fatras mental" pour décider de ce qui mérite vraiment notre intérêt.
2.1 - La méthode "MêmePasDésolé" de Sarah Knight
- Votre esprit est un hangar
Pour commencer ce travail d'introspection, Sarah Knight nous encourage à visualiser notre esprit comme un vaste hangar. Nous pouvons alors imaginer ce hangar encombré d'innombrables choses. De choses que l'on exige de nous. De choses dont on attend de nous que nous en ayons quelque chose à foutre, et ce, que nous le voulions ou pas.
Il va alors falloir, indique l’auteure, nous aventurer au fin fond de ce hangar mental. Nous allons ainsi tout passer en revue et faire l'inventaire de :
Ce qui nous rend heureux,
Ce qui nous contrarie.
C'est en osant affronter cette "overdose de prises de tête" que nous pourrons mesurer combien certaines choses nous pompent du temps, de l'énergie et de l'argent. Et que nous pourrons trouver la motivation pour faire le tri.
Sarah Knight promet qu'en dressant cette liste une bonne fois pour toutes, nous serons ensuite armé d'une méthode pour rester libéré de ce fatras. Et ce même quand les attentes extérieures changent avec le temps. Le principe est de tout lister, le bon comme le mauvais, car nos vraies priorités sont souvent noyées sous un tas de prises de tête futiles.
Et même si c'est inconfortable, il faut aller jusqu'au bout de cet état des lieux avant d'espérer faire de l'ordre. Comme disait Einstein, mieux vaut passer 55 minutes à bien cerner un problème et 5 minutes à trouver la solution, que l'inverse. En prenant le temps d'explorer ce bazar intérieur, les réponses sur ce qui compte et ne compte pas apparaîtront d'elles-mêmes.
- Classez vos intérêts par catégorie
Pour faciliter ce tri, Sarah Knight nous propose sa méthode qu’elle a appelée la Méthode "MêmePasDésolé". L’idée est de classer ces préoccupations potentielles en quatre catégories :
Les Choses,
Le Travail,
Les Amis/Connaissances/Inconnus,
La Famille.
Il est recommandé de suivre cet ordre précis.
En commençant par les "Choses", des éléments inanimés qui ne risquent pas de protester, puis en passant au "Travail", grand pourvoyeur de contrariétés pour beaucoup d’entre nous, nous prenons nos marques avant d'aborder les sujets plus sensibles que sont les relations amicales et familiales.
L'auteure nous met d’ailleurs en garde contre la tentation de commencer par la Famille. Celle-ci représente un véritable champ de mines en termes de culpabilité et de sens du devoir. Il vaut donc mieux avoir déjà travaillé sur sa capacité à "n'en avoir rien à foutre" dans les autres domaines avant de s'y frotter.
2.2 - Les Choses
- Quelles sont les "Choses" dont je pourrais (ou pas) n’avoir rien à foutre ?
La catégorie des "Choses" englobe les objets, concepts et activités.
Certains éléments peuvent recouper d'autres catégories (des personnes considérées comme des "choses", des inconnus). Il suffit alors de les classer là où ça fait le plus sens pour nous.
Pour identifier ce dont on pourrait se foutre parmi les "Choses", Sarah Knight nous invite à noter ce qui provoque chez nous un soupir de contentement ou au contraire une sensation de malaise, façon "fourchette coincée dans le broyeur de l’évier".
Elle partage sa propre liste de 10 choses dont elle se fout désormais. Celle-ci englobe les avis des autres, son allure en bikini, le basket, les matins, Taylor Swift, l'Islande, le calcul infinitésimal, faire semblant d'être sincère, Google + ... Une sélection éclectique qui montre bien que chacun a ses propres priorités et lubies.
L'invitation est donc lancée de dresser notre propre liste sans filtre.
Si cette permission de "n'en avoir rien à foutre" a quelque chose de grisant, il peut être utile, pour un débutant dans la méthode, de voir aussi une liste de ce qui compte pour nous.
L’auteure de "La magie du j'en ai rien à foutre" partage ici la sienne et comment elle y consacre plus de ressources. Cette liste va des grands enjeux (le climat plutôt que le nucléaire iranien) aux choix lifestyle (le houmous plutôt que le yaourt grec, préférer dormir que d'aller au sport, regarder Game of Thrones plutôt que les Jeux Olympiques).
Derrière leur apparente futilité, ces exemples représentent, en réalité, un vrai gain quantifiable de temps, d'énergie et d'argent.
- Une étape libératrice
En parcourant ainsi ces 4 catégories, chacun va pouvoir identifier ce qui l'agace vraiment et ce qui lui plaît, sans se soucier du regard extérieur. C'est déjà un changement libérateur, lâche l’auteure.Aussi, se fixer de tels objectifs de lâcher-prise est essentiel pour Sarah Knight. Et plutôt que de ressasser ce que l'on "devrait" faire, il est temps, lance-t-elle, de lister noir sur blanc ce qui nous pourrit la vie et ce qui l'enchante vraiment.
Ça tombe bien, Sarah Knight a laissé quelques colonnes vierges dans cette partie du livre "La magie du j'en ai rien à foutre" dans le but de coucher ce premier jet d'inventaire.
Un pas décisif vers une vie allégée et plus heureuse !
2.3 - Le travail
Dans cette partie, Sarah Knight nous explique comment appliquer la magie du "je n'en ai rien à foutre" à notre vie professionnelle et ainsi devenir des employés épanouis et respectés.
Elle nous encourage globalement à nous libérer des contraintes et des attentes inutiles. L'objectif étant de nous concentrer sur ce qui compte vraiment, autrement dit faire du bon boulot tout en préservant notre énergie et notre bien-être.
"Vous pouvez contrôler à quel point vous êtes BON dans votre boulot, et COMBIEN de temps et d’énergie vous y consacrez ; le tout afin de minimiser l’ennui et de maximiser le plaisir."
- Les réunions et téléconférences
Sarah Knight n'y va pas par quatre chemins : les réunions inutiles et les téléconférences sont une plaie pour notre efficacité au travail.
L’auteure de "La magie du j'en ai rien à foutre" nous incite alors à décliner poliment ce genre d'invitations quand c'est possible. Quitte à laisser d'autres volontaires y aller à notre place.
Sarah Knight remarque avec humour que même lorsqu'on ne peut y couper, rien ne nous oblige à prendre des notes ou à suivre religieusement les PowerPoint soporifiques. Profitons-en plutôt pour avancer sur des tâches plus gratifiantes !
- Être respecté plutôt qu'aimé : la clé du succès (et de la santé mentale)
Sarah Knight nous met également en garde contre le piège de vouloir absolument être apprécié de ses collègues et supérieurs. Elle souligne qu'il vaut mieux viser le respect par son travail de qualité.
À ce propos, l'auteure nous alerte sur la "spirale infernale du je veux qu'on m'aime". Celle-ci, dit-elle, nous fait accepter des tâches ingrates et chronophages juste pour bien se faire voir. Son conseil : concentrons-nous sur nos missions et "fuck" le reste !
- Dress code ou pas, habillons-nous comme bon nous semble !
Avec son ton décalé habituel, Sarah Knight s'attaque aux codes vestimentaires aussi stricts qu'absurdes.
Évidemment, si notre tenue excentrique risque de nous faire virer, il est temps de revoir nos priorités... Mais dans la plupart des cas, elle constate que personne "ne pipe mot" si on troque ses escarpins inconfortables pour des sandales mignonnes.
L'essentiel est de faire du bon boulot, le reste n'est que détails !
"Je l’ai déjà dit et le redirai : il est très dur de se faire virer quand on bosse bien. Compte tenu de la quantité de choses auxquelles vous accordez de l’importance quand vous êtes au boulot, il doit bien en avoir trois ou quatre dont vous pouvez vous foutre, et améliorer ainsi votre vie quotidienne. Le code vestimentaire est l’une d’entre elles."
- La paperasse inutile
Vous savez, tous ces rapports que personne ne lit, ces notes qui partent directement de notre bureau à la poubelle... Sarah Knight nous conseille de tester par nous-même leur utilité. La prochaine fois, "oublions" donc de les remplir et observons ce qui se passe. Si aucun cataclysme n'éclate, c'est que nous pouvons définitivement les bannir de notre to-do list.
Après tout, notre temps et notre énergie sont trop précieux pour les gâcher dans des tâches inutiles !
- Les sollicitations des collègues : apprenons à dire non avec le sourire
Entre la collecte pour le dernier marathon caritatif de Gail et l'anniversaire de Tim au karaoké, difficile de trouver du temps pour soi.
Sarah Knight nous rassure : il est possible de décliner poliment ce genre d'invitations sans passer pour un ours mal léché. Inutile de nous forcer si le cœur n'y est pas. Réservons notre précieuse énergie pour les causes et les gens qui nous tiennent vraiment à cœur !
- Nous, notre réputation et notre "Putain de Budget" : le tiercé gagnant
Au final, Sarah Knight nous rassure : en appliquant la méthode "Je n'en ai rien à foutre" avec discernement, on ne nuit pas à sa réputation professionnelle, bien au contraire !
Elle insiste sur l'importance de bien choisir ses "battles" en fonction de ses priorités (son "Putain de Budget" dans le langage coloré de l'auteure).
Finalement, ce qui compte est de se concentrer sur la qualité de son travail. Pour le reste, osons le "Je n'en ai rien à foutre" libérateur !
2.4 - Les amis, connaissances et inconnus
Dans cette 3ème catégorie à passer au crible du "j'en ai rien à foutre" de Sarah Knight, les choses se corsent.
Si on aime ses amis, les relations humaines restent complexes. En cela, les amis aussi peuvent nous taper sur les nerfs, comme lorsqu’ils sont sous l'effet de l'alcool par exemple. Il est donc crucial de savoir prendre du recul et en n’avoir rien à foutre, faire preuve de tact pour ne pas ruiner une amitié.
- Se blinder
Notre fatras mental est encombré par ce que les autres y ont déposé, que ce soit des sujets de préoccupation temporaires ou des prises de tête qui moisissent là depuis des années. Mais au fond, si tout cela a atterri dans notre esprit, c'est bien qu'on les y a laissé entrer ! s’exclame l’auteure.
Pour se blinder face aux contrariétés induites par les relations, Sarah Knight conseille alors d'établir un périmètre de sécurité autour de notre "hangar à pensées". Cela peut prendre la forme de :
Limites invisibles : s'arranger pour ne pas se retrouver dans une situation qu'on sait stressante.
Barrières plus explicites : dire directement à des amis qu'on n'aime pas une activité et qu'on n'y participera plus).
En guise d’illustration, l'auteure évoque ici l'exemple de soirées quiz auxquelles elle était sans cesse conviée. Plutôt que de décliner avec des excuses bancales, elle a fini par annoncer clairement à ses amis qu'elle détestait ce concept et ce lieu, et qu'elle ne viendrait plus. Ainsi, en étant franche mais polie, elle dit avoir posé sa limite sans froisser personne.
Sarah Knight nous conseille de commencer à nous entraîner à ces refus directs avec de simples connaissances avant de nous attaquer aux proches.
- Sollicitations, donations et prêts, oh bon sang !
L’auteure de "La magie du j'en ai rien à foutre" poursuit avec un autre sujet épineux : les demandes de dons qui affluent via les réseaux sociaux, par mail ou de vive voix. Même avec les meilleures intentions du monde, impossible de répondre favorablement à toutes, sous peine de faire sauter notre budget !
Sarah Knight explique, elle, classer ces sollicitations par ordre croissant de proximité émotionnelle : les demandes de parfaits inconnus qui ont eu notre contact, celles de connaissances, et enfin celles de proches qui nous tiennent à cœur.
Pour les premières, inutile de culpabiliser. On peut les refuser poliment sans risque de représailles. Pour les connaissances, on peut aussi décliner en invoquant un désaccord d'opinion sur la cause en question, sans que cela ne nous retombe dessus.
C'est avec les amis proches que cela se corse. Si leur projet ne nous emballe pas mais que nous craignons de les froisser, il faut faire preuve de psychologie. Par exemple, leur signifier qu'on est content pour eux même si on ne donne pas. Ou absorber leur énergie contrariée en répondant du tac au tac sur un ton badin.
- Principes personnels
Quand on sent qu'un refus risque vraiment de blesser, une parade très efficace est d'invoquer des "principes personnels" informe l’auteure. Cela consiste à expliquer qu'on a pour règle de ne jamais donner pour tel type de projet, sinon on devrait le faire pour tous.
Personne ne peut contester ce genre de position de principe sans passer pour un goujat. C'est une prise imparable, à utiliser avec parcimonie pour ne pas éveiller les soupçons. On peut l'appliquer aux mariages, aux conseils pro gratuits, aux séances de lecture publique, etc.
L'auteure de "La magie du j'en ai rien à foutre" termine sur le sujet en listant les choses auxquelles nous pourrions opposer des principes personnels. Elle mentionne alors les enterrements de vie de garçon/ jeune fille pour un remariage, offrir gratuitement un conseil professionnel, les petits déjeuners d'affaires, un aller-retour de 4 heures en voiture dans la même journée, les karaokés, les "dîners pot commun", etc.
- RSVP : non, c’est non
Pour illustrer la puissance des principes personnels, Sarah Knight prend l'exemple d'une invitation à un vernissage par un ami artiste susceptible. Plutôt que d'avouer qu'elle a horreur de ces événements, elle préfère prétendre que quelque chose de traumatisant lui est arrivé dans ce contexte et qu'elle a fait le serment de ne plus jamais y aller. L'ami n'osera pas insister.
Bien sûr, cela ne fonctionne que si on en n'a vraiment rien à faire de l'activité en question. Sinon, on s'expose à devoir constamment esquiver et mentir, ce qui est contre-productif.
- Le minuscule petit éléphant dans la pièce
Dernier sujet sensible de cette catégorie : les enfants des autres.
Quand on n'est pas parent soi-même, il peut être délicat d'admettre qu' "on n'en a rien à cirer" des bambins d'amis ou de connaissances, vu l'attachement viscéral qu'ils suscitent chez leurs géniteurs.
Pourtant, l'auteure de "La magie du j'en ai rien à foutre" a découvert en interrogeant des parents que même eux avouent, après quelques verres, n'avoir rien à faire de la marmaille des autres !
Pour Sarah Knight, la clé est alors de se concentrer sur les interactions qui nous rendent heureux - jouer, lire ou cuisiner avec son propre enfant par exemple - et non sur celles qui nous ennuient (les couches et les détails de garderie des enfants d'amis).
De plus, Sarah Knight met en évidence, par divers exemples, les avantages d’avoir des enfants en ce qui concerne sa méthode.
Par exemple, une mère confie qu'elle essaie d'apprendre à sa progéniture à faire le tri dans ce à quoi ils accordent de l'importance, sans se soucier du regard des autres. Un père confirme que devenir parent aide paradoxalement à hiérarchiser ses priorités dans d'autres domaines comme le boulot, et à poser des limites.
"Avoir un enfant peut, en réalité, servir à déterminer et prioriser ce dont on a (ou pas) à foutre dans les autres aspects de la vie, comme le travail. Le bien-être de ce petit être humain tout neuf est parfois le catalyseur qui permet de n’avoir enfin rien à foutre de rester plus tard au bureau, d’accepter des responsabilités supplémentaires et d’entrer dans l’équipe de foot (au sens propre ou au sens figuré) de la boîte. Cela peut aider à tracer des frontières nettes aussi bien avec ses supérieurs qu’avec les employés et à se montrer franc et ferme sur ce que l’on est capable de supporter au quotidien. En d’autres termes, cette précieuse créature pourrait être l’élément déclencheur de l’application de la méthode MêmePasDésolé, catégorie 2 : le Travail. Bam !"
Être un bon parent implique donc aussi de cultiver son propre éveil au "j'en ai rien à foutre" !
- Les choses dont même les parents n’ont rien à foutre
L'auteure de "La magie du j'en ai rien à foutre" termine sur le sujet en listant les choses dont même les parents n’ont rien à foutre. Ainsi, contrairement à ce qu’on imagine, la majorité des parents n’en ont en rien à faire de "par où est sorti notre bébé", si nous allaitons ou pas, de "ce que disent les spécialistes", "de quand, où, comment et dans quelles circonstances" notre enfant a acquis la propreté, de ses plannings de sieste, etc.
- Ce n’est pas toujours un problème de heurter les sentiments
Enfin, Sarah Knight avoue que parfois, pour avoir une vie meilleure, il faut accepter de potentiellement heurter les sentiments des inconnus.
Pas question d'être volontairement méchant, mais l'auteure liste, avec humour, quelques situations où on peut s'autoriser à choquer un peu : face à des gens qui veulent nous convertir, des indécis qui retardent la file d'attente, des comiques ratés, des femmes qui urinent sur la cuvette des toilettes ou encore des passagers sans gêne dans l'avion.
Elle conclut que tout l'enjeu est, encore une fois, de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous.
2.5 - La famille
La famille, dernier bastion de ce dont on pense devoir se préoccuper... et pourtant !
Comme un impôt supplémentaire qui viendrait grever notre budget, les attentes familiales pèsent souvent plus lourd que tout le reste réuni. Le moteur ? La culpabilité.
"La culpabilité n’est pas un sentiment positif. Elle ressemble plus à une envie soudaine et douloureuse de vous gratter l’entrejambe alors que vous êtes en société et qu’il vous est impossible de passer à l’acte. Et, bien évidemment, vous mourez d’envie d’apaiser cette démangeaison. Voilà, la culpabilité, c’est ça."
- Cessez de vous sentir coupable
Or, culpabiliser signifie justement qu'on a échoué à appliquer la méthode "MêmePasDésolé". Sarah Knight nous exhorte alors à employer tous les outils présentés jusque-là pour désactiver la culpabilité avant qu'elle ne nous engloutisse, au risque d'être broyés.
Certes, les liens familiaux rendent plus délicate la frontière entre "devoir" et "plaisir". Mais il est faux de croire qu'on doit se préoccuper de quelqu'un juste parce qu'on partage ses gènes. Encore une fois, c'est une question de choix, pas d'obligation.
- Quand un cigare n’est pas seulement un cigare et une tasse de thé pas seulement une tasse de thé
L'auteure illustre ce dilemme avec l'exemple de notre mère qui tiendrait à nous refiler le vieux service à thé en porcelaine de sa propre mère, notre grand-mère. Dire non, même de façon polie, ce serait la froisser. Mais accepter par culpabilité, c'est gâcher de la place et de l'énergie pour quelque chose dont on n'a rien à faire.
La seule issue est de faire primer ses propres sentiments et opinions de façon diplomate. Et c'est ce que l'auteure souhaite nous apprendre dans ce chapitre du livre "La magie du j’en ai rien à foutre".
- D’après les sondages…
Un sondage mené par Sarah Knight révèle que, dans le domaine familial, les gens n’en ont massivement rien à foutre :
Des divergences politiques et religieuses (ex-aequo),
Des traditions ringardes et fêtes qui tournent au malaise,
De ces vieilles rancunes et rivalités qui monopolisent les discussions,
Des photos de famille obligatoires et mal orchestrées,
De devoir "apprécier" tout le monde juste au nom des liens du sang,
Qu'on utilise ces liens pour les forcer à faire des choses.
Qu'on partage ces avis ou pas, il est réconfortant de voir que nous ne sommes pas seul à trouver certains aspects familiaux pesants.
- Religion et sujet de débats houleux
La religion est typiquement un sujet explosif en famille. Pourtant, chacun a le droit d'avoir sa propre foi, sans avoir à en débattre.
Pour Sarah Knight, il faut savoir couper court, sans agressivité mais avec fermeté, aux tentatives de prosélytisme d'une tante "grenouille de bénitier" par exemple. Si elle est vexée, ce n'est pas notre faute. Aussi :
"La prochaine fois que Tante Jennifer fait une allusion pas-si-subtile-que-ça à votre inclination à vivre dans le péché, contentez-vous d’essuyer la coulure d’œuf Bénédicte sur votre menton et de déclarer : "Je respecte ton opinion, Tatie, mais je préférerais ne pas avoir de conversation sur nos différentes conceptions de la religion ici, pendant le brunch du soixantième anniversaire de mariage de Mamounette et Papounet." C’était franc et poli, non ? Vous êtes, dans ce cas précis, tout sauf un trouduc."
Mieux vaut donc jouer la carte de la franchise, quitte à froisser, que de perdre un temps et une énergie folle à louvoyer pour esquiver le débat. Sachant que :
"Le pouvoir de la franchise est tout sauf exagéré. Sincèrement, la perte de temps et d’énergie que représente le fait de tourner autour du pot est inimaginable. En fait, la simple idée de le faire est épuisante."
En guise d’illustration, Sarah Knight relate un dîner de famille où la conversation a dévié sur les polémiques de naissance autour du président de l'époque. Avant que cela ne s'envenime, elle a calmement mais fermement déclaré à ses proches qu'elle les aimait mais que la discussion était close. Résultat : le reste du repas s'est déroulé dans la bonne humeur, préservant l'essentiel.
- Refuser de porter le poids de la honte
Culpabiliser de ne pas se conformer aux attentes familiales, c'est porter le poids de la honte, en solitaire. S'en libérer est justement le but de la méthode "MêmePasDésolé".
Les sondages montrent que nous sommes nombreux à partager ce fardeau. S'appuyer sur ce consensus aide à assumer ses choix avec plus d'assurance.
Aussi, si l’on applique la méthode de Sarah Knight avec bonne foi, en respectant certains principes comme la franchise et la politesse, les risques de conflit ouvert ou de rupture sont faibles. C’est plutôt une façon d’entrer dans une forme d'apaisement et de respect mutuel, assure l’auteure. Et si d'aventure notre tribu est peuplée d'hystériques, est-ce si grave de ne plus être invité ?
- Vacances : un principe personnel
Pour illustrer la puissance des "principes personnels" en famille cette fois-ci, Sarah Knight explique le système qu'elle a instauré avec son mari pour Thanksgiving. Finis les casse-têtes pour contenter tout le monde. Un programme de rotation sur 3 ans a été établi, sans dérogation possible. Quitte à paraître rigide, personne n'est vexé et tout le monde est traité équitablement.
- La belle-famille
"Sachez-le, en vous mariant, vous avez doublé d’un seul coup vos "dépenses" familiales. C’est un peu comme quand vous avez une prime au boulot, que vous faites des bonds partout ("trop génial !") et puis que les impôts vous en taxent 50 %… WTF ?" s'amuse l'auteure.
La belle-famille est une donnée avec laquelle il faut aussi composer. Et là encore, il est possible de moduler subtilement son investissement pour limiter les prises de tête et optimiser les bons moments, sans froisser.
La clé est de se mettre d'accord en couple sur un "Putain de Budget" commun et un partage équitable des corvées belle-familiales (cadeaux, visites etc). L’idée est ici aussi de déclencher un cercle vertueux qui profite à tous.
- La dernière ligne droite
Dernière exploration en date de notre hangar mental, la famille est sans doute la partie la plus ingrate. Pourquoi ? Car profondément enfouie sous des années de non-dits et de ressentiment. Mais ce grand déballage une fois fait, le plus dur est derrière nous !
Il ne reste plus qu'à dresser la liste définitive de ce dont on peut vraiment se foutre dans cette catégorie. Et à s'y tenir.
L'étape 1 - "décider de ce dont on n'a rien à foutre" - est enfin bouclée. Place à la libération de l'étape 2 !
Partie 3 - N’en avoir rien à foutre
Nous voilà arrivés au moment tant attendu de l'étape 2 de la méthode "MêmePasDésolé". C'est-à-dire arrêter concrètement d'avoir quelque chose à foutre des éléments identifiés dans les listes de l'étape 1.
3.1 - La foutue Sainte Trinité : temps, énergie et argent
Pour nous motiver à passer à l'action, Sarah Knight nous invite à visualiser tout ce que nous avons à y gagner en termes de temps, d'énergie et d'argent.
Ne plus aller à un barbecue vegan ennuyeux, c'est gagner une heure pour un bon bain relaxant. Sécher un dîner tardif un mardi soir, c'est être en forme le lendemain matin pour aller à la salle de sport. Zapper le mariage d'une vague connaissance, c'est s'offrir des vacances de rêve dans les Caraïbes. Les exemples ne manquent pas !
L'auteure nous invite à placer les éléments de nos listes sur un "diagramme de Venn temps-énergie-argent". Ceci afin de bien identifier ce qui nous coûte le plus.
Elle partage son propre diagramme en exemple. Elle y révèle que le temps est sa ressource la plus précieuse car non renouvelable, contrairement à l'énergie et l'argent dans une certaine mesure.
L'auteure décrit aussi ce que ce tri salvateur dans ses priorités lui a personnellement apporté. À savoir : des grasses matinées, des week-ends câlins, des congés déconnectés, une culture web pointue, des apéros détente, une confiance décuplée... La récolte est alléchante.
3.2 - À petits pas
Pour faciliter le passage à l'étape 2 et ne pas perdre la motivation gagnée à l'étape 1, Sarah Knight suggère de procéder graduellement, en douceur.
D'abord en s'attaquant aux points de nos listes qui n'impliquent et n’affectent que nous. Pas besoin d'être poli, juste honnête avec soi-même. Raccrocher au nez d'un télévendeur, se faire porter pâle le jour de son anniversaire, ou ouvrir au plombier en pyjama plutôt que de se pomponner à l'aube… voilà de bons débuts dans l'art de ne plus en avoir rien à faire ! Et ces petites révolutions ne dépendent que de nous, inutile de se justifier.
Ensuite, classer les autres points sur une échelle de complexité :
Facile (niveau jaune) : se désabonner du drame Facebook d'un ami, arrêter de s'acharner contre les rides, admettre son incompréhension des marchés financiers...
Moyen (niveau orange) : refuser poliment d'aider un pote à déménager en prétextant le boulot, ne pas se forcer à "faire de la synergie" au bureau...
Difficile (niveau rouge) : sécher le mariage d'un cousin éloigné malgré le carton d'invitation, instaurer des limites avec les enfants envahissants de ses amis...
Plus la situation est délicate, plus elle nécessite de diplomatie pour ne froisser personne. L'idée est d'avancer en douceur pour ne pas se décourager, en appliquant les principes de franchise et de politesse. La maîtrise vient avec la pratique !
3.3 - La soirée à laquelle personne ne veut aller
Sarah Knight aborde, dans cette partie du livre, des situations courantes où il peut être difficile, mais libérateur, de n'en avoir rien à foutre.
La soirée d'entreprise à laquelle personne ne veut aller en est un bon exemple. L'auteure de "La magie du j'en ai rien à foutre" nous rassure : si nous décidons de ne pas y aller, pas de panique si le lendemain, on se sent un peu mal à l'aise. C'est juste la liberté qui s'installe, pas de la honte ! Il ne faut pas confondre ce sentiment inhabituel avec du regret.
3.4 - À propos du degré de franchise : quand une franchise totale n’est peut-être pas la meilleure règle à adopter
Ensuite, Sarah Knight nuance son propos sur la franchise à tout prix.
"Si vous avez le pressentiment qu’une franchise totale N’EST PAS, en réalité, la meilleure règle à adopter, vous pouvez légèrement la distordre."
Certes, l'honnêteté est la meilleure politique pour ne rien avoir à foutre de quelque chose. Mais parfois, une franchise totale n'est pas la meilleure approche. Notamment quand il s'agit des talents culinaires de quelqu'un, de l'emploi du temps, de la santé mentale, du Père Noël, des femmes enceintes ou encore des belles-mères (voire des belles-mères enceintes !).
Pour l’auteure de "La magie du j'en ai rien à foutre", un peu de filtre peut, dès lors, s’avérer judicieux !
3.5 - Intérêts différents, même principe
L'auteure propose ensuite des exemples concrets de choses dont les gens n'ont rien à faire. Ceux-ci sont issus d'un sondage. Et sont classées en 3 catégories selon le niveau de difficulté à ne plus s'en soucier : débutant, intermédiaire, confirmé.
Dans la catégorie "Choses", on retrouve des sujets comme les célébrités, le recyclage, la radio publique NPR, la paternité réelle des œuvres de Shakespeare, Game of Thrones ou encore les réseaux sociaux. L’auteure partage des stratégies adaptées à chaque niveau pour affirmer qu'on n'en a rien à faire, sans vexer son entourage.
La catégorie "Travail" regroupe les classiques mails non sollicités, ragots, séminaires de cohésion, léchage de bottes, évaluations annuelles. Là encore, des conseils malins permettent de se libérer du superflu, du niveau débutant (partir en vacances le jour du séminaire) au niveau confirmé (imaginer son boss en maillot de bain ridicule pendant l'évaluation).
Enfin, l'auteure aborde le domaine des relations (amis, connaissances, inconnus), plus subtil car les interactions y sont variées et fréquentes. En nous préparant mentalement, nous pouvons néanmoins, assure l’auteure, réussir à ne plus accorder d'importance à ce qui nous pèse, sans froisser les gens. Le mariage illustre bien ce défi relationnel : merveilleux au début, il peut devenir pesant quand les invitations s'accumulent. On a le droit de décliner, si le budget, l'emploi du temps ou le degré de proximité ne le permettent pas.
L'enjeu est toujours d'assumer ses choix pour préserver son bien-être.
3.6 - Le cas d’étude parfait : les mariages
- Admettre qu'avec le temps, les invitations au mariages peuvent devenir pesants
Sarah Knight développe ensuite l'exemple des mariages.
Le mariage est un cas d'étude parfait, observe l'auteure. Il illustre très bien l'art délicat d’en avoir rien à foutre dans la catégorie des relations (amis, connaissances et inconnus tout à la fois). Il implique, en effet, toute une gamme de personnes, du cercle proche aux parfaits étrangers. Et englobe une multitude d'attentes en termes de temps, d'énergie et d'argent :
"Il n’y a aucune honte à admettre que tous les mariages auxquels vous serez invités jusqu’à la fin des temps ne sont pas des mariages auxquels vous devez vous rendre. Vous faites souvent, et avec plaisir, des sacrifices pour participer aux événements exceptionnels qui jalonnent la vie de vos amis (ou des enfants de vos amis). Mais, parfois… Parfois, il se peut que la destination choisie ne soit pas dans vos moyens. Ou que vous ayez envie de vous rendre au mariage, mais ne puissiez faire entrer dans votre calendrier les seize autres soirées qui l’accompagnent. Ou encore que vous ne connaissiez pas très bien ces gens. Vous pouvez même ne pas vouloir ou être dans l’incapacité d’y assister pour tout un tas de raisons parfaitement justifiables."
L'auteure poursuit :
"On en est tous passés par là, même si je suis la seule à l’avouer noir sur blanc. Les mariages sont là où se rendent les Esprits éclairés pour descendre des shots tièdes de bonne vodka et rendre les armes dans les bras d’une demoiselle d’honneur bien disposée."
L'enjeu, poursuit l'auteure de "La magie du j’en ai rien à foutre", est alors de trouver le juste équilibre entre préserver son bien-être et éviter de froisser les mariés ou leur entourage.
Bref, les mariages sont un concentré de défis pour le "j'en ai rien à foutre".
- Quatre scénarios de mariage dans lesquels nous pourrions ne plus vouloir nous investir
L'auteure détaille 4 scénarios typiques où le naturel reviendrait au galop de vouloir en faire moins, voire sécher carrément :
Le mariage programmé pendant un week-end habituellement réservé à une escapade ou une réunion de famille.
L'enterrement de vie de garçon/jeune fille qui s'ajoute au mariage, avec surcoût financier et de congés.
Le mariage aux mille activités qui gâcherait un séjour de rêve au spa.
Le brunch du lendemain alors qu'on décuve et qu'on veut juste dormir.
Pour chacune de ces situations, Sarah Knight propose un "diagramme Franchise et Politesse". Ce diagramme aide à visualiser le curseur du "j'en ai rien à faire" entre honnêteté absolue et diplomatie. L'idée est de trouver sa zone de confort. Tout en évitant le territoire du "trouduc" où on enverrait tout balader sans égards pour les autres.
Et si malgré tous les efforts, l'envie de fuir reste forte face aux sollicitations, l'auteure suggère un recours aux "principes personnels". Clamer par exemple qu'on a pour règle de ne jamais voyager pour un enterrement de vie de garçon. Bien dosée et utilisée avec parcimonie, cette astuce peut être un atout décisif.
3.7 - Le sujet épineux de l'héritage familial
Dans la catégorie des relations familiales, Sarah Knight aborde le délicat sujet de l'héritage et de l'énergie folle dépensée en marchandages et plaintes sur le partage des biens.
Beaucoup affirment s'en moquer, mais peinent en réalité à mettre en pratique le "j'en ai rien à foutre" face à leurs proches sur ce terrain sensible.
Pourtant, en s'alignant vraiment sur cette position de détachement, nous pourrions davantage profiter des moments en famille au lieu de nous déchirer.
3.8 - S'offrir des compensations
Parfois, malgré toute notre bonne volonté, certaines obligations familiales resteront incontournables.
L'auteure propose alors de nous octroyer des "primes de rendement" pour passer la pilule. Par exemple : un massage le lendemain d'une fête de famille barbante, un vol en classe affaires au retour d'une réunion éreintante ou encore un Percocet subtilisé à notre mère avant un déjeuner Rotary interminable. Et si une photo de groupe est imposée, rien ne nous empêche de porter en douce une lingerie décalée sous nos vêtements, s’amuse l’auteure !
3.9 - FAQ (Foutoir Aux Questions)
Pour finir, Sarah Knight répond aux interrogations fréquentes sur la mise en pratique de sa méthode. Celles-ci vont de la peur de devenir apathique à la difficulté d'expliquer tout ça à sa mère.
L'essentiel est de garder en tête l'objectif : non pas basculer dans le "je m'en foutisme" généralisé, mais nous libérer du superflu pour nous consacrer à ce qui nous épanouit vraiment.
C'est, en effet, tout l’intérêt de cette philosophie de vie subtile mais puissante, au potentiel libérateur immense, précise l’auteure.
Partie 4 - Quand la magie du j’en ai rien à foutre change radicalement votre vie
Nous voici arrivé au terme de notre initiation à la méthode "MêmePasDésolé".
Nous avons appris à identifier ce qui compte vraiment pour nous et à nous libérer du reste. Il est temps, annonce l’auteure de "La magie du j'en ai rien à foutre", de faire le bilan des gains obtenus. Puis, d'explorer de nouveaux horizons de joie.
4.1 - Vous gagnez à ne pas vous disperser
Ne plus accorder plus de temps, d'énergie et d'argent à ce qui ne nous épanouit pas nous amène à récupérer des ressources précieuses.
L'auteure nous invite donc à quantifier précisément ces gains : combien d'heures, de peps et d'euros avons-nous économisés ?
Dresser la liste de ces bénéfices concrets est motivant et très satisfaisant ! soutient l’auteure.
4.2 - Épargnez votre corps, votre esprit et votre âme
Mais, poursuit Sarah Knight, les bienfaits de cette démarche vont au-delà de ces aspects matériels.
En arrêtant de nous inquiéter pour des broutilles, nous avons aussi gagné en connaissance de nous-même, en confiance et en enthousiasme pour la vie.
Sarah Knight aborde également avec humour les conséquences physiques d'accorder trop d'importance à des choses futiles. Elle raconte comment, en voulant absolument finir une partie de Scrabble en ligne, elle a raté son train et s'est tordu la cheville. Depuis, "courir pour attraper un train" figure sur sa liste des choses dont elle n'a rien à faire !
L'autrice souligne enfin les bénéfices mentaux et spirituels du "j'en ai rien à foutre". En arrêtant de se préoccuper de obligations pesantes, on gagne en sérénité et en liberté intérieure. C'est ce qu'elle appelle avec un brin de provocation "l'affirmation de l'âme".
Ce sont donc à la fois notre corps, notre esprit et notre âme qui se portent mieux.
4.3 - Une autre manière de n’en avoir rien à foutre
Parfois, ajoute Sarah Knight, n'en avoir rien à faire prend une forme plus passive.
Face à un interlocuteur pénible qu'on ne peut éviter (un patron, un opérateur téléphonique...), plutôt que de s'agacer, on peut se répéter en boucle "ça n'en vaut pas la peine", et passer à autre chose.
Ce mantra est une autre façon de lâcher prise qui soulage aussi à coup sûr.
4.4 - Un monde meilleur ou l'art de devenir un agent du changement
Pour Sarah Knight, en goûtant aux joies de cette philosophie, nous devenons naturellement un ambassadeur du "j'en ai rien à foutre" dans notre entourage. Or, aider les autres à y parvenir procure encore plus de satisfaction que sa propre libération, pense-t-elle.
"Si nous en avions tous moins à foutre et étions exponentiellement plus heureux et en meilleure santé, le monde s’en porterait bien mieux" clame l’auteure. À nous donc d'y contribuer !
4.5 - Ce dont vous devriez avoir davantage quelque chose à foutre
Pour l’auteure de "La magie du j'en ai rien à foutre", nous pouvons, une fois dans la dynamique, aller encore plus loin. Interrogeons-nous : quelles sont les choses auxquelles on devrait accorder plus d'importance, une attention nouvelle ?
En s'inspirant des regrets les plus courants des personnes en fin de vie, elle cite des pistes : voyager davantage, prendre plus soin de sa santé, apprendre une langue, préparer sa retraite, cultiver un talent... L'idée est de voir plus grand, au-delà des petites victoires du quotidien. Et la clé, conclut l’auteure, reste surtout de suivre sa propre voie.
Pour autant, il ne s'agit pas de nous infliger de nouvelles injonctions. Juste d'une invitation à réfléchir à nos priorités profondes. De même, on a le droit de changer d'avis en cours de route. L'essentiel est de rester à l'écoute de ses désirs et de ce qui nous fait vibrer. Et ce, envers et contre les "haineux" déconcertés par nos choix.
4.6 - Atteindre l’éveil
Au terme de son livre, Sarah Knight nous interpelle : sommes-nous décidé à embrasser pleinement la magie du "j'en ai rien à foutre" ?
La balle est dans notre camp, ajoute-t-elle. Et une chose est sûre, c’est que cette lecture n'était qu'un début.
"Elle [cette lecture] peut vous permettre de vous sortir la tête du nœud coulant mais, mieux encore, empêcher que vous n’en arriviez jamais à ce stade."
À nous donc de déployer à notre façon le meilleur de la méthode dans notre vie pour rejoindre les rangs des Esprits éclairés !
Conclusion de "La magie du j’en ai rien à foutre" de Sarah Knight
Les 3 idées clés du livre "La magie du j’en ai rien à foutre"
- Identifier et éliminer les sources de contrariété
Sarah Knight nous offre, dans "La magie du j'en ai rien à foutre", une véritable boîte à outils pour faire le tri dans nos prises de tête.
Sa méthode "MêmePasDésolé" en deux étapes nous apprend à cibler ce qui nous pourrit la vie, puis à nous en libérer concrètement. L'auteure nous aide à visualiser notre esprit comme un vaste hangar encombré. Hangar qu'il nous faut nécessairement passer au crible, avant d'oser affirmer nos choix sans culpabilité. Un processus cathartique et salvateur !
- Préserver son temps, son énergie et son argent
Au-delà de l'inventaire mental, Sarah Knight nous invite à chiffrer précisément le coût des choses dont on n'a rien à faire : le temps, l'énergie et l'argent qu'elles dévorent.
Grâce à son "diagramme de Venn temps-énergie-argent", on visualise mieux où passe notre précieux "budget d'intérêt". Et les bénéfices concrets de la méthode "MêmePasDésolé" n'en ressortent que plus clairement : des heures, du peps et des euros récupérés pour ce qui compte vraiment !
- Rayonner autour de soi avec le "je n'en ai rien à foutre"
Sarah Knight ne s'arrête pas à notre épanouissement personnel. Pour elle, en goûtant aux joies du "j'en ai rien à foutre", on devient naturellement un ambassadeur de cette philosophie libératrice. Tel un "agent du changement", on aide alors nos proches à s'alléger eux aussi du superflu. Car l'auteure est convaincue : si nous étions tous plus détachés et heureux, le monde s'en porterait bien mieux. Bref, un cercle vertueux inspirant !
Qu’est-ce que vous apportera la lecture de "La magie du j’en ai rien à foutre"
En refermant ce livre, vous aurez en main de nombreuses clés pour enfin lâcher prise. Avec "La magie du j'en ai rien à foutre", Sarah Knight propose un art de vivre tourné vers l'essentiel, et nous apprend à le mettre en place concrètement dans nos vies.
Finalement, que vous souhaitiez vous libérer des conventions, affirmer vos envies, préserver votre énergie ou rayonner autour de vous, son programme s'adapte à toutes vos aspirations.
Pourquoi lire "La magie du j’en ai rien à foutre" ?
Je recommande la lecture de cet ouvrage pour deux raisons principales :
D'abord parce que Sarah Knight aborde avec un humour décapant un sujet ô combien sérieux : comment cesser de se prendre la tête avec des choses qui n'en valent pas la peine.
Ensuite, parce que sa méthode "MêmePasDésolé", ultra pratique et bien rodée, nous guide pas à pas vers un quotidien enfin centré sur nos priorités profondes.
En somme, de quoi entamer une vraie révolution intérieure et devenir, à votre tour, un "esprit éclairé" épanoui !
Points forts :
Une méthode accessible et assez "fun" à lire pour se libérer du superflu.
Des conseils pragmatiques applicables à tous les domaines (travail, relations, famille...).
L'humour décapant de l'auteure qui dédramatise un sujet de développement personnel essentiel et, dans le même temps, le traite de façon sérieuse.
Point faible :
Le ton et langage familier (voire très familier) peuvent ne pas plaire à tous.
Ma note :
★★★★☆
Avez-vous lu "La magie du j’en ai rien à foutre"? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin d'acheter le livre de Sarah Knight "La magie du j’en ai rien à foutre"
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Sarah Knight "La magie du j’en ai rien à foutre"
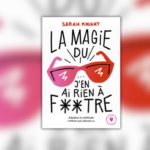 ]]>
]]>Résumé de « L’Erreur de Descartes » d’Antonio R. Damasio : un succès inattendu de librairie pour un livre qui navigue entre neurosciences et philosophie pour démontrer toute l’importance des émotions sur nos manières de penser et d’agir.
Antonio R. Damasio, 1994 (2010 pour la dernière édition), 394 p.
Chronique et résumé de « L’erreur de Descartes » d’Antonio R. Damasio :
Avant d'aller plus loin : qui est Antonio Damasio ?
Neurobiologiste de renom, Antonio Damasio est le directeur du Brain and Creativity Institute (Institut pour l'étude neurologique de l'émotion et de la créativité) de l'université de Californie du Sud. Il enseigne également au Salk Institue for Biological Studies dans la région de San Diego (La Jolla).
Il s'est fait connaître du grand public par la publication de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique exigeante et de grande qualité. L'Erreur de Descartes (initialement paru en 1995, actualisé en 2010) est le premier et sans doute le plus connu. Mais d'autres ont également eu un grand succès :
Le Sentiment même de soi : corps, émotions, conscience (1999) ;
Spinoza avait raison : joie et tristesse, le cerveau des émotions (2003) ;
L'ordre étrange des choses : la vie, les émotions et la fabrique de la culture (2017) ;
Sentir et savoir : une nouvelle théorie de la conscience (2021).
Préface à la nouvelle édition
Antonio Damasio propose ici un résumé très rapide du développement des neurosciences et de ses espoirs pour l'avenir. Il cite rapidement les pionniers de la psychologie scientifique du début du XXe siècle ayant questionné le rôle des émotions chez les humains :
Charles Darwin ;
William James ;
Sigmund Freud ;
Charles Sherrington.
Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, un fossé s'est creusé entre le domaine naissant des neurosciences (qui s'intéresse au fonctionnement du cerveau humain) et l'étude des sentiments. Heureusement, la publication de L'Erreur de Descartes a changé la donne.
Selon l'auteur, il existe des marqueurs somatiques (expliqués plus loin dans l'ouvrage) qui permettent de faire le "pont" entre émotion et raison. Cela permet de montrer que :
Certes, les émotions peuvent créer des préjugés et nuire au raisonnement.
Mais qu'elles interviennent également de façon beaucoup plus positive qu'on ne le croit souvent.
En fait, selon Antonio Damasio, la raison a évolué à partir des émotions. Celles-ci peuvent augmenter la prise de décision et son efficacité et ainsi nous assurer de meilleures chances de survie.
Notre instinct nous guide en se rappelant des bonnes décisions prises par le passé. Plus encore, nos sentiments et nos émotions jouent un grand rôle dans l'apprentissage et, notamment, dans l'apprentissage des règles sociales.
Les sciences humaines et sociales (et par extension, le marketing (digital), par exemple) peuvent-elles apprendre quelque chose de la neurobiologie ? C'est ce qu'espère l'auteur !
Introduction
Les philosophes et les scientifiques opposent souvent raison et passion. Mais l'auteur souhaite remettre en question cette opposition. Comment en est-il venu à se questionner à ce sujet ?
Il raconte une anecdote d'un patient qui ne pouvait plus ressentir d'émotions en raison d'une maladie neurologique. La personne était intelligente, mais elle ne pouvait plus, suite à son problème de santé, prendre des décisions "socialement appropriées" ou "personnellement avantageuses".
Que s'était-il passé ? Pour l'auteur, c'était le signe que prise de décision rationnelle et émotions avaient un lien. En tant que spécialiste de neurobiologie, Antonio Damasio en a fait une hypothèse scientifique : la raison nécessite la capacité de ressentir des sentiments pour agir correctement.
Après 20 ans de recherche clinique, son hypothèse devient enfin une théorie "viable". Son travail montre que le cerveau n'est pas le seul centre de raisonnement. En fait, il semble que les pensées humaines soient régulées au sein d'une organisation complexe de réseaux neuronaux qui dépasse le seul cerveau.
Tous nos ressentis et émotions participent à nous faire agir dans un sens ou dans un autre. Plus précisément, c'est grâce à eux que nous pouvons adhérer à des principes moraux ou des conventions sociales. Éthique et biologie sont donc étroitement corrélées.
Autre contribution majeure des recherches de l'auteur : l'idée que les sentiments ne sont pas seulement "dans la tête" mais plutôt un reflet de ce qui se passe dans l'ensemble du corps. En réalité, ils sont des guides internes qui permettent une surveillance continue de l'état du corps et qui nous renseignent sur notre état (douleur, plaisir, joie, satisfaction, etc.).
Nous avons tendance à oublier que notre cerveau — où nous plaçons notre "esprit" et notre intelligence — est le fruit d'une évolution qui commence par le reste du corps. Or, c'est d'abord par les organes sensoriels que nous appréhendons notre environnement ; la raison ne vient que dans un deuxième temps !
Première partie
Chapitre 1 : Désagrément dans le Vermont
Antonio Damasio commence par raconter l'histoire de Phineas P. Gage, un travailleur des chemins de fer très promis à une belle carrière dans le Vermont de la fin du XIXe siècle. Doué, proactif et sociable, il avait tout d'un futur leader.
Malheureusement, un accident survint : le cheminot reçut une barre de métal droit dans la tête, transperçant de la joue jusqu'au crâne. Il n'en mourut pas, mais — chose étrange — sa personnalité changea du tout au tout. Il avait toujours un côté rationnel, mais n'avait plus aucune discipline et ne pouvait plus se comporter correctement en société.
Licencié par son employeur, il mourut à 38 ans. Son cas devint célèbre auprès des médecins.
Pourtant, les scientifiques de l'époque n'interrogèrent pas directement le lien entre le dommage cérébral et les défaillances éthiques et sociales de Phineas P. Gage, excepté son propre médecin, le Dr. Harrow.
Pour Antonio Damasio, cette histoire montre qu'agir de façon personnellement et socialement avantageuse requiert au moins deux composantes :
La connaissance des règles sociales ;
Le fonctionnement correct des systèmes cérébraux qui y sont liés.
Toutefois, de nombreuses énigmes restent à éclaircir, et les témoignages et les relevés réalisés à l'époque ne permettent pas de lever tout le mystère.
Chapitre 2 : L'étude du cerveau de Gage
Antonio Damasio explique comment l'affaire fut résolue dans le monde scientifique à l'époque :
Les médecins Paul Broca et Carl Wernicke considérèrent que les lésions cérébrales avaient causé une aphasie (altération du langage). Après quelques hésitations, le monde scientifique se rangea sous cette explication.
L'hypothèse du Dr. Harlow (selon laquelle les dommages causés à certaines zones du cerveau affecteraient le comportement social) n'a, quant à elle, pas été reprise aussi largement par le corps scientifique et médical.
Néanmoins, le Dr. Harlow réussit à convaincre la famille de Phineas Gage de donner le crâne du pauvre homme à la science pour plus d'études. Il se trouve aujourd'hui à la Harvard Medical School.
Beaucoup plus récemment, la neuroscientifique Hanna Damasio développa un système novateur pour réétudier le cerveau de Phineas Gage. Elle remarqua que les zones dédiées au langage et au mouvement étaient intactes, mais que l'hémisphère gauche et la région préfrontale étaient eux davantage touchés.
Or, les recherches récentes montrent que ces régions sont impliquées dans la prise de décision. Sa conclusion va donc plutôt dans le sens de l'hypothèse du Dr. Harlow.
Si vous êtes intéressés par les détails de l'anatomie du système nerveux, Antonio Damasio propose un "intermède" assez technique sur ce sujet p. 48-55.
Chapitre 3 : un Phineas Gage d'aujourd'hui
Elliot est le nom fictif d'un patient qu'Antonio Damasio a évalué durant sa carrière. Sa personnalité avait radicalement changé à la suite de lésions du cortex préfrontal dues à une opération pour lui retirer une tumeur cérébrale.
Pour l'auteur, le cas d'Elliot était "une version particulièrement pure" de l'état de Phineas Gage : son intellect demeurait ici aussi intact, mais ses aptitudes à décider correctement pour lui-même et en contexte social avaient empiré.
Comme Phineas, Elliot avait perdu son emploi. Malheureusement, il n'avait reçu aucune prestation d'invalidité de l'État, car celui-ci n'avait pas reconnu son problème. C'est pourquoi son médecin cherchait à faire connaître sa maladie en venant trouver l'auteur de L'erreur de Descartes.
Comme Phineas, il commença à avoir des attitudes bizarres, comme collectionner des déchets. Pire, il ne parvenait plus à faire des plans pour le futur et à maintenir une attitude sociale ; il divorça même deux fois. Pourtant, Elliot paraissait étrangement distant lorsqu'il racontait toutes les tristes histoires qui lui étaient arrivées. Et il en était conscient…
C'est là que le neurobiologiste se rendit compte qu'il fallait qu'il prenne en compte les émotions ! Lors de tests ultérieurs menés en laboratoire, Antonio Damasio prit conscience que son patient connaissait les règles de conduite sociale, mais n'arrivait pas à les appliquer dans la vie réelle.
Il émit alors pour la première fois son hypothèse centrale : la réduction de la réactivité émotionnelle d'Elliot devait être liée, d'une manière ou d'une autre, à son incapacité à agir correctement en société.
Chapitre 4 : De sang-froid
"Personne n'a jamais douté que, dans certaines circonstances, l'émotion perturbe la faculté de raisonnement. Les preuves en sont abondantes et sont à l'origine du conseil fort juste que nous avons tous appris depuis notre plus jeune âge : Gardez la tête froide, contrôlez vos émotions ! Ne laissez pas vos passions interférer avec votre jugement." (L'Erreur de Descartes, p. 83)
Bien sûr, les émotions peuvent nous mener à faire des choix terribles et à agir de façon manifestement "irrationnelle". Pour autant, Antonio Damasio refuse que nous considérions les émotions comme une "faculté mentale surnuméraire" et comme un "à-côté de la pensée rationnelle" qui serait "de trop".
En fait, les histoires de Phineas et d'Elliot nous apprennent aussi autre chose : le manque d'émotions peut également être à l'origine de comportements irrationnels. L'auteur, bien sûr, ne s'est pas contenté de ces deux cas ; il a étudié chez d'autres patients et ceux-ci ont confirmé cette hypothèse.
Cela dit, l'erreur serait d'identifier trop rapidement des zones du cerveau avec ces facultés. En réalité, il existe de nombreuses interactions entre "sites cérébraux" et celles-ci interviennent dans le rapport entre émotions, raisonnement et prise de décision.
C'est ce que l'auteur souhaite montrer en présentant plusieurs autres cas assez techniques tout au long du chapitre. Finalement, il lui apparaît que les dommages peuvent non seulement venir du cortex préfrontal, mais également de :
La zone de l'hémisphère cérébral droit qui traite les signaux du corps ;
Certaines structures du système limbique (et en particulier l'amygdale).
Deuxième partie
Chapitre 5 : L'élaboration d'une explication
À partir de ce chapitre, l'auteur va chercher à élaborer une explication scientifique aux constats qu'il a réalisés dans sa carrière et qu'il a résumés dans la première partie du livre. Le contenu des chapitres devient plus complexe et plus technique. L'auteur se livre à plusieurs distinctions et explications de base.
Par exemple, il distingue le corps et l'organisme. Le second est l'ensemble de l'individu, dont la frontière est la peau. Le corps, quant à lui, est l'organisme "moins les tissus nerveux" (système nerveux central et périphérique).
Un organisme change constamment. Il peut être dans un état mental ou corporel à un moment donné, et en changer à un autre moment. Les relations entre le mental et le corporel se réalisent via deux "canaux" spécifiques :
Le système nerveux périphérique ;
Le système sanguin (par lequel transitent les hormones, neurotransmetteurs, etc.).
Lorsqu'un organisme reçoit un stimulus, il y répond par une action, un mouvement. Ces mouvements peuvent être volontaires ou non (c'est-à-dire automatiques). Le mouvement délibéré est lié à la pensée et aux images qui peuvent se former à l'esprit.
L'organisme interagit non seulement avec lui-même, mais avec l'extérieur ; son milieu. Celui-ci se rend présent à l'organisme via ses 5 sens. Les informations ainsi recueillies seront transmises au cerveau qui les traitera de façon sélective.
La mémoire est un élément crucial qui nous aide également à raisonner. Il faut distinguer entre les images qui nous viennent directement de la perception (via nos sens) et celles que nous nous formons à partir de la mémoire (nos souvenirs).
Selon Antonio Damasio, la mémoire est fondamentalement "reconstructive", à savoir qu'elle recompose une image du passé à partir de différents éléments et zones du cerveau, sans reproduire à l'identique l'événement. Connaître, c'est accumuler les représentations qui nous viennent des sens et de la mémoire. Nous pensons et parlons d'abord à partir d'images qui se forment dans notre esprit.
Bien que nous nous réinventions constamment, nous avons aussi un "ensemble de préférences de base" constituées pour notre survie au cours de l'évolution.
Chapitre 6 : La régulation biologique de la survie
Les instincts nous permettent de répondre rapidement à des stimuli de notre corps ou de l'environnement. Par ailleurs, nos émotions et sentiments manifestent certains instincts. Ainsi, quand nous avons faim (instinct) et que nous nous plaignons (sentiment), c'est parce que le niveau de sucre dans notre corps commence à diminuer (stimuli corporels).
Les instincts sont indispensables à notre survie. Ils sont une forme de mécanisme pré-organisé qui nous aide à classer les événements selon des catégories négatives ou positives. Grâce à la mémoire, nous pouvons nous souvenir d'événements passés et ainsi pré-classer les événements futurs.
Ici, corps et esprit ne sont pas distincts mais travaillent complètement ensemble. L'enjeu ? Accroître les chances de survie de l'organisme !
Pour Antonio Damasio, il est clair que la pensée ne vient pas d'une origine divine, mais bien des processus longs et complexes de l'évolution biologique. Selon lui, nous pouvons utiliser la neurobiologie pour étudier la manière dont nous agissons et prenons nos décisions.
Pour autant, cela ne signifie pas nécessairement réduire l'explication des comportements humains à la biologie ; afin d'étudier ceux-ci, le scientifique plaide plutôt pour l'utilisation de méthodes interdisciplinaires qui associeraient neurosciences et sciences humaines.
Chapitre 7 : Les émotions et leur perception
Antonio Damasio considère la différence entre :
Certains animaux comme les reptiles qui ne possèdent que d'anciennes structures cérébrales, fonctionnent à l'instinct et vivent souvent dans des environnements simples ;
Les organismes dont le cerveau comprend des structures plus récentes, telles que le néocortex, qui doivent tenir compte de plus de facteurs lorsqu'ils prennent des décisions et vivent dans des milieux plus complexes.
Nous retrouvons ici, d'une certaine manière, la différence entre "le système 1 et le système 2", pour reprendre l'expression d'un livre fameux : un cerveau reptilien qui agit par pure habitude ou instinct et un cerveau développé capable de prendre des décisions précises et subtiles en fonction de situations changeantes.
Cela dit, c'est un peu plus complexe que ça ! Tout le chapitre vise à montrer que les émotions (sensées cantonnées au premier niveau) s'invitent constamment dans la prise de décision et le raisonnement.
Le chercheur distingue trois types d'émotions :
Primaires = depuis la naissance (joie, tristesse, colère, peur et dégoût)
Secondaires = appréciations plus fines de l'environnement en fonction du passé ;
Sentiments d'arrière-plan = qui nous donnent une image de l'état de notre corps à un moment T.
Le scientifique distingue également les émotions (emotions) et les sentiments (feelings). Tous les sentiments ne génèrent pas d'émotions, alors que toutes les émotions génèrent des sentiments.
À noter : c'est une vérité qui est à la base, notamment, des ateliers du rire où le simple fait de produire le rire crée progressivement l'émotion qui lui correspond !
Nos sentiments et nos émotions sont tout aussi concrets que nos organes ou notre langage, par exemple. Ils sont, de ce fait, parfaitement "étudiables" par la biologie contemporaine. Cependant, Antonio Damasio y insiste, cela ne signifie pas que ce type d'interprétation matérialiste, scientifique, suffise à rendre compte de leur richesse.
Chapitre 8 : L'hypothèse des marqueurs somatiques
Nous voici arrivés au cœur de l'hypothèse scientifique de l'auteur. À nouveau, si vous souhaitez entrer dans les détails techniques et rigoureux de l'explication, il est préférable de vous référer directement à l'ouvrage. Nous nous en tenons ici aux grandes lignes.
Qu'est-ce qui constitue une prise de décision ? Selon le chercheur, la prise de décision est le but ultime du raisonnement. Son résultat est le choix lui-même (aller dans tel sens ou tel autre). Pour penser et nous décider, nous avons besoin d' :
Une connaissance de la situation actuelle ;
Des options d'action disponibles et de leurs conséquences ;
Une capacité inhérente à trier et jauger ces situations, options et conséquences.
Antonio Damasio suggère en outre, nous l'avons vu, que les émotions sont tout aussi importantes que la raison et la mémoire dans le raisonnement et la prise de décision.
Par ailleurs, il met en avant (après d'autres, bien sûr) que certaines décisions peuvent être :
Inconscients (vous ne choisissez pas consciemment d'avoir faim) ;
Conscients, mais sans raisonnement (vous ne raisonnez pas quand vous vous protégez contre un danger).
Jusqu'alors, nous pensions que raisonnements intuitifs et raisonnements délibérés et rationnels devaient être strictement séparés, tant au niveau logique que sur le plan biologique. C'est ainsi que le voyait notamment le philosophe Descartes. Or, selon Damasio, c'est faux ; ces différents types de raisonnements opèrent à partir du même noyau neurobiologique.
Bien sûr, nous avons aussi vu que certaines personnes, comme Phileas Gage (voir chapitre 1), peuvent raisonner rationnellement sur un plan mathématique, par exemple, et pourtant échouer à prendre des décisions justes sur un plan social. Pour l'auteur, cela montre que ces décisions en contexte social sont particulièrement complexes et ne peuvent être gérées de la même façon.
En fait, ces décisions ne peuvent fonctionner sur un mode purement utilitaire de coûts et bénéfices, en évacuant toute émotion. Et c'est là qu'intervient l'hypothèse des marqueurs somatiques — la clé de l'argument d'Antonio Damasio.
Que signifie cette expression ? Dit simplement, c'est l'idée qu'un sentiment instinctif (gut feeling) peut déjouer tous nos plans cartésiens. Le corps (soma en grec) provoque une image et lui associe un sentiment viscéral. De ce fait, il "oblige" l'esprit à restreindre les options disponibles en en rejetant automatiquement certaines de façon émotionnelle.
Bref, les marqueurs somatiques court-circuitent la pensée rationnelle ! Ils font partie des émotions secondaires, mais trouvent leur base dans les émotions primaires. Dès l'enfance, nous acquérons un ensemble de marqueurs somatiques qui dirigeront notre vie durant (ou tenterons de le faire).
Certaines conditions socio-politiques (régimes autoritaires, etc.) ou individuelles (maladies, etc.) peuvent contrarier le développement et l'expression corrects de ces marqueurs somatiques.
Troisième partie
Chapitre 9 : La mise à l’épreuve de l’hypothèse des marqueurs somatiques
Pour tester son hypothèse, Antonio Damasio conduisit plusieurs expériences avec son équipe. Il rapporte en particulier le succès de deux expériences rassemblées sous le nom générique du test du "jeu de poker".
Dans la première version de l'expérience, des cartes sont distribuées à un "Joueur" (le sujet de l'expérience) à qui l'on demande de gagner le plus d'argent possible en piochant des cartes dans deux paquets distincts. Certaines cartes lui font gagner gros (paquets A et B) et d'autres moins (paquets C et D). Parfois même, certaines cartes exigent de lui qu'il paie une somme plus ou moins importante (quand elles sont "mauvaises", les cartes du paquet A exigent un remboursement important).
Le Joueur découvre, chemin faisant, comment éviter les plus grosses pertes tout en cherchant à optimiser ses gains :
Les joueurs "normaux" apprennent à préférer progressivement les paquets C et D par prudence.
Ceux qui ont des lésions frontales spécifiques agissent à l'inverse en persistant à jouer "risqué".
Plusieurs interprétations sont dégagées par le chercheur et ses collègues. Pour choisir parmi elles, un autre test fut imaginé dans lequel la punition était première (les cartes "négatives" arrivant plus souvent que les cartes "positives", qui font gagner de l'argent). Les résultats de ce deuxième test permirent d'y voir plus clair.
Pour mettre un mot sur leurs résultats, les scientifiques forgèrent l'expression de "myopie de l'avenir". Selon eux, ces tests montrent que "les patients atteints de lésions frontales souffriraient d'une profonde exagération de ce qui pourrait être une tendance fondamentale normale, à savoir : se saisir du présent plutôt que de miser sur l'avenir".
Voici ce qu'en dit encore Antonio Damasio :
"Il semble bien que les patients atteints de lésions frontales aient perdu ce qu'ils avaient acquis par l'éducation et la socialisation. L'une des aptitudes les plus caractéristiques de l'homme est d'apprendre à orienter son comportement en fonction de perspectives lointaines et non en fonction d'objectifs immédiats, apprentissage que nous commençons à faire dès l'enfance. Les lésions frontales, chez nos patients, mettent à mal non seulement tous les acquis accumulés jusque là, dans ce domaine, mais empêchent toute acquisition nouvelle. Le seul côté un peu positif de ce triste constat est que, comme c'est souvent le cas en neuropathologie, il ouvre des perspectives au progrès de la science. L'effet des lésions nous permet d'entrevoir la nature des processus qui ont été perdus." (L’Erreur de Descartes, Chapitre 9)
Chapitre 10 : Le corps dans le fonctionnement mental du cerveau
Percevoir le monde, ce n'est pas seulement une attitude passive de réception ; c'est aussi de l'action. Lorsque je perçois, mon corps agit ou mieux, interagit avec son environnement.
Prenons un exemple. Si vous vous baladez la nuit et que vous vous sentez suivi, votre esprit et votre corps reconnaissent tous les deux la menace et initient des changements pour assurer votre survie. Et si vous décidez de fuir, tous les systèmes de votre corps seront déjà alignés pour suivre cet objectif !
Corps et cerveau interagissent constamment entre eux et avec le monde via les circuits neuronaux. C'est ainsi que le corps peut se maintenir en équilibre (homéostasie).
Mais Antonio Damasio va plus loin. Il soutient que le concept de soi est un état biologique qui est constamment mis à jour. Rien à voir avec l'idée d'un inspecteur ou d'un juge qui agirait "par-delà" le corps, comme jugé sur sa tour d'ivoire. Sans corps, pas de vie de l'esprit !
Inversement, le développement de l'esprit assure la survie en donnant aux organismes un moyen de s'adapter aux changements imprévus dans le génome. Cela signifie aussi que le corps est la priorité de l'esprit. Première tâche de celui-ci : comprendre quelles sont les limites du corps, sa "géographie". Deuxième tâche : localiser les interactions à l'extérieur du corps grâce aux sens.
En fait, l'esprit surveille constamment l'état du corps et interagit avec lui en arrière-plan pour s'assurer de notre survie. D'ailleurs, remarque-t-il, « quand vous voyez, vous ne voyez pas seulement : vous sentez que vous voyez quelque chose avec vos yeux ».
L'auteur se pose encore une autre question importante dans ce chapitre : quel est le fondement biologique de la conscience ? Nous pouvons chercher à le comprendre à partir de certaines pathologies.
Si les personnes malades sont généralement capables de décrire le changement d'état par rapport à eux-mêmes, les anosognosiques complets (personnes incapables de reconnaître le mal dont elles souffrent) ne le peuvent pas. Pourquoi ?
C'est peut-être, d'après l'auteur, parce qu'elles ont subi des dommages au sein de leur "moi neural". Ils deviennent incapables de reconstruire une image neuve de l'état de leur corps pour la comparer à l'ancien.
Le moi neuronal comprend deux ensembles de représentations qui sont constamment mis à jour :
Les événements autobiographiques, tels que la notion d'identité, de routines et d'aspirations.
Les représentations du corps tel qu'il est actuellement et le compare à la façon dont il est généralement.
D'habitude, ces processus restent masqués. Pourtant, ces pathologies nous donnent des indices de ce qui passe hors de la scène. Le chercheur va même jusqu'à émettre des hypothèses sur la formation de la subjectivité comme "troisième étape" à partir de ces deux premières étapes (voir p. 325-329).
Chapitre 11 : La passion fondant la raison
Bien que certaines de ses idées aient été vérifiées par l'expérience, le propos central de l'auteur demeure une hypothèse qui demande encore du travail afin d'être totalement validée.
Par ailleurs, Antonio Damasio met en garde contre des interprétations trompeuses de ses théories. Il ne dit pas que les émotions et les sentiments sont "supérieurs" à la raison ni qu'ils l'emportent toujours face au raisonnement. S'ils font partie du processus de raisonnement, cela ne diminue en rien l'importance de celui-ci.
Nous pouvons néanmoins apprendre à comprendre ce qui se passe au sein de ces interactions, et en particulier lorsque ce "monde intérieur" ne fonctionne plus.
Pour Antonio Damasio, l'erreur fondamentale de Descartes — quelle que soit l'interprétation qu'on fasse de sa philosophie par ailleurs — consiste dans la séparation du corps et de l'esprit. Et le problème est que sa pensée reste influente dans le milieu de la recherche, y compris en neurobiologie ou en neurochimie.
Pour l'auteur, la rationalité humaine est fragile et finie — et c'est parce qu'elle est incorporée. Il importe donc de changer de paradigme afin de pouvoir nous appréhender de façon plus complète et aussi plus humble.
Post-scriptum
Antonio Damasio dit avoir écrit L’Erreur de Descartes afin de donner un aperçu de la recherche en neurobiologie au plus grand nombre et pour faire comprendre comment ce savoir peut affecter la façon dont nous envisageons l’humanité.
Par ailleurs, il a écrit pour que le corps médical change de perception sur la question des rapports entre le corps et l'esprit. Si elle modifie son paradigme pour prendre en compte les interactions constantes entre corps, émotions et raison, la médecine sera en mesure de développer de meilleurs traitements et d'être plus respectueuse du patient.
Pour l'instant, la situation académique n'est, selon lui, pas satisfaisante. Les étudiants de tous les cursus devraient apprendre les bases de la psychologie humaine. Dans les facultés de médecine ou de neurosciences, il faudrait éduquer davantage les étudiants à l'empathie.
En fait, le "biais cartésien" — qui dissocie nettement raison et passion — ne fait pas du bien à la recherche et devrait être modifié pour :
Faire davantage de progrès ;
Augmenter l'efficacité du diagnostic et du traitement des maladies psychologiques ;
Redonner confiance en la médecine occidentale.
Antonio Damasio poursuit ses investigations. Ses plus récentes recherches ont par exemple établi que la douleur et le plaisir sont tous deux nécessaires pour qu'un organisme fonctionne normalement et efficacement. Ce sont des dispositions innées qui ont pour fonction de configurer correctement nos instincts. Ceux-ci peuvent ensuite servir à établir des stratégies de prise de décision complexes.
Conclusion sur « L’Erreur de Descartes » d’Antonio R. Damasio :
Ce qu’il faut retenir de « L’Erreur de Descartes » d’Antonio R. Damasio :
Retenez que :
Le raisonnement est éclairé par les émotions et les sentiments ;
Pour raisonner correctement, nous avons besoin de l'intégrité des systèmes de notre cerveau (et non seulement d'une petite partie où se logerait la "raison").
Le raisonnement prend ses sources dans l'esprit autant que dans le corps ;
Celui-ci évolue avec l'expérience et peut en général être amélioré.
Contrairement à ce que pensait le philosophe René Descartes, la raison n'est ni pure, ni complètement immatérielle. Si cette théorie s'avère exacte, alors elle impliquera une reconfiguration profonde de nos façons de voir le monde et notamment nos interactions sociales.
Points forts :
Un livre savant par l'un des plus grands neuroscientifiques actuels ;
Des explications claires malgré la complexité du sujet, avec des sections spécifiques pour introduire certains termes techniques ;
De nombreuses images qui aident à la compréhension ;
Une écriture agréable, qui allie la raison à l'émotion, notamment via des anecdotes personnelles.
Point faible :
C'est un peu difficile à lire, mais l'effort en vaut la peine !
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu le livre d’Antonio R. Damasio « L’Erreur de Descartes » ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre d’Antonio R. Damasio « L’Erreur de Descartes ».
Visitez Amazon afin d’acheter le livre d’Antonio R. Damasio « L’Erreur de Descartes ».
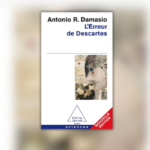 ]]>
]]>Résumé de "Le Livre du lagom | L’art suédois du ni trop, ni trop peu" d’Anne Thoumieux : cet ouvrage nous initie à la philosophie suédoise du "ni trop, ni trop peu". Il nous fait découvrir un art de vivre équilibré, épuré et ancré dans la nature, dont le socle est une consommation raisonnée, l'authenticité, le vivre ensemble, le respect de l'environnement et la quête d'un bonheur simple au quotidien.
Par Anne Thoumieux, 2017, 228 pages.
Chronique et résumé de "Le Livre du lagom | L’art suédois du ni trop, ni trop peu" d’Anne Thoumieux
Introduction
Dans l'introduction de son ouvrage intitulé "Le Livre du lagom", Anne Thoumieux, l'auteure nous présente le concept suédois de lagom, une philosophie de vie axée sur la modération et l'équilibre.
"Alors que les Italiens ont la dolce vita et les Danois le désormais incontournable hygge, les Suédois ont le lagom (prononcer LAR - GOM), une approche de la vie reposant sur une recherche de l’équilibre personnel par la pondération."
Ainsi, le terme, difficile à traduire, incarne l'idée de "juste assez", promouvant une vie simple et satisfaite sans excès ni manque.
Fascinée par cette approche peu connue hors de Suède, Anne Thoumieux explique avoir rencontré des Suédois experts dans divers domaines pour démêler cette notion profondément ancrée dans la culture suédoise.
À travers ses découvertes, elle révèle comment le lagom, opposé à notre société de surconsommation, enseigne la satisfaction de ce que l'on a. Elle montre comment le lagom encourage la modestie, la gratitude, une consommation réduite, le respect de l'environnement et l'appréciation des plaisirs simples, et conduit ainsi à une plus grande joie de vivre et au bonheur.
Chapitre 1 – Intraduisible lagom kézako ?
1.1 - Lagom : un mot suédois difficile à traduire mais utilisé à toutes les sauces
Le chapitre 1 du "Livre du lagom" d'Anne Thoumieux décrypte le concept de lagom.
On l’a vu, ce petit mot suédois échappe aux tentatives de traduction. "Ni trop, ni trop peu", "juste ce qu'il faut", "ce qui convient" ou encore "ce qui est juste" : autant d'expressions pour en parler sans vraiment percer le secret de ce concept aux mille facettes.
En fait, selon l’auteure, les Suédois en usent (et en abusent !) à toutes les sauces. Ce terme sert aussi bien à dire "c'est assez" quand on les sert, qu'à qualifier ce qui est parfaitement dosé, pile-poil comme il faut.
1.2 – Le lagom, une philosophie de vie qui prône l’équilibre et la juste mesure
Le lagom, c'est l'art de la juste mesure, l'équilibre subtil entre quantité et qualité. Une philosophie de vie basée sur le contentement et la pleine conscience de ce que l'on a, sans céder à la tentation du toujours plus.
En somme, ce principe, profondément ancré dans la culture suédoise, se manifeste dans divers aspects de la vie pour encourager à vivre de manière équilibrée, à valoriser la communauté, et à agir de façon écologiquement responsable.
"En Suède, il est de bon ton de consommer lagom, comprendre : consommer sans excès, ne pas acheter plus que nécessaire, faire ses choix en pensant à la planète. Exit la fièvre acheteuse et l’excentricité que l’on valorise parfois sous nos latitudes. En Suède, la norme c’est… la norme. On se veut réfléchi, on pèse le pour et le contre, on achète "ni trop, ni trop peu", ni trop cher, ni trop cheap. Bref, une philosophie éco et écolo positive qui s’inscrit dans la tendance slow qui valorise une consommation sage et respectueuse de l’environnement. Alors que les Français veulent "apprendre à ralentir" leur rythme de vie, à désamorcer une pression toujours plus forte qui fait oublier l’essentiel, les Suédois, eux, n’ont pas besoin de cours pour se souvenir de ce qui est fondamental."
1.3 – Des origines "viking"
Selon la légende, le lagom puiserait ses racines au temps des Vikings, où l'on faisait tourner la corne d'hydromel pour que chacun en ait juste assez. De "laget om" - le tour du groupe - serait né "lagom".
Issu de cette pratique ancienne, le lagom symbolise aujourd’hui la cohésion et le juste partage au sein du groupe.
1.4 - L’art de renouer avec l’essentiel et de savourer les choses simples
Mais le lagom ne se résume pas à une simple modération. Il est aussi fait de minimalisme, d'éthique, de bon sens. Un concept qui arrive à point nommé pour nous reconnecter à nous-mêmes dans un monde en perte de repères.
Alors, pour Anne Thoumieux, pas question de réduire le lagom à une dimension ennuyeuse et moralisatrice ! Loin des diktats de notre société de consommation effrénée et valorisant l’excès, le lagom est une invitation à renouer avec l'essentiel, à savourer les plaisirs simples de la vie :
"Si cette pondération peut nous paraître ennuyeuse, c’est parce que nous voyons cela d’un œil qui n’est pas habitué au civisme, aux tempéraments altruistes et à une vie tendant vers la simplicité. Chez nous, l’excès est souvent valorisé et considéré comme une qualité : manger avec appétit, c’est convivial ; boire beaucoup, c’est être un bon vivant ; avoir un intérieur surchargé, un signe de personnalité ; avoir un couple explosif, c’est être passionné, etc. Passer en mode lagom nous demande donc un véritable ajustement de cette perception."
1.5 - Le lagom lifestyle n’est pas réducteur mais au contraire libérateur
Pour l’auteure, le lagom est un vent de fraîcheur et de liberté venu du Nord pour nous aider à retrouver plus qu’un équilibre, mais notre propre équilibre :
"Alléger sa penderie, partir du travail le soir avec le sentiment du devoir accompli et non une culpabilité écrasante, refaire sa déco sans se ruiner et avec la certitude ne pas avoir contribué un peu plus à épuiser les ressources de la planète, c’est assez jubilatoire. Tout comme de parler gentiment à son voisin dans le métro, à venir sans effort vestimentaire particulier à un anniversaire ou encore partir en vacances pas loin de chez soi.
Quel soulagement soudain de vivre sainement et simplement. De faire fi de codes sociaux exigeants au profit de plus de spontanéité. D’apprendre à apprécier ce que l’on a déjà, en arrêtant de vouloir toujours plus, toujours mieux. De se faire plaisir au quotidien par une multitude de petites satisfactions ressenties en conscience. Ou encore d’aller simplement marcher chaque week-end ou de faire du yoga pour garder la forme et non de s’imposer un régime drastique ponctué de séances de torture running alors que l’on déteste ça. C’est tout ça vivre lagom, ou vivre tout court, peut-être."
Chapitre 2 – Une consommation raisonnée pour des consommateurs raisonnés
Dans le chapitre 2 du "Livre du lagom", Anne Thoumieux commence par nous proposer un petit test pour savoir si nous sommes "lagom".
Puis 5 grandes idées sont développées pour mieux comprendre ce qu’est de consommer "lagom".
2.1 – Le principe de moins mais mieux
Au pays du lagom, la frénésie de consommation n'a pas droit de cité. Ici, on prend le temps de réfléchir avant d'acheter, guidé par une volonté culturelle de dépenser intelligemment.
En fait, le shopping à la suédoise, c'est l'art de trouver le juste équilibre entre envies et besoins, explique l’auteure dans le chapitre 2 du "Livre du lagom" : on privilégie la qualité à la quantité, on attend un peu pour s'offrir quelque chose mais on en profite d'autant plus longtemps.
Et le plaisir d'acheter est décuplé par le temps pris pour choisir l'objet qui nous correspond vraiment.
2.2 - Le rapport qualité prix avant tout
Acheter lagom, c’est rechercher une juste proportion entre la qualité et le coût des choses :
Ni trop, ni trop peu : le Suédois choisit rarement l’objet le plus cher de la gamme… mais pas le moins cher non plus. Il choisira un bon rapport qualité prix la plupart du temps, celui du milieu, guidé par une volonté culturelle nationale de dépenser intelligemment.
2.3 – On n’étale pas sa richesse !
Dans cette quête de modération, le luxe ostentatoire n'a pas sa place, lance l’auteure du "Livre du lagom".
Étaler sa réussite et son argent est même considéré comme de mauvais goût.
L’auteure décrit, à ce propos, le Jantelagen (ou "loi de Jante") dont est imprégnée la société suédoise : un code de conduite nordique prônant l'humilité et le respect d'autrui, qui invite à rester dans la moyenne, à ne pas froisser son prochain en affichant des signes extérieurs de richesse. Autrement dit, une culture qui rejette l'ostentation au profit du bien-être collectif.
Cette mentalité se reflète également dans les choix de consommation, privilégiant des biens qui ne sont pas destinés à afficher le statut social mais à répondre de manière pragmatique aux besoins de la vie quotidienne, dans le respect de l’environnement et des principes éthiques.
2.4 – L’impact sur l’environnement de sa consommation
Autres maîtres-mots de la consommation à la suédoise : durabilité et écologie.
"En réfléchissant "global", l’acte d’achat devient, de fait, un acte citoyen et une manière de montrer que l’on a à cœur (et en tête) les enjeux environnementaux actuels."
Ainsi, en mettant systématiquement dans la balance l'impact environnemental d'un achat, le consommateur agit en citoyen responsable. Repeindre son escalier plutôt que d'en racheter un, opter pour des ampoules LED, faire réparer ses bottes chez le cordonnier... Autant de choix guidés par une conscience écologique très ancrée. Car "s’il peut s’éviter d’acheter et faire réparer à la place", le Suédois n’hésite pas.
Les initiatives gouvernementales suédoises, comme la réduction de la TVA sur les réparations, témoignent d'un engagement à promouvoir cette économie circulaire et à lutter contre l'obsolescence programmée.
2.5 – Le sens de la communauté
Cette attention portée à l'environnement est en fait profondément liée à un fort sens de la communauté. Penser d'abord au collectif s'avère, au final, bénéfique pour chacun. En limitant le gaspillage et la pollution, on œuvre pour une société meilleure, où les ressources sont utilisées avec parcimonie et sagesse.
2.6 – Les 5 grands principes du "Livre du lagom" pour résister aux sirènes de la surconsommation
Anne Thoumieux termine ce chapitre du "Livre du lagom" en partageant une multitude de conseils pratiques autour de 5 grands principes pour adopter un mode de consommation plus lagom : réduire sa facture d'énergie, mieux gérer son budget, recycler, privilégier le made in local (des produits locaux et durables), troquer plutôt que jeter, acheter au jour le jour et éviter les stocks de produits qui encombrent nos placards... Bref, de quoi alléger à la fois sa vie, son porte-monnaie et son empreinte carbone !
Pour résumé, la consommation "lagom" n'est pas synonyme de privation, mais d'un juste milieu qui équilibre besoins et désirs, générant satisfaction et durabilité. Car pour les Suédois, le bonheur se trouve dans cette simplicité volontaire, cet art de se contenter de ce que l'on a, de consommer moins mais mieux. Une philosophie aussi bénéfique pour soi que pour la planète !
Chapitre 3 – Mode consciente : minimalisme et écologie
La mode à la suédoise est l'incarnation parfaite du lagom, observe l’auteure dans ce troisième chapitre du "Livre du lagom".
En effet, là encore, point d'extravagance ou de démesure : on mise sur un style épuré, intemporel mais toujours élégant.
3.1 - Le "normcore", un style simple, fonctionnel et discrètement élégant
Selon Anne Thoumieux, l'élégance à la suédoise se niche dans les détails, subtilement trendy sans jamais être tape-à-l'œil. Voici comment elle décrit la mode suédoise :
"L’équilibre parfait entre une allure low profile et pourtant parfaite. Juste. Ni trop ceci, ni pas assez cela. Ni luxe, ni négligée, elle est pointue grâce à des créateurs revendiquant des coupes tendances sans pour autant avoir besoin de se faire remarquer."
Mais attention : ce look minimal, souligne l’auteure, "n’est pas plus facile à concevoir qu’un look excentrique". Derrière son apparent refus de la tendance, ce style appelé "normcore" est en réalité tout un art : il "repose sur un savant goût des associations afin de n’être ni fade ni passe-partout".
Dès lors, avec ses couleurs neutres, ses coupes étudiées et ses basiques de haute qualité mais non ostentatoires, le "normcore" règne en maître dans les dressings scandinaves :
"La mode suédoise possède donc cette incroyable capacité à offrir ce que nous pourrions appeler des basiques qui se révèlent d’un style fou, une fois portés. Bien loin des pièces hors de prix de créateurs, chacun possède ici le goût du lagom pour choisir ses vêtements et se faire un style propre… dans tous les sens du terme ! Ou propret serait-on tenté de dire. Assez sage, peut-être, mais au tombé toujours parfait qui permet de se fondre gentiment dans la masse. Attention, n’allez pas croire que c’est un point négatif, au contraire ! Vous l’aurez compris, c’est précisément le but recherché."
3.2 – Des marques accessibles et ultra branchées à la fois
Les marques suédoises excellent tellement dans cette "normalité" si désirable qu'elle en devient pointue, voire iconique.
Porter leurs créations, c'est arborer ce "je-ne-sais-quoi" de décontracté chic, ce naturel savamment travaillé qui semble couler de source, confie Anne Thoumieux. Une allure à la fois accessible et furieusement tendance, à mille lieues de la course effrénée aux it-bags et aux must-have des capitales de la mode.
"De Filippa K à Acne en passant par COS, les marques qui se sont fait connaître au-delà des frontières suédoises par cette maîtrise de la "normalité" sont tellement branchées qu’elles ne parlent qu’aux hipsters chez nous alors qu’en Suède, elles sont le quotidien du plus grand nombre. C’est en rejetant la différence au profit d’une normalisation maîtrisée et en abandonnant la quête de singularité vestimentaire que les Suédois, paradoxalement, se distinguent ! Vraiment trop fort !"
3.3 – L’essor de la slow fashion ou mode durable
Des créateurs responsables et engagés
Mais la mode lagom ne se résume pas à une question de style.
Elle embrasse une philosophie bien plus vaste, fait remarquer l’auteure du "Livre du Lagom" : celle de la "slow fashion", en opposition totale avec les diktats frénétiques de l'industrie actuelle.
"Pour avoir les faveurs des Suédois, les enseignes doivent afficher une réelle éthique tout au long de leur processus de production, depuis les conditions de travail de la main-d’œuvre, même à l’étranger, jusqu’aux matériaux utilisés qui doivent être "propres", en passant par des points de vente éco-conçus."
Les marques suédoises citées dans le chapitre, comme Velour, Sandqvist, Filippa K, Acne Studios, et Cheap Monday, illustrent cet engagement envers des produits de qualité, conçus dans le respect de l'environnement et des principes sociaux équitables.
Elles privilégient les petites séries. Les créateurs prennent le temps, eux, de concevoir des pièces durables et bien pensées. Les consommateurs achètent moins mais mieux, en se laissant guider par des critères éthiques autant qu'esthétiques.
"Les marques n’ont pas pour ambition de dominer le monde, alors elles produisent des collections souvent courtes et des quantités "justes suffisantes" pour éviter les stocks et le gâchis. C’est aussi le règne des éditions limitées, des séries capsules qui mettent en avant un styliste ou un savoir-faire."
Par ailleurs, les marques s’engagent en soutenant des causes via les ventes :
"Le Suédois a donc non seulement la conscience écologique tranquille quand il achète un pull dont il a vérifié auparavant que la laine était obtenue sans mauvais traitements des moutons, mais aussi la satisfaction de faire de son achat une bonne action puisqu’il sait qu’une partie sera par exemple reversée à une association."
Des consommateurs éthiques
Car, pour les Suédois, s'habiller est un acte engagé. Hors de question de contribuer à l'exploitation des travailleurs du textile ou de porter des vêtements gourmands en eau et en pesticides.
Les fashionistas nordiques sont de véritables "consomm'acteurs", qui mettent un point d'honneur à choisir des marques transparentes sur leurs pratiques. Quitte à payer un peu plus cher pour s'offrir un basique en coton bio ou en fibres recyclées, fabriqué dans des conditions décentes.
"Tout doit être transparent et peut être un motif d’achat ou de désamour : tissu en coton bio ou fibres de bambou éco-produites ou soutenant le commerce équitable, utilisation de colorants et teintures propres et non toxiques, emballages issus de produits recyclés… l’impact sociologique et économique des vêtements est scruté à la loupe, car il en découle son propre impact personnel et le Suédois vivrait mal d’avoir contribué à la pollution d’un cours d’eau en achetant du made in China qui, en plus de polluer, déteindra à la première lessive."
"Il faut participer à "rendre" ce que l’on prend en donnant en retour"
Cette exigence écolo va jusqu'au bout du cycle de vie des vêtements. On n'hésite pas à troquer, revendre ou donner ce dont on ne veut plus, pour offrir une seconde jeunesse à nos tenues. Une manière de boucler la boucle, dans une logique d'économie circulaire si chère au lagom.
"Les penderies lagom ne sont pas surchargées, au contraire […] On privilégie la qualité à la quantité, "ni trop, ni trop peu". On réfléchit avant de passer à la caisse et on ne sort sa carte bleue que si la marque répond à nos critères esthétiques mais aussi éthiques. On choisit des intemporels qui pourront durer d’une saison à l’autre. On se questionne "Ai-je vraiment besoin de ce tee-shirt ?".
Et dans cette même philosophie, les Suédois pratiquent abondamment le recyclage : les habits sont souvent achetés d’occasion. Quand on s’en est lassés et qu’ils sont encore en bon état, ils sont vendus ou échangés.
3.4 - Le potentiel créatif de ces contraintes
La créativité peut-elle s'épanouir dans un tel carcan éthique ? Assurément oui. En témoignent chaque saison les créateurs suédois tels que Hope ou Cheap Monday.
Chez eux, le respect de l'environnement et des hommes est un moteur et non un frein, soutient Anne Thoumieux : la contrainte devient source d'inventivité, permettant l'éclosion de collections toujours plus innovantes et responsables.
Chapitre 4 – Beauté et bien-être naturels : réunir le corps et l’esprit
Selon la philosophie du lagom, la beauté se conjugue au naturel.
Ainsi, dans le chapitre 4 du "Livre du lagom", nous apprenons qu’il n’est surtout pas question de s'acharner à effacer les rides ou collectionner les produits "miracle". Non… l'objectif ? Obtenir une peau saine et lumineuse, en misant sur des soins simples mais efficaces.
"Hommes et femmes prennent ainsi soin de leur peau tout en acceptant de vieillir : la beauté en mode lagom […] ne cherche pas à arrêter ou remonter le temps, mais à protéger et accompagner la peau avec bienveillance sur le principe de la slow beauty, hérité de la tendance slow life qui préconise, comme pour la mode, une approche plus sereine, plus tolérante et plus simple des choses."
Entre cosmétiques green, gymnastique douce, escapades au grand air et rituels bien-être millénaires, l’art de prendre soin de soi version nordique s’inspire des préceptes authentiques du lagom.
4.1 – L’approche naturelle et minimaliste de la beauté
Les routines beauté des Suédoises sont minimalistes, adaptées à leur type de peau, avec des formules choisies avec soin. Les salles de bain et les produits sont fonctionnels et efficaces. On achète juste les soins qu’il nous faut, et on les teste pendant au moins un cycle de renouvellement cutané pour en constater les effets, observe Anne Thoumieux.
"Le lagom […], c’est acheter les produits dont on a besoin au quotidien, pas tout le rayon maquillage, et en utiliser peu : réduire sa routine au minimum, aller au plus simple mais avec des produits de grande qualité. Et bien sûr, les choisir de préférence bio et écoresponsable."
4.2 - Le "no make-up look" ou l’art de parfaitement équilibrer fraîcheur et sophistication
Côté maquillage, le "no make-up look" et le "make-up nude" règnent en maître.
Incarné à merveille par les beautés scandinaves, ce style mise sur un teint glowy, comme illuminé de l'intérieur, souligné par quelques touches de couleur savamment distillées. Le secret d'une mise en beauté réussie à la suédoise ? Sublimer sa carnation avec un soupçon de blush, une ombre pastel sur les paupières, un voile de mascara et une bouche glossy. Autrement dit : l'équilibre parfait entre fraîcheur et sophistication, sans jamais tomber dans l'excès.
4.3 - L’importance des rituels comme le sauna dans une vision holistique du bien-être
Mais la beauté lagom, ce n’est pas uniquement avoir une jolie peau ou à un trait d'eyeliner maîtrisé.
Non, la beauté selon le concept du lagom, est indissociable d'une approche holistique du bien-être, où l'on prend soin de soi dans sa globalité. Et pour les Suédois, adeptes de la slow life, cela passe avant tout par des rituels profondément ancrés dans leur culture, à l'image du sauna.
Alternance de chaleur intense et de bains froids vivifiants, moment de détox et de relaxation... Le sauna est une véritable ode au corps et à l'esprit, qui permet de se reconnecter à soi et à la nature.
4.4 - Le lien fort entre beauté et mode de vie sain
C’est bien là que réside le secret de la beauté à la scandinave : dans cette symbiose entre mode de vie sain, contact avec les éléments et conscience de soi.
Aussi, pratiquer la fameuse gym suédoise, prendre l'air, s'écouter, traiter son corps avec douceur, ne pas braver la nature mais vivre en harmonie avec elle... sont autant de préceptes qui façonnent les habitudes healthy des Suédois.
Chapitre 5 – Maison lagom : une déco design qui respire
Le 5ème chapitre du "Livre du lagom" dresse un portrait global du lagom appliqué à l'habitat, à notre "déco". En gros, il s’agit de se rapprocher, par son intérieur et divers éléments clés (ambiance, matériaux, couleurs, éco-conception...) d'un mode de vie plus serein et authentique.
5.1 – Less is more : l'esthétique épurée, fonctionnelle et naturelle de la déco suédoise
La décoration selon le style de vie lagom est apaisante et moderne. Les intérieurs scandinaves célèbrent la pureté des lignes et rendent hommage à la nature environnante.
On y ose le minimalisme, sans pour autant sombrer dans l'austérité : les Suédois excellent dans cet art d'épurer leur déco, pour ne garder que l'essentiel, le sens, l'utile.
Dès lors, pas d'accumulation ni de fioritures : l'espace est savamment pensé, chaque objet méticuleusement choisi, pour créer une atmosphère zen et chaleureuse à la fois. Un style "pur avec rendu intimiste" écrit l’auteure.
La qualité prime sur la quantité, avec des meubles et accessoires beaux et durables, dont on profitera longtemps.
L'aménagement aussi se veut à l'image du mode de vie lagom : fonctionnel, compact, optimisé. On multiplie les rangements malins, on joue sur les volumes pour gagner en praticité sans sacrifier le style. Même dans les petites surfaces, l'organisation est reine, sublimée par un design épuré qui respire.
5.2 – L’art du détail, de l’équilibre et minimalisme chaleureux
Côté ambiance, place à la douceur et au cocooning :
"La déco lagom se construit dans la recherche d’une ambiance recherchée, mais pas sophistiquée. Objectif : se sentir bien chez soi."
Les lignes souples apportent une touche de rondeur, comme un écho apaisant aux courbes gracieuses de la nature scandinave.
Coussins moelleux, plaids en laine, voilages de coton... Les matières invitent à la détente et créent un cocon ouaté, explique l’auteure. Celles-ci doivent être nobles et naturelles. Surtout, on bannit au maximum le plastique.
Autre must : la lumière, une denrée si précieuse sous ces latitudes ! On la fait entrer à flots le jour, et on compense son manque le soir venu avec une ribambelle de bougies, de guirlandes et de leds savamment disposées.
Les teintes, elles, se font l'écho des paysages enneigés et des forêts profondes. Camaïeux de blanc, de gris, de beige... Les tons se déclinent dans une palette minérale et naturelle.
Le bois, matériau roi du style nordique, réchauffe l'ensemble de sa douceur organique. Clair ou foncé, il s'invite sous toutes ses formes, du parquet aux meubles iconiques des années 50.
Enfin, la maison lagom a une déco en harmonie parfaite avec la nature, jusque dans ses partis pris écoresponsables et l'usage de matériaux recyclés, observe l’auteure.
Accessoires cocooning, végétaux luxuriants, objets chinés, touches de couleurs subtiles... Quelques clins d'œil bien choisis suffisent à personnaliser cet univers feutré et épuré, sans le surcharger, note Anne Thoumieux : l'art de l'équilibre et du détail, tout en nuances et en délicatesse.
5.3 – Un espace désencombré, organisé et harmonieux
Dans les intérieurs lagom, l’espace est désencombré et savamment optimisé. Les étagères ne supportent que quelques objets choisis. Le reste est rangé pour ne pas polluer la vue.
"Comme les intérieurs ne sont pas toujours spacieux mais plutôt intermédiaires (ni trop petit ni trop grand, hein...), ils sont pensés pour être utilisés dans toutes leurs ressources", souligne Anne Thoumieux : "un placard sous l’escalier, une penderie dissimulée derrière un rideau, de jolies boîtes casées dans les renfoncements visibles…"
5.4 - La quête d'harmonie et d'équilibre
L’auteur du "Livre du lagom" termine ce chapitre en partageant les interviews de deux designers suédoises de renom : Marie-Louise Hellgren et Nathalie Dackelid.
Pour elles, concevoir un intérieur ou un objet, c'est rechercher l'harmonie parfaite avec son environnement et ses usages. Une approche éminemment lagom, qui place le bien-être et le respect de la planète au cœur du processus créatif.
Quelques mots pour résumer le home sweet home du lagom : lignes pures, harmonieuses, matériaux authentiques, naturels, teintes sobres, touches de chaleur et de lumière, un intérieur qui respire et qui rassemble en mode cosy !
Chapitre 6 – Loisirs et vacances, la nature à l’honneur
Le 6ème chapitre du "Livre du lagom" partage avec nous la recette suédoise des vacances parfaites. Nous apprenons que les vacances selon le concept du lagom sont synonymes d'équilibre et d'authenticité au plus près des éléments.
6.1 - La symbiose profonde des Suédois avec la nature
Quand on pense à la Suède, on imagine souvent de vastes étendues sauvages, des lacs à perte de vue, des forêts profondes... Et pour cause : la nature est au cœur du mode de vie lagom !
"En Suède, la nature est absolument centrale dans la vie de chacun. Sans doute parce que le climat est rude, la nature semble toujours proche, même en ville."
Omniprésente jusque dans la Constitution, qui garantit à chacun un droit d'accès total aux espaces naturels, elle rythme ainsi le quotidien et les loisirs des Suédois.
6.2 - Le goût pour les activités outdoor en toutes saisons
Aussi, été comme hiver, qu'il vente ou qu'il neige, impossible pour les Suédois de résister à l'appel du grand air.
Randonnée, vélo, cueillette, pêche ou encore pique-nique au bord d'un lac... Les activités outdoor sont légion, et se pratiquent en toute saison, rapporte l’auteure de "Livre du lagom". L'objectif ? Se ressourcer au contact des éléments, se reconnecter à soi et aux autres, loin du tumulte de la ville.
6.3 - L'institution de la "stuga" et le tourisme vert et responsable
Et pour prolonger ces parenthèses nature, quoi de mieux qu'un séjour dans sa "stuga" ?
Véritable institution en Suède, ces petites maisons de campagne au charme rustique (souvent en bois rouge, sommaire, nichée au cœur de grands espaces et sans barrière autour) sont le point de chute idéal pour des week-ends en famille ou entre amis. Feu de cheminée, cueillette de baies sauvages, balade en forêt au crépuscule... On y savoure une vie simple et authentique, en harmonie avec son environnement.
Car le lagom, c'est aussi cela : faire le choix d'un tourisme doux et responsable, respectueux des écosystèmes et des communautés locales.
Les Suédois en sont des adeptes convaincus, privilégiant des expériences au plus près du terrain. Du camping sur un radeau façonné de ses mains à une immersion en pleine taïga, en passant par des croisières écologiques le long des fjords, les possibilités ne manquent pas pour des vacances 100 % nature et éthiques.
6.4 - La soif de voyages et de découvertes en tribu...
Cette quête d'authenticité se double d'une soif d'ailleurs, qui pousse les Suédois à s'envoler vers des contrées lointaines. Habités par leur légendaire sens du collectif, ils n'hésitent pas à partir en tribu pour des échappées exotiques placées sous le signe du ressourcement. L'occasion de découvrir d'autres cultures, de s'enrichir au contact de l'autre, tout en cultivant la cohésion familiale, lance l’auteure.
6.5 – Les fêtes suédoises
En Suède, les fêtes rythment la vie au fil des saisons. Cette partie du "Livre du lagom" liste et décrit les plus populaires :
Walpurgis Eve, qui célèbre le printemps autour de feux de joie.
Midsummer Eve, où l’on danse couronné de fleurs.
La Toussaint, un moment de recueillement lumineux.
La Sainte-Lucie, où la "reine de lumière" est élue lors d'un défilé enchanteur.
6.6 - Les activités suédoises les plus lagom
Le vélo, le tennis et le golf
En Suède, le vélo est roi ! Tout le monde en fait, que ce soit pour aller travailler, faire les courses ou se balader. De même, pour le tennis et le golf, rendus accessibles à tous grâce à de très nombreux terrains publics et des tarifs abordables.
Les activités : des expériences uniques et nature avant tout
Anne Thoumieux partage ici des idées d’activités parmi les plus lagom : randos en patin à glace, parcours gastronomique en raquettes, traîneau à chiens, balade en bateau, camping sur un radeau fait main ou encore une nuit dans la taïga sur les traces des Sâmes.
Finalement, la philosophie des loisirs et des vacances se résume en un mot : équilibre.
Équilibre entre aventure et contemplation, entre évasion et ancrage local, entre dépassement de soi et cocooning... Autant d'expériences pour nourrir corps et esprit, et se reconnecter à l'essentiel et qui soit, le moins possible, lié à la consommation.
Chapitre 7 – Gastronomie : des traditions et un plaisir qui commencent en cuisine
Dans le chapitre 7 du "Livre du lagom" dédié à l'art de vivre gourmand et épicurien en Suède, Anne Thoumieux nous montre comment la gastronomie y rime à la fois avec simplicité, convivialité et respect des produits de saison.
Une philosophie culinaire qui n'est pas sans rappeler le mouvement slow food, prônant une alimentation de qualité, éthique et durable.
Et au pays du lagom, on met les petits plats dans les grands, sans pour autant passer des heures en cuisine.
7.1 - La slow food ou l'amour des Suédois pour les produits locaux et de saison
Pour les Suédois, manger local et de saison est une évidence. Leur immense territoire regorge de trésors à portée de main, qu'ils prennent plaisir à cueillir ou pêcher eux-mêmes. Baies sauvages, champignons, poissons fraîchement pêchés...
Autant de mets savoureux qui passeront directement de la forêt ou du lac à l'assiette, sans intermédiaire. Une manière de renouer avec les cycles naturels et de redécouvrir les saveurs authentiques.
Comme les hivers suédois sont longs et qu’on aime manger frais, il faut alors faire des réserves en conservant ses aliments de plein de manières possibles : confitures, congélations, légumes dans du vinaigre, viandes et poissons fumés, salés ou marinés…
7.2 - Le goût pour le fait-maison et les plats peu transformés
Selon Anne Thoumieux, cette quête de fraîcheur se double d'un goût prononcé pour les produits bruts, peu transformés.
Le lagom, c'est aussi cela, déclare l’auteure : privilégier le fait-maison aux plats préparés et la qualité à la quantité. Quitte à passer un peu de temps en cuisine pour mitonner des petits plats sains et goûteux.
7.3 – Cuisiner ensemble : l'importance du partage et de la transmission en cuisine
D'ailleurs, cuisiner est avant tout un moment de partage et de convivialité pour les familles suédoises.
Petits et grands mettent la main à la pâte, dans une ambiance chaleureuse et décontractée. On épluche, on émince, on remue les casseroles, on goûte... Autant de gestes simples pour créer du lien et transmettre les traditions culinaires. Le tout, sans prise de tête : ici, on mise sur des recettes familiales, généreuses et faciles à réaliser.
7.4 - Le sens de la mesure allié à la gourmandise
Le lagom, c'est aussi savoir se faire plaisir sans tomber dans l'excès, poursuit l’auteure du "Livre du lagom". Les Suédois raffolent des douceurs, qu'ils dégustent volontiers à l'heure du "fika", cette pause-café gourmande typiquement scandinave. Mais pas question de grignoter n'importe quoi, n'importe quand ! Là encore, l'équilibre est de mise, jusque dans le choix des en-cas.
7.5 – L’attachement aux fêtes traditionnelles et aux mets emblématiques...
Selon Anne Thoumieux, cet art de vivre frugal et épicurien trouve son apothéose lors des fêtes traditionnelles, qui rythment le calendrier suédois.
Écrevisses, harengs, brioches à la cannelle, gaufres... Chaque occasion a ses mets emblématiques, souvent liés aux saisons et aux produits du terroir.
Cette partie du "Livre du lagom" liste quelques-unes de ces fêtes dédiées à la célébration d’un aliment en particulier :
Le premier dimanche de l'Avent, les Suédois se détendent entre amis en buvant du glögg, un vin blanc chaud épicé, accompagné de biscuits au gingembre.
Le 4 octobre, c'est la fête de la kanelbullar (Kanelbullens dag), la célèbre brioche roulée à la cannelle que les Suédois dégustent à tout moment de la journée.
Pour Mardi gras, lors de la Fettisdagen, les Suédois savourent des semla, des pains au lait à la cardamome fourrés à la pâte d'amande et recouverts de crème fouettée à la vanille.
Le 25 mars, c’est Våffeldagen : place aux gaufres accompagnées de confiture et de crème fouettée, que tout le pays mange sans culpabilité.
Au mois d'août, les Suédois se réunissent entre amis pour déguster des écrevisses cuites à l'eau de mer avec de l'aneth, souvent importées mais toujours délicieuses.
Fin août, les plus courageux se lancent dans la dégustation du surströmming, un hareng fermenté à l'odeur pestilentielle, servi en sandwich avec des pommes de terre et des oignons.
Tous ces rituels savoureux célèbrent le plaisir d'être ensemble autour d'une table bien garnie.
7.6 - Petit déj’, alcool, fika et restaurants
Le petit déjeuner suédois
En Suède, contrairement à de nombreux pays, le petit déjeuner reste un vrai repas chaud et cuisiné, qu’on prend le temps de savourer assis, lors d'une vraie pause. Que ce soit à l'école où les élèves bénéficient d'un repas gratuit et d'options végétariennes, ou en entreprise où les Suédois apportent souvent leur déjeuner préparé à l'avance, le déjeuner sur le pouce devant l'ordinateur n'est pas dans les habitudes.
L’alcool avec modération… et régulation
En Suède, l'État régule rigoureusement la vente d'alcool grâce à un monopole d'État et des règles strictes (horaires limités, interdiction aux moins de 20 ans, pas de promotion). Mais ce système initialement conçu pour réduire la consommation a parfois l'effet inverse, poussant les Suédois à faire des stocks importants avant le week-end ou à s'approvisionner dans les pays voisins.
L’emblématique fika
En Suède, le fika, est bien plus qu'une simple pause-café : c'est un véritable rituel convivial et gourmand du quotidien, que ce soit au travail, entre amis ou en famille, avec toujours de bons petits gâteaux à partager !
Chapitre 8 – Bonheur au travail : un équilibre qui va de soi
Le chapitre 8 du "Livre du lagom" apporte des clés concrètes pour "travailler à la suédoise".
Miser sur la confiance et l'autonomie, cultiver la flexibilité et le dialogue, mettre l'humain au cœur des priorités... font partie des idées qui y sont développées par Anne Thoumieux pour réinventer le travail version "lagom" et selon l’auteure, redonner du sens et de la sérénité à notre vie professionnelle.
8.1 – Des entreprises "family friendly" : la conciliation vie pro/vie perso et le rejet du présentéisme au profit de l'efficacité
Au pays du lagom, concilier vie pro et vie perso n'est pas un vain mot. C'est une évidence, un équilibre qui coule de source, ancré dans l'ADN même des entreprises.
Ici, assure l’auteure, nous pouvons quitter le bureau à 17h sans culpabilité, pour passer du temps avec sa famille. Un credo qui profite à tous, poursuit-elle : les salariés sont plus épanouis, donc plus productifs, et les employeurs y gagnent en performance.
Bref, une équation gagnant-gagnant, à mille lieues de la culture du présentéisme qui sévit sous d'autres latitudes.
"Alors qu’en France on attend parfois que le patron parte pour ne pas avoir l’air d’un tire-au-flanc en partant avant lui, en Suède les employés prennent leur travail très au sérieux et le quittent à 17 heures pour être avec leur famille avec le sentiment positif du travail accompli. Bien sûr, personne ne vous tiendra rigueur si vous êtes absent du bureau parce que votre enfant est malade et le congé parental ne saurait déboucher sur une mise au placard à votre retour. Au contraire, vous pourrez demander à travailler moins, l’employeur ne peut pas le refuser, et ce, jusqu’aux 8 ans de l’enfant !"
8.2 - La confiance et la souplesse accordées aux salariés
D’ailleurs en Suède, rester tard au bureau est vu comme un aveu d'inefficacité. Mieux vaut miser sur un travail de qualité, réalisé dans le temps imparti, que sur des heures sup' à rallonge. Une philosophie qui va de pair avec une grande confiance accordée aux collaborateurs.
Télétravail, temps partiel pour s'occuper des enfants, congés parentaux prolongés... Tout est fait pour faciliter la vie des salariés, sans jamais remettre en cause leurs compétences.
8.3 - Un management bienveillant, coopératif et un fonctionnement collégial
Cette approche bienveillante se retrouve jusque dans le management.
Selon Anne Thoumieux, les chefs se veulent proches de leurs équipes, dans une logique de coaching plus que de contrôle. Accessibles et à l'écoute, ils font confiance à leurs collaborateurs pour s'organiser et prendre des initiatives. Un mode de fonctionnement horizontal et collégial, aux antipodes des hiérarchies pyramidales.
La communication, elle aussi, se veut fluide et transparente, note l’auteure.
L'information circule librement, sans rétention ni jeux de pouvoir. Chacun est impliqué dans les décisions, consulté selon son expertise plutôt que son rang.
"En Suède, on estime que les décisions doivent être prises en consultant la personne la mieux placée pour répondre, c’est-à-dire celle qui connaît le mieux le sujet, quelle que soit sa position hiérarchique. Dans son processus de décision, le chef recueille les avis et les opinions des concernés, rendant ainsi l’application des mesures plus réaliste et donc plus efficace puisque souvent inspirée par les employés sur le terrain."
Autrement dit, une culture du dialogue et du consensus, garante d'un climat apaisé et constructif, assure Anne Thoumieux.
8.4 - Des valeurs fortes comme socle...
Enfin, au cœur de ce modèle : des valeurs profondément ancrées, comme l'égalité, l'honnêteté, la modération, l’éthique qui impliquent d’être vrai. Autant de principes qui guident les Suédois au quotidien, dans leur façon d'être et de travailler. Avec en fil rouge, cette quête d'harmonie et de juste milieu si chère au lagom.
8.5 – Travailler à la suédoise
Anne Thoumieux énonce ici 10 règles faciles à suivre pour travailler comme les Suédois.
Puis, elle partage un interview avec Per Hällerstam, un chef d’entreprise suédois. Lorsqu’il décrit son milieu professionnel, il est facile de retrouver l’influence du "lagom", à travers notamment :
La mentalité égalitaire au travail,
La hiérarchie plus plate et l'accessibilité des dirigeants,
Le bon équilibre vie pro/perso : télétravail, pauses café en commun, départs tôt pour s'occuper des enfants…
Les décisions prises en consensus, sans confrontation directe,
Les désaccords qui s'expriment plutôt à l'écrit,
L'exécution rapide.
Enfin, en tant que directeur, il explique laisser beaucoup de liberté et d'initiative à ses employés. Il dit se positionner comme un support pour les aider à être performants, tel un coach fixant des objectifs.
Chapitre 9 – Société : politesse et fluidité avant tout
9.1 – L'équilibre subtil entre réserve et convivialité
La société suédoise est un savant dosage de retenue et de consensus, commence par nous expliquer Anne Thoumieux.
On y cultive l'art de la modération en toutes circonstances. Pas de débordements en public, de coups de klaxon rageurs ou de soupirs exaspérés dans les files d'attente. Les Suédois sont les champions de la maîtrise de soi, même dans les situations les plus irritantes.
Une sagesse du juste milieu qui n'exclut pas pour autant le dynamisme et la répartie, mais toujours avec mesure et humour, souligne l’auteure.
9.2 – Sorties : simplicité et authenticité
D’après l’auteur du "Livre du lagom", cet équilibre subtil se retrouve jusque dans l'art de recevoir à la suédoise. Oubliez les dîners guindés et les réceptions tape-à-l'œil ! La société lagom aime la simplicité et la convivialité, dans une ambiance casual chic.
Question dîner, chacun fait ce qu'il veut, du moment que c'est "lagom", indique l’auteure. En effet, gare à celui qui en ferait trop : un repas trop gastronomique pourrait mettre mal à l'aise les convives, sommés de rendre la pareille. Mieux vaut miser sur des agapes sans chichis, pour que tout le monde se sente bien.
9.3 - Le sens du collectif, du respect d'autrui et de la ponctualité
Autre "must" des soirées suédoises ? Des invités chaussons aux pieds, pour ne pas salir l'intérieur impeccable de leurs hôtes. Un détail qui en dit long sur le sens du pratique et du respect de l'autre, si chers aux Scandinaves.
De même, la ponctualité élevée au rang d'art de vivre, est une évidence. Ici, on n'arrive pas à l'heure, mais à l'heure pile. Un retard, même minime, est perçu comme un affront.
9.4 - Le côté ultra-connecté et innovant
Cela dit, le lagom n’est pas qu’une affaire de bienséance, prévient l’auteure. C'est aussi un état d'esprit résolument tourné vers l'innovation et la connexion.
Ultra-connectés, les Suédois expérimentent les dernières technologies avec un temps d'avance : paiement mobile, rendez-vous médicaux en ligne, administration 2.0... Le tout, avec ce souci constant de sécurité et de bien-être qui les caractérise.
9.5 - L'engagement écologique
Dans le domaine de l’innovation justement, l'écologie est un autre pilier de ce modèle de société exemplaire, termine l’auteure. Pionnière en matière de développement durable, la Suède regorge d'initiatives inspirantes.
En effet, écoquartiers, villes zéro carbone, énergies vertes... les exemples abondent, portés par une conscience environnementale chevillée au corps.
9.6 – Parité, codes sociaux et poésie…
Le neuvième chapitre du "Livre du lagom" se termine par différents petits encarts dans lesquels Anne Thoumieux liste "5 trucs lagom rigolos", "5 choses que les Suédois aiment faire pendant leur temps libre", "5 choses que les Suédois ne feraient jamais", la façon dont la famille royale essaie d’être "comme tout le monde" et autres anecdotes sur la société suédoise.
Elle évoque aussi "Midsummer", la fête traditionnelle la plus importante en Suède. Celle-ci est célébrée avec des repas, des danses et deux traditions florales poétiques : la confection de couronnes de fleurs et un rituel pour les femmes non mariées, qui crée une ambiance colorée et festive jusque tard dans les jardins.
Chapitre 10 – La famille : un pilier fondateur
La recette suédoise de la famille épanouie ? Cultiver des rituels simples, placer l'enfant au cœur des priorités, miser sur une éducation positive, réinventer sa vie de couple...
Dans ce chapitre du "Livre du lagom" dédié à l'art d'être parent version lagom, Anne Thoumieux partage quelques pistes inspirantes pour insuffler un vent de lagom dans sa tribu.
10.1 - La place centrale de la famille dans la société suédoise
En Suède, la famille est reine.
Véritable pilier de la société, elle est au cœur de toutes les attentions et de tous les aménagements. Des horaires de travail adaptés aux congés parentaux généreux, en passant par des modes de garde accessibles et des espaces publics pensés pour les poussettes...
Tout est fait pour faciliter la vie des parents et le bien-être des enfants, observe l’auteure du "Livre du lagom" dans cet avant-dernier chapitre de l’ouvrage.
"Dehors, tout est fait pour faciliter la vie avec une poussette […]. Magasins, banques ou encore administrations, […] les Suédois accueillent partout les enfants avec le sourire, là où habituellement en France on serait regardé de travers et on s’efforcerait de faire taire le bambin à tout prix. En tant que parents, on ne se demande pas si "on gêne" en Suède !
Les centres commerciaux mais aussi les bibliothèques disposent d’espaces dédiés aux enfants, de tables à langer et souvent de parking à poussettes et landaus, tandis que les restaurants sont tous pourvus de chaises hautes… Le paradis des parents, n’est-ce pas ? Mais ce n’est pas fini : dans certaines villes, les bus équipés de larges portes centrales pour faciliter leur montée sont gratuits pour les parents accompagnés d’un jeune enfant pour leur éviter d’avoir à laisser la poussette pour aller payer leur ticket à l’avant ! La société suédoise étant ainsi "calibrée" pour la famille, c’est sans surprise que les traditions perdurent et que les liens familiaux sont renforcés."
10.2 - L'implication des pères
Cette politique volontariste se double d'une répartition équitable des rôles au sein du couple.
Ici, les papas s'impliquent autant que les mamans, sans craindre le regard des autres, souligne Anne Thoumieux. Ainsi, il est courant de les voir pouponner en écharpe au parc ou donner le goûter en terrasse. Un équilibre rendu possible par des congés paternité conséquents (chaque parent a droit à 3 mois de congé paternité et maternité) et une culture de la parité bien ancrée.
10.3 - L'importance des moments partagés et la priorité donnée au bien-être de l'enfant
Pour Anne Thoumieux, cet environnement bienveillant permet aux liens familiaux de s'épanouir en toute sérénité.
Les week-ends à la campagne et les vacances au vert sont autant d'occasions de se retrouver, de partager des moments simples et authentiques. Cueillette de champignons, balades en forêt, jeux au grand air, longues soirées devant la cheminée... Des rituels qui se transmettent de génération en génération, pour le plus grand bonheur de tous.
Car ici, le bien-être de l'enfant est une priorité absolue, ajoute l’auteure du "Livre du lagom". Dès son plus jeune âge, il est placé au cœur d'un système tourné vers son épanouissement. Crèches accessibles, pédagogie positive, activités d'éveil... Tout est pensé pour favoriser son développement harmonieux, dans le respect de ses besoins et de sa personnalité.
10.4 - La philosophie éducative bienveillante au cœur de la parentalité et de la scolarité
Anne Thoumieux explique ensuite que cet art d'être parent à la suédoise se nourrit d'une philosophie éducative résolument bienveillante et tournée vers l'autonomie. Pas de fessée ni de punition, mais une écoute attentive et des encouragements constants. L'enfant est considéré comme une personne à part entière, dont on cultive la confiance et la créativité.
L'école, dans la droite ligne de ces principes, mise sur l'épanouissement plus que sur la performance. Notation tardive, apprentissages ludiques, proximité avec la nature, encouragements, développement de la créativité, jeux en plein air... L'objectif est de former des citoyens libres et responsables, heureux d'apprendre et de grandir.
10.5 - La redéfinition des codes du couple
Cette approche globale du bien-être familial ne serait pas complète sans une redéfinition des codes amoureux, note l’auteure.
Dans la lignée du lagom, les rendez-vous se font "à la cool", autour d'un café et l'addition est partagée. Quant à la vie de couple, elle laisse une large place aux amis, aux enfants et au temps pour soi. Un équilibre subtil, à mi-chemin entre complicité et indépendance.
10.6 – L’enfance suédoise
Ulrika Dezé est la créatrice du concept Yogamini, qui propose des ateliers de yoga pour enfants dans une approche ludique et respectueuse de la nature.
À la fin de ce chapitre du "Livre du lagom", Anne Thoumieux partage son témoignage. Dans celui-ci, elle raconte ce qu’est une enfance à la suédoise. En voici un petit résumé :
L’enfant suédois est au cœur de la vie familiale : à la maison, les tâches sont partagées entre lui/elle et ses parents.
L'école encourage le jeu et les apprentissages sensoriels plutôt que la compétition.
L'éducation est permissive, les punitions corporelles interdites depuis les années 70.
Les familles suédoises vivent dans l'ouverture, sans clôtures ni barrières.
La nature occupe une place centrale, presque sacrée. Les enfants grandissent libres, jouant dehors par tous les temps.
Les conflits sont gérés de manière apaisée, avec l'aide de médiateurs si besoin.
Chapitre 11 – Prêt pour la vie lagom ?
Le dernier chapitre du "Livre du lagom" est court : il met en lumière, sous forme de 10 commandements, les valeurs clés du lagom, tout en invitant à un bilan personnel à travers l'exemple de l'auteure. L'objectif est de susciter une réflexion chez nous, lecteurs, sur nos propres habitudes.
Ainsi, les 10 commandements du lagom énoncés par Anne Thoumieux invitent à cultiver :
L'altruisme,
La gratitude,
Le respect de la nature,
La modération,
Le soin de soi,
Les liens familiaux,
Les plaisirs simples,
L'équilibre travail-vie,
La sobriété
L'humilité.
En somme, le condensé inspirant de cette philosophie de vie qu’est le lagom !
Et entre astuces déjà adoptées et résolutions à prendre, chacun peut faire son "bilan lagom personnel". De petits pas vers un quotidien plus serein et plus conscient, à la suédoise ! termine l’auteure.
Conclusion
Au terme de cette immersion au cœur du lagom, l’auteure du "Livre du lagom" partage avec nous, en guise de conclusion, combien son envie de tester grandeur nature cet art de vivre à la suédoise se fait pressante.
Car vivre le lagom est pour elle, au-delà d'un simple voyage et des frontières scandinaves, une véritable quête d'équilibre et de justesse qui résonne comme un appel universel au bonheur du quotidien, confie-t-elle.
Pour Anne Thoumieux, le "ni trop, ni trop peu" prôné par le lagom s'offre en fait à nous comme une boussole nous indiquant un cap à suivre pour évoluer sereinement dans un monde en perte de repères.
Il ne tient alors plus qu’à nous de l'adopter, pour cultiver la voie du milieu... et du bonheur !
Conclusion de "Le Livre du lagom | L’art suédois du ni trop, ni trop peu" d’Anne Thoumieux
1/ Les 3 grandes idées clés à retenir du livre "Le Livre du lagom" d'Anne Thoumieux
Idée n°1 : Le lagom, une philosophie holistique pour une vie épanouie
La première grande idée du "Livre du lagom" est que le lagom est bien plus qu'un simple précepte prônant la modération.
C'est, selon Anne Thoumieux, une véritable philosophie de vie qui s'est ancrée via les traditions nordiques et qui nous invite à cultiver un art de vivre respectueux de soi, des autres et de l'environnement. Une approche holistique où tout est lié : notre manière de consommer, de nous nourrir, de nous vêtir, de nous loger, de nous divertir et même de travailler.
Idée n°2 : Une quête d'équilibre et d'authenticité, en harmonie avec la nature
Bousculant les diktats de notre société de surconsommation et de gaspillage, le lagom nous appelle aussi à retrouver l'essentiel, les vrais plaisirs de l'existence. En privilégiant le local, le durable, le naturel. En redécouvrant les joies simples d'une randonnée, d'un pique-nique ou d'un feu de cheminée en famille. Bref, en nous reconnectant à ce qui fait sens, dans le respect de notre environnement.
Idée n°3 : La voie du "juste milieu" comme recette du bonheur
Loin des extrêmes de la démesure ou de la privation, le lagom célèbre enfin ce que nous pourrions appeler la "voie du milieu". Ni trop, ni trop peu, mais "ce qu'il faut", suffisamment pour être pleinement satisfait. Une quête d'équilibre permanent, en somme, entre nos besoins et nos désirs.
Au lieu de l'excès "tape à l'œil" ou du manque frustrant, "Le Livre du lagom" prône une modération rassasiante pour goûter aux petits bonheurs du quotidien et atteindre une réelle sérénité.
2/ Ce que cette lecture va vous apporter
"Le Livre du lagom" est une lecture qui va vous immerger dans le mode de vie suédois. Elle vous invite à retrouver l'essentiel, à consommer de façon plus responsable et à apprécier les joies simples et authentiques, loin de l'agitation stressante de notre monde.
Que vous soyez entrepreneurs en quête d'un meilleur équilibre, parents souhaitant transmettre des valeurs responsables à vos enfants, ou simplement citoyens désireux d'allier bien-être et respect de la planète, les préceptes du lagom vous proposent de ralentir, de savourer chaque moment, chaque geste, dans un esprit de pleine conscience et de gratitude.
C'est donc une lecture que je recommande à tous ceux qui aspirent à une autre façon d'aborder la vie, avec plus de plénitude et d'équilibre au quotidien. En somme, "Le Livre du lagom" est un ouvrage inspirant et instructif qui vous aidera à réinventer votre vie dans le respect de vos valeurs personnelles et des enjeux écologiques actuels.
Points forts :
Les illustrations, les photos et la mise en page qui en font une lecture très agréable.
La présentation complète et holistique de cette philosophie suédoise qu'est le "lagom" (tous les aspects du mode de vie sont couverts : consommation, habitat, loisirs, travail, famille, etc.).
Les encarts, témoignages, petites listes et exemples pour illustrer les principes.
Les valeurs du "ni trop ni trop peu" de cet art de vivre équilibré, authentique et respectueux de l'environnement.
Le style d'écriture fluide et bienveillant.
Point faible :
Certains pourront trouver ce mode de vie trop sobre/ minimaliste à leur goût.
Ma note : ★★★★☆
Avez-vous lu "Le Livre du lagom"? Combien le notez-vous ?
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre d’Anne Thoumieux "Le Livre du lagom"
Visitez Amazon afin d'acheter le livre d’Anne Thoumieux "Le Livre du lagom"
 ]]>
]]>Résumé de « Au cœur de l’intelligence artificielle » d’Axel Cypel : ce livre, rédigé par un ingénieur travaillant de près avec les algorithmes, a pour ambition de vous aider à démêler le vrai du faux en matière d'IA — pour ce faire, il vous plonge au cœur des questions techniques, éthiques et sociales que posent le développement de l'intelligence artificielle.
Axel Cypel, 2020, 455 pages.
Chronique et résumé de "Au cœur de l'intelligence artificielle" d'Axel Cypel
Introduction : Du scientisme ambiant
Axel Cypel raconte plusieurs anecdotes personnelles qui montrent qu'il existe un flou autour de notre compréhension de l'IA et de ses pouvoirs. D'où les questions qu'il se pose dans cet ouvrage et auxquelles il voudrait donner des réponses réalistes :
"Quelle est la part du vrai dans ce qui s'entend sur l'IA et dans ce qui se lit ? Jusqu'où cette technologie peut-elle aller ? Est-ce souhaitable ?" (Au cœur de l'intelligence artificielle, Introduction)
Pour l'auteur, le flot incessant d'informations contradictoires et exagérées autour de l'IA nuit fortement à la compréhension sereine du phénomène. Axel Cypel veut donc démêler le vrai du faux et poser les questions calmement.
Mais, se demande-t-il, comment écrire sur l'IA ? Comment prendre en compte tous les aspects de cette réalité ? Pour nous aider à naviguer dans l'ouvrage, il a établi les sigles suivants :
T pour Technique (bases informatiques et mathématiques) ;
D pour Dangers (problèmes potentiels pour l'humain) ;
L pour Limitations (soucis "techniques" à résoudre) ;
C pour collatéraux (technologies affiliées à l'IA, questions philosophiques).
Dans le livre, ces sigles permettent de faciliter le repérage des grands thèmes liés à l'IA. Nous noterons la lettre correspondante après le titre de chaque chapitre (par exemple, au chapitre 1, [T]).
Partie A : Expliquer l'IA
L'auteur s'intéresse ici aux questions scientifiques et techniques. Le deuxième chapitre, plus "amusant", a pour but d'interroger nos perceptions de l'IA. Souvent, nous fantasmons et exagérons ce que peut cette technologie. C'est pourquoi un petit rappel de ses principes de fonctionnement s'avère utile.
Chapitre 1 : Présentation générale de l'IA [T]
Axel Cypel se lance ici dans les définitions. Qu'est-ce que l'IA d'un point de vue scientifique et technique ? Mais aussi :
Quel est le rôle des données ?
Qu'est-ce que le cloud ?
Et la notion d'apprentissage ?
Sans oublier : qu'est-ce qu'un algorithme ?
L'auteur cherche la clarté, mais pas la simplification. Il propose des développements intéressants pour lier les définitions entre elles. Par exemple, voici sa définition de l'algorithme :
"Un algorithme est un procédé (une sorte de recette) qui permet de résoudre un problème par la mise en œuvre de suites d'opérations élémentaires selon un processus défini aboutissant à une solution." (Au cœur de l'intelligence artificielle, Chapitre 1)
]]>Résumé de "Le Livre du hygge" de Meik Wiking : cet ouvrage nous invite à découvrir le concept danois qu’est le "hygge", un art de vivre basé sur la convivialité, la simplicité, le partage, la lumière ou encore la chaleur. Il partage des conseils et astuces pour créer cette ambiance cosy qui constituerait pour l’auteur, chercheur à l’Institut de bonheur de Copenhague, la clé du bonheur.
Par Meik Wiking, 2016, 334 pages.
Edition anglaise : "The Little Book of Hygge: The Danish Way to Live Well"
Chronique et résumé de "Le Livre du hygge" de Meik Wiking
Introduction - Comprendre le concept du hygge
L'auteur, Meik Wiking, chargé d'étudier le bonheur au sein d'un institut de recherche à Copenhague, développe 4 idées dans l’introduction de son "Livre du hygge" :
- Le hygge, un concept danois difficile à définir
Meik Wiking explique d’abord que le hygge est un concept difficile à définir précisément.
"Écrire et prononcer "hygge", c’est encore la partie la plus facile. Expliquer exactement ce dont il s’agit, c’est nettement plus compliqué. Le hygge a été défini de tant de manières, depuis "l’art de créer de l’intimité" jusqu’au "réconfort de l’âme", en passant par "l’absence de contrariété", "prendre plaisir à la présence d’objets apaisants", ou encore "être ensemble tranquillement", et mon préféré : "un chocolat chaud à la lueur d’une bougie"."
- Le hygge, c'est une ambiance
Ainsi, il s'agit avant tout, indique-t-il, d'un état d'esprit, d'une ambiance, plus que d'éléments matériels : le hygge renvoie, en effet, au fait de se sentir en sécurité, entouré des gens qu'on aime.
"Le hygge parle d’ambiance et d’expérience, plutôt que de choses tangibles : c’est être avec les personnes que l’on aime. Le sentiment d’être à sa place, comme à la maison. La sensation d’être en sécurité, protégé du monde extérieur, et de pouvoir enfin baisser la garde."
Voici un autre extrait du livre particulièrement parlant pour comprendre ce qu’est le hygge :
"Un jour, en décembre, juste avant Noël, je passais un week-end dans un vieux chalet à la montagne, entouré d’amis. Le jour le plus court de l’année se réfléchissait sur la couverture de neige blanche du paysage environnant."
Une fois le soleil couché, vers 16 heures, alors que nous ne le reverrions pas avant dix-sept heures, nous sommes rentrés pour allumer un feu.
"Nous étions tous fatigués après une randonnée, à moitié endormis, assis en demi-cercle autour de la cheminée, emmitouflés dans de gros pulls et des chaussettes en laine. Les seuls bruits audibles étaient le ragoût qui mijotait, les étincelles du feu et les gorgées de vin chaud que l’un d’entre nous avalait.
C’est alors qu’un de mes amis a brisé ce silence.
"Est-ce que ce moment pourrait être encore plus hygge ?" a-t-il demandé, sans attendre de réponse.
– "Oui, a répondu une des filles au bout d’un moment. Si une tempête de neige faisait rage dehors."
Et nous avons tous hoché la tête."
- Le lien entre hygge et bonheur
Selon Meik Wiking, le concept de hygge est probablement un ingrédient clé dans le haut niveau de bien-être observé au Danemark, pays qui arrive dans le top 3 du classement des pays les plus heureux du monde.
Il fait remarquer, à ce propos, que les Danois passent beaucoup de temps avec leurs proches et font partie des populations les plus pacifiques sur la planète.
- L'intérêt croissant pour le hygge
Enfin, partout dans le monde, on observe un intérêt grandissant pour ce concept typiquement danois, observe l’auteur.
De nombreux journalistes et chercheurs tentent de plus en plus à percer ses secrets. Le hygge inspire de nouveaux commerces et est même enseigné dans certaines universités.
Meik Wiking termine cette introduction en nous informant sur le contenu du "Livre du hygge".
Ainsi, il mentionne vouloir :
Explorer les liens entre le hygge, le bien-être et le bonheur,
Définir plus précisément ce concept,
Partager des clés pour que nous puissions nous-même créer une atmosphère hygge.
Chapitre 1 – La lumière
1.1 - Le hygge instantané : les bougies
Selon "Le Livre du hygge", les bougies sont essentielles pour créer une ambiance hygge.
D’ailleurs, Meik Wiking, l’auteur, nous apprend que 85 % des Danois les associent avant tout au hygge. Et que le Danemark est le plus gros consommateur de bougies en Europe : chaque Danois en brûle 6 kg par an ! Cette consommation augmente par trois durant les mois de décembre avec la fameuse tradition danoise de la "bougie de l'Avent".
"L’ambassadeur américain au Danemark Rufus Gifford a dit un jour, parlant de l’histoire d’amour entre les Danois et les bougies : "Ce n’est pas juste dans le salon, c’est partout. Dans les classes à l’école, dans les salles de réunion. En tant qu’Américain, je ne peux m’empêcher de penser : “Au feu ! Comment est-il possible d’allumer une flamme dans une école ?” Les bougies créent un sentiment de bonheur et de confort"."
Petite mise en garde de l’auteur tout de même : allumer des bougies libère énormément de particules toxiques dans l'air.
1.2 - Les lampes
Au-delà des bougies, les Danois accordent une grande importance à la lumière en général. Le but est de créer une atmosphère chaleureuse, observe Meik Wiking.
À ce propos, l’auteur confie avoir, un jour, "marché deux heures dans Rome avec sa [ma] petite amie de l’époque afin de trouver un restaurant qui ait un éclairage hygge".
Ainsi, les Danois choisissent minutieusement leurs lampes, souvent issues du design danois (comme celles du fameux Poul Henningsen). Ils les placent stratégiquement. La règle est la suivante : plus la température de la lumière est basse, plus elle est propice au hygge.
Pour l’auteur "Livre du hygge", cette obsession danoise pour la lumière vient du manque de luminosité naturelle dans le pays pendant une grande partie de l'année.
1.3 - Trois types de lampes danoises cultes
Dans cette partie du "Livre du hygge", Meik Wiking nous présente trois créateurs de lampes emblématiques au Danemark :
Poul Henningsen qui a consacré sa carrière à apprivoiser la lumière électrique pour qu'elle soit plus douce, avec sa lampe PH.
La famille Klint et ses abat-jours plissés.
Verner Panton et son arche fluorescente diffuse, la VP Globe.
1.4 - Mieux que Photoshop
L'auteur fait ensuite le parallèle entre le goût danois prononcé pour la lumière et celui des photographes. Il explique que la lumière de "l'heure dorée" (golden hour) au lever et coucher du soleil est la plus flatteuse. C'est ce type d'éclairage chaleureux qu'il faut tenter de reproduire à l'intérieur pour un sentiment hygge.
1.5 - Astuce hygge : créer un éclairage hygge
Pour conclure ce premier chapitre du "Livre du hygge", Meik Wiking livre des conseils pour créer facilement une ambiance lumineuse propice au hygge chez soi. Il suggère notamment d’utiliser des bougies en prenant garde à l'aération. Ou des petites lampes d'appoint disséminées en formant comme des "puits de lumière".
Chapitre 2 – Et si on parlait du hygge
2.1 - Le syndrome de la Tourette
Weik Wiking se permet ici une touche d’humour. Il explique, en effet, que les Danois utilisent tellement les mots "hygge" et "hyggelig" dans leur langage quotidien, pour qualifier à peu près tout, qu'ils donnent l'impression aux étrangers de souffrir d'une forme de syndrome de Gilles de la Tourette !
Il ajoute également que le hygge sert d'instrument de mesure à la plupart des événements sociaux au Danemark et qu'il sert aussi d’argument de vente pour les cafés et restaurants.
2.2 - Qu'y a-t-il dans un nom ?
Dans cette partie du "Livre du hygge", l'auteur explique réfuter l'idée que le hygge soit intraduisible et purement danois.
En effet, d'autres cultures, assure-t-il, ont des concepts similaires.
L'auteur passe ici en revue divers termes étrangers qui se rapprochent du hygge : le "gezelligheid" plus social des Néerlandais, le "koselig" norvégien associé à la chaleur et l'intimité, le "Gemütlichkeit" allemand lié à la bière et aux rassemblements ou encore le "hominess" au Canada.
Cependant, admet-il, seuls les Danois l'utilisent comme verbe et lui accordent une telle importance dans leur identité nationale.
2.3 - Du hygge pour tout le monde
Pour Meik Wiking, ces différents concepts retrouvés dans d'autres cultures prouvent que le hygge n'est pas l'apanage des Danois. S'il prend des formes variées selon les communautés, le sentiment de réconfort et de convivialité qu'il véhicule est universel.
L’auteur du "Livre du hygge" observe d’ailleurs que les pays où ce type de concept est très intégré, comme le Danemark et les Pays-Bas, figurent parmi les plus heureux au monde, note l’auteur.
Deux encarts sont ici consacrés aux expressions danoises et dans le monde autour de ce concept.
2.4 - D'où vient le mot hygge ?
Le mot "hygge" tire son origine du norvégien, où il signifiait à l'époque "bien-être", indique Meik Wiking.
Cette partie du "Livre du hygge" décrit les liens étymologiques du mot "hygge" avec différents termes évoquant le réconfort, les câlins, la considération.
2.5 - Une conversation mondiale autour du hygge
L'auteur Meik Wiking termine le chapitre 2 de son ouvrage "Le Livre du hygge" en constatant que le hygge suscite aujourd'hui un intérêt grandissant à travers le monde. En témoigne, en effet, un foisonnement d'articles, d'ouvrages, de commerces et de formations liés à ce concept.
Chapitre 3 – Être ensemble
3.1 - Comme un câlin sans se toucher
Pour Meik Wiking, le meilleur moment de ses vacances au ski reste, plus que la descente, celui où tout le monde se retrouve autour d'un café sur le balcon du chalet, fatigués mais heureux.
Cette scène que l’auteur nous décrit illustre l'importance des relations sociales pour le bonheur au Danemark. Constat, souligne-t-il, confirmé par de nombreuses études. Sans surprise, le hygge s’inscrit dans cette valeur si chère aux danois : il permet de recréer ce sentiment de plénitude d'être ensemble.
"Quand je fais des conférences autour de la recherche sur le bonheur, je demande toujours aux auditeurs de fermer les yeux et de repenser à la dernière fois où ils se sont sentis vraiment heureux. […]. Lorsque je leur demande de lever la main pour dire si, dans leur souvenir, ils étaient entourés d’autres personnes, en général neuf sur dix le font."
3.2 - Qu'est-ce que l'amour a à voir là-dedans ? Une question d’ocytocine
Meik Wiking met ici en évidence que les interactions sociales, lors d'un moment hygge, libèrent de l'ocytocine, hormone du bonheur et de l'attachement qui renforce les liens.
En ce sens, le hygge procure amour, chaleur et sécurité : les 3 ingrédients de base de cette neurohormone.
3.3 - Heureux ensemble
L’auteur expose ici de nombreuses études qui ont démontré l’idée que : plus on est satisfait de ses relations sociales, plus on a tendance à se dire heureux dans l'ensemble.
À ce sujet, il écrit :
"Être avec d’autres personnes est un élément clé du hygge, mais en tant que chercheur sur la question du bonheur, je peux aussi affirmer que ces liens sociaux sont probablement l’ingrédient le plus important du bonheur. Il est largement admis parmi les scientifiques et chercheurs qui étudient la question que les relations sociales sont essentielles au bonheur."
Puis, il poursuit :
"Selon le Rapport mondial sur le bonheur commandé par les Nations unies : "Si un niveau de vie minimum est essentiel au bonheur, une fois que ces besoins de base sont comblés, le bonheur varie davantage selon la qualité des relations humaines que selon le revenu"."
Alors, bien sûr, toutes ces recherches ne nous apprennent rien de vraiment surprenant. Toutefois, elles procurent des chiffres, des données et des preuves. Et ces conclusions utiles, "nous pouvons et devons les utiliser pour modeler nos décisions politiques, nos sociétés et nos vies" soutient l’auteur.
3.4 – Le besoin d’appartenance
Meik Wiking parle aussi ici de "l’hypothèse de l’appartenance". Celle-ci entend que "nous avons tous le besoin fondamental de nous sentir liés les uns aux autres".
La preuve en est que :
"Les êtres humains, où qu’ils soient dans le monde, naissent avec la capacité et l’envie de créer des relations solides, qu’ils sont réticents à couper des liens tissés, et que les couples mariés ou les personnes en cohabitation vivent plus longtemps que les personnes seules (bien que ce soit en partie également lié à un système immunitaire plus fort)."
L’auteur du "Livre du hygge" précise que :
"Les relations sociales les plus importantes sont les relations avec des proches, qui permettent de vivre des choses ensemble, de se sentir compris, de partager des pensées et sentiments, et de donner et recevoir du soutien. En un mot : hygge."
Par conséquent, le hygge, basé sur le partage et la connivence en petit comité, répond à ce besoin fondamental d'appartenance. Et c’est peut-être pour cette raison que les Danois ont une préférence pour des groupes restreints (4 personnes en moyenne).
3.5 - Le côté obscur du hygge
Si le hygge solidifie les liens au sein d'un groupe soudé, le revers de la médaille, confie Meik Wiking, est qu'il est très difficile pour un étranger de s'intégrer dans ces cercles sociaux déjà établis.
Mais :
"La bonne nouvelle, comme dit mon ami Jon : "Une fois que t’es dedans, t’es dedans". Une fois que vous avez fait votre place, vous pouvez être sûr que ces relations dureront toute la vie."
3.6 - Hygge : des relations sociales pour les introvertis
L’auteur termine le chapitre 3 du "Livre du hygge" en partageant une anecdote : un jour, une étudiante américaine lui a fait remarquer que le hygge était un cadeau pour les introvertis, car il était une façon d'avoir une vie sociale sans épuisement.
"Ce qu’elle voulait dire, c’est qu’aux États-Unis, elle avait l’habitude de participer à des événements avec beaucoup de monde, beaucoup de réseautage rapide, d’enthousiasme mondain. En gros, elle vivait au royaume des extravertis. Au Danemark, elle a découvert que la façon dont les activités sociales étaient organisées lui correspondait bien plus […] C’était une façon d’avoir une vie sociale sans peine."
En effet, les petits groupes et les conversations détendues du hygge conviennent bien mieux aux introvertis que les grands événements mondains.
"Le hygge est un moyen de fréquenter les autres qui convient aux introvertis : ils peuvent passer une soirée détendue, à l’aise avec quelques amis, sans devoir inclure un grand nombre de convives ni beaucoup d’activités. Un introverti préférera peut-être rester à la maison plutôt que de se rendre à une grande fête d’anniversaire où sont invités beaucoup d’inconnus, et le hygge offre une solution intermédiaire entre voir du monde et se relaxer. Il permet à deux mondes de cohabiter."
3.7 - Astuce hygge : comment se fabriquer des souvenirs
Meik Wiking nous suggère de lancer une nouvelle tradition avec nos proches. Cela peut être une soirée "jeux de société" mensuelle ou une célébration annuelle du solstice d'été au bord de la mer. Ces moments, choisis autour d’une activité significative pour nous, soudent nos liens tout en créant des souvenirs précieux qui se perpétueront au fil des ans.
Chapitre 4 – Manger et boire
4.1 - Vous êtes ce que vous mangez
Le chapitre 4 du "Livre du hygge" commence par expliquer que l'alimentation typiquement danoise, riche en viande, sucreries et café, est intrinsèquement liée au hygge. Et que faire plaisir à ses papilles, se réconforter, partager un bol de pop-corn, sont autant d'éléments hyggelig.
4.2 - Vivons ensemble dans le péché
Les Danois sont de gros consommateurs de bonbons, qu'ils associent beaucoup au hygge, signale l’auteur.
Il relate une anecdote amusante à ce propos :
"Il y a deux ans, je rendais visite à un ami et à sa famille. Sa fille avait alors quatre ans et, pendant le dîner, elle s’est tournée vers moi et m’a demandé :
"C’est quoi, ton travail ?"
"J’essaie de découvrir ce qui rend les gens heureux", ai-je répondu.
Elle a haussé les épaules : "C’est facile, ça. Les bonbons."
Quand on parle de bonheur, je ne suis pas sûr que la réponse soit aussi simple, mais je pense qu’elle a mis le doigt sur un élément du hygge."
4.3 - Les pâtisseries
Il en va de même pour les gâteaux, omniprésents dans les bureaux et salons de thé danois.
Des figures comme le "gâteaumann", bonhomme en pain d'épice des anniversaires, ou des pâtisseries typiques comme le "kringle" sont également très hyggelig.
"Kringle est une pâtisserie danoise traditionnelle, et bon signifie facture. Le principe du bon-kringle est le suivant : lorsque vous avez acheté des gâteaux ou pâtisseries pour un montant de 1 000 couronnes (environ 130 euros) chez le pâtissier du coin, si vous lui présentez les factures, il vous offre un kringle gratuit. C’est un peu comme la carte de fidélité de la pâtisserie, mais sans la carte."
En fait, plus c’est rustique, plus c’est hygge. De même, plus c’est "fait maison", plus c’est hygge.
D’ailleurs :
"Se salir les mains pour pâtisser à la maison est une activité hyggelig que vous pouvez pratiquer seul, ou bien avec des amis ou de la famille. Peu de choses contribuent autant au hygge que l’odeur de gâteaux qui sortent du four."
4.4 - Les boissons chaudes
86 % des Danois lient les boissons chaudes au hygge. Le pays fait partie des plus gros buveurs de café au monde. Un "kaffehygge", ou café hygge, est toujours apprécié. Le thé, le chocolat et le vin chaud participent aussi à l'atmosphère hygge.
4.5 - Accro au hygge ?
L'auteur du "Livre du hygge" montre ici, recherches à l'appui, que notre attirance pour le sucré est liée à la libération de dopamine, l'hormone du plaisir, et à notre instinct de survie.
Si le hygge invite certes à la gourmandise et au réconfort, Meik Wiking souligne que le concept nous invite à nous faire plaisir avec modération à ce niveau-là.
4.6 - Le cousin rondouillard des plats mijotés
Plus un plat demande du temps à préparer, plus il sera hyggelig, annonce Meik Wiking.
Ainsi, cuisiner un ragoût qui mijote des heures est l'archétype de l'activité hygge car on prend plaisir au processus lent.
Pour terminer le quatrième chapitre du "Livre du Hygge", plusieurs recettes traditionnelles danoises sont proposées. Nous retrouvons, par exemple, parmi celles-ci : le plat de marin "skipperlabskovs" ou encore le vin chaud "gløgg" de Noël.
4.7 - Astuce hygge : mettre en place un atelier de cuisine
Meik Wiking raconte avoir créé, il y a quelques années, un atelier de cuisine entre amis dans le but de les voir régulièrement.
Lors de ces soirées, chacun apporte des ingrédients sur un thème défini et tous cuisinent ensemble dans une ambiance détendue et égalitaire, propice au hygge. Même si le résultat n’est pas toujours à la hauteur, plaisante l’auteur, cette activité très hyggelig n’a fait que renforcer leurs liens au fil du temps.
Chapitre 5 – S’habiller
5.1 - Décontracté, c’est la clé
Dans le chapitre 5 du "Livre du hygge", Meik Wiking nous parle du style vestimentaire danois. Celui-ci se veut décontracté, minimaliste, élégant mais peu varié. Il s'inscrit entre "hygge" et "design fonctionnel" informe-t-il. Par ailleurs, les Danois privilégient les superpositions de lainages ou encore les écharpes épaisses, nous dit-il.
5.2 - Comment s'habiller comme un Danois
Quelques conseils sont ensuite partagés pour adopter le look danois "hygge".
En voici quelques-uns :
Portez une écharpe : la règle d’or étant que "plus elle est épaisse, mieux c’est.
Misez sur les teintes sombres comme le noir,
Optez pour des matières épaisses et chaudes en hiver,
Utilisez le principe des couches pour s'adapter à tous les temps,
Arborez une coupe de cheveux décontractée.
5.3 - Le pull à la Sarah Lund
L'auteur clôt le cinquième chapitre du "Livre du hygge" en évoquant le célèbre pull en laine porté par le personnage de Sarah Lund dans la série "The Killing". Celui-ci, indique-t-il, est devenu extrêmement populaire auprès des Danois et symbole d'une mode à la fois tendance et hyper-décontractée.
5.4 - Astuce hygge : comment acheter
Meik Wiking nous invite ici à associer ses achats à des moments importants de notre vie.
Il raconte avoir lui-même attendu la publication de son premier livre pour s'offrir une chaise. Cette chaise qui lui rappelle aujourd’hui cet accomplissement. De même, il nous suggère d'acquérir un vêtement à un moment hyggelig : ainsi, nous nous en souviendrons plus tard, à chaque fois que nous le porterons.
Chapitre 6 – À la maison
6.1 - Le quartier général du hygge
Selon Meik Wiking, le foyer est le cœur du hygge pour les Danois. Ils passent, en effet, plus de temps chez eux qu'à l'extérieur. Ils accordent beaucoup d'importance à la décoration intérieure, d'où le succès de ces séries danoises montrant de superbes intérieurs.
Les Danois disposent de l'espace de vie par habitant le plus grand d'Europe.
L'auteur illustre aussi leur obsession du design à travers l'anecdote du "Vasegate" : le 25 août 2014, plus de 16 000 Danois ont tenté d'acheter en ligne un vase Kähler en édition limitée, créant une rupture de stock immédiate et une hystérie collective pour un simple vase aux rayures cuivrées de 20 cm de haut.
6.2 - La liste de souhaits hygge : 10 choses pour rendre votre maison plus hyggelig
L'auteur propose 10 conseils pour créer un intérieur propice au hygge. Les voici résumés :
Aménagez un "hyggekrog", petit coin douillet pour lire ou se détendre.
Installez une cheminée au cœur de votre intérieur, pour vous y reposer tranquillement devant, ressentir la chaleur et le confort et passer du temps convivial avec vos proches.
Disposez des bougies un peu partout.
Intégrez des objets en bois évoquant la nature.
Faire entrer les éléments naturels via peaux, branchages, etc.
Créez-vous une bibliothèque pleine d’étagères de livres bien épais.
Ajoutez de la vaisselle et des poteries.
Jouez sur les matières et les textures.
Chinez du mobilier vintage.
Multipliez couvertures douillettes et coussins moelleux.
6.3 - Le kit de secours hygge : les indispensables
Enfin, Meik Wiking termine le chapitre 4 du "Livre du hygge" en proposant 14 éléments à toujours avoir sous la main pour plonger instantanément dans une ambiance hygge.
"Vous pouvez vous préparer un kit de secours hygge à mettre de côté pour les soirs où vous êtes fatigué, n'avez rien de prévu et avez envie de rester tranquillement à la maison pour profiter d'un peu de temps pour vous. Faites-vous une boîte, un placard ou une valise remplie des indispensables du hygge."
À savoir :
Des bougies,
Du bon chocolat,
Notre thé préféré,
Un livre qu’on aime,
Un film ou une série qu’on adore regarder,
De la confiture,
Des chaussettes en laine,
D’anciennes lettres manuscrites que nous affectionnons,
Un pull chaud,
Un joli carnet,
Une belle couverture,
De la musique,
Un album photo,
Du papier et un stylo.
Chapitre 7 – Le hygge en dehors du foyer
7.1 - En pleine nature
Bien que la maison soit le cœur du hygge, il est tout à fait possible de vivre des moments hyggelig à l'extérieur, stipule Meik Wiking. Et ce le sera d’autant plus dans des lieux comme les chalets ou au contact de la nature.
Certains facteurs y favorisent le hygge, ajoute l’auteur :
La bonne compagnie,
La décontraction,
La proximité de la nature,
Le fait d'être pleinement dans l'instant présent.
"Le hygge est rempli de cette forte présence et de cet investissement dans l’expérience du moment présent et dans le plaisir qu’il procure" écrit l'auteur du "Livre du hygge".
En effet, passer du temps avec d'autres dans un cadre informel, se relaxer sans chichis, savourer la simplicité d'un paysage naturel, et se connecter au moment présent sont des leviers puissants pour faire naître le hygge, assure ici l’auteur.
Aussi, qu'il s'agisse d'un dîner au coin du feu lors d'un camping ou d'un coucher de soleil sur le pont d'un voilier, les expériences hyggelig ont pour point commun d'être vécues pleinement, sans distraction.
7.2 - Être dans l'instant présent
Ce passage du "Livre du hygge" reflète bien ce que peut être le hygge en dehors de la maison :
"Mes plus beaux souvenirs d’enfance tournent autour de ce petit chalet d’été que ma famille possédait à seulement dix kilomètres de la ville, et où nous restions de mai à septembre. À cette période de l’année, quand même la nuit ne connaît pas l’obscurité, mon frère et moi profitions de ces journées d’été sans fin.
Nous grimpions dans les arbres, attrapions des poissons, jouions au football, faisions du vélo, explorions des tunnels, dormions dans des cabanes dans les arbres, nous cachions sous les bateaux sur la plage, construisions des barrages et des châteaux forts, tirions à l’arc, et partions en forêt chercher des baies et l’or caché des nazis."
Meik Wiking poursuit :
"Le chalet ne faisait que le tiers de la surface de notre maison en ville, les meubles étaient vieillots, la télé en noir et blanc avait un écran 35 cm et une antenne assez capricieuse. Mais c’est bien là que nous vivions le plus de hygge. À bien des égards, j’ai connu alors mes moments les plus heureux, et les plus hyggelige. C’est sans doute parce que, de façon générale, le chalet comprenait tous les facteurs du hygge : les odeurs, les bruits et la simplicité.
Quand on habite dans un chalet, on est plus proche de la nature et de l’autre. Un chalet oblige à vivre plus simplement et plus lentement. À sortir. À être ensemble. À profiter de l’instant présent."
7.3 - Le hygge pendant les heures de travail
Les Danois estiment que le hygge a aussi sa place au bureau.
"Le Livre du hygge" partage alors quelques conseils pour introduire plus de hygge au travail.
Par exemple : multipliez les pauses gâteaux, favorisez un environnement décontracté plutôt que formel, apportez des bougies, installez des canapés pour lire ou tenir des réunions informelles. L’auteur lui-même préfère mener ses interviews installé confortablement dans un canapé plutôt qu'assis de façon guindée de part et d'autre d'une table, confie-t-il.
Chapitre 8 – Du hygge toute l’année
Dans le chapitre 8 de son ouvrage "Le Livre du hygge", Meik Wiking explique que même si le hygge est surtout associé à Noël au Danemark, il est, en fait, possible de cultiver cette atmosphère conviviale tout au long de l'année.
Voici quelques-unes des suggestions qu’il conseille pour cela :
Janvier : proposer une soirée cinéma à la maison entre amis, chacun apportant à grignoter.
Février : partir au ski en groupe et profiter de moments de détente hyggelig ensemble au chalet.
Mars : préparer nos futures vacances en explorant le pays de destination choisi (cuisine, musique, langue...).
Avril : faire une randonnée avec nuit à la belle étoile et repas au coin du feu.
Mai : initier la saison des barbecues hyggelig en se concoctant un week-end à la campagne.
Juin : cueillir des fleurs de sureau pour en faire une limonade parfumée rappelant l'été, et célébrer la Saint-Jean.
Juillet : organiser un grand pique-nique estival avec voisins et amis.
Août : observer la pluie de météores des Perséides, couché dans l'herbe.
Septembre : ramasser des champignons en forêt en famille ou entre amis (accompagné d'un expert si besoin pour éviter tout risque d'intoxication).
Octobre : cueillir des châtaignes avec les enfants pour fabriquer des figurines, ou les déguster grillées, accompagnées de mandarines et d'un bon livre.
Novembre : organiser un concours de soupes entre amis ou en famille, chacun apportant des ingrédients pour concocter une soupe originale que tous pourront goûter.
Décembre : préparer du gløgg (vin chaud épicé) et des æbleskiver (petites crêpes en forme de chou) pour un après-midi ou une soirée hyggelig avec ses proches.
Chapitre 9 – Le hygge sans se ruiner
9.1 – Les meilleures choses dans la vie sont gratuites
Le chapitre 9 du "Livre du hygge" rappelle que le hygge est fait de choses simples, modestes et peu coûteuses. Les expériences de luxe comme le champagne et les huîtres, par exemple, sont à l'opposé de cet esprit.
"Le hygge est humble et lent. C’est choisir le rustique au lieu du neuf, le simple au lieu du raffiné, et l’ambiance plutôt que l’excitation. De manière générale, le hygge est la version danoise d’un mode de vie lent et simple. Le hygge, c’est regarder Le Seigneur des Anneaux en pyjama la veille de Noël, c’est s’asseoir sur le rebord de la fenêtre et regarder le ciel dehors, en savourant une tasse de son thé préféré, c’est regarder le feu de joie d’un solstice d’été, entouré de ses amis et sa famille, pendant que votre baguette enroulée cuit lentement."
Meik Wiking explique aussi, études à l'appui, que le bonheur dépend plus de la qualité des relations sociales que du niveau de revenus. De même, le hygge repose sur le partage d'un moment de bien-être, non sur l'argent dépensé.
L'auteur cite ensuite un poème danois sur notre capacité à apprécier les plaisirs simples de l'existence. Cet état d'esprit correspond, selon lui, à la philosophie du hygge.
9.2 – Dix activités "hygge" avec un petit budget
Meik Wiking propose enfin 10 activités permettant de cultiver une atmosphère hygge avec un petit budget :
Jouer à des jeux de société.
Faire une petite fête en cuisine.
Organiser des soirées télé entre amis.
Créer une mini-bibliothèque dans son immeuble ou son quartier.
Jouer à la pétanque.
Faire un feu de camp.
Aller à des séances de cinéma en plein air.
Organiser une fête de troc d'objets.
Faire de la luge.
Jouer pour le simple plaisir de jouer.
L'auteur conclut qu'oublier un peu le sérieux de l'âge adulte pour retrouver son âme d'enfant est une des clés du hygge.
Chapitre 10 – Visite guidée "Hygge de Copenhague"
Dans ce chapitre du "Livre du hygge", Meik Wiking propose quelques lieux emblématiques de Copenhague pour vivre l'esprit hygge lors d'un séjour dans la capitale danoise.
Il suggère notamment de flâner dans le quartier pittoresque de Nyhavn, de s'offrir des douceurs dans la plus ancienne pâtisserie du pays "La Glace", ou encore d'arpenter les allées du parc Tivoli sous les lumières de Noël.
Faire une balade en barque dans les canaux de Christianshavn, déambuler dans les ruelles historiques telles que Gråbrødre Torv ou Værnedamsvej, et déguster des tartines à la danoise dans un restaurant typique sont quelques-unes des autres expériences hyggelig proposées.
Ainsi, en suivant ce mini-guide, le visiteur pourra facilement découvrir certains des endroits les plus propices pour saisir l'esprit du hygge à Copenhague.
Chapitre 11 – Noël
11.1 – Noël, la période la plus hyggelig de l’année
La période de Noël est considérée par les Danois comme la plus propice pour cultiver l'atmosphère hygge, souligne Meik Wiking. Ils utilisent d'ailleurs, pour en parler, un mot composé spécifique : le "julehygge", qui veut dire "hygge de Noël". Pour eux, si le hygge n'est pas au rendez-vous à Noël, la fête est ruinée !
11.2 - La famille et les amis
L’auteur du "Livre du hygge" explique ensuite que réunir ses proches pour partager un moment privilégié est la base d'un Noël réussi. C’est le cas aussi ailleurs, indique-t-il, mais seuls les Danois diront "c'est hyggelig !" pour savourer pleinement cet instant.
11.3 - Les traditions
Ensuite, Meik Wiking partage certains rituels typiques et selon lui, indispensables au hygge de Noël. Il évoque alors la préparation de plats traditionnels danois très caloriques dont l’élément principal est la viande (rôti de porc ou canard).
Il décrit aussi ce qu’est le "délicieux risalamande", un dessert de crème fouettée et de riz cuit, recouvert d’amandes effilées et de coulis de cerises chaud. Servi dans un grand saladier, on y dissimule une amande entière :
"Celui qui la trouve dans son bol gagne un cadeau […] Le but pour celui qui a trouvé l’amande est de la cacher et de nier l’avoir trouvée afin de tromper les autres et de les pousser à manger tout le contenu de leur bol : cela se transforme en un championnat de dégustation un peu tordu."
11.4 - Les décorations
"Aucun Noël hyggelig n’est vraiment complet sans ses décorations" fait remarquer l’auteur.
Il s’agit d’un riche décor intégrant, entre autres, les fameuses figurines de nisse (elfe ou gnome) et "cœurs tressés" en papier brillant.
Mais aussi, bien entendu, des bougies…
Une version spécifiquement danoise de la bougie de Noël est la bougie de l’Avent :
"Décorée comme une toise murale avec les dates allant du 1er au 24 décembre, de haut en bas. Chaque jour, le bout de bougie correspondant à la journée est brûlé et fond. Néanmoins, personne n’allume ce calendrier tout seul. On fait plutôt cela soit le matin, à l’heure où les parents essaient désespérément de préparer tout le monde pour l’école et le travail, soit le soir, quand la nuit s’est installée et que toute la famille est attablée pour le dîner. Cette lumière en forme de calendrier est littéralement le centre de la famille. Naturellement, tout le monde se rassemble autour d’elle, le temps qu’elle brûle. Et puis, elle nourrit l’obsession danoise du compte à rebours jusqu’à Noël."
11.5 - Le compte à rebours jusqu'au hygge
Cette partie du "Livre du hygge" nous fait ensuite découvrir différents objets qui ponctuent l'attente fébrile de Noël et entretiennent le hygge : la bougie de l’Avent, le calendrier de l'Avent, les petites cases à ouvrir chaque jour ou encore des programmes télévisés rituels pour enfants (qui proposent une activité hyggelig chaque jour ou une petite histoire de Noël).
11.6 – Les préparatifs pour mieux profiter du hygge à Noël
Paradoxalement, confie l’auteur, tous les préparatifs plutôt stressants d’avant Noël sont nécessaires. Car grâce à eux, nous pourrons, ensuite, mieux savourer l'atmosphère apaisée du hygge, poursuit Meik Wiking.
Aussi, pour les adeptes du hygge, Noël doit permettre de faire une pause dans les tracas du quotidien. L'esprit se veut alors resté égalitaire, sans démonstration de pouvoir.
Enfin, l'auteur termine ce chapitre du "Livre du hygge" en partageant :
La recette d’une douceur traditionnellement consommée à Noël au Danemark : les "æbleskiver", sorte de crêpes.
Un tuto pour fabriquer les "cœurs tressés" en papiers décoratifs pliés, une coutume devenue populaire notamment parce qu’elle participe à la motricité fine des enfants.
Chapitre 12 – Le hygge estival
Au chapitre 12, l'auteur du "Livre du hygge" décrit comment le hygge a aussi sa place en été. Certes sans cheminée ni plaid. Mais il prend alors d'autres formes tout aussi conviviales et simples.
Voici 5 idées partagées par l’auteur du "Livre du hygge" :
Le verger : une cueillette de fruits entre amis fait partie des activités "hyggelig" par excellence. On peut ensuite transformer ses récoltes en confitures ou autres préparations.
Le barbecue avec ses proches : réunir sa famille et/ou ses amis autour de grillades est un classique estival, propice au partage d'instant précieux.
Les jardins partagés : s'occuper d'un potager collectif permet de se rassembler avec des voisins dans une ambiance villageoise au cœur de la ville. C'est à la fois hyggelig et créateur de lien social.
Les pique-niques sur la plage : partir en balade à la mer avec un panier garni de victuailles est une façon simple et agréable de passer du temps de qualité ensemble.
Les balades en vélo cargo : se promener en ville sur un vélo équipé d'une remorque, entre amis ou en couple, rend n'importe quelle virée ludique avec son lot de moments privilégiés.
L'auteur termine en abordant les bienfaits du vélo sur le bonheur et le bien-être collectif. Il présente différentes études montrant que l'usage du deux-roues pour les trajets quotidiens est bon pour la santé et favorise le lien social.
Chapitre 13 – Les 5 dimensions du hygge
Dans l’avant-dernier chapitre du "Livre du hygge", Meik Wiking explore le hygge à travers nos sens.
Le goût du hygge
Les saveurs associées au hygge sont familières, douces et réconfortantes : miel, chocolat, crème, vin... En fait, tout ingrédient accentuant le côté douillet d'un plat ou d'une boisson les rend plus hyggelig.
Le son du hygge
Le crépitement d'un feu de cheminée est probablement le son le plus typique du hygge. Plus largement, les bruits apaisants d'un environnement sécurisant en sont la bande originale : bruissement du vent et de la pluie, craquement du plancher...
L'odeur du hygge
Les senteurs rappelant la sécurité et le réconfort, souvent teintées de nostalgie, sont propices au hygge. Elles invitent, en effet, à lâcher prise, souffle l’auteur. Et chacun y associera ses propres expériences personnelles.
Les sensations tactiles du hygge
Toucher du bois, de la laine, de la céramique... est plus hyggelig que le contact avec des matières modernes comme l'acier ou le verre. De même, les petits objets artisanaux ont plus de potentiel hygge que des créations industrielles, poursuit Meik Wiking.
Voir le hygge
Visuellement, le hygge s'incarne dans des mouvements lents, des lumières tamisées, des couleurs naturelles. Toute silhouette trop graphique ou aseptisée lui est étrangère.
Le sixième sens du hygge
Au-delà des sens, le hygge se ressent dans la confiance et le bien-être procurés par un moment. L'auteur conclut qu'au fond, il s'apparente au bonheur.
Chapitre 14 – Le hygge et le bonheur
14.1 - Les heureux Danois
Dans ce dernier chapitre du "Livre du hygge", Meik Wiking rappelle que le Danemark arrive systématiquement dans les premiers des classements internationaux sur le bonheur.
Il expose alors les raisons pour lesquelles le pays se situe au premier rang : l'État providence qui réduit les sources de stress, un bon équilibre vie privée/vie professionnelle, la confiance interpersonnelle...
Mais il souligne qu’en encourageant le bien-être au quotidien, le hygge jouerait aussi un rôle non négligeable dans ce phénomène.
Et ce, grâce à au moins 3 constats…
14.2 - Le hygge est facteur de tissu social
De nombreuses études placent la qualité des relations sociales comme premier facteur de bonheur. Or, la culture du hygge pousse les Danois à accorder beaucoup de temps à leurs proches pour tisser des liens solides.
14.3 - L’appréciation et gratitude sont des éléments piliers du hygge
Le hygge apprend à savourer l'instant présent et les plaisirs simples.
Or, la recherche montre que la gratitude envers ces petits plaisirs de l'existence accroît le bien-être. De plus, se remémorer des moments hyggelig génère de la nostalgie positive, soutient l’auteur.
14.4 - Le hygge favorise le bonheur au quotidien
Meik Wiking nous parle ensuite de son travail. Il se questionne et évoque le scepticisme de certaines personnes à l’idée qu’on puisse mesurer le bonheur.
Au cours de cette réflexion, il distingue trois dimensions du bonheur qui s’entremêlent :
La satisfaction qu’on a de la vie d’une façon générale,
La dimension affective ou hédonique : autrement dit, les émotions positives que l’on ressent au quotidien,
Le sentiment que notre existence a un sens.
Selon l’auteur, le hygge stimulerait surtout la deuxième : ainsi, en permettant de goûter le bien-être au quotidien, il devient un moteur durable de bonheur.
Il écrit :
"En faisant des recherches pour écrire ce livre, je me suis aperçu que le hygge peut devenir un moteur du bonheur dans la vie quotidienne. Le hygge nous donne les mots, l’objectif et les méthodes pour prévoir et préserver le bonheur – et pour en vivre un peu chaque jour. Le hygge est peut-être ce qui se rapproche le plus du bonheur quand nous rentrons à la maison après une longue journée de travail, un jour pluvieux de janvier."
Et, soyons-en bien conscients, c’est là que la plus grande partie de nos vies se joue. Pas les jours pluvieux de janvier, non, mais chaque jour. Une fois par an – ou plus, si nous avons de la chance – nous pouvons nous retrouver sur une plage dans un pays exotique, et nous pourrions tout à fait éprouver hygge et bonheur dans ces contrées lointaines. Mais le hygge, c’est tirer le meilleur de ce que nous avons en abondance : le quotidien. C’est peut-être Benjamin Franklin qui en parle le mieux : "Le bonheur n’est pas tant le produit des grands coups de bonne fortune qui arrivent rarement, que celui des petits avantages et plaisirs qui ont lieu tous les jours"."
Conclusion de "Le Livre du hygge" de Meik Wiking
Les idées clés du "Livre du hygge" de Meik Wiking
Au fil des chapitres de son ouvrage "Le Livre du hygge", Meik Wiking a exploré les multiples facettes du concept danois du "hygge" et nous a livré de précieux conseils pour l'intégrer dans notre quotidien.
Voici les 3 idées clés à retenir :
Le hygge est une atmosphère chaleureuse propice au bien-être
Le hygge se définit avant tout comme une ambiance, un état d'esprit tourné vers la convivialité, le partage et la douceur de vivre. Il s'agit de créer un cocon de bien-être où l'on se sent en sécurité, entouré de ses proches.
Le hygge fait appel à tous nos sens : la lumière tamisée des bougies, le crépitement du feu de cheminée, le goût réconfortant d'un plat mijoté, l'odeur de gâteau qui embaume la maison, la sensation d'un plaid douillet.
Le hygge comme art de vivre au quotidien, facteur de bonheur durable
Plus qu'un simple concept, le hygge est un véritable art de vivre qui encourage à prendre le temps d'apprécier les petits plaisirs du quotidien. Partager un moment de qualité avec ses proches, savourer sa tasse de thé au coin du feu, se promener dans la nature, cuisiner un gâteau...
Le hygge nous invite aussi à cultiver la gratitude et la pleine conscience. D'ailleurs, Meik Wiking explique que cette capacité à ressentir du bien-être dans les gestes simples de tous les jours serait l'une des clés du bonheur durable des Danois.
Le hygge, un état d'esprit à adopter tout au long de l'année
Si le hygge est souvent associé à l'hiver et aux fêtes de Noël, Meik Wiking souligne qu'il peut se vivre à chaque saison. Cueillette de fruits entre amis, dîner au coin du feu lors d'un camping, séance de cinéma en plein air, atelier cuisine... L'auteur multiplie les suggestions d'activités accessibles pour insuffler une dose de hygge chaque mois. Le secret ? Favoriser les plaisirs simples, le partage et la convivialité.
Que vous apportera la lecture "Le Livre du hygge" de Meik Wiking ?
En refermant "Le Livre du hygge", vous aurez toutes les clés en main pour développer votre propre art de vivre "hygge".
Grâce aux conseils de Meik Wiking, vous saurez comment créer une atmosphère chaleureuse et réconfortante chez vous. Vous aurez aussi plein d'idées d'activités propices aux liens et à la déconnexion. Surtout, vous réaliserez que le bonheur se niche dans une multitude de petits gestes simples à portée de tous.
Le "Livre du hygge" est un livre que je recommande à ceux et celles qui sont en quête d’inspiration pour adopter un mode de vie plus serein, convivial et porteur de sens. Agréablement illustré d’images et de dessins hygge, cette lecture est une véritable bouffée de douceur et de bien-être. Nul doute qu'il vous donnera envie d'allumer quelques bougies, de servir une tasse de thé fumante et de prendre le temps d'un moment "hygge"...
Points forts :
C'est un beau livre, joliment illustré.
Un concept très inspirant pour développer son bien-être au quotidien.
Les conseils pratiques et accessibles pour créer une atmosphère "hygge".
De nombreuses anecdotes agréables à lire.
Point faible :
Certains conseils pourraient paraître évidents ou superficiels pour certains lecteurs.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu "Le Livre du hygge"? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Meik Wiking "Le livre du hygge"
Visitez Amazon afin d'acheter le livre de Meik Wiking "Le Livre du hygge"
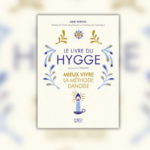 ]]>
]]>Résumé de "Le grand saut" de Gay Hendricks : ce psychologue vous montre comment retrouver un surplus de confiance en vous et découvrir que tout ce que vous voulez entreprendre est réellement possible — un best-seller du New York Time lors de sa sortie aux États-Unis.
Gay Hendricks, 2010, 284 pages.
Titre original : The Big Leap (2009).
Chronique et résumé de "Le grand saut" de Gay Hendricks
Introduction - Supprimez le dernier obstacle à la réussite ultime en amour, au travail et en santé
Le seul problème qui vous retient
Pour Gay Hendricks, ce problème a un nom : c'est le problème de la limite supérieure. Lorsque vous êtes déjà une personne motivée et avec du succès, il se peut que vous perdiez confiance au moment d'atteindre vos objectifs ultimes. Ou que vous les pensiez impossibles.
C'est ça, le problème de la limite supérieure : la difficulté à "franchir les derniers kilomètres". Pour le résoudre, une chose est à accomplir : apprendre à apprendre ou, si vous voulez, être ouvert à l'apprentissage. Telles sont la question et la thèse principales de l'auteur.
Comment atteindre votre zone de génie ? Telle est une autre formulation de cette même interrogation. Cela dit, pour être heureux, il ne suffit pas de réussir dans les affaires. L'important est de parvenir au meilleur de soi-même dans tous les domaines de l'existence.
Pour vous aider à réaliser ce potentiel que vous sentez en vous, Gay Hendricks choisit de s'adresser à vous simplement et directement, à partir de sa propre expérience personnelle et comme thérapeute.
Le moment de la découverte
L'auteur raconte comment lui est venue l'idée principale de sa méthode. C'est alors qu'il s'inquiétait inutilement pour sa fille (qui était en sécurité dans un camp de vacances) qu'il a pris conscience que son inquiétude était générée à cause de bien-être antérieur. Comment ? Cela mérite une explication !
"Une partie de moi craignait de jouir d'une énergie positive pour une période prolongée de temps. Lorsque j'atteignais ma limite supérieure, quant à la quantité de sentiments positifs que je pouvais gérer, je créais une série de pensées désagréables pour me dégonfler." (Le grand saut, Introduction)
Ce schéma fonctionne dans tous les domaines :
Vous mangez sainement puis vous "craquez" ;
Ou bien vous vous disputez après une période de couple harmonieuse ;
Etc.
Les pensées ou attitudes négatives seraient donc un moyen — mis en place de façon inconsciente ou presque inconsciente — pour stopper net une avancée positive. Pourquoi ? Car, ainsi, nous restons dans notre zone de confort, c'est-à-dire dans ce que nous connaissons déjà.
D'où une première question pratique : "Comment puis-je augmenter les périodes de contentement dans ma vie ?" Suivie de trois autres :
"Si je peux éliminer les comportements qui interrompent le flot d'énergie positive, puis-je apprendre comment me sentir bien tout le temps ?
"Puis-je permettre aux choses d'aller bien dans ma vie en tout temps ? Dans mes relations, puis-je vivre en harmonie et en intimité tout le temps ?"
" Notre espèce peut-elle vivre des périodes plus longues de paix et de prospérité, libres du schéma où nous chamboulons tout lorsque les choses vont bien ? » (Le grand saut, Introduction)
Chapitre 1 - Vous préparer pour le grand saut
Comment commencer
Dans ce chapitre, tout l'enjeu consiste à identifier le problème et la façon de le résoudre. Commencez par vous demander si vous êtes prêt à être mieux au quotidien. Cela peut paraître stupide (tout le monde a envie de répondre "oui !"), mais ne l'est pas.
"Se sentir bien", pour Gay Hendricks, c'est avant tout ressentir un "sentiment profond et naturel de bien-être qui ne dépend pas de facteurs extérieurs".
Prenez un peu de temps chaque jour pour rechercher ce sentiment. Puis, vous pourriez progressivement vous demander si vous voulez étendre ce bien-être à votre "vie tout entière" (dans tous les aspects de votre existence) et, finalement, si vous voulez vous sentir bien absolument "tout le temps".
Ici encore, la réponse évidente semble être positive. Mais quand nous y pensons un peu, nous voyons qu'en fait, nous nous mettons des bâtons dans les roues ou, plutôt, nous nous imposons des limites. Or, celles-ci n'ont pas lieu d'être ; elles sont simplement issues de croyances restrictives et erronées.
En fait, répondre par oui à ces questions est un acte courageux. Il vous prépare au "grand saut" !
Le grand saut de Maynard
Maynard Webb est l'une des personnes qui ont permis à la plateforme eBay de connaître un grand succès dans les années 2000-2010. Dans cette compagnie, il était dans sa zone d'excellence, selon Gay Hendricks, mais pas dans sa zone de génie. Il pouvait — et souhaitait — faire mieux.
Il s'est finalement décidé à entrer dans une autre compagnie et a connu un succès retentissant.
Autre exemple. Le Dr Jordan a lui reculé au dernier moment, lorsqu'une grande entreprise a voulu racheter sa petite compagnie. Il a tellement créé de difficultés que les acheteurs se sont enfuis. Mais cela lui a permis d'apprendre la leçon et il est devenu un adepte du grand saut.
Vous concentrer sur vous-même
"Une fois que vous vous engagez à vivre votre plein potentiel, votre ego est soudainement menacé d'extinction. Il a fabriqué des excuses pour vous tout le long de votre vie. Si votre engagement à faire votre grand saut est sincère, vous devrez montrer la porte à votre ego. Mais à moins que vous ayez de la chance, votre ego ne partira pas calmement. Il a toute une carrière derrière lui." (Le grand saut, Chapitre 1)
Que veut dire ce passage ? Eh bien que nous nous faisons un cinéma intérieur et que le projectionniste n'est autre que notre ego, qui cherche à nous protéger contre une perte d'estime de nous-même en préférant se bercer d'illusions.
Le chemin à parcourir
En fait, c'est de la peur. La peur est ce brouillard qui vous empêche d'avancer et de trouver votre chemin hors de votre zone de confort (le cinéma intérieur). Pourtant, la crainte peut être maîtrisée et mise à profit comme un carburant. À condition de "respirer".
En fait, la peur est de l'excitation "sclérosée".
Pour lui redonner vie, il faut respirer, c'est-à-dire prendre concrètement des bouffées d'air pour donner de l'espace à cette émotion et la contrôler. C'est ce que font de nombreux acteurs et actrices quand ils ont le trac, par exemple !
Si votre envie d'atteindre votre zone de génie est sincère, la méthode qui sera exposée dans les lignes qui suivent vous sera d'un secours précieux.
Comment fonctionne le problème de la limite supérieure
Selon l'auteur, nous sommes dotés d'un "thermostat" qui nous indique les limites d'amour, de réussite professionnelle, etc. que nous pouvons tolérer. Ces mesures ont été arrêtées, pour la plupart, dans l'enfance. Autrement dit, nous avons appris à limiter les hausses "dangereuses" du thermostat.
La culpabilité joue un rôle particulièrement important dans ce processus :
"La culpabilité est un moyen dont dispose notre esprit pour presser douloureusement sur le conduit où circulent nos sentiments positifs." (Le grand saut, Chapitre 1)
Une idée radicale
Pour Gay Hendricks, tout l'enjeu consiste à dissiper ces sentiments négatifs en prenant appui sur la réserve de bien-être intérieur que nous pouvons retrouver à chaque instant en nous.
Souvent, nous pensons que, pour être heureux, vous devez avoir réussi, être en bonne santé, etc., c'est l'inverse qui est vrai. Retrouvez cette source de bien-être et faites-la grandir progressivement : c'est là que vous serez en bonne voie pour vous accomplir dans tous les domaines !
Cette idée est radicale car elle s'oppose à ce qui est communément cru. Vous n'avez besoin de rien pour commencer à être heureux, sinon d'une pensée positive qui vous aide au quotidien dans vos réalisations.
Apprenons à ne pas saboter notre capacité à vivre mieux en "enclenchant le commutateur de la limite supérieure", c'est-à-dire en nous créant des problèmes inutiles (et parfois graves). Trouvons le moyen de retrouver notre énergie positive.
Le thermostat de la limite supérieure des personnes à succès
Gay Hendricks prend plusieurs exemples de personnalités qui achoppent au moment même où ils réussissent. Certains, en effet, se "tirent une balle dans le pied" parce qu'ils ne supportent pas avoir autant de succès. L'auteur prend les exemples de :
Christian Bale ;
John Belushi ;
Bill Clinton.
Il montre aussi comment la chanteuse Bonnie Raitt est parvenue à entrer dans sa zone de génie et à accomplir ses plus grands espoirs musicaux.
Résoudre un problème et vous libérer
"Par sa nature, le problème de la limite supérieur est impossible à résoudre dans votre état de conscience ordinaire. Si cette résolution avait été possible, il y a déjà longtemps que vous l'auriez faite. Le problème de la limite supérieure ne se résout que par un bon dans la conscience." (Le grand saut, Chapitre 1)
Impossible, ici, de recueillir des informations, puis de faire le choix adéquat. Il faut purement et simplement "dissoudre" le problème, en une seule fois.
Pour bien faire comprendre de quoi il s'agit, le psychologue rappelle les quatre "zones" d'interaction efficace avec le monde :
Incompétence (nous ne savons pas comment agir) ;
Compétence (nous pouvons résoudre des problèmes donnés) ;
Excellence (nous avons la maîtrise de notre environnement et sommes reconnus pour notre travail) ;
Génie (nous créons sans aucune difficulté et c'est notre don qui est mis en avant).
Souvent, c’est autour de 40 ans que notre « génie naturel » nous envoie des alarmes pour se rappeler à nous. Nous avons souvent évolué en faisant taire les petites voix qui nous appelaient, mais celles-ci se font de plus en plus pressantes.
Chapitre 2 - Faire le saut
Souvent, les problèmes et les réussites s'emmêlent. Une réussite dans la sphère du travail peut vous procurer un problème côté "cœur". Et vice-versa : les gâchis dans un domaine se répercutent ou peuvent se répercuter dans un autre.
Le déclenchement du problème de la limite supérieure
Selon Gay Hendricks, il y a quatre croyances limitantes qui nous empêchent d'accéder à notre plein potentiel. La plupart du temps, après un effort, nous sommes capables d'en reconnaître au moins deux ou trois. Il est plus rare d'arriver à quatre.
Avant de les présenter, l'auteur montre que ces barrières intérieures se manifestent sous la forme de mantras négatifs du type :
"Je ne peux développer mon plein potentiel parce que (...)" ;
"Je suis incapable de vivre des relations sereines parce que (...) ;
Etc.
Barrière cachée numéro 1 : se sentir fondamentalement imparfait
Souvent, nous pensons que quelque chose manque en nous. Ce défaut nous empêcherait d'atteindre nos objectifs professionnels ou de développer notre créativité, par exemple. Mais est-ce si sûr ?
Si vous réussissez, alors vous entrez en contradiction avec ce mantra négatif. Il y a "dissonance cognitive", c'est-à-dire conflit intérieur entre vos valeurs ou croyances (limitantes) et vos actions (réussite).
Pour résoudre cette tension intérieure, votre thermostat cherche à se remettre à la normale et à évacuer la réussite gênante par un nouveau problème ! Mais il y a une autre voie : vous pouvez mettre fin à cette croyance fausse et limitante, que l'auteur compare à un "bug" de notre cerveau.
Barrière cachée numéro 2 : déloyauté et abandon
Une autre façon de s'interdire de faire les choses est de considérer que vous souffrirez d'abandon ("je serai seul") ou que vous trahirez vos origines ("je ne peux pas lui/leur faire ça") en cas de réussite.
Souvent, vous vous inquiétez pour votre famille (vos parents). "Vais-je réussir à combler les attentes de mes proches ?" Telle est l'une des questions que vous vous posez. Vous vous sentez coupable et n'osez pas avancer.
Souvent, une bonne conversation permet de mettre les choses à plat et d'éteindre ces peurs inutiles. Celle-ci demande du courage, mais vous soulage d'un poids immense ensuite. L'auteur donne l'exemple d'un couple nouvellement marié qui a dû en passer par là pour vivre pleinement la relation.
Barrière cachée numéro 3 : croire qu'un plus grand succès entraîne un plus grand fardeau
Vous pouvez penser que vous serez un plus grand fardeau pour vous-même ou pour les autres si vous réussissez. Ce type de croyance peut vous poser problème depuis votre plus jeune âge, selon les messages que votre entourage familial vous a transmis inconsciemment ou implicitement.
Gay Hendricks raconte une histoire liée à sa propre enfance. Selon lui, sa mère et son frère l'ont toujours vu comme un fardeau, alors qu'il était une bénédiction pour ses grands-parents. Heureusement, il a fini par le comprendre et à voir que sa culpabilité reposait sur une faute imaginaire.
Barrière cachée numéro 4 : le crime d'éclipser les autres
Parfois, nous nous sentons retenu dans nos actions par la peur de faire du tort aux autres — souvent un proche. Nous ne voulons pas qu'il se sente exclu ou éclipsé par nos réussites. C'est un phénomène qui se produit régulièrement avec les enfants doués et talentueux.
Demandez-vous si vous avez peur d'éclipser quelqu'un en exprimant qui vous êtes et ce que vous faites de mieux. Peut-être que la dissolution de votre limite supérieure est liée à cet interdit qui vous a été imposé un jour…
Aller de l'avant
Ces 4 barrières cachées forment des mantras négatifs qui, répétés au fil des jours, peuvent vous limiter considérablement. Apprenez à les repérer par une réflexion honnête ; peut-être aussi à l'occasion de discussions avec des proches ou des professionnels de psychologie.
Une fois identifiés, vous serez capable d'aller de l'avant… C'est-à-dire de faire le grand saut !
Chapitre 3 - Pour être plus précis
Voyons maintenant de façon plus précise comment détecter le problème de la limite supérieure dans la vie quotidienne. Autrement dit, entrons dans encore plus de détails ; cette enquête nous aidera à nous préparer au changement.
Modèles typiques où nous atteignons notre limite supérieure
Voici les cinq modèles typiques de limite supérieure que Gay Henricks développe dans ce chapitre :
L'inquiétude ;
Le blâme et la critique ;
La "déviation" ;
Les disputes ;
Le fait de tomber malade ou de se blesser.
- L'inquiétude
Pourquoi survient l'inquiétude ? Souvent, elle survient… pour rien, c'est-à-dire pour rien d'important. Elle est alors la manifestation évidente de notre limite intérieure. Bien sûr, il y a des inquiétudes légitimes, mais elles ne sont pas en cause ici. Pour dissocier l'une de l'autre, demandez-vous :
Si elle est liée à une possibilité réelle (et non imaginée) ;
S'il y a quelque chose que vous pouvez mettre en œuvre ici et maintenant pour créer une différence positive (pour résoudre le problème).
Si ce n'est pas le cas, alors c'est sans doute que l'inquiétude ne mérite pas toute cette énergie mentale de votre part. L'auteur prévient qu'il n'est pas si aisé de se déprendre de ses inquiétudes inutiles. En quelque sorte, nous y tenons. Le psychologue donne néanmoins un plan en 7 étapes pour parvenir à la maîtriser (voir pages 98-99).
- La critique et le blâme
Souvent, la critique a aussi peu avoir avec la réalité que l'anxiété.
"En d'autres termes, lorsque nous critiquons quelque chose, cela n'a habituellement rien à voir avec la chose que nous critiquons. Quand nous blâmons quelqu'un — ou quelque chose — nous le faisons parce que nous avons atteint notre limite supérieure et que nous essayons de retarder le flot d'énergie positive." (Le grand saut, Chapitre 3)
Souvent, nous sommes accro au blâme et à la critique. Nous nous en prenons à l'autre (ou aux choses ou aux autres de façon générale) de façon répétée et, en fait, nous ne pouvons nous arrêter. Faites l'expérience : cessez de critiquer ou blâmer pendant une journée et voyez si vous avez des difficultés.
Il en va de même lorsque vous vous critiquez vous-même. C'est le même processus. Souvenez-vous : la critique et le blâme ne visent jamais à parvenir à des résultats tangibles. Ils ont juste pour objet de vous mettre des bâtons dans les roues.
Apprenez donc à vous observer très attentivement pour reconnaître les moments où vous jouez le rôle du critique et de l'accusateur. Ici encore, apprenez à trier entre celles qui sont véritablement méritées et demandent une action concrète ici et maintenant — puis celles qui sont véritablement inefficaces et destructrices.
- La déviation
"Faire dévier" signifie ici minimiser ou se refuser à profiter de l'énergie positive qui émane de nos actions. Concrètement, vous refusez par exemple de recevoir une critique positive ou un compliment sur votre travail.
Ce faisant, vous ne pouvez mettre en place une véritable scène de reconnaissance, où chacun des interlocuteurs estime l'autre. C'est dommage, puisque cela nuit à votre propre énergie. Nous restons dans notre zone de compétence, peut-être, mais nous refusons l'excellence et le génie.
Dans ce cas-ci, apprenez à distinguer la louange honnête et méritée (de la flatterie sans intérêt) et à la recevoir comme il se doit. De cette façon, vous vous mettrez au défi d'aller encore plus loin !
- Les disputes
Gay Hendricks aborde la question à la fois sur le plan personnel du couple et sur celui, international, des conflits entre pays ou confessions religieuses et politiques. Selon lui, c'est à chaque fois le même scénario : quelqu'un revendique le statut de victime et veut rendre l'autre partie responsable.
Comment sortir de ces engrenages ? En affirmant à 100 % sa propre responsabilité à la fois dans la création du conflit et dans sa volonté à le résoudre. Chacun, bien sûr, doit s'engager de la même façon. En fait, il n'y a pas 100 % à diviser, mais 100 % à additionner de part et d'autre !
- Blessures et maladies
Gay Hendricks affirme que certaines — pas toutes, bien sûr ! — affections ou accidents peuvent survenir de façon à créer un problème de limite supérieure. Et, dans tous les cas, cela ne doit pas vous empêcher de le traiter avec des médecins compétents.
Simplement, demandez-vous si ce problème de santé survient à un moment particulièrement "inadéquat", lorsque vous venez tout juste de réussir quelque chose ou que vous vous apprêtiez à faire le grand saut, par exemple.
Pour savoir si vos douleurs peuvent être liées à un problème de limite supérieure, utilisez la technique suivante.
Les trois P
Que sont les trois P ? Ils sont comme une carte. Les trois P signifient :
Punition ;
Prévention ;
Protection.
La punition peut survenir lorsque vous faites quelque chose manière irrationnelle et que votre corps vous "punit" pour vous signaler un souci. L'auteur prend l'exemple d'une personne ayant des migraines affreuses après des ébats amoureux hors mariage.
Selon Gay Hendricks, voilà un signe que cette personne se châtie de son comportement irrationnel et ne s'autorise pas, en fin de compte, d'explorer sa zone de génie. Solution ? Reconnaître que les "sensations délicieuses" qu'il expérimente avec sa maîtresse pourraient être libérées de façon plus saine, sans tricher.
Quant à la prévention et la protection, elles surviennent souvent ensemble. Ce peut être dû à une tentative de votre corps et de votre subconscient de vous éviter de faire quelque chose que vous n'avez pas totalement (ou du tout, en fait) envie de faire.
Atteinte à l'intégrité
"Poser une atteinte à votre intégrité est l'un des moyens les plus rapides pour vous rabaisser après une excursion au-delà de votre limite supérieure. Les atteintes à l'intégrité les plus répandues sont les mensonges, le non-respect d'un accord, et les vérités cachées." (Le grand saut, Chapitre 3)
Nous sommes souvent des experts au petit jeu de nous cacher ce que nous pensons vraiment. Nous évitons d'être honnêtes avec nous-mêmes et avec les autres pour ne pas dépasser notre limite supérieure, mais nous nous imaginons que ce sont d'autres raisons qui nous y poussent.
Le psychologue prend de nombreux exemples, dont celui de Bill Clinton à nouveau, pour illustrer ce phénomène. Il suggère aussi de considérer l'intégrité moins comme un problème moral (même si c'en est un) que comme un problème physique : le manque de sincérité, par exemple, "bouche" les relations et les rend moins fluides.
En reconnaissant que nous n’avons pas été sincères, nous pouvons enlever le caillou et laisser le flux de la communication se rétablir naturellement. De ce fait, nous pouvons, dans nos interactions quotidiennes, atteindre de bien meilleurs niveaux de succès et de bien-être.
L'auteur propose de faire le point en acceptant de prendre en considération le fait que le mensonge ou le manque d'intégrité soit lié à une peur d'évoluer positivement (pour soi-même ou au sein d'une relation).
La première étape vers la plénitude : découvrir votre histoire
Pour découvrir ce qui empêche la plénitude d'être restaurée, il importe de se pencher sur son histoire. Posez-vous les questions suivantes :
"À quel moment est-ce que je sens que je ne suis plus intègre face à moi-même ?"
"Qu'est-ce qui m'empêche de me sentir complet et entier ?"
"Quels sont les sentiments importants que je ne laisse pas apparaître dans ma conscience ?"
"Y a-t-il un aspect de ma vie où je ne révèle pas toute la vérité ?"
"Y a-t-il un aspect de ma vie où je n'ai pas tenu mes promesses ?"
"Dans ma relation avec (...), qu'ai-je besoin de dire ou de faire pour me sentir complet et entier ?"
Ces interrogations vous aideront à "déprogrammer" votre histoire et à vous reconnecter à votre zone de génie.
L'attitude
Ces exercices peuvent paraître longs et fastidieux. Mais Gay Hendricks se veut rassurant : recherchez des choses déterminées (un sentiment de tristesse ou de peur, par exemple) et cherchez à l'analyser.
Important : agissez avec une tonalité de remerciement et d'émerveillement, plutôt que sur le mode du blâme ! Rechercher la vérité est une activité qui s'exerce préférablement dans une atmosphère ludique.
Actions requises
En ayant cette attitude à l'esprit, commencez vos recherches de "problèmes de limite supérieure", ce que l'auteur résume par ULPs (pour upper limit problem, en anglais). Chaque fois que vous constatez que votre problème est lié à un ULP, cherchez à le dissoudre en utilisant l'une des techniques citées plus haut.
Cherchez aussi consciemment à accroître l'épanouissement, l'amour et le succès dans votre corps et votre esprit. Savourez les sensations corporelles qui sont liées au bien-être et à la plénitude intérieure.
Enfin, mettez-vous à la recherche d’une histoire de vous-même qui soit en lien avec votre zone de génie. Créez votre propre récit positif afin de reconnaître votre plein potentiel et accepter de le partager.
Chapitre 4 - Construire un nouveau nid dans votre zone de génie
"Ceux et celles qui ont le courage de découvrir et de faire naître leur génie font une percée vers des hauteurs sans précédent de productivité et de satisfaction." (Le grand saut, Chapitre 4)
La plupart du temps, nous "sautillons" dans notre zone de compétence, mais nous n'osons pas franchir le pas, faire le grand saut — le seul qui compte vraiment. Notre tâche consiste à repérer les moments où nous n'avançons plus en raison du problème de la limite supérieure afin de déverrouiller ce plafond de verre.
De façon régulière, les personnes souhaitent réaliser un projet créatif, mais n'y parviennent pas. Le grand saut consiste à passer le cap et à se donner les cartes en main. Les histoires que nous construisons et que nous racontons pour justifier notre maintien dans la zone de compétence ne peuvent pas durer éternellement !
Votre engagement au génie
Dans cette partie, Gay Hendricks cherche à vous faire passer le précipice ; bref, il veut que vous vous engagiez à sauter. Pour vous faire à l'idée, il vous propose de commencer par la répétition de cette phrase :
"Je m'engage à vivre dans ma zone de génie, maintenant et pour toujours." (Le grand saut, Chapitre 4)
En répétant plusieurs fois cette phrase et en étant attentif à ce qu'elle provoque en vous, vous ancrerez cette nouvelle croyance positive et vous serez prêt à changer.
Les questions géniales
Voici une série de questions à vous poser pour identifier votre zone de génie et ne pas la laisser s'échapper :
"Qu'est-ce que j'aime le plus faire ?"
"Quel est le travail que je fais sans sentir que c'est du travail ?"
"Dans mon travail, qu'est-ce qui produit le ratio le plus élevé de rentabilité et de satisfaction par rapport au temps consacré ?"
"Quelle est mon habilité unique ?"
L'auteur explicite chacune de ces questions pour que vous puissiez y répondre de façon précise. À noter : c'est aussi la méthode employée dans Vivre la vie de ses rêves grâce à son blog !
Articuler votre habileté unique
Il n'est pas si aisé de la rencontrer. Il faut souvent défaire "les poupées russes" qui la cachent. Par exemple, ce n'est pas "animer les réunions" qui sera, peut-être, l'habilité de quelqu'un. Mais plutôt : la capacité à sentir des changements d'humeur dans les groupes et à les canaliser.
Trouvez une affirmation simple et précise commençant par :
"J'excelle dans…"
Selon Gay Hendricks :
« Vous saurez que vous approchez de votre habileté unique quand vous ressentirez une lueur intérieure d’émerveillement et d’excitation. » (Le grand saut, Chapitre 4)
Chapitre 5 - Vivre dans votre zone de génie
Sortez de votre boîte et engagez-vous dans la spirale
La zone de génie n'est pas tellement stable : en fait, c'est plutôt une spirale d'ascension permanente. Une fois passée la limite supérieure, il n'y a plus de limites selon Gay Hendricks. Du moins, comparé à l'état très restreint dans lequel vous étiez avant, à savoir bloqué dans des "boîtes" et des croyances erronées.
Le mantra de la réussite suprême : une intention directrice centrale
Le mantra de la réussite suprême (ou appelez-le autrement si vous préférez) est une sorte de méta-programme à installer au cœur ou à la racine de vous-même.
Il s'agit d'un mantra dans la mesure où c'est "un son ou une idée que vous employez comme point de focalisation dans la méditation". Souvent, le mantra est simplement l'attention à la répétition. Mais il existe aussi d'autres techniques où vous pouvez focaliser votre attention sur une phrase précise.
L'important est d'y revenir à chaque fois, comme à un "port d'attache". Il est normal que vos idées vagabondent vers le passé ou l'avenir ; l'enjeu, c'est de les laisser filer et de revenir à l'instant présent.
Votre mantra de la réussite suprême
Dans la suite de l'ouvrage, l'auteur utilise l'acronyme MRS pour en parler. Il vous permet de garder l'intention centrale de votre zone de génie à l'esprit. Le voici :
"Je me développe chaque jour dans l'épanouissement, le succès et l'amour, et j'inspire ceux et celles qui m'entourent à faire de même." (Le grand saut, Chapitre 5)
Commencez par le dire à voix basse plusieurs fois. Puis tentez à voix haute. Ressentez son action en vous. Pour le psychologue Gay Hendricks, il s'agit de la meilleure méthode pour tenir à distance le problème de la limite supérieure et parvenir à vous installer durablement dans votre zone de génie.
Comment utiliser le MRS
Deux voies complémentaires sont préconisées par l'auteur :
Formellement, c'est-à-dire dans le cadre de méditations régulières ;
Informellement, dans la vie quotidienne, lorsque vous en avez l'occasion.
Pour la méditation, Gay Hendricks propose d'alterner des répétitions toutes les 15-20 secondes.
Ce à quoi vous pouvez vous attendre
En fait, se répéter ce mantra dans le cadre d'une méditation n'ira pas sans difficulté. Comme l'auteur le signale, il est fort probable — et même souhaité — que vous esprit riposte à cette phrase nouvelle.
En effet, l'objectif est de "recabler" le conscient et le subconscient. Mais le cerveau, lui, préfèrerait garder ses bonnes vieilles habitudes ! Il va donc vous faire penser (en boucle) à tout le contraire. Par exemple : "Je ne suis pas assez bon pour inspirer qui que ce soit", etc.
Mais persévérez et vous verrez un changement. Ces ripostes sont un bon signe. Elles cesseront quand votre subconscient et votre conscient auront assimilé le nouveau programme.
Un important raccourci : le refus éclairé
Il importe de savoir dire non ou, pour le dire avec un livre célèbre : cessez d'être gentil et soyez vrai ! Le refus n'est pas mauvais en soi, au contraire. Il vous permet de rester focaliser sur ce qui vous intéresse et vous profite le plus.
Les refus éclairés et motivés honnêtement vous offriront même de bonnes surprises. L'auteur raconte comment il a lui-même réussi à obtenir des avantages et des opportunités grâce à sa capacité à dire non.
Un autre raccourci : renouveler et raffiner votre engagement
S'engager est le point de départ de tout projet : amoureux comme professionnel. Mais il ne se suffit pas à lui-même. En réalité, il faut souvent renouveler l'engagement pris à l'égard d'autrui. Il en va de même avec vous-même et votre MRS.
En prenant soin de votre engagement pour la zone de génie, vous donnerez l'exemple autour de vous. C'est ce qu'affirme Gay Hendricks dans ce passage :
"L'un des sentiments les plus savoureux au monde, c'est de voir que votre engagement à vivre dans votre zone de génie inspire d'autres personnes à faire de même. Non seulement inspirer les autres leur fera du bien, mais vous vous sentirez aussi merveilleusement bien." (Le grand saut, Chapitre 5)
Chapitre 6 - Le temps selon Einstein
Pour bénéficier d'une existence plus harmonieuse, vous devez comprendre que le temps n'est pas linéaire et objectif, mais avant tout subjectif. Nous pouvons le "créer". Oui, pour Gay Hendricks — qui s'inspire ici assez librement de la théorie de la relativité d'Einstein — vous pouvez maîtriser le temps !
Le problème et la solution
Pour l'auteur, qui cite ici David Allen (son voisin !), nous avons tous un problème avec le temps. Nous n'arrivons pas à "caser" tout ce que nous voulons ou devons faire dans le temps qui nous est "imparti".
Il y a bien des méthodes, dont celle de David Allen justement, mais celles-ci sont souvent compliquées et nous les laissons tomber en partie ou complètement après quelques essais. En tout cas, c'est l'expérience qu'en a faite Gay Hendricks.
Pour celui-ci, le vrai secret réside dans le fait de se donner une autre conception du temps. C'est ce qu'il appelle le paradigme Einstein, en opposition à l'ancien paradigme, celui de Newton.
Une fois adopté le temps selon Einstein, vous pourrez augmenter le temps disponible pour vos activités créatrices et productives. Comment ? Voyons d'abord en quoi consiste la différence entre les deux formes de temps.
L'ancien paradigme et le piège du temps newtonien en détail
Pour résumer, le temps newtonien est un temps fini, puisqu'il existe une quantité limitée de temps. Du coup, nous sommes toujours dans un état de pénurie. Toujours à le chercher pour réaliser la moindre activité.
En fait, nous sommes pris dans un piège, selon lequel il existe d'un côté le temps comme réalité matérielle et physique, indubitable, et de l'autre nous-mêmes, qui subissons sa pression. Nous sommes pris dans un dualisme où nous sommes les esclaves du maître-temps !
Notre problème de temps : un problème d'espace
Le changement de conception du temps va de pair avec un changement de conception de l'espace. Dans l'ancien paradigme, l'espace est lui aussi fixe. Dans la version d'Einstein, l'espace peut se contracter ou s'élargir — comme le temps justement !
La phrase clé du célèbre physicien contemporain est la suivante :
"Placez votre main sur un poêle une minute et ça vous semble durer une heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille une heure et ça vous semble durer une minute. C'est ça la relativité." (Albert Einstein)
Gay Hendricks interprète cette remarque en disant que notre conscience s'étend dans l'espace lorsque nous sommes bien, alors qu'elle se rétrécit le plus possible quand nous sommes en mauvaise posture.
La vérité à propos du temps et toutes ces choses que vous ne voulez pas vraiment faire
"Pour arriver à vivre dans le temps selon Einstein, il vous faut effectuer une importante transformation, et c'est un concept qui est tellement inconcevable que j'ai effectivement vu des adultes avoir le souffle coupé d'étonnement lorsque je leur ai présenté comment procéder." (Le grand saut, Chapitre 6)
Êtes-vous prêt à essayer ?
En fait, vous avez besoin de déprogrammer votre persona du temps. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le persona, ici, désigne "un modèle d'action et de sentiments qui sont apparus dans notre vie à un certain moment en réaction à certaines conditions".
En fait, persona signifie masque en latin. Mais laissons les complications aux universitaires, dit l'auteur, et entrons dans le concret.
Ce que vous avez vraiment besoin de savoir au sujet de votre persona
Nous avons plusieurs persona, au moins deux ou trois le plus souvent. Ceux-ci se sont développés durant notre enfance. À l'âge adulte, l'un des enjeux consiste à les repérer et à "supprimer" ceux qui nous sont devenus inutiles ou néfastes.
Pour Gay Hendricks, nous agissons également avec le temps en fonction d'un persona. Le plus souvent, nous agissons par exemple comme des "policiers du temps", recadrant la moindre personne en retard. Mais nous pouvons adopter en profondeur une autre personnalité relative au temps.
Le temps selon Einstein
Devenir maître de son temps, c'est refuser le dualisme et considérer que vous êtes la source du temps. Le temps vous appartient ; vous avez prise sur lui. Ce n'est pas une ruse, selon le psychologue. Vous pouvez générer davantage de temps. Commencez par vous dire :
"Où dans ma vie je n'assume pas ma pleine responsabilité ?" ou "Qu'est-ce que j'essaie de nier ?" ou encore "Où dans ma vie dois-je assumer ma pleine responsabilité ?" (Le grand saut, Chapitre 6)
Prendre ses responsabilités aiderait-il à mieux gérer son temps ? C'est ce que prétend l'auteur. En fait, prendre en main le stress permet aussi de prendre en main le temps. Regardons comment.
Comment commencer
Une première action pourrait être de cesser de vous plaindre du temps — ou plutôt de votre manque de temps. Les phrases du genre "Je n'ai pas le temps" doivent disparaître de votre vocabulaire.
Imaginez un peu : si votre enfant veut jouer avec vous, vous pourriez être tenté de lui répondre que "vous n'avez pas le temps maintenant". Mais qu'en serait-il s'il se coupait en jouant seul et que vous deviez l'amener à l'hôpital ?
Dans un cas, vous avez le temps mais pas dans l'autre. Cela n'est pas une bonne manière de prendre ses responsabilités. Vous êtes la source du temps que vous prenez et que vous accordez aux autres.
La sensation de la pression du temps
Cette pression que nous ressentons lorsque nous sommes pressés, en retard et stressés, vous l'avez déjà sûrement expérimentée. En fait, vous pouvez modifier cet état corporel. Et il en va de même avec l'ennui que vous ressentez peut-être comme un vide.
Rendez-vous compte que, en réalité, ces sensations proviennent de vous-même et d'un "ferment créateur" en vous. Vous pouvez maîtriser cet élan créateur et le diriger là où il vous semble bon d'agir.
Une invitation
Créez donc suffisamment de temps pour apprendre sur vous-même et mettre en œuvre ces principes !
"Ce qu'il faut principalement, c'est une attention enthousiaste. Surveillez constamment les plaintes qui sortent de votre bouche ou circulent dans votre esprit à propos du temps. En les détectant pour les éliminer une par une, vous deviendrez de moins en moins occupé tout en en accomplissant beaucoup plus." (Le grand saut, Chapitre 6)
Chapitre 7 - Résoudre les problèmes relationnels
Souvent — nous dit l'auteur qui s'appuie ici sur une étude scientifique de John Cuber et Peggy Harroff —, les personnes qui réussissent ont des relations conjugales décevantes. Pourquoi ? En fait, avant d'en venir à cette question, il convient de voir quels sont les types de relations dites décevantes :
Celles qui sont dépourvues de vitalité, c'est-à-dire d'envie de partager et de libido.
Il y a aussi celles qui sont passives-agréables, c'est-à-dire où l'amour est sans passion (et ne l'a peut-être jamais été). Peu d'attente, peu de disputes, mais pas de véritable harmonie profonde.
Enfin, il y a les relations où le conflit est prédominant.
Alors maintenant, revenons sur les raisons. Selon Gay Hendricks, il en existe deux :
Parce qu'ils ont du succès (nous l'avons dit) ;
Mais qu'ils ne connaissent pas le fonctionnement de la limite supérieure.
Dès lors, ces couples se créent des noises sans savoir pourquoi. Les personnes inconscientes de ce qu'elles croient et de ce qu'elles projettent sur l'autre ne peuvent pas rétablir leurs relations.
La projection survient quand vous vous rendez compte que vous attribuez à l'autre vos propres sentiments. Ces projections sont souvent nocives et nuisent à l'énergie et à l'équilibre du couple.
Pour apprendre à prendre vos responsabilités au sein du couple lorsque vous avez déjà du succès, l'auteur donne quelques conseils :
Prenez du temps en suffisance sans votre partenaire ;
Exprimez vos émotions et vos vérités de façon simple ;
Permettez-vous de vivre les sentiments (les vôtres et ceux de l'autre) ;
Soyez affectueux ;
Apprenez à relâcher l'intimité autrement que par la dispute ;
Cherchez des amitiés avec lesquelles réaliser des projets communs.
Conclusion sur « Le grand saut » de Gay Hendricks :
Que faut-il retenir du livre "Le grand saut" de Gay Hendricks :
Ce manuel typique de développement personnel vous apprendra à ne plus vous auto-saboter et à réaliser le meilleur de vous-même. Bien entendu, cela demande des efforts. L'enquête sur ses propres croyances limitantes, par exemple, est un processus délicat ; mais vous pouvez la mener à bien !
Dans la conclusion du livre, Gay Hendricks insiste sur le fait qu'il s'agit d'une trajectoire ascendante continue. Les moments où nous nous libérons d'une limite supérieure sont les moments du grand saut.
"Voici ce que je vous souhaite : un voyage de toute une vie béni de plusieurs moments de découverte de ce genre. À mesure que vous avancez sur votre chemin puisse chaque jour être rempli d'autant de magie pratique et miracles quotidiens." (Le grand saut, Conclusion)
Points forts :
Un livre pour aller encore plus loin dans le succès, dans tous les domaines ;
De grandes séquences autobiographiques ;
Des concepts expliqués clairement ;
Une méthode pas à pas pour le changement ;
Des annexes avec encore plus d'anecdotes.
Point faible :
On peut regretter l'absence d'un bibliographie avec des sources scientifiques.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu le livre de Gay Hendricks « Le grand saut » ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Gay Hendricks « Le grand saut ».
Visitez Amazon afin d’acheter le livre de Gay Hendricks « Le grand saut ».
 ]]>
]]>Résumé de "Belle et bien dans son âge. Ma méthode pour prendre de l’âge sans vieillir" de Natacha Dzikowski : ce guide pratique et motivant partage des conseils concrets de beauté, santé et bien-être mental ainsi que des expériences inspirantes pour nous aider à assumer notre âge avec optimisme et à traverser la cinquantaine en restant belles, rayonnantes et épanouies.
Par Natacha Dzikowski, 2021, 256 pages.
Chronique et résumé de "Belle et bien dans son âge. Ma méthode pour prendre de l’âge sans vieillir" de Natacha Dzikowski
Début – Préambule
Le cap de la cinquantaine : une période charnière
En préambule de son livre "Belle et bien dans son âge", l'auteure, Natacha Dzikowski, souligne que la cinquantaine est une période charnière dans la vie des femmes.
"Prendre de l’âge, pour moi, c’est avancer dans la vie, accumuler des expériences, mûrir".
C’est, poursuit-elle, "une opportunité de s’alléger, se désencombrer de tous les faux-semblants avec lesquels nous avons longtemps vécu", "accepter de sortir de sa zone de confort pour aller vers le changement" et "développer de la souplesse, se départir des croyances erronées, se délester de nos vieilles structures, créer de l'ouverture, se donner de l’espace et préparer un terrain nouveau."
Car "c'est avec l’âge que l’on peut décider d’abandonner qui nous croyons devoir être pour devenir ce que nous sommes vraiment. C’est un moment charnière."
Natacha Dzikowski observe que ce cap peut être source d'inquiétude, notamment à cause des changements physiques liés au vieillissement. Cependant, affirme-t-elle, il est possible de rester belle et en bonne santé après 50 ans.
Affronter les défis de la cinquantaine avec confiance
L'auteure note que de nombreuses femmes sont angoissées face aux rides, à la ménopause ou à la prise de poids à cet âge. Pourtant, elle insiste sur le fait qu’elles ne devraient pas le vivre comme une fatalité. Au contraire, elle considère la cinquantaine comme l'occasion de prendre un nouveau départ.
Natacha Dzikowski explique alors que son livre a pour objectif d'aider les femmes à assumer sereinement cette étape de vie. Grâce à des conseils pratiques sur l'alimentation, l'activité physique et la gestion du stress, elle promet à ses lectrices qu'elles pourront rester belles, rayonnantes et en pleine forme.
"Je suis convaincue qu’on peut prendre de l’âge sans vieillir, que notre âge civil et notre âge biologique ne sont pas forcément corrélés. Nous pouvons agir sur notre âge biologique grâce à notre hygiène de vie globale et à une gestion proactive de notre santé. Il y a une grande règle d’or à garder en mémoire toujours qui est qu’il faut aider son corps pour qu’il nous aide en retour. Le meilleur moyen pour ça est de devenir une experte de soi-même, la coautrice de sa santé et de son bien-être, tant physique qu’émotionnel."
Introduction | L’âge dans tous ses états
Bien vivre dans son âge
Natacha Dzikowski introduit le sujet de son livre "Belle et bien dans son âge" en soulignant que l'âge n'est pas synonyme de vieillesse et qu'il est possible de rester jeune malgré les années qui passent. Elle affirme que la jeunesse est avant tout une énergie et une façon de se comporter plutôt qu'un état.
Aussi, selon l'auteure, bien vivre dans son âge c'est l'habiter et l'aimer comme sa propre maison : "à partir de 50 ans, l’âge c’est un peu comme une maison de campagne, on la veut d’abord pour soi, pour y être bien avec ses amis et ses proches" écrit-elle.
L’âge n’est pas une faute
L'auteure dénonce l'âgisme, cette idéologie négative sur l'âge, comme source de frustration et de manque de confiance en soi.
"Dans mon monde idéal, l’âge ne devrait plus être un sujet, juste un fait qui n’entraînerait pas plus de conséquences que d’être brune, blonde ou rousse."
Aussi, Natacha Dzikowski appelle les femmes à ne plus s'interdire des choses au nom de leur âge :
"Ce qui nous importe en vrai, c’est l’âge que l’on ressent et non celui que les autres nous renvoient avec en prime leurs peurs accrochées à leur flan. Bannissons de notre vocabulaire des phrases du type : "Je ne peux pas m’habiller comme ça, ce n’est plus de mon âge." Au nom de quoi et de qui les vêtements seraient-ils rangés par âge ? Ça me peine quand j’entends ce type de phrases, à propos d’habillement, mais aussi de coiffure, de chaussures, de style de vie… car je sens que la personne qui la prononce s’interdit quelque chose qui lui ferait plaisir au nom d’un regard collectif qui fixerait la norme de ce qui est acceptable selon l’âge."
Faire de notre âge un droit
L’auteure de "Belle et bien dans son âge" clôt son introduction en invitant les lectrices à devenir les héroïnes de leur âge. Elle dit proposer ce livre pratique pour aider les quadras, quinquas et plus à conserver un corps en bonne santé et un mental d'acier.
Chapitre 1 : Le cap des 50 ans
Natacha Dzikowski introduit le premier chapitre de "Belle et bien dans son âge" en soulignant que l'approche de la cinquantaine est un cap, un moment "pivot" dans la vie d’une femme.
En effet, cette dernière se sent souvent dans une position inconfortable : "c’est une dizaine qu’on n’a pas très envie de voir arriver, même chez celles qui n’ont pas le nez collé à leur âge : 50 ans, ça fait quelque chose" note l’auteure. Et ce, souvent, à cause des changements physiques liés à l'âge et à l'image négative véhiculée par la société sur la cinquantaine.
1.1 - Tout va bien et pourtant...
Natacha Dzikowski décrit ici ce sentiment de malaise qui peut accompagner l'approche de la cinquantaine. Malgré une situation où, a priori, tout va bien, de petits signes trahissent en réalité le temps qui passe : la peau qui vieillit, des kilos en trop, une énergie en dents de scie, le regard des autres qui change.
L’auteure explique alors que ce mal-être est lié à la peur de vieillir et, au fond, tout ce qu’on ne veut pas :
"Les mots en "-ior" et les cases toutes faites dans lesquelles on n’a pas envie d’entrer, nos parents qui vieillissent, les enfants qui n’en sont plus, les questions qu’on se pose, le boulot qu’on questionne, le sens que l’on cherche avec plus d’avidité probablement… Toutes ces petites horloges jalonnent nosjournées. […] Jour après jour, on sent la pression qui monte et le malaise qui s’installe."
Ainsi, la cinquantaine marque une transition, avec son lot de questions existentielles. On remet en cause ses habitudes, son travail, le sens de sa vie.
Toutefois, si ce moment peut être déstabilisant, il est bien normal, assure Natacha Dzikowski. C'est l'étape de la "transition du milieu de vie". L'auteure confie avoir elle-même traversé cette période difficile avant de s'en libérer.
Elle nous incite alors à lâcher nos "masques", ces personnages que nous nous sommes forgés, pour accueillir de nouvelles parts de nous-mêmes.
Elle conclut en soulignant les difficultés des seniors à conserver un emploi, mais appelle à ne jamais renoncer et à continuer de croire en ses rêves, quel que soit son âge.
1.2 - La ménopause, oh non, pas elle !
- Qu’est-ce que la ménopause ?
Natacha Dzikowski aborde ensuite le sujet délicat de la ménopause. Ce sujet est encore souvent tabou et source d'appréhension chez les femmes. Elle explique que cette étape peut être vécue de manière positive si on la prépare et qu'on accepte la transformation de son corps.
Elle souligne que "la ménopause n'est pas une maladie" ni un signe de vieillissement. C'est juste une adaptation naturelle à un changement hormonal.
C’est une transformation, pas une dégradation :
"La ménopause est un mécanisme biologique par lequel les règles disparaissent naturellement et la fonction ovarienne s’arrête définitivement. Ménopause veut donc dire fin des cycles menstruels. À la naissance, les ovaires disposent d’un stock défini de follicules contenant des ovules. À la puberté, le signal de départ du mécanisme d’ovulation est lancé et quand le stock de follicules est épuisé, c’est la ménopause. Simple, non ?"
Et cette transformation n’arrive pas d’un seul coup :
"Elle est précédée d’une période plus ou moins longue, entre 45 et 55 ans, où les cycles se dérèglent, entraînant une série d’effets secondaires plus ou moins présents. Les premiers symptômes commencent en général vers 47 ans avec un âge moyen de la ménopause à 51 ans. Entre 50 et 54 ans, 80 % des femmes sont ménopausées, chacune à leur manière, tellement nous vivons différemment les symptômes collatéraux de cet ajustement hormonal."
Pourtant, constate-elle, la peur de ne plus être désirable et les discours anxiogènes sur les "risques" de la ménopause rendent les femmes inquiètes.
- Comment reconnaît-on la ménopause ?
L’auteure de "Belle et bien dans son âge" partage des conseils pour :
Identifier les premiers symptômes de la ménopause (comme les bouffées de chaleur par exemple).
Mieux comprendre son corps durant cette période.
Devenir actrice de sa santé.
Elle insiste sur le fait qu'il ne faut pas dramatiser cette période de fragilité temporaire mais au contraire la voir comme une opportunité de se renouveler.
En somme, pour Natacha Dzikowski, toutes les femmes peuvent traverser sereinement la ménopause si elles anticipent les changements et adoptent les bons réflexes d'hygiène de vie :
"Non, à la ménopause, notre corps ne se dégrade pas si on en prend soin, si on l’aide à s’adapter à la nouvelle donne hormonale et aux changements de notre métabolisme."
Selon elle :
"Plus tôt on adopte une hygiène de vie adéquate, plus vite on arrive à gérer les effets collatéraux dès la périménopause. Plus vite on atteint notre équilibre métabolique, moins on subit de déséquilibres en chaîne."
Ainsi, ces périodes de périménopause et de ménopause se préparent. Elles s’anticipent "exactement comme certaines femmes calculent le bon moment pour une grossesse dans leur carrière".
1.3 - Passer le cap tête haute, choisir sa vie !
- 50 ans : le bon moment pour oser
La cinquantaine, poursuit l’auteure, marque une transition dans la vie des femmes. C'est le moment de faire le point sur soi-même, ses envies, son travail, ses relations.
Aussi, pour Natacha Dzikowski, il ne faut pas avoir peur du changement. Au contraire, c'est le bon moment pour oser, lance l’auteure : changer de vie, de métier, d'apparence, de ville… 50 ans peut être un nouveau départ pour nous : nous devenons moins dépendante du regard des autres et pouvons alors décider de vivre pour nous.
- La cinquantaine : se créer une nouvelle féminité
La ménopause signe aussi la fin d'une période de fécondité. L'auteure de "Belle et bien dans son âge" nous suggère de nous créer une nouvelle féminité, loin des diktats de la société sur l'apparence des femmes :
"La féminité n’est pas linéaire, elle se sculpte à chaque étape de la vie. Adolescence et arrivée des règles qui signent le passage dans le clan du féminin, maternité qui exulte la puissance du féminin créateur et immortel, ménopause qui clôt la fertilité, mais pas le désir. C’est un moment de notre vie où nous nous sentons en transition avec une peur de perdre notre intégrité corporelle. Quand on commence à perdre la finesse de sa taille, le fuselage de ses bras et de ses cuisses, quand on sent que son ventre est de moins en moins plat, on ne peut pas s’empêcher d’avoir peur de perdre son corps, ses contours, sa consistance, sa maîtrise de soi."
Elle poursuit :
"C’est aussi un moment où nous devons revoir tout notre calendrier intime qui était rythmé par nos cycles. Pour certaines d’entre nous, se séparer de ses règles et de la possibilité d’enfanter revient à se séparer d’un processus vivant en nous. Faire le deuil de ses règles, c’est faire le deuil de toute une période pleine, pratiquement quarante ans de la vie qui s’envolent."
L’auteure raconte ici comment elle, a commencé à mieux prendre soin de son corps et de sa santé quand elle a eu 40 ans, dans le but d’aborder sereinement la cinquantaine. Elle partage ses rituels de sport, de méditation, d'alimentation saine, conseillant à chacune de trouver ce qui lui fait du bien.
1.4 - Passer à l’action, y croire
Natacha Dzikowski termine ce premier chapitre en insistant sur l'importance de la discipline pour prendre soin de soi après 50 ans. Car sans régularité, il est impossible de profiter des bienfaits du sport, de la méditation ou d'une alimentation saine, rappelle-t-elle.
Selon l’auteure de "Belle et bien dans son âge", cette discipline consiste simplement à mettre en place des rituels agréables pour soi, pas des contraintes. Et puis, en transformant une activité en habitude, on finit par la trouver naturelle.
Ce sont d’ailleurs ces astuces - pour rester en forme malgré l'âge et apprivoiser les changements - qu’elle nous propose de découvrir dans les prochains chapitres de "Belle et bien dans son âge"
L'auteure souligne enfin que les hommes ne sont pas épargnés par les changements hormonaux de la cinquantaine. Elle explique que cette sorte de "ménopause masculine" est appelée l’andropause et développe ses effets.
Chapitre 2 : Faire équipe avec son corps
Le chapitre 2 de "Belle et bien dans son âge" montre combien comprendre et prendre soin de son corps est la clé de la longévité.
On y apprend que le corps possède des capacités innées d'autodéfense qu'il faut écouter et respecter, et qu’il est notre meilleur allié dans la vie. L’auteure y relate aussi des exemples personnels sur les bienfaits de l'activité physique et d'une alimentation saine.
2.1 - De quoi notre corps a-t-il besoin ?
Natacha Dzikowski commence par nous faire observer que le corps a des besoins simples et vitaux : respirer, boire, manger sainement, éliminer, faire du sport et se reposer. Et que respecter ces besoins est ce qui permet de conserver son énergie et sa vitalité.
Elle détaille le fonctionnement du métabolisme, processus essentiel de gestion de l'énergie dans l'organisme. Celui-ci fait intervenir le catabolisme et l’anabolisme. Le métabolisme de base diminue avec l'âge mais peut être stimulé par l'activité physique, souligne-t-elle.
Ce chapitre parle ensuite de l'importance de respecter les rythmes biologiques (chronobiologie) dictés par notre horloge interne.
Les 3 grandes phases d'une journée y sont décrites :
L’assimilation de 12 h à 20 h,
La régénération de 20 h à 4 h du matin,
L’élimination de 4h à 12h.
Pour l’auteure de "Belle et bien dans son âge", il est essentiel de dîner tôt et léger. Ceci dans le but de ne pas perturber la phase cruciale de détoxination nocturne.
Ainsi, en respectant la chronobiologie, on aide son corps à rester en bonne santé.
2.2 - Qu’est-ce qui fait vieillir prématurément notre corps ?
Natacha Dzikowski nous met ici en garde contre deux facteurs de vieillissement prématuré : l'excès d'acidité et le sucre.
Elle présente d’abord le fonctionnement de l'équilibre acido-basique dans le corps et l'importance du pH. Un pH trop acide, souligne-t-elle, notamment à cause d'une alimentation acidifiante, conduit à une fatigue cellulaire et à des problèmes comme l'ostéoporose.
Puis, l’auteure donne des conseils pour ajuster son alimentation et atteindre le bon ratio acide/alcalin.
Elle décrit aussi le rôle catastrophiquement néfaste du sucre qu’elle qualifie d’ennemi public n°1 de la santé, de la silhouette et de la belle peau. Le sucre, lance-t-elle, est une véritable drogue addictive qui provoque des pics d'insuline, un stockage des graisses, le développement des rides et des déséquilibres intestinaux.
À l’approche de la ménopause, le sucre est encore plus un danger. Le supprimer est "non négociable", assène l’auteure de "Belle et bien dans son âge". Un encart liste alors des astuces pour absorber moins de sucres.
2.3 - À la ménopause, que se passe-t-il dans notre corps ?
Natacha Dzikowski expose ensuite ce qui se passe dans le corps des femmes à l'approche de la ménopause, période charnière entre 40 et 50 ans.
Elle détaille le rôle capital des œstrogènes. Ceux-ci agissent sur l'humeur, la densité osseuse, la qualité de la peau et des cheveux ou encore la répartition des graisses.
- Les fragilités à surveiller
Ainsi, avec la baisse des œstrogènes, le métabolisme est déstabilisé. D'où l'importance de surveiller diverses fragilités, à savoir :
Gynécologiques : après 45 ans, il est crucial de réaliser tous les ans un bilan complet (bilan sanguin, mammographie, échographies des seins et des ovaires, frottis).
Cardiaques : "les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de décès des femmes après 55 ans, devant tous les cancers" informe l’auteur, d’où l’importance de faire contrôler son cœur au moins tous les 5 ans.
Du poids : la prise de poids engendrés par le ralentissement du métabolisme et la perte de masse musculaire peut être contrôlée avec une petite discipline alimentaire et sportive.
Psychologiques : les bouleversements importants de cette période (corps qui change, image de soi brouillée, enfants qui quittent la maison, vieillissement de nos parents, questionnements professionnels, personnels…) nous rendent plus vulnérable. Natacha Dzikowski nous suggère de parler avec notre entourage, d’échanger, de nous faire aider par des professionnels pour retrouver confiance en nous.
- Les stratégies gagnantes à partir de 45 ans
L'auteure liste des conseils pour soulager les troubles typiques de la ménopause que sont les bouffées de chaleur, l’irritabilité, les insomnies, la sécheresse vaginale, la prise de poids.
Par exemple :
Pour les bouffées de chaleur, la première chose à faire, dit-elle, est d’éviter les excitants (épices, café, alcool). L’auteure met ici en garde contre les traitements hormonaux substitutifs, non dénués de risques, et partage les solutions naturelles qu'elle a expérimentées avec succès : homéopathie, acupuncture, sophrologie.
Pour les sautes d’humeur, la fatigue et le sommeil irrégulier, Natacha Dzikowski conseille de faire vérifier ses dosages en vitamines B.
Enfin, elle rappelle que l'alimentation et l'activité physique sont primordiales pour accompagner son corps dans cette transition, éviter la prise de poids et rester en bonne santé.
2.4 - Comment garder un corps au top de son énergie
Ici, il est question du rôle fondamental de l'intestin, notre "deuxième cerveau", dans notre vitalité et notre santé.
"L’intestin est un organe majeur de notre organisme. Pour bien le comprendre, il est important d’avoir à l’esprit une notion simple, mais essentielle et que nous oublions : nous sommes ce que nous digérons."
Natacha Dzikowski détaille plus précisément le fonctionnement du microbiote intestinal, élément clé de notre immunité qu'il faut préserver : "c’est le chef d’orchestre du corps" écrit-elle.
L’auteure montre comment la mise au repos périodique du système digestif via le jeûne ou la monodiète permet de le régénérer. Cela booste les défenses immunitaires, favorise l'élimination des toxines et protège la flore intestinale.
À ce propos, elle partage plusieurs conseils pratiques pour jeûner ou faire une monodiète au quotidien, à la semaine ou au mois. L'objectif étant de soulager ses intestins régulièrement pour rester en bonne santé.
2.5 - Aimer son corps, lui porter de l’attention au quotidien
- Fuir le corps idéalisé
Pour Natacha Dzikowski, le rapport complexe que nous entretenons avec notre corps est souvent lié à une image idéalisée irréaliste que nous poursuivons en vain.
""Pas assez" devient un peu notre mantra quotidien. Pas assez svelte, pas assez mince, pas assez grande, pas assez… Rares sont les moments où on lui dit merci. Merci d’être là, en bonne santé ; d’être notre véhicule terrestre, notre compagnon de route fidèle ; de nous permettre de sentir et de ressentir toutes une palette d’émotions et de sensations. Merci d’être notre canal de connexion, notre canal d’ancrage."
- La prise de conscience tardive de Natacha Dzikowski
L’auteure raconte, à ce sujet, comment elle a mis des années à accepter son physique et lâcher prise sur les diktats.
"J’ai passé un nombre incroyable d’années à chercher à être autrement. Je ne me trouvais jamais assez. (…) J’avais une garde-robe à plusieurs tailles et j’étais sous contrôle permanent, voyageant avec ma balance pour corriger immédiatement tout écart de poids. À l’époque, je suivais un régime draconien avec un acupuncteur que j’adorais, mais qui me terrorisait avec sa pesée quotidienne. Sa méthode marchait super bien. Je perdais du poids et je pouvais enfiler mes pantalons taille 36. Dès que je relâchais ma vigilance, je reprenais du poids et hop, je repartais pour une cure avec lui. Ça a duré assez longtemps, en fait. Et puis un jour, je me suis dit stop. Stop à cet archi-contrôle, à cet état d’alerte rouge tous les jours, toute l’année. Ce moment est arrivé autour de mes 40 ans."
Finalement, Natacha Dzikowski a appris à aimer son corps, et ce grâce au sport, aux massages, à la méditation, confie-t-elle.
Elle raconte comment elle s’est fait une raison sur le fait qu’elle ne pourrait jamais avoir le corps idéal de ses 25 ans et comment elle a, petit à petit, réinvesti son énergie positivement.
- Comprendre ses besoins, s’accepter et retrouver l’estime de soi
Après avoir partagé son cheminement, l’auteure conseille aussi aux lectrices de renoncer aux régimes draconiens et à la quête de la perfection.
Le secret, selon elle, est ailleurs : il est de développer l'estime de soi.
Enfin, le chapitre 2 de "Belle et bien dans son âge" nous encourage à :
Devenir, chacune, experte de notre corps pour répondre à ses besoins, et non pour le malmener.
Accorder la priorité dans son emploi du temps aux activités qui nous ressourcent comme le yoga, l'écriture ou le sport : "si l’on veut que notre corps nous aide, nous devons l’aider aussi", lui donner ce dont il a besoin.
Cette partie du livre "Belle et bien dans son âge" parle aussi de l’EFT (Emotional Freedom Technique). Cette pratique psycho-énergétique de libération des émotions utilise les méridiens énergétiques chinois. C’est un outil qui aide à se libérer des émotions négatives en tapotant des points spécifiques d’acupuncture (tapping).
Finalement, le message de ce chapitre est le suivant : on peut apprendre à s'aimer soi-même, avec nos qualités et nos défauts. C'est la clé pour entretenir son énergie et sa vitalité, et vieillir sereinement.
Chapitre 3 : L’alimentation vertueuse
Le 3ème chapitre du livre "Belle et bien dans son âge" montre comment l'alimentation influence le vieillissement et la santé. Il souligne que manger pour des raisons émotionnelles détourne la nourriture de son rôle énergétique et entraîne une prise de poids.
3.1 - Pourquoi le surpoids est dangereux
Natacha Dzikowski commence par alerter sur les dangers du surpoids pour la santé, notamment après 50 ans où le métabolisme ralentit.
En effet, le surpoids accélère le vieillissement, dérègle les hormones et favorise les maladies.
- Viser une meilleure hygiène alimentaire
L’auteure nous met en garde contre "la nourriture réconfort" : "la nourriture, c’est de l’énergie, pas un doudou émotionnel". Elle déconseille aussi les régimes, sources de frustration, et nous invite à mettre en place plutôt une hygiène alimentaire durable. Elle préconise l'IMC comme repère objectif et invite chacune à calculer son indice.
- Éviter d’encrasser son corps
Cette partie de "Belle et bien dans son âge" explique que nous produisons des toxines en interne (toxines endogènes ou endotoxines) et que nous en ingérons aussi via notre alimentation (toxines exogènes ou exogènes ou xénobiotiques).
Ces toxines nuisent au bon fonctionnement de nos cellules. C’est pourquoi il est essentiel de les éliminer grâce aux organes filtres que sont le foie, les reins ou la peau. Sinon, elles s'accumulent et rendent malades.
L'auteure de "Belle et bien dans son âge" partage alors deux règles d’or pour éviter l'encrassement du corps :
Choisir des aliments peu toxiques,
Stimuler les organes d'élimination.
Elle conseille alors de bannir les produits industriels, transformés, raffinés, artificiels, grillés, fumés et riches en gluten. Et de privilégier les fruits et légumes crus (la "raw food") qui contiennent des fibres protectrices.
3.2 - Les 5 règles gagnantes pour avoir un corps naturellement sain et performant
L'auteure de "Belle et bien dans son âge" énonce 5 autres règles simples pour éliminer les toxines et garder un corps sain :
Boire suffisamment d'eau,
Consommer des fibres,
Pratiquer une activité physique régulière,
Bien respirer,
Dormir assez.
Natacha Dzikowski revient également sur le rôle de chaque organe - reins, intestins, peau, poumons - dans le processus naturel d'élimination. Elle suggère des habitudes faciles à adopter pour les stimuler : marcher, prendre les escaliers, méditer ou faire du yoga.
3.3 - Qu’est-ce qu’une alimentation saine, une alimentation longévité ?
L'auteure décrit le rôle de deux hormones essentielles dans l'organisme : l'insuline et le cortisol. L’insuline régule la glycémie et le stockage des graisses, le cortisol agit contre l'inflammation.
Mais leur déséquilibre, dû au sucre et au stress, provoque des dérèglements : diabète, prise de poids, affaiblissement du système immunitaire.
C’est pourquoi l'alimentation doit permettre de réguler ces hormones et éviter les états inflammatoires chroniques néfastes pour la santé.
3.4 – Les 8 piliers de l’alimentation longévité
Natacha Dzikowski termine le troisième chapitre de son livre "Belle et bien dans son âge" en détaillant les 8 piliers d'une alimentation saine et protectrice.
Manger moins et plus lentement : en restreignant nos apports caloriques et en prenant le temps de bien mastiquer, on favorise la satiété, on digère mieux et on évite la prise de poids.
Privilégier les aliments naturels et peu cuits : "plus la cuisson dure, plus on perd de substances nutritives", explique l’auteure. Elle recommande une cuisson douce, à la vapeur ou en papillote, pour préserver les nutriments.
Consommer beaucoup de fruits et légumes, essentiels grâce à leur concentration en vitamines, fibres, antioxydants. Ils protègent la santé et la beauté de la peau.
Préférer les aliments à indice glycémique bas, qui n'entraînent pas de pic d'insuline et de fatigue. "Ils sont les partenaires privilégiés des bonnes performances physiques et intellectuelles", souligne l'auteure.
Consommer des protéines, qui jouent un rôle central dans la reconstruction cellulaire. Il faut alterner protéines animales (viandes, poissons, œufs) et végétales (légumineuses, céréales) pour un bon équilibre.
Dire oui aux bonnes graisses insaturées, comme les oméga 3 et 6. Elles protègent les parois cellulaires et le système cardio-vasculaire.
Bannir totalement le sucre, responsable de rides, de fatigue, de dérèglements hormonaux et d'envies compulsives.
Bien répartir les aliments dans la journée selon le rythme chronobiologique naturel du corps, en respectant le principe du decrescendo alimentaire : petit-déjeuner copieux, déjeuner équilibré/ moyen, dîner léger.
L'alimentation influence directement le processus de vieillissement. En suivant ces quelques principes, on aide son corps à rester en bonne santé.
À la fin de ce chapitre, sont partagés une check-list, un "zoom" pour nous aider à gérer les écarts et un autre sur les vertus de l’œuf , la protéine par excellence.
Chapitre 4 : Doper son métabolisme et sa bonne santé
Dans le chapitre 4 de son livre "Belle et bien dans son âge", Natacha Dzikowski présente le corps comme un allié à long terme, capable de s'autoréparer.
Elle indique que, quand nous prenons soin de lui et que nous répondons à ses besoins, notre corps reste un compagnon fidèle, "pilier de nos performances quotidiennes, de notre vitalité, de notre envie de bouger, de faire, de découvrir". Il est donc de notre responsabilité de l'aider consciemment.
4.1 - Conserver un corps performant, dans lequel on se sent bien et qui nous plaise
Selon l'auteure de "Belle et bien dans son âge", le sport est indispensable pour conserver un corps performant et sain.
Pourquoi ? Parce que "le corps a besoin de mouvement" fait observer Natacha Dzikowski :
"Il [le corps] n’est pas fait pour être immobile ni sédentaire. (…) La sédentarité est le pire ennemi de la bonne santé et des bonnes performances de notre corps."
Le sport, en stimulant la circulation sanguine et lymphatique, oxygène les cellules et élimine les toxines. Il augmente aussi les hormones antistress, régule le sommeil et l'humeur. Il booste le métabolisme, ce qui permet de mieux contrôler son poids. Et en renforçant la masse musculaire, il ralentit le vieillissement.
Enfin, voir les résultats de ses efforts est très gratifiant. Cela renforce l'estime et la confiance en soi.
"Cela donne la sensation d’être aux commandes, […] en pleine possession de soi. Cette boucle effort-visibilité du résultat est extrêmement stimulante. Elle nous apprend l’automotivation, la persévérance dans l’effort, elle nous donne envie de nous regarder, de nous féliciter et cerise sur le gâteau, de nous étonner dans nos capacités à nous dépasser, à sortir de notre zone de confort. Se gratifier nous permet de nouer avec nous-mêmes une relation de confiance, de respect et d’amour. […] On sort du jugement pour entrer dans une collaboration, un partenariat. On apprend faire équipe avec soi."
4.2 – Quelle activité physique choisir ?
Natacha Dzikowski révèle ici le trio gagnant du sport.
En effet, selon elle, pour maximiser les bienfaits du sport, il faut pratiquer trois grandes activités :
La musculation, pour renforcer/ conserver ses muscles, réduire son excès de graisse ("plus on a de muscles, plus on brûle de calories"), retarder le relâchement de la peau, booster son métabolisme et sa densité osseuse.
Le cardio-training, comme la course ou le vélo, pour affiner la silhouette, améliorer la santé cardio-vasculaire et respiratoire, prévenir agir sur le diabète, le cholestérol, agir positivement sur les vaisseaux sanguins, les os, les muscles et le mental.
Les étirements (stretching) via le yoga ou le Pilates, pour assouplir le corps et gérer le stress.
L’auteure détaille longuement toutes les vertus de ces disciplines : perte de poids, meilleure oxygénation des cellules, augmentation des hormones du bien-être, amélioration de l'humeur et du sommeil...
4.3 – Comment me remettre au sport ?
Natacha Dzikowski partage ici son expérience personnelle pour montrer qu'il n'est jamais trop tard pour se (re)mettre au sport.
Elle relate comment à 40 ans, souffrant de maux de dos, elle a commencé par le Pilates. Puis, comment elle y a ensuite ajouté le cardio-training et enfin la musculation pour un programme complet.
Selon elle, il est important de commencer progressivement, en douceur et de choisir des activités motivantes adaptées à chacune.
"Pour mettre toutes les chances de votre côté, donnez-vous des objectifs atteignables et raisonnables, qui soient compatibles avec votre emploi du temps et votre biorythme, que vous n’aurez aucune peine à tenir. Surtout, ne mettez pas la barre trop haut tout de suite. On ne peut pas décider de courir un marathon du jour au lendemain ! Commencez par planifier des séances réalistes et au bout de quelques semaines, ajustez en fonction de vos envies, de vos résultats. Chaque personne a sa recette."
Le fait d'avoir un coach ou de pratiquer en groupe rend aussi les choses plus faciles.
Puis, avec de la discipline, on finit par prendre goût au sport. Et les bienfaits sont nombreux : silhouette affinée, énergie décuplée, confiance en soi accrue. Le sport devient alors un plaisir. Il sculpte le corps et l'esprit !
À la fin de ce chapitre, l’auteure partage une check-list et un programme adapté pour nous donner envie de reprendre le sport à 50 ans.
Chapitre 5 : Entretenir sa peau et ses cheveux
Dans le 5ème chapitre de son ouvrage "Belle et bien dans son âge", Natacha Dzikowski présente la peau comme un organe vivant, protecteur et miroir de notre santé.
Elle nous montre en quoi celle-ci joue un rôle majeur dans notre organisme, en protégeant les autres organes des infections, des blessures et des rayons solaires nocifs : "c’est notre principale barrière immunologique" écrit l’auteure.
Dans ce chapitre, Natacha Dzikowski rappelle aussi que la nourriture, le soleil ou le tabac vieillissent prématurément la peau. Le but, souligne-t-elle, est donc de garder une peau lumineuse, lisse et sans imperfections.
5.1 – La peau a son propre rythme
"La peau est un organe vivant et non juste une surface. Ça veut dire que c’est un organe qui vit, se transforme, qui interagit avec notre organisme" explique Natacha Dzikowski.
De fait, la peau a sa propre chronobiologie : le jour, elle a besoin d'hydratation et de protection, la nuit, elle se régénère grâce à une microcirculation intense qui oxygène les cellules.
Ce chapitre nous apprend également comment fonctionne la peau sous l’influence des hormones, comment elle se renouvelle en un mois et que, pour qu'elle reste saine, nous devons la nourrir de l'intérieur avec des antioxydants et des vitamines A, E et C.
Plus globalement, l'alimentation et l'hydratation sont cruciales pour la peau. Et il est tout aussi important de respecter ses rythmes biologiques dans les soins quotidiens, informe l’auteure.
5.2 – Qu’est-ce qui accélère le vieillissement de la peau ?
"La peau, notre peau, est un organe essentiel. Notre interface avec le monde extérieur. Avoir une belle peau, c’est un peu notre Graal commun à tout âge, ce que nous recherchons toutes. Peu importe d’avoir quelques rides, elles font partie de la vie de notre visage. En revanche, une belle peau douce, lumineuse, dense, soyeuse, sans imperfections ni taches, oui nous en avons envie. Parce que la peau, c’est ce que nous voyons en premier de nous, c’est ce qui nous enveloppe et ce qui parle de nous, de notre état émotionnel souvent."
L'auteure de "Belle et bien dans son âge" rappelle que 80 % du vieillissement cutané est dû à des facteurs externes qui sont la pollution, le tabac et l’alimentation. Ces agressions épuisent les défenses antioxydantes de la peau.
Elle met aussi en évidence les changements liés à la ménopause : peau qui s'affine, pores qui se dilatent, déshydratation... En fait, la production de collagène et d'élastine ralentit, d'où l'apparition des rides.
Pour lutter contre ce processus, l’auteure recommande donc de consommer des vitamines A, C et E aux vertus anti-âge. Et d'utiliser des actifs comme l'acide hyaluronique ou le rétinol.
L'hydratation et la protection solaire sont aussi primordiales.
5.3 – Les 4 gestes de la belle peau
Natacha Dzikowski partage les 4 gestes clés et incontournables pour entretenir sa peau après 50 ans.
Le double nettoyage, matin et soir, en deux étapes : une phase huileuse pour décoller toutes les impuretés, puis une phase aqueuse avec un gel nettoyant pour parfaire le nettoyage. Ce rituel quotidien permet de bien "débarrasser la peau afin qu'elle puisse respirer et se régénérer la nuit".
L'exfoliation, deux fois par semaine avec des gommages doux. En éliminant les cellules mortes, nous boostons la pénétration des soins, nous stimulons le renouvellement cellulaire et nous estompons rides, taches pigmentaires et pores apparents.
L'application d'une protection solaire et des antioxydants le jour, pour former un bouclier contre les agressions extérieures qui accélèrent le vieillissement cutané.
L'utilisation d'actifs réparateurs et d'huiles nourrissantes la nuit, moment où la peau est plus réceptive et met en place ses mécanismes de régénération.
En suivant ces quelques règles, la peau reste lumineuse et lisse plus longtemps.
5.4 – Nourrir sa peau de l’intérieur
Natacha Dzikowski rappelle que notre hygiène alimentaire influence la qualité de notre peau.
Elle recommande alors de manger des probiotiques, fruits, légumes et huiles riches en vitamines A, C et E. Et de bannir le sucre néfaste à la fermeté de l'épiderme.
5.5 – Médecine esthétique, y aller ou pas ?
Face aux rides et à la perte de fermeté, l'auteure comprend qu'on soit tentée par la médecine esthétique. De plus, les progrès permettent désormais des traitements légers efficaces.
Toutefois, elle insiste sur l'importance du dialogue avec le praticien, qui doit rester mesuré dans ses recommandations. L'idéal est de consulter toujours le même médecin et de procéder par touches successives.
Natacha Dzikowski partage, à ce propos, son expérience personnelle des injections d'acide hyaluronique et de botox, qu'elle espace de façon à conserver un résultat naturel. L'essentiel est de ne pas en faire trop et de respecter les volumes harmonieux de son visage.
5.6 - Cheveux, mes beaux cheveux !
- Soigner son cuir chevelu
De beaux cheveux commencent par un cuir chevelu sain, qu'il faut chouchouter avec des masques et automassages. En effet, le microbiome du cuir chevelu est primordial pour une belle chevelure, précise Natacha Dzikowski.
Un brossage doux quotidien, avec une brosse en poils naturels, est également indispensable.
- Bien traiter sa fibre capillaire
L’auteure conseille aussi de :
Renforcer et régénérer notre fibre capillaire, fragilisée à la ménopause, avec des soins nourrissants et reconstructeurs à base de kératine ou d'huiles (huiles de coco, beurre de karité).
Privilégier les shampoings doux en base neutre sans additifs inutiles.
Éviter le sèche-cheveux.
D’autre part, elle recommande une alimentation équilibrée, riche en protéines et vitamines B, ainsi que des cures régulières de compléments capillaires.
Chapitre 6 : Muscler son mental, cultiver l’optimisme
Le chapitre 6 du livre "Belle et bien dans son âge" montre qu'il est possible de "cultiver son jardin intérieur" malgré les doutes.
Il invite à prendre le temps de découvrir ses envies profondes pour se sentir alignée avec soi-même. Car c'est en explorant ses passions qu'on trouve de nouveaux chemins.
"Pour se sentir bien, alignée avec soi, il est super important d’entretenir sa force vitale, de se regarder avec lucidité et en conscience pour déterminer ce qui vraiment nous anime, nous pousse, nous motive. Prendre de l’âge, mûrir diraient certains, nous autorise ce scan de nos envies, de nos passions, de nos rêves. C’est vraiment le moment pour laisser tomber les "il faut que…" et d’aller vers les "j’ai envie de…", "je peux…". Et ça n’a aucune importance si cette exploration vous prend un peu de temps. Donnez-vous ce temps de la réflexion pour vous, juste pour vous !"
6.1 – Tout cela vous paraît difficile ? Insurmontable ?
Muscler son mental demande un entraînement quotidien, comme le font les sportifs, affirme l’auteure.
Selon Natacha Dzikowski, nos pensées influencent directement notre réalité. Elle croit, dit-elle, en la loi d'attraction. Pour elle, des pensées négatives attirent des énergies négatives tandis que cultiver l'optimisme ouvre la porte au bonheur.
Pour cette raison, il est possible de reprendre le pouvoir sur son existence en changeant son état d'esprit.
6.2 – Comment entretenir sa force vitale ?
L'auteure "Belle et bien dans son âge" partage ici 3 étapes pour muscler son mental et sa force vitale.
- Étape n°1 : Apprendre à s'aimer vraiment
Natacha Dzikowski invite d'abord à développer l'autocompassion, l’empathie pour soi-même en apprenant à se parler avec douceur et à se récompenser pour ses succès.
- Étape n°2 : Renforcer sa confiance en soi
Via 5 règles :
S'honorer,
Éviter les comparaisons,
User de mots bienveillants envers soi,
Renoncer à la perfection,
S'accepter avec ses qualités et défauts, se réconcilier avec soi-même.
- Étape n°3 : Ne plus vivre obsédé par le passé, s’ouvrir aux possibles et "aimer voir devant"
L’auteure parle ici de combattre ce qu’elle nomme le syndrome du rétroviseur. Pour cela, nous devons "aimer voir", autrement dit accueillir le moment présent au lieu de ressasser le passé.
Aussi, pour Natacha Dzikowski, chacun a le pouvoir de créer sa propre réalité en changeant son interprétation des événements :
"Le réel n’existe pas, en fait. Chacun de nous crée son réel à partir de ce qu’il projette car nos projections deviennent nos perceptions. Et ce que nous percevons est basé sur nos interprétations. Notre interprétation du moment détermine donc notre perception de la réalité que nous vivons. Nous sommes donc responsables de la façon dont nous percevons ce que nous voyons. Par exemple, on peut interpréter une dispute amoureuse comme une raison supplémentaire de divorcer ou bien comme une opportunité d’apprendre et de rendre la relation plus solide et profonde. Dans le premier cas, vous créez un sentiment négatif, du stress et vous fabriquez un excès de cortisol accélérant ainsi le processus de vieillissement alors que dans le second cas, vous créez une stimulation constructive."
6.3 - Inventer son âge
Natacha Dzikowski termine ce chapitre de "Belle et bien dans son âge" en nous proposant d’ "inventer notre âge". Car c’est, écrit-elle, "une porte ouverte sur un infini de possibles" :
"Nous avons la liberté de choisir ce que prendre de l’âge va signifier pour nous, comment nous allons habiter notre âge, comment nous allons le construire, le décorer, le faire vibrer. C’est une opportunité fabuleuse. Prenez-la à bras-le-corps et donnez-vous l’opportunité d’être alignée avec vos choix de vie quels qu’ils soient. Nous sommes responsables de la taille de nos rêves. Personne ne peut décider à notre place de là où nous voulons aller, de comment nous allons vivre notre âge, le posséder et en habiter tous les recoins avec plaisir."
De même, l’auteure nous invite à considérer notre âge comme une maison de campagne à aménager pour soi, pas pour les autres. 50 ans est le moment rêvé pour explorer ses passions profondes, qui changent avec le temps. Il faut, insiste-elle, sortir de sa zone de confort et casser ses routines.
Pour cultiver sa joie de vivre, elle recommande enfin la méditation, la pleine conscience et des exercices de respiration : apprendre à observer ses pensées permet de s'en libérer.
Le sommeil est aussi primordial pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête.
Chapitre 7 : Je peux (enfin) faire comme j’ai envie
Natacha Dzikowski ouvre le dernier chapitre de son livre "Belle et bien dans son âge" en nous encourageant à embrasser la vie dont nous rêvons, sans nous laisser dicter notre conduite par les normes.
Elle affirme qu'avec l'âge, vient l'envie de sortir des faux-semblants, de laisser derrière soi les carcans qui enferment. La cinquantaine est ainsi une bonne occasion d’explorer de nouvelles voies, de rebondir et d’oser le changement.
Mais comment trouver le courage de franchir le pas quand la peur nous paralyse ? Comment dépasser nos doutes et nos appréhensions pour nous lancer dans l'inconnu ?
L'auteure partage sa méthode qui, selon elle, marche à tous les coups : refuser de se laisser intimider par ceux qui prétendent savoir ce que l'on peut ou ne peut pas faire. Écouter son intuition plutôt que les injonctions extérieures.
La plus grande aventure que nous puissions entreprendre consiste à devenir la personne que l'on rêve d'être, assure Natacha Dzikowski. À 50 ans, il est temps de se défaire des chaînes du conformisme pour embrasser notre véritable nature.
7.1 – Prendre de l’âge n’est pas un problème
Vieillir n’est pas un problème. "C’est la façon dont on le regarde qui l’est" écrit Natacha Dzikowski.
L’auteure de "Belle et bien dans son âge" nous appelle d’abord à ne plus confondre jeunesse et vitalité, la première étant un état d'esprit. Elle nous invite à considérer chaque année comme un cadeau, une chance qui ouvre de nouvelles possibilités plutôt que comme une fatalité.
En fait, pour elle, la cinquantaine est le moment rêvé pour laisser derrière soi les faux-semblants et devenir qui on souhaite vraiment être.
7.2 – Quand le monde du travail nous regarde de travers
Dans cette partie assez longue du livre "Belle et bien dans son âge", Natacha Dzikowski aborde la difficulté de la cinquantaine sur le marché du travail, où les entreprises rechignent à recruter des seniors. Mais si perdre son emploi à cet âge est un choc, cela peut aussi être l'opportunité de se reconvertir, fait remarquer l’auteure.
Natacha Dzikowski insiste sur l'importance, dans ce cas, de procéder par étapes. De faire d'abord un bilan personnel pour définir ses objectifs avant de se lancer. Et de s'entourer d'une équipe de soutien, car on ne réussit pas seul rappelle-t-elle.
Ce qui est capital, ajoute-elle, est d’avoir suffisamment de lucidité pour évaluer ses atouts, et de détermination pour persévérer avec courage et volonté. Accepter l'insécurité financière et dépasser la peur de l’échec font aussi partie du changement de vie.
L’auteure relate avec détails sa propre histoire à ce sujet. Elle revient aussi sur plusieurs parcours inspirants de femmes qui ont créé leur entreprise avec succès après 50 ans dans la mode, les bijoux ou les accessoires. Leur point commun est d'avoir osé sortir de leur zone de confort en suivant leur intuition.
7.3 – Je me débarrasse de tout ce qui m’ennuie et des obligations inutiles
Natacha Dzikowski encourage ses lectrices à faire, lorsqu’elles ont 50 ans, du tri dans leur vie. À se débarrasser des personnes ou obligations futiles qui les ennuient. L'idée n'est pas de devenir ermite, mais de créer de l'espace pour accueillir la nouveauté :
"Donnez-vous le droit de choisir votre environnement, votre temps et votre planning."
- Revoir son écosystème affectif et relationnel
Pour Natacha Dzikowski, c'est en élargissant ses cercles d’amis, de connaissances, en faisant circuler l'air nouveau, en essayant de nouvelles activités qu'on ouvre la porte aux surprises. Celle-ci recommande alors de revisiter son écosystème affectif, de laisser certains liens se défaire et d'en créer de nouveaux.
"On ne peut pas forcément choisir sa famille, mais nous sommes responsables de l’environnement que nous créons autour de nous. Nous choisissons notre écosystème affectif et relationnel. Rien ne nous oblige à rester dans un cadre qui ne nous convient plus, avec des personnes dont nous ne partageons plus les valeurs ou les centres d’intérêt. Nous avons le droit de changer. Notre écosystème affectif et relationnel est le reflet de notre état d’esprit. Certains liens se défont et cela ne doit pas vous entraîner dans des abîmes de culpabilité. D’autres se créent."
L'âge autorise cette liberté.
- Changer de tête et de garde-robe
Pourquoi, par ailleurs, ne pas changer de look si on en a envie ? Histoire de booster notre estime de soi.
Il est en effet essentiel de se plaire à tout âge. C’est pourquoi l’auteure de "Belle et bien dans son âge" nous encourage à vider nos placards et là aussi, accueillir du neuf et du nouveau : "il y a pléthore de plateformes digitales de vente de vêtements de seconde main. C’est facile et vous avez la satisfaction de vous constituer une réserve pour vous faire des cadeaux".
7.4 – Osez tout ce qui vous tente
À ce propos, Natacha Dzikowski nous pousse également à oser explorer de nouvelles voies en matière de style, de look et de séduction après 50 ans. Elle nous recommande d’adapter notre maquillage et notre garde-robe sans nous soucier du regard des autres.
Ainsi, pour l’auteure, chacune peut mener la vie dont elle rêve à tout âge et non celle que la société attend d'elle. La séduction n'a pas d'âge, il suffit de s'aimer soi-même et de prendre soin de son corps.
"Le rejet de soi ne peut pas vous ouvrir les portes d’une relation amoureuse et/ou sexuelle épanouissante. Se sentir séduisante vous demandera peut-être des efforts en termes d’hygiène de vie, d’habitudes alimentaires à changer, d’activités sportives à réintégrer dans votre quotidien, oui probablement, mais le bénéfice que vous aurez en retour en vaut vraiment la peine."
Natacha Dzikowski conclut par un message d'optimisme, incitant toutes les femmes à embrasser leur maturité avec confiance et audace :
"Allez, soyez sans complexe ! Bien dans votre âge, dans votre vie et haut les cœurs pour les 50 prochaines années !"
7.5 – Ma méthode en 4 étapes
Pour clore ce chapitre, l'auteure de "Belle et bien dans son âge" résume en 4 étapes sa méthode pour transformer positivement sa vie après 50 ans :
Faire le point sur ses motivations profondes.
Recenser ses forces et ses limites.
Se donner suffisamment de temps.
Mettre toutes les chances de son côté en se faisant accompagner.
Selon elle, visualiser ses objectifs (avec un "vision board") est aussi une technique puissante pour passer à l'action.
Conclusion de Natacha Dzikowski
Dans sa conclusion, Natacha Dzikowski nous invite à prendre de l'âge avec enthousiasme et confiance.
"Que puis-je vous laisser en guise de conclusion de ce guide pratique de l’âge sans complexe ? De la joie j’espère, celle d’avoir envie d’habiter votre âge, de l’occuper pleinement, d’avoir envie de le rendre confortable en prenant soin de vous, de votre corps, ce merveilleux véhicule terrestre. Il est votre compagnon de route et plus tôt vous l’aimerez et en prendrez soin, plus vous pourrez profiter de tous vos âges. Vous avez tout le temps de décider d’être vieille un jour. Ne laissez pas le regard des autres vous définir, vous donner une place que vous ne choisissez pas. (…) L’âge est une chance. Être vivante est bien plus stimulant et enthousiasmant qu’être jeune."
Finalement, l’auteure de "Belle et bien dans son âge" nous exhorte ici d’habiter pleinement notre maturité, en prenant soin de notre corps et de notre mental. Le but est, souligne-t-elle, de toujours cultiver notre joie de vivre en refusant les images négatives liées à l'âge, afin de rester maîtresse de notre existence.
Conclusion de "Belle et bien dans son âge. Ma méthode pour prendre de l’âge sans vieillir" de Natacha Dzikowski
Les idées clés
Dans son ouvrage "Belle et bien dans son âge", Natacha Dzikowski dévoile une méthode complète et inspirante pour vivre sereinement la cinquantaine.
Voici les 2 grandes idées qui se dégagent au terme de cette lecture.
Prendre soin de son corps est la clé de la longévité
L'auteure insiste sur l'importance de comprendre et d'écouter les besoins de son corps. En adoptant une alimentation saine, une activité physique régulière et en respectant son rythme biologique, on booste son énergie et on ralentit le vieillissement.
Le sport, en particulier, est indispensable pour préserver sa masse musculaire, sa souplesse et un mental d'acier.
Cultiver l'optimisme permet de vieillir sereinement
Selon l'auteure de "Belle et bien dans son âge", il est possible de muscler son mental comme un sportif entraîne ses muscles.
En pratiquant la gratitude, l'autocompassion, la pleine conscience, nous développons notre résilience face aux aléas de la vie. Apprendre à s'aimer, sortir de sa zone de confort et réaliser ses rêves permettent aussi de trouver un nouvel élan à 50 ans.
Que vous apportera la lecture de "Belle et bien dans son âge" ?
Grâce aux conseils concrets de Natacha Dzikowski, vous aurez toutes les clés pour aborder la cinquantaine avec confiance et sérénité.
Que ce soit sur le plan physique, psychologique ou cosmétique, vous saurez prendre soin de vous de manière globale au quotidien. Vous apprendrez à écouter votre corps, resterez active, positive et épanouie.
Loin des clichés sur l'âge, vous saurez comment préserver votre vitalité et votre beauté durablement.
En somme, je recommande vivement ce livre inspirant à tous les quadras, quinquas et plus qui souhaitent vivre en pleine santé, se sentir belles et bien dans leur âge.
Le livre "Belle et bien dans son âge" vous accompagnera avec bienveillance pour transformer cette étape charnière de la vie en une formidable opportunité de renouveau !
Points forts :
Des conseils pratiques et accessibles pour comprendre ce qui change vers la cinquantaine, prendre soin de soi et s'épanouir à 50 ans.
L'approche globale du bien-être (alimentation, sport, mental, beauté).
Un ton bienveillant et encourageant qui donne envie de passer à l'action, de se prendre en main, et qui inspire du positif sur un sujet souvent tabou et empreint de négatif.
De nombreux témoignages et expériences personnelles inspirants.
Points faibles :
Certaines recommandations peuvent sembler difficilement applicables à certains au quotidien (jeûne, monodiète, etc.).
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu "Belle et bien dans son âge. Ma méthode pour prendre de l’âge sans vieillir"? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Natacha Dzikowski "Belle et bien dans son âge. Ma méthode pour prendre de l’âge sans vieillir"
Visitez Amazon afin d'acheter le livre de Natacha Dzikowski "Belle et bien dans son âge. Ma méthode pour prendre de l’âge sans vieillir"
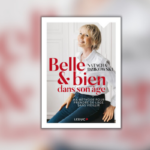 ]]>
]]>Résumé de "Manuel du langage corporel" de Robert Mercier : Il nous parle de l'importance du non verbal dans la communication, dévoilant les principes clés du langage corporel, de la posture aux expressions faciales, et comment ces éléments influencent les interactions humaines. À travers des exemples concrets, Mercier nous apprend à décoder les signaux non verbaux et à éviter les erreurs courantes. Ce livre vous permet d'améliorer votre compréhension et votre efficacité dans les échanges personnels et professionnels.
Par Robert Mercier, 2021, 164 pages.
Note : cet article a été écrit par Rémi Bonnet du blog : L'action suit tes pensées.
Chronique et résumé de « Manuel du langage corporel » de Robert Mercier :
Chapitre 1 - Les types de langages.
Le paralangage.
Alors, qu'est-ce que le paralangage ?
Le paralangage est un aspect fondamental de la communication.
Il englobe les éléments vocaux qui accompagnent notre discours verbal.
Contrairement aux mots eux-mêmes, le paralangage inclut des aspects tels que le ton de la voix, l'intonation, le volume, le rythme et les pauses.
Ces éléments apportent des nuances émotionnelles et contextuelles qui enrichissent le message que nous transmettons.
Par exemple, imaginez une phrase prononcée avec une intonation montante.
Cette variation indique généralement une question, alors qu'une intonation descendante marque souvent une affirmation ou une certitude.
Le volume de la voix joue également un rôle crucial : un volume élevé peut signaler l'importance ou l'urgence d'un message, tandis qu'un volume plus modéré peut être perçu comme plus réfléchi ou moins pressant.
Les pauses, quant à elles, peuvent servir à créer du suspense ou à offrir un moment de réflexion.
Voyons maintenant comment le paralangage se révèle particulièrement important dans les interactions professionnelles et sociales.
Lors d'un entretien d'embauche, par exemple, un candidat peut exprimer sa confiance et son enthousiasme par un ton de voix dynamique et un rythme de parole fluide.
En revanche, en situation de négociation, un volume bien contrôlé et des pauses bien placées peuvent renforcer l'efficacité de la persuasion et l'autorité perçue.
Le paralangage est également un révélateur des émotions et des intentions non verbales.
Par exemple, une voix tremblante peut trahir une nervosité sous-jacente, même lorsque les mots prononcés sont positifs.
Donc, comprendre le paralangage nous permet non seulement d’interpréter plus précisément les messages des autres, mais aussi d'améliorer notre propre communication.
En somme, le paralangage, bien que subtil, joue un rôle crucial dans une interaction réussie et empathique.
En appréhendant ces nuances, nous pouvons faire une réelle différence dans la qualité de nos échanges et dans la compréhension mutuelle, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel.
La Proxémique.
La proxémique c’est l'utilisation de l'espace personnel dans la communication humaine.
Ce concept, développé par l'anthropologue Edward T. Hall dans les années 1960, examine comment vous utilisez et percevez l'espace autour de vous selon différents contextes culturels et sociaux.
Hall a identifié plusieurs zones de distance interpersonnelle, chacune correspondant à des types d'interactions spécifiques :
- Pour en savoir plus : La proxémie: comprendre l'espace personnel à travers les cultures.
1- La zone intime :
Elle s'étend de 0 à 45 cm.
Cette zone est généralement réservée aux relations très proches, comme celles entre partenaires ou membres de la famille.
La proximité dans cette zone permet une intimité physique et émotionnelle.
2 - La zone personnelle :
Elle va de 45 cm à 1,2 m.
Vous utilisez couramment cette zone dans les interactions amicales ou professionnelles, où un certain degré de confort est attendu sans intimité physique intense.
Cette distance permet une communication ouverte tout en maintenant une certaine réserve.
3 - La zone sociale :
Elle s'étend de 1,2 à 3,6 m.
Typique des interactions formelles et des échanges professionnels, cette distance est souvent adoptée lors des réunions ou des conversations avec des connaissances moins proches.
Elle favorise une communication respectueuse tout en préservant une certaine distance.
4 - La zone publique :
Elle dépasse 3,6 m et est utilisée pour les discours ou les présentations.
Cette distance permet de maintenir une certaine objectivité, l'orateur étant perçu comme distinct du public.
Cependant, la perception et l'utilisation de ces zones varient considérablement d'une culture à l'autre.
Par exemple, dans les cultures méditerranéennes, vous pouvez vous tenir plus près des autres, tandis que dans les cultures nord-européennes ou anglo-saxonnes, une distance plus grande est souvent préférée.
Ces différences sont dues à des normes culturelles distinctes concernant l'espace personnel et l'intimité.
Finalement, comprendre la proxémique est essentiel dans la communication interculturelle et professionnelle.
Une gestion appropriée de l'espace peut faciliter des interactions harmonieuses et éviter des malentendus.
Par exemple, une personne habituée à une grande distance physique pourrait percevoir une approche rapprochée comme intrusive, tandis qu'une personne provenant d'une culture plus tactile pourrait trouver une distance excessive froide et distante.
Ainsi, la proxémique joue un rôle crucial dans la manière dont vos messages sont reçus et interprétés.
Une connaissance approfondie de ces dynamiques permet d'améliorer vos échanges et d'éviter les conflits dus à des différences culturelles.
En fin de compte, maîtriser l'espace personnel contribue à des interactions plus fluides et plus respectueuses dans divers contextes sociaux et professionnels.
La Kinésique.
La kinésique est une discipline fascinante qui explore les mouvements corporels et leur rôle dans la communication non verbale.
Elle se concentre sur la manière dont les gestes, les postures, les expressions faciales et d'autres mouvements corporels transmettent des informations et des émotions.
En fait, la kinésique est un pilier fondamental de la communication humaine, souvent plus révélateur que les mots eux-mêmes.
Parce que les gestes sont l'un des aspects les plus analysés de la kinésique.
Leur signification peut varier considérablement d'une culture à l'autre.
Cependant, certains gestes, comme le sourire, ont une interprétation universelle.
Ce geste est généralement perçu comme un signe de convivialité et d'amitié dans la plupart des cultures.
En revanche, d'autres gestes peuvent être spécifiques à une culture particulière et nécessitent une compréhension contextuelle pour éviter les malentendus.
Les postures jouent également un rôle crucial dans la communication non verbale.
Elles reflètent souvent notre état émotionnel et notre attitude envers les autres.
Par exemple, une posture fermée, avec les bras croisés, peut signaler une attitude défensive ou un malaise.
En revanche, une posture ouverte, avec les bras détendus et les paumes visibles, est souvent interprétée comme un signe d'ouverture et d'accueil.
Ces variations posturales sont essentielles pour comprendre les dynamiques interpersonnelles et adapter vos propres comportements en conséquence.
De plus, les expressions faciales sont un autre aspect clé de la kinésique.
Elles ont la capacité d'exprimer des émotions telles que la joie, la tristesse, la colère ou la surprise.
Souvent, elles sont plus sincères que les mots utilisés pour décrire ces sentiments.
Les micro-expressions, ces variations subtiles et rapides du visage, peuvent révéler des émotions profondes et parfois inconscientes.
Ces indices fugitifs témoignent souvent de sentiments que nous ne verbaliserions pas immédiatement.
Au final, la kinésique joue un rôle fondamental dans notre compréhension des signaux non verbaux.
En développant votre aptitude à interpréter ces signes, vous pouvez améliorer votre communication et établir des relations plus profondes.
De plus, la capacité à décoder les gestes, les postures et les expressions faciales enrichit vos interactions avec les autres et vous permet de mieux comprendre les nuances de la communication humaine.
Chapitre 2- Les origines et l'évolution du langage corporel.
Pour commencer, le langage corporel, qui comprend gestes, postures et expressions faciales, est une forme essentielle de communication non verbale.
Son histoire est aussi fascinante que complexe, remontant à nos ancêtres préhistoriques.
Les premiers humains ont développé des formes de communication non verbale cruciales pour leur survie dans des environnements sociaux variés.
À leurs débuts, les manifestations du langage corporel étaient principalement des gestes et des postures utilisés pour exprimer des émotions, établir des hiérarchies sociales et coordonner les activités de groupe.
Ainsi, ces formes de communication renforçaient les interactions sociales nécessaires à la cohésion des groupes.
Puisque les gestes pour signaler la peur, la colère ou la joie étaient essentiels dans la vie quotidienne des premiers humains.
Toutefois, avec le temps, le langage corporel s'est considérablement affiné.
Chez les Homo sapiens, il est devenu un complément indispensable au langage verbal.
Les recherches anthropologiques montrent que des gestes spécifiques étaient utilisés pour renforcer les messages verbaux et faciliter la communication dans divers contextes.
Par exemple, lors de la chasse, les signes non verbaux aidaient à coordonner les actions des membres du groupe, tandis que dans les rituels sociaux, ils exprimaient des valeurs communes.
À mesure que les sociétés se complexifiaient et que les civilisations se développaient, le langage corporel a continué d’évoluer.
Les conventions culturelles ont enrichi le répertoire des signes non verbaux, chaque culture développant ses propres codes et significations.
Ainsi, le salut par poignée de main ou les gestes de respect, comme l'inclinaison de la tête, portent des significations profondes qui varient d'une culture à l'autre.
Ces gestes reflètent les valeurs et les normes sociales propres à chaque groupe.
Aujourd'hui, le langage corporel demeure crucial dans les interactions humaines.
Il complète le langage parlé et révèle souvent des émotions ou des intentions cachées.
De plus, les avancées en psychologie et en neurosciences ont approfondi notre compréhension des signaux non verbaux.
D'ailleurs, ces recherches montrent que le langage corporel joue un rôle clé dans la communication quotidienne et dans les relations interpersonnelles.
Il est devenu un outil indispensable pour saisir les subtilités des échanges humains.
En bref, le langage corporel est le fruit d'une longue évolution historique.
De ses premières formes primitives aux conventions culturelles modernes, il reste un élément central de la communication humaine.
Et sa capacité à exprimer des émotions et à compléter le langage verbal souligne son importance dans notre vie sociale.
Chapitre 3 - Comprendre le Langage Corporel : Le Positif et le Négatif.
Tout d'abord, le langage corporel est un élément essentiel de la communication humaine.
Il révèle souvent plus que les mots eux-mêmes et joue un rôle déterminant dans vos interactions et perceptions.
Vous pouvez classer le langage corporel en deux catégories principales : positif et négatif.
Ces deux aspects influencent fortement la manière dont vous vous comprenez et interagissez avec les autres.
Le langage corporel positif inclut des gestes et des postures qui favorisent une atmosphère ouverte et accueillante.
Par exemple, un sourire est un signe universel de bienveillance.
Un sourire sincère, associé à un contact visuel direct, transmet des sentiments d’accessibilité et de confiance.
De même, une posture ouverte, comme se tenir droit avec les épaules légèrement en arrière, montre de l'assurance et du respect.
Ces comportements non verbaux permettent de créer une connexion positive avec les autres.
En outre, les mouvements de tête en signe d’acquiescement et le fait de se pencher légèrement vers votre interlocuteur sont des indicateurs d’engagement et d’intérêt.
Ces gestes suggèrent que vous êtes pleinement présent et attentif à la conversation.
En revanche, le langage corporel négatif peut engendrer des malentendus et des barrières dans la communication.
Les bras croisés, par exemple, peuvent être perçus comme une posture défensive, même si ce n'est pas votre intention.
De plus, éviter le contact visuel peut donner l'impression de désintérêt ou de méfiance.
Un ton de voix tendu, associé à une posture rigide, peut également traduire de l'hostilité ou de l’inconfort.
D’autres signes de langage corporel négatif incluent des gestes agités ou des expressions faciales fermées, qui peuvent refléter de la nervosité ou de l’irritation.
Ces indices non verbaux peuvent freiner la communication et créer des tensions dans vos relations interpersonnelles.
En fin de compte, le langage corporel est un outil puissant pour exprimer vos émotions et intentions.
Parce que comprendre les nuances entre les signes positifs et négatifs vous permet d’améliorer vos interactions humaines et de favoriser une communication plus harmonieuse.
En prêtant attention aux détails du langage corporel, vous pouvez mieux interpréter les messages non verbaux des autres et adapter votre propre communication en conséquence.
Chapitre 4 - La Poignée de Main : Sa signification et ses implications.
Pour débuter, la poignée de main, souvent perçue comme un geste banal, joue en réalité un rôle crucial dans la communication non verbale et les dynamiques sociales.
Ce geste peut révéler beaucoup sur vous, en fonction de sa fermeté, de sa durée et du contexte dans lequel il se manifeste.
En général, une poignée de main ferme mais pas écrasante est perçue comme un signe de confiance et de respect.
Elle montre que vous êtes sûr de vous tout en respectant les limites de l’autre personne.
À l’inverse, une prise molle peut être interprétée comme un manque d’assurance ou d’engagement.
Elle peut aussi donner l’impression que vous n’êtes pas sincère ou réellement intéressé par l’interaction.
D'ailleurs, la durée du contact est également importante : une poignée de main trop brève peut sembler désintéressée, tandis qu’une poignée prolongée peut être perçue comme excessive ou intrusive.
Votre posture lors de la poignée de main est également déterminante.
Une posture ouverte et droite, avec les épaules en arrière, projette une image de confiance et d’engagement.
À l’inverse, une posture fermée, avec les bras croisés ou les épaules voûtées, peut signaler de la réticence ou un manque d’ouverture.
Pour que votre poignée de main soit perçue positivement, il est crucial que votre posture et votre geste soient en harmonie.
Un décalage entre ces deux éléments peut créer une impression incohérente et potentiellement négative.
Les mains elles-mêmes ajoutent une dimension supplémentaire au geste.
Les gestes des mains, comme un léger toucher des doigts ou un mouvement de balancement pendant la poignée de main, peuvent accentuer la chaleur ou la cordialité du geste.
Il est également essentiel que vos mains soient propres et bien entretenues pour maintenir une image soignée et professionnelle.
Des détails comme des ongles soignés et une peau propre contribuent à l’impression globale que vous laissez.
En somme, la poignée de main est bien plus qu’un simple geste de salutation.
Elle est chargée de signification et son impact est amplifié par la posture et l’état des mains.
Une poignée de main appropriée, accompagnée d’une posture ouverte et de mains bien entretenues, peuvent jouer un rôle crucial dans la formation d’une première impression positive lors des interactions sociales.
Chapitre 5 - Calibrer votre langage corporel : Réussir votre première impression.
Pour commencer, calibrer votre langage corporel est essentiel pour faire une première impression réussie.
Le langage corporel constitue une part importante de notre communication, souvent plus influente que les mots que nous utilisons.
La première impression repose largement sur des signaux non verbaux tels que la posture, les expressions faciales et les gestes.
Pour optimiser votre première impression, adoptez une posture ouverte et détendue.
Tout d'abord, gardez une posture droite avec les épaules légèrement en arrière et avancez avec assurance : cela communique confiance et professionnalisme.
Cependant, évitez de croiser les bras ou de vous replier sur vous-même, car ces gestes peuvent être interprétés comme des signes de fermeture ou d’insécurité.
Le contact visuel est tout aussi essentiel.
Un regard direct mais non intimidant établit une connexion et montre votre engagement et votre sincérité.
Un sourire authentique joue également un rôle crucial : il crée une atmosphère chaleureuse et accueillante.
Et assurez-vous que votre sourire soit naturel et non forcé, afin qu'il reflète réellement une attitude positive.
De plus, soyez attentif à vos gestes et à votre tonalité.
Des gestes ouverts et mesurés, ainsi qu’une voix claire et calme, renforcent l’impression de confiance et de compétence.
Évitez les mouvements nerveux ou les tics qui peuvent distraire ou suggérer une anxiété sous-jacente.
En bref, pour réussir votre première impression, il est important de prêter attention aux détails et de maîtriser votre langage corporel.
Car une posture ouverte, un bon contact visuel, un sourire sincère et des gestes contrôlés peuvent profondément influencer la perception des autres dès les premiers instants.
Chapitre 6 - Comprenez le langage non verbal pour décoder les émotions et les intentions.
Pour débuter, apprendre à "lire" les autres passe par la compréhension du langage non verbal, ce qui vous permettra de mieux saisir leurs émotions et intentions.
Puisque chaque partie du corps donne des indices précieux pour interpréter ce que les gens ressentent ou pensent réellement.
Les mains sont particulièrement révélatrices.
Quand une personne montre ses paumes, cela indique souvent sincérité et ouverture.
En revanche, des mains fermées ou en retrait peuvent signaler une réserve ou une attitude défensive.
Les gestes des mains, comme les mouvements rapides ou hésitants, peuvent aussi révéler des sentiments de nervosité ou d'enthousiasme.
Les pieds jouent un rôle crucial dans la communication non verbale.
L'orientation des pieds montre l'engagement d'une personne dans une conversation.
Si quelqu'un se tourne vers vous avec les pieds dirigés vers vous, cela témoigne d'intérêt.
À l'inverse, si ses pieds pointent vers la sortie, cela peut suggérer qu'il souhaite mettre fin à la conversation ou quitter la situation.
Les bras, quant à eux, signalent divers états émotionnels.
Les bras croisés sont souvent interprétés comme un signe de protection ou de désaccord.
Cependant, cette posture peut aussi simplement refléter un besoin de confort ou de sécurité.
Les mouvements des bras, comme les gestes d'accompagnement pendant la parole, offrent également des indices sur l'engagement et le confort de la personne.
Le visage est un miroir précieux des émotions.
Les expressions faciales, telles que les sourires ou les froncements de sourcils, donnent des indications immédiates sur des sentiments de joie ou de frustration.
Les yeux jouent un rôle central dans la communication non verbale : un contact visuel direct peut signifier intérêt et confiance, tandis qu'un regard évité peut signaler inconfort ou tromperie.
La tête et le corps complètent ce tableau.
Un hochement de tête est souvent interprété comme un signe d'accord, tandis qu'une inclinaison de la tête peut indiquer une écoute attentive.
Les mouvements du corps, comme se pencher en avant ou reculer, révèlent l'engagement ou le désintérêt de la personne.
De plus, la respiration, qu'elle soit rapide ou saccadée, peut trahir des sentiments d'anxiété ou de stress, fournissant ainsi un aperçu supplémentaire de l'état émotionnel de quelqu'un.
En combinant ces éléments, vous obtenez une vue d'ensemble plus précise des sentiments et des intentions des autres.
Cette compréhension améliore la communication en rendant les échanges plus empathiques et efficaces.
Donc, analyser le langage non verbal vous aide non seulement à interpréter les émotions des autres, mais aussi à adapter votre propre comportement pour favoriser des interactions plus harmonieuses.
Chapitre 7 - Identifier un mensonge : Les signes et indices.
Tout d'abord, identifier un mensonge peut être plus facile en observant les signes subtils que le corps révèle.
Lorsque quelqu'un ment, son corps émet souvent des indices non verbaux qui trahissent ses véritables sentiments ou intentions.
L'un des signes les plus révélateurs est la cohérence des expressions faciales avec le discours.
Les expressions faciales sincères correspondent généralement aux émotions que la personne prétend ressentir.
À l'inverse, un sourire forcé ou une expression qui ne correspond pas au contexte émotionnel peut indiquer une dissimulation.
Les changements dans le contact visuel sont également significatifs : une personne qui ment peut éviter le regard ou, au contraire, fixer intensément les yeux de son interlocuteur pour paraître honnête.
Les gestes et les postures peuvent aussi trahir un mensonge.
Par exemple, si quelqu'un se touche fréquemment le visage, ajuste ses vêtements ou se gratte, il peut essayer de gérer le stress lié à la dissimulation.
De même, les mouvements corporels comme croiser les bras ou les jambes peuvent signaler une tentative de se protéger ou de se défendre.
Les variations dans le ton de la voix sont également révélatrices.
Les hésitations ou les changements de rythme peuvent indiquer un manque de sincérité.
Une voix qui devient plus aiguë ou qui présente des variations inattendues peut révéler de la nervosité.
La manière dont une personne construit ses phrases peut aussi fournir des indices.
Les mensonges sont souvent accompagnés d'explications excessivement détaillées ou de justifications compliquées pour masquer la vérité.
Une explication trop élaborée peut suggérer une tentative de tromperie.
Les expressions faciales jouent un rôle crucial dans la communication émotionnelle humaine.
Elles reflètent souvent les sentiments internes, mais peuvent également être influencées par des processus cognitifs plus complexes.
En observant les expressions faciales, telles que les sourires, les froncements de sourcils ou les regards fuyants, vous pouvez déduire une large gamme d’émotions, allant de la joie et la colère à la tristesse et la confusion.
En observant attentivement ces signes non verbaux, vous pouvez discerner plus facilement la vérité derrière les mots.
Le langage corporel, associé à une écoute attentive, vous permet souvent de mieux comprendre les véritables intentions d’une personne et de détecter les mensonges plus efficacement.
Chapitre 8 - Les indices non verbaux : Les gestes, tics et micro-expressions.
En premier lieu, les gestes, les tics et les micro-expressions jouent un rôle crucial dans la communication non verbale.
Ils offrent des indices précieux sur les émotions et les états mentaux des individus.
Les gestes peuvent renforcer ou contredire les messages verbaux.
Par exemple, un sourire accompagné d'une attitude ouverte peut signaler de la sincérité, tandis qu'un geste fermé, comme croiser les bras, peut indiquer de la réticence ou de la défensive.
Les tics, tels qu’un clignement excessif des yeux ou une grimace involontaire, sont souvent des signes de stress ou de malaise.
Ces mouvements répétés, généralement inconscients, peuvent révéler des sentiments internes que les mots seuls ne dévoilent pas.
Ils fournissent un aperçu des tensions ou des émotions non exprimées verbalement.
Les micro-expressions, quant à elles, sont des manifestations fugaces des émotions.
Elles durent généralement moins d'une fraction de seconde et sont souvent difficilement contrôlables.
Ces expressions brèves mais intenses révèlent les véritables sentiments.
Elles apparaissent lorsque quelqu'un tente de dissimuler une émotion, mais que cette tentative échoue brièvement, laissant transparaître l’état émotionnel réel.
Ainsi, reconnaître et comprendre ces expressions faciales est essentiel dans divers contextes professionnels et personnels.
Par exemple, dans la psychologie clinique, la capacité à identifier les micro-expressions peut aider les thérapeutes à évaluer les émotions des patients de manière plus précise.
De même, dans les négociations professionnelles, lire les expressions faciales peut permettre d’adapter ses propres stratégies et de répondre de manière plus appropriée aux émotions des interlocuteurs.
Alors, apprendre à décoder ces signes subtils enrichit la qualité des interactions humaines.
Une meilleure reconnaissance des expressions faciales permet de développer des relations plus empathiques et d'éviter les malentendus en offrant un aperçu plus profond des sentiments non exprimés verbalement.
Une attention accrue aux expressions faciales contribue ainsi à une communication plus authentique et efficace, favorisant des échanges plus clairs et harmonieux.
En conclusion, les gestes, les tics et les micro-expressions jouent un rôle vital dans la communication non verbale.
Ils fournissent des indices essentiels sur les émotions et les états mentaux des individus.
En apprenant à reconnaître ces signes, vous pourrez améliorer votre compréhension des autres, ajuster vos propres comportements et favoriser des interactions plus sincères et efficaces.
Chapitre 9 - Comprendre les différences culturelles dans le langage corporel.
Tout d'abord, les différences culturelles dans le langage corporel sont essentielles pour une communication interculturelle réussie.
Les gestes, les expressions faciales et la posture varient grandement d'une culture à l'autre, ce qui peut entraîner des malentendus entre personnes de milieux culturels différents.
Prenons l'exemple du contact visuel.
Dans les sociétés occidentales, un regard direct est souvent perçu comme un signe de sincérité et de confiance.
Cependant, dans certaines cultures asiatiques, un contact visuel prolongé peut être interprété comme un défi ou une impolitesse.
La modestie, dans ces cultures, se manifeste souvent par un regard abaissé.
Les gestes varient également d'une culture à l'autre.
Aux États-Unis, le geste "OK" avec le pouce et l'index formant un cercle est généralement perçu positivement.
En revanche, en Grèce et au Brésil, ce même geste peut être considéré comme offensant.
De même, les poignées de main diffèrent : aux États-Unis, une poignée de main ferme est souvent perçue comme un signe de confiance, tandis qu'en Asie du Sud-Est, une poignée de main plus légère est généralement préférée pour respecter les hiérarchies sociales.
Les expressions faciales portent aussi des significations culturelles distinctes.
Par exemple, un sourire est souvent associé au bonheur dans de nombreuses cultures.
Toutefois, dans certains contextes, il peut également servir à dissimuler des émotions négatives ou des malaises.
Ces variations culturelles soulignent l'importance de comprendre les normes du langage corporel pour éviter les malentendus.
En étant sensibilisé aux différences interculturelles, vous pouvez favoriser des interactions respectueuses et efficaces avec des personnes de cultures différentes.
Chapitre 10 - La Communication non verbale et le genre.
Pour débuter, la communication non verbale joue un rôle crucial dans la perception et l’expression du genre.
Les gestes, les postures et les expressions faciales transmettent des messages aussi puissants que les mots.
Cette forme de communication est profondément influencée par les normes culturelles et les stéréotypes de genre.
Dès l’enfance, vos comportements non verbaux sont façonnés par les attentes sociétales.
Ces attentes définissent ce qui est considéré comme approprié pour chaque genre.
Par exemple, dans de nombreuses cultures, les hommes sont souvent encouragés à adopter des postures expansives et dominantes.
Ils se tiennent fréquemment debout avec les jambes écartées ou occupent beaucoup d’espace, ce qui est associé à des traits de leadership et de pouvoir.
En revanche, les femmes sont souvent socialisées pour adopter des postures plus fermées et réservées, ce qui est perçu comme des comportements de soumission ou de modestie.
Ces normes influencent également la manière dont vous interprétez les signaux non verbaux.
Une femme qui occupe beaucoup d’espace peut être perçue comme agressive ou non conforme aux normes traditionnelles de genre.
De même, un homme qui utilise des gestes plus délicats peut être jugé comme moins assertif.
Ainsi, les attentes sociétales dictent souvent la façon dont vos comportements non verbaux sont reçus et interprétés.
Les perceptions de genre évoluent et reconnaissent désormais la diversité des expressions de genre.
Cela souligne l’importance de réévaluer les normes non verbales.
Puisque prendre conscience des biais non verbaux liés au genre est crucial pour favoriser une communication plus inclusive.
Une telle approche peut refléter une gamme plus large d’identités et d’expressions de genre.
En conclusion, la communication non verbale et les attentes de genre sont étroitement liées.
Vos gestes et postures sont influencés par les normes sociétales qui définissent ce qui est considéré comme approprié pour chaque genre.
Donc, une compréhension approfondie de ces biais peut vous aider à promouvoir une communication plus respectueuse et inclusive, reflétant la diversité des expressions de genre.
Chapitre 11 - Maîtriser le langage du corps pour réussir dans divers contextes.
Pour commencer, le langage du corps joue un rôle fondamental dans la réussite de vos interactions, que ce soit lors de prises de parole en public, de rendez-vous, d’entretiens d’embauche ou de négociations.
Ce langage non verbal peut soit soutenir vos propos, soit les contredire, influençant ainsi la perception que les autres ont de vous.
Lors de la prise de parole en public, il est crucial d’adopter une posture ouverte et une gestuelle maîtrisée.
Une posture droite et un contact visuel régulier transmettent confiance et autorité.
Évitez les gestes distrayants, comme vous frotter les mains ou croiser les bras, car ils peuvent détourner l’attention et réduire l’impact de votre discours.
Dans un rendez-vous, qu’il soit professionnel ou personnel, le langage corporel est déterminant pour instaurer la confiance.
Un sourire sincère et une poignée de main ferme mais non écrasante créent une première impression favorable.
Les signes non verbaux, comme hocher la tête et adopter une posture ouverte, montrent une écoute active et favorisent une interaction fluide.
En entretien d’embauche, la cohérence entre vos paroles et votre langage corporel est essentielle.
Une posture droite, un contact visuel direct et des gestes mesurés renforcent l’image d’un candidat sûr de lui et engagé.
Évitez de croiser les bras, car cela peut être perçu comme une attitude défensive ou fermée, diminuant ainsi votre efficacité.
Lors de négociations, le langage corporel peut influencer significativement les perceptions et les décisions.
Utilisez des gestes pour illustrer des points importants et adoptez une posture ouverte pour favoriser une attitude collaborative.
Les gestes tels que tapoter du doigt ou regarder fréquemment l’horloge peuvent signaler impatience ou hostilité, ce qui peut nuire à l’accord souhaité.
En résumé, maîtriser le langage corporel est essentiel pour renforcer vos messages verbaux, établir des relations positives et améliorer vos chances de succès dans diverses situations de communication.
Adapter votre langage corporel en fonction du contexte vous permet d’optimiser vos interactions et de laisser une impression favorable.
Conclusion sur "Manuel du langage corporel" de Robert Mercier.
Le "Manuel du langage corporel" de Robert Mercier est un livre très pertinent, se distinguant par sa profondeur d'analyse et sa clarté pédagogique.
En tant que lecteur, vous trouverez dans ce livre une ressource précieuse pour comprendre et maîtriser le langage corporel.
De plus, Robert Mercier aborde le langage corporel de manière méthodique, en intégrant des concepts clairs et des exemples pertinents.
Il décompose les éléments complexes du langage non verbal en principes accessibles, facilitant ainsi votre compréhension et l'application des idées présentées.
Le livre est divisé en sections bien structurées, chacune traitant un aspect spécifique du langage corporel.
Cette organisation vous aide à progresser de manière logique, en passant des bases aux applications plus avancées.
Les transitions entre les sections sont fluides, renforçant ainsi la cohérence du texte.
Mercier utilise des phrases courtes et des explications directes, rendant le contenu facile à suivre et à assimiler.
L’un des points forts de l’ouvrage est sa capacité à rendre le langage corporel accessible à un large public.
Mercier évite les termes techniques excessifs et opte pour une langue simple, favorisant ainsi votre compréhension.
Cette clarté est particulièrement bénéfique pour ceux qui découvrent ce sujet.
De plus, les exemples concrets et les illustrations enrichissent le texte et facilitent votre apprentissage.
Ce que ce livre « Manuel du langage corporel » m’a apporté ?
Dans l'ensemble, je savais à peu près tout ce qui se trouvait dans ce livre.
Cependant, j'ai tout de même pu approfondir mes connaissances sur le langage corporel.
Ce livre ne m'a certes rien appris de nouveau, mais il m'a permis d'approfondir ce que je savais déjà.
Donc, même si, comme moi, vous avez déjà des connaissances sur le langage corporel, je vous le recommande vivement.
Car il est facile à lire et à comprendre, et il vous apprendra forcément quelque chose.
Rémi Bonnet du blog L'action suit tes pensées.
Les points forts et points faibles du "Manuel du langage corporel" :
Points forts :
Rapide à lire et va droit au but.
Il offre une excellente introduction aux principes fondamentaux du langage corporel.
Des exemples concrets et des études de cas qui rendent les concepts plus tangibles et applicables dans votre vie quotidienne.
Point faible :
Manque de nuance sur le langage corporel, trop général.
Ma note : ★★★★☆
Avez-vous lu le livre "Manuel du langage corporel" de Robert Mercier ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Robert Mercier "Manuel du langage corporel"
Visitez Amazon afin d'acheter le livre de Robert Mercier "Manuel du langage corporel"
 ]]>
]]>Résumé de "Kilomètre zéro" de Maud Ankoua : ce roman initiatique nous entraîne dans le parcours de Maëlle, une jeune cadre surbookée qui, pour tenir une promesse faite à son amie mourante, s'envole pour le Népal et vit une transformation intérieure. Au rythme d'un trek dans l'Himalaya ponctué d'enseignements de sagesse, de rencontres inspirantes et d'une histoire d'amour aussi inattendue qu'intense, Maëlle va en effet retrouver le chemin de son cœur et découvrir la clé du bonheur en elle.
Par Maud Ankoua, 2017, 304 pages.
Chronique et résumé de "Kilomètre zéro" de Maud Ankoua
Chapitre 1 - Regret ou remords ?
1.1 Une bien triste nouvelle
Maëlle, une jeune femme ambitieuse et surbookée, travaille d'arrache-pied dans une start-up parisienne dont elle est la directrice financière. Alors qu'elle s'apprête à partir en vacances après une période intense au bureau, elle reçoit un appel mystérieux de son amie Romane qui insiste pour la voir de toute urgence.
Intriguée par le ton grave de cette dernière, Maëlle accepte de la retrouver à l'adresse indiquée le lendemain matin.
Le rendez-vous est donné à l'Institut Curie, ce qui inquiète immédiatement Maëlle. Ses craintes se confirment lorsque Romane lui annonce qu'elle se bat contre un cancer depuis plusieurs mois. Choquée et peinée, Maëlle peine à trouver les mots. Elle suit son amie jusqu'à la salle de chimiothérapie, un lieu angoissant qui la met face à la dure réalité de la maladie.
1.2 L’histoire improbable du manuscrit
Pendant la perfusion de Romane, cette dernière se livre. Elle explique avoir rencontré un chercheur américain, Jason, lors d'une mission à Katmandou. Cet homme lui a parlé d'un mystérieux manuscrit népalais contenant le secret d'une méthode ancestrale pour guérir du cancer. D'abord sceptique, Romane a fini par croire en cette idée lorsque Jason lui a annoncé avoir retrouvé ce texte.
Trop faible pour faire le voyage, Romane supplie Maëlle de se rendre à sa place à Katmandou pour récupérer le précieux manuscrit des mains de Jason. Partagée entre son esprit rationnel qui la pousse à se méfier et son envie d'aider son amie, Maëlle commence par refuser catégoriquement. Mais devant l'insistance de Romane qui lui rappelle qu'elle ne lui a jamais rien demandé en seize ans d'amitié, la jeune femme finit par céder, à contrecœur.
De retour au bureau passablement chamboulée, Maëlle affronte son patron qui ne comprend pas son absence. Incapable d'expliquer la situation, elle quitte le travail bouleversée et rentre chez elle. Toute la journée, elle se torture l'esprit : doit-elle vraiment partir pour le Népal comme promis à Romane ? Cette histoire de manuscrit lui paraît rocambolesque, mais l'idée de décevoir son amie malade lui est insupportable.
1.3 Un départ précipité
Après des heures à tergiverser, Maëlle s'apprête à ouvrir l'enveloppe mystérieuse que Romane lui a remis. À l'intérieur, elle découvre stupéfaite un billet d'avion pour Katmandou à son nom, ainsi qu'une lettre de Romane la suppliant de partir dès le lendemain. Prise au piège par sa promesse, Maëlle comprend qu'elle n'a plus le choix…
C'est ainsi que pour honorer son amitié et malgré ses doutes, elle s'envole à contrecœur pour le Népal, avec l'espoir fou de trouver ce remède miracle qui pourrait sauver Romane.
Chapitre 2 - Avec des yeux d’enfant
2.1 Une arrivée difficile
Dans le deuxième chapitre de "Kilomètre zéro" de Maud Ankoua, Maëlle découvre Katmandou et ses environs. Maya, l'amie de Romane qui tient l'hôtel Mandala où elle est descendue, la guide.
Dès son arrivée au Népal, Maëlle est décontenancée par le dépaysement et le choc des cultures. Tout la déstabilise, des embouteillages chaotiques de la capitale aux coupures d'électricité quotidiennes de l'hôtel, en passant par l'absence de réseau pour son téléphone.
Épuisée et à cran, elle peine à s'adapter à ce nouvel environnement qu'elle juge arriéré et inconfortable.
2.2 Une contrariété de plus
Sa contrariété s'accentue lorsqu'elle apprend par une lettre que Jason, l'homme qui doit lui remettre le mystérieux manuscrit népalais, est parti précipitamment dans l'Himalaya. Il lui faudra le rejoindre là-bas, accompagnée d'un certain Shanti, guide et ami de Jason.
Alors qu'elle attend Shanti, Maya propose à Maëlle une visite de Bodnath, l'un des principaux sanctuaires bouddhistes du pays. La propriétaire de l'hôtel tente d'ouvrir les yeux de la jeune femme sur la beauté des lieux et de l'initier à la méditation. Mais Maëlle, obnubilée par ses tracas professionnels et l'absence de réseau, peine à lâcher prise.
2.3 Le défi lancé par Maya
Face à la mauvaise volonté de Maëlle, Maya la met au défi de poser un regard neuf sur les choses, comme un enfant qui découvre le monde, sans a priori ni jugement. Elle l'invite à vivre pleinement l'instant présent et à faire de ce voyage imprévu une expérience enrichissante, malgré l'inconfort :
"Chaque instant que tu perds à être malheureuse ne te sera jamais rendu. Tu sais où commence ta vie, mais pas quand elle s’arrête. Une seconde vécue est un cadeau que nous ne devons pas gâcher. Le bonheur se vit maintenant."
Puis elle continue :
"Si tu penses qu’être ici est une obligation, tu vas vivre des moments difficiles ces prochaines heures, car la montagne est un miroir géant. Elle est le reflet de ton âme… Le reflet de ton état d’être. Tu as le choix de saisir l’opportunité qui t’est offerte, d’expérimenter ce voyage autrement, en arrêtant de comparer ce que tu es, ce que tu sais, ta culture, ton niveau de vie, ton confort. Si tu acceptes d’observer, sans juger, avec un regard neuf, en oubliant tout ce que tu as déjà vu, alors malgré toutes ces différences, tu découvriras un monde nouveau dans lequel tu pourras prendre un plaisir supérieur à celui que tu connais."
2.4 Maëlle accepte le défi
D'abord réticente, Maëlle accepte alors de jouer le jeu.
Ainsi, lors de leur promenade autour du grand stupa de Bodnath, la jeune femme s'efforce de mettre ses sens en éveil et de savourer la beauté des lieux. Mais elle peine encore à faire taire son mental qui la ramène sans cesse à ses repères et ses préoccupations.
Maya la rassure, la transformation demande du temps, comme tout apprentissage. L'envie et la persévérance sont les clés du succès, assure-t-elle.
Au terme du 2ème chapitre du livre "Kilomètre zéro" de Maud Ankoua, nous pressentons que le périple de Maëlle sera bien plus qu'une simple course au trésor.
Et c'est, en effet, un véritable cheminement intérieur qui commence, avec Maya comme guide spirituelle. Les bases d'une profonde remise en question sont posées, ouvrant la voie à de multiples révélations à venir.
Chapitre 3 - Pile ou face
Maëlle rencontre Shanti, le guide qui doit l'emmener rejoindre Jason dans l'Himalaya.
Effarée, elle découvre qu'il lui faudra marcher 5 à 6 jours si elle veut atteindre le monastère reculé où se terre le chercheur américain !
Shanti explique qu'ils ne peuvent pas y aller en hélicoptère car l'endroit abrite des réfugiés tibétains recherchés par les autorités.
Maëlle fait alors face à un vrai dilemme : elle veut aller au bout de sa promesse faite à Romane mais ne peut pas non plus s’absenter si longtemps de son travail. La jeune femme est d’abord tentée de renoncer. Mais Shanti la pousse dans ses retranchements : n'est-elle pas venue pour sauver son amie ? Ses peurs ne dictent-elles pas sa décision ?
Ébranlée mais convaincue par la sagesse de Shanti, Maëlle finit par écouter son cœur. Pour Romane, elle est prête à tenter l'aventure et à dépasser ses craintes. Le trek peut commencer.
Chapitre 4 - Chance ou malchance
4.1 Le départ pour l'Himalaya
Maëlle profite de ses derniers instants à Katmandou avant le grand départ pour l'Himalaya. Malgré les paroles rassurantes de Maya et la perspective d'un voyage en plusieurs étapes, la jeune femme est envahie par le doute et l'angoisse. Elle redoute cette expédition avec des inconnus dans un environnement hostile.
Le trajet en minibus jusqu'à Pokhara, point de départ du trek, est l'occasion pour Maëlle de mettre en pratique les conseils de Maya : observer ce nouveau monde avec des yeux neufs, sans a priori. Si les embouteillages, la conduite erratique et le manque de confort la rebutent au départ, elle s'efforce peu à peu de s'émerveiller de ces scènes de vie hautes en couleur.
Maud Ankoua fait ainsi parler Maëlle :
"Les mots de Maya résonnaient dans ma tête : "Expérimente chaque instant en amnésique." Je n’avais aucun mal, tout était si loin de ce que je connaissais. Cette route, empruntée par les camions surpeuplés, les vélos rafistolés, les vaches errantes cherchant un brin d’herbe à ruminer m’offrait des scènes improbables. (…) Dans un pays comme le Népal, il est facile pour moi de constater la nouveauté, puisque rien ne m’est familier ! Ce qui est plus difficile, c’est de ne pas le critiquer ! Parce qu’immédiatement je compare avec ce que je connais. Je me rends compte que j’émets un commentaire sur tout."
4.2 Les premiers enseignements de sagesse de Shanti
Shanti pousse plus loin la réflexion en invitant Maëlle à être maître de ses émotions. Lorsqu'un chauffard manque de les percuter, il lui explique que sa colère ne dépend que d'elle. Rester dans le ressentiment ne fait que la desservir : "si nous admettons que le bonheur prend naissance en nous et que rien ne peut le déséquilibrer, nous verrouillons l’accès aux situations extérieures toxiques" fait-il observer à Maëlle. Un enseignement qui fait son chemin dans l'esprit de la jeune femme.
Après une halte chez une guérisseuse qui leur offre une tisane aux vertus revigorantes, un contretemps les retarde. Karma, le chauffeur, a raté une sortie. Shanti relativise en racontant à Maëlle l'histoire du vieil homme et de son cheval, qui illustre la relativité de la chance et de la malchance : un aléa peut toujours cacher une opportunité.
Le chapitre de "Kilomètre zéro" se clôt sur une note gourmande et chaleureuse : la découverte émerveillée par Maëlle du "dal bhat", plat népalais typique, savouré face à un panorama époustouflant sur l'Himalaya. Ces quelques heures de route ont déjà éveillé chez l'héroïne de nouvelles perspectives. Son cheminement intérieur semble bel et bien enclenché, tandis que l'aventure du trek s'apprête à commencer.
Chapitre 5 - Refus de priorité
5.1 Au départ du trek
Maëlle et son équipe arrivent à Kande, point de départ du trek. La jeune femme rencontre les porteurs Nishal et Thim, neveu de ce dernier, ainsi que Goumar le cuisinier. Malgré la fatigue, elle ne peut s'empêcher d'admirer les sommets majestueux de l'Himalaya qui se dévoilent au fil de l'ascension.
Arrivés à l'étape du soir, Maëlle découvre avec déception le confort plus que spartiate de sa chambre. Mais la beauté du coucher de soleil sur les montagnes lui fait vite oublier ces désagréments. Attablée avec Shanti, elle en profite pour joindre Romane et lui laisser un message.
5.2 La métaphore du pot en verre
S'ensuit une discussion à bâtons rompus où Shanti questionne Maëlle sur sa vie. Quand il constate que son travail occupe toute la place au détriment de sa vie personnelle, il lui fait la leçon, au grand dam de la jeune femme qui se braque.
Pour lui faire prendre conscience de ses priorités, Shanti utilise la métaphore d'un pot en verre qu'il remplit de cailloux, de graviers et de sable. Si elle met d'abord le sable, symbolisant le superflu, il ne restera plus de place pour les cailloux, c'est-à-dire l'essentiel. Le message est limpide : si elle ne se concentre que sur son travail, elle passe à côté de sa vie.
5.3 Une leçon de vie qui inspire Maëlle sur ses priorités de vie
Touchée, Maëlle avoue que l'amour, la famille, les amis et les petits bonheurs sont ce qui compte le plus à ses yeux. Shanti l'encourage alors à faire de ces aspirations ses priorités.
"Si tu avais une baguette magique, quelle serait pour toi la vie idéale ?
- Euh… Je vivrais aux côtés d’un homme extraordinaire qui me comprendrait, que je soutiendrais et qui m’épaulerait. Je voyagerais, je découvrirais le monde avec lui ! Je partagerais des soirées et des week-ends avec ma famille, mes amis, j’aurais un quotidien simple, rempli de petits bonheurs : une balade à la campagne, un coucher de soleil, un verre de vin, des discussions tardives, de l’attention, de l’amour… Enfin, tout ça, c’est bien gentil, mais ça n’existe que dans les contes de fées !
- Non, c’est une réalité pour les personnes qui en ont fait leurs priorités. Cequi n’est pas ton cas puisque pour le moment, seul ton travail est essentiel."
(...) Parce qu’il me manquait le reste, je m’accrochais à ce que j’avais. "Raisonne en sens inverse. En définissant tes priorités, tu les vivras, car toute ton énergie sera focalisée sur ce qui est essentiel."
Shanti révèle à Maëlle que pour lui, c'est la santé qui prime sur tout.
Inspirée, Maëlle nomme ses trois pierres angulaires : la santé, l'amour ainsi que le partage et le bonheur. Son travail n'arrive qu'en priorité secondaire, avec ses rêves et ses envies. Une prise de conscience salutaire pour la jeune femme qui sent son cœur vibrer à nouveau en réalisant ce tri.
Chapitre 6 - Esprit positif
6.1 Le chemin continue
Malgré une nuit inconfortable, Maëlle se réveille en pleine forme pour cette deuxième journée de trek. Émerveillée par le spectacle du lever de soleil sur l'Himalaya, elle savoure un copieux petit-déjeuner avant le grand départ.
Shanti lui explique le programme du jour : monter jusqu'au col de Deurali à 2100 mètres puis redescendre vers le village de Landruk. Un parcours qui semble infini à Maëlle qui choisit pourtant de rester positive. Elle questionne son guide sur le mystérieux manuscrit qu'ils recherchent. Shanti reste évasif, seul le chemin leur apportera des réponses.
6.2 Visualiser sa vie rêvée
L'amour est une de ses priorités mais elle a peur de souffrir à nouveau. Le guide l'encourage alors à s'ouvrir aux opportunités en adoptant un état d'esprit positif :
"Tu as mis des noms sur tes priorités, maintenant il te faut changer ton état d’esprit pour accueillir les opportunités sans répéter les mêmes erreurs. Pour recevoir le bonheur, il va falloir penser autrement, être positive, croire en ce que tu souhaites et en la Vie, car tu attires ce que tu es."
Maëlle enchaîne :
"- Je suis quelqu’un d’optimiste !
C’est un bon début. Mais être positif, c’est s’ouvrir vers l’extérieur. Prenons un exemple : si tu t’apprêtes à demander l’heure dans la rue, te tourneras-tu vers la personne qui est pressée, en pleine conversation téléphonique, ou celle qui te sourit ?
Vers celle qui m’accueille du regard, non ? Je n’aurais pas envie de déranger l’autre.
Je ferais la même chose ! Ce qui n’empêche pas que celle qui est absorbée par son appel puisse être optimiste, non ?
Oui, ça y est, je comprends. Mais comment s’ouvrir vers l’extérieur ?
C’est avant tout se remplir de l’intérieur. Lorsque tu rumines tes réflexions nocives, tu expires du négatif et tout ton corps exprime cet état : tes muscles se tendent, ton visage se crispe, tu ne peux appréhender les occasions qui se présentent. À l’inverse, quand tes pensées sont positives, ton être se détend, tu deviens accueillante. Les personnes qui te croisent ont envie de venir à toi."
6.3 Visualiser sa vie rêvée
Shanti explique à Maëlle que le bonheur est à sa portée si elle cesse de le verrouiller par ses peurs : "sois audacieuse" glisse-t-il, "l’amour implique le risque. Si tu es fermée, personne ne viendra te demander l’heure".
Pour changer sa façon de penser, Shanti lui conseille aussi de visualiser son idéal et de ne laisser aucune pensée toxique la détourner de son objectif. Maëlle doit imaginer sa vie rêvée dans les moindres détails pour l'attirer à elle. Shanti insiste : c'est maintenant qu'elle doit modifier son état d'esprit, pas à son retour à Paris. Chaque seconde compte.
6.4 La pensée positive
Le trek se poursuit dans la bonne humeur, l'équipe sentant le changement d'attitude de Maëlle.
Shanti l'aide à repérer ses pensées négatives pour mieux les chasser : "plus tu prendras conscience de tes automatismes, moins ils s’imposeront. L’observation te sort de ce cercle infernal. Dans un premier temps, quelques secondes d’attention suffisent, puis un peu plus chaque jour, et enfin ce processus devient naturel."
Pas facile quand 80 % des 60 000 pensées quotidiennes sont des répétitions de la veille ! Mais en les remplaçant une à une par une pensée positive, Maëlle avance sur le chemin de la transformation.
En fait, tout est une question d'entraînement : rester dans l'instant présent pour vivre pleinement les opportunités au lieu de ressasser le passé ou d'angoisser pour l'avenir. Shanti lui donne quelques astuces pour créer de nouveaux automatismes. Par exemple, quand lui a commencé à travailler sur ses pensées, il s'était fixé des points de repère : à chaque fois qu'il franchissait une porte, il tentait de se recentrer.
Après une pause déjeuner chez l'habitant, la descente vers Landruk se fait à travers de splendides paysages façonnés par les rizières. Maëlle médite les paroles de Shanti, bien décidée à adopter cette nouvelle philosophie.
La beauté de l'Annapurna au coucher du soleil achève cette journée riche en révélations.
Chapitre 7 - Suspendu
7.1 Maëlle, paralysée par la vue d'un pont suspendu
Maëlle se réveille courbaturée après une nuit inconfortable. Shanti l'encourage à faire quelques étirements avant de repartir. La montée est rude mais la jeune femme trouve son rythme, portée par la beauté des sommets.
Soudain, elle se fige, tétanisée par la vue d'un pont suspendu au-dessus du vide. Sa peur panique du vertige la paralyse. Shanti tente de la rassurer : le pont est solide, des troupeaux le traversent depuis des années. Mais rien n'y fait, Maëlle est prisonnière de ses pensées catastrophistes.
7.2 Maëlle dépasse sa peur du vide
Shanti lui explique que sa peur n'est qu'une construction mentale, comme un cauchemar dont elle peut sortir. Il l'invite à respirer profondément et à se concentrer sur ses pas en fermant les yeux :
"Il est temps pour toi d’expérimenter la virtualité de la peur. Comme tu viens de le voir, le pont peut supporter d’énormes charges : des troupeaux le traversent depuis des années. Il danse, se déforme, mais il est toujours là ! Ton cerveau imagine les pires scénarios, mais ce ne sont que des inventions. Rien n’est réel.
Peut-être, mais mon malaise, lui, l’est !
C’est la même chose que dans un rêve.
Tu veux dire un cauchemar !
Lorsque tu dors, rien ne te semble plus réel que ton imagination. Ton corps réagit aux émotions : face à la peur, il se raidit, ton cœur s’accélère, ton souffle est court, mais lorsque tu te réveilles, tu sors de cet état de stress, parce que le signal donné à ton cerveau est rassurant. C’est la même chose ici : tu es bloquée dans un cauchemar imaginaire. La réalité est tout autre, tu vois bien !
Je comprends, mais c’est plus fort que moi. Mon corps s’immobilise à l’idée d’essayer
Tu dois le rassurer et contrôler tes pensées négatives pour sortir de cet état de panique. Commence par respirer profondément."
Tant bien que mal, encadrée par Goumar et Shanti, Maëlle parvient à traverser, non sans être passée par toutes les émotions.
“Si la peur frappe à ta porte et que tu as le courage de l’ouvrir, tu t’apercevras que derrière, il n’y a personne” souffle Shanti.
7.3 L’art de maîtriser ses peurs selon Shanti
De l'autre côté, soulagée mais encore tremblante, elle confie à son guide à quel point il lui est difficile de contrôler ses émotions.
Shanti la rassure : cela s'apprend. La peur naît dans la pensée. En prenant conscience de ce mécanisme, elle peut apaiser l'enfant apeuré en elle et laisser l'adulte pondéré prendre le relais. Tout est une question d'entraînement.
"Les peurs naissent de la pensée. Par des exercices réguliers de prise de conscience, tu n’en seras plus le jouet, mais le maître. Si tu observes ce qui arrive, tu peux calmer l’enfant en panique qui est en toi. Nous jonglons entre un double état : l’enfant qui sommeille en nous et l’adulte que nous sommes devenu. Face à nos peurs, c’est le petit être qui domine, nous quittons notre lucidité. Ses émotions négatives l’emprisonnent, jusqu’à ce que l’aîné trouve les paroles rassurantes pour le ramener à la raison."
7.4 Une révélation mystique
Après un déjeuner réparateur à Jhinu Danda, Shanti propose à Maëlle de se délasser dans les sources chaudes.
Une promenade de 30 minutes les mène à ce havre de paix naturel créé par des geysers. La jeune femme savoure ce moment de détente en se prélassant dans les bassins, ses courbatures se déliant dans l'eau bouillonnante.
Sur une suggestion de Shanti, elle tente une expérience inédite : s'allonger dans l'eau et écouter les sensations de son corps. D'abord sceptique, elle se laisse guider et sombre dans un état méditatif profond. Son esprit se tait, elle a l'impression de ne faire qu'un avec l'eau, la montagne, l'univers. Une révélation mystique qui la bouleverse.
7.5 Toucher à l'amour universel
Dans ce passage de "Kilomètre zéro", Maud Ankoua restitue l'expérience improbable que vit Maëlle :
"Tout à coup, mon cerveau se tut, il ne concevait plus rien, une trappe s’ouvrit au niveau de ma gorge, j’avais le sentiment d’habiter mon corps pour la première fois.
Il se passa alors quelque chose d’étrange : je ne distinguais plus la limite entre mon corps et l’eau. Je me mêlais à la sève des montagnes avec laquelle je fusionnais. J’eus le sentiment que mon être se prolongeait dans toutes les directions. Au fur et à mesure qu’il s’étendait à droite puis à gauche, il transperçait le décor au-dessus et en dessous de moi, jusqu’au centre de la Terre, puis ressortait de l’autre côté de la planète pour se fondre dans l’univers. J’eus l’impression de ne faire qu’un avec tout ce qui m’entourait. Je n’avais jamais ressenti cette force en moi, ni même imaginé sa puissance. Je n’arrivais plus à revenir de cette éternité. Toute image disparut. Les battements de mon cœur résonnaient à l’infini, comme si le reste n’existait plus."
Shanti rassure la jeune femme. Elle vient, lui dit-il, de toucher à la source, à l'amour universel en elle.
Déstabilisée mais curieuse, Maëlle mesure le chemin parcouru. En quelques jours à peine, sa vision de la vie et d'elle-même a radicalement changé. Un nouveau monde semble s'ouvrir à elle.
Chapitre 8 - Ma chère colère
De retour à l'hôtel, la rencontre avec Matteo, un bel Italien, va remettre en question ce bel équilibre. Malgré son attirance immédiate pour cet homme, Maëlle se braque, prisonnière de ses préjugés et de son passé douloureux. Son attitude glaciale pousse Matteo à quitter les lieux à l'aube, pour le plus grand désarroi de la jeune femme.
Shanti tente de lui faire comprendre que son ego et ses peurs ont dicté sa conduite, l'empêchant de saisir cette belle opportunité. Maëlle, vexée, s'emporte contre son guide qui a le tort de lui renvoyer ses contradictions. S'ensuit une longue discussion où Shanti décortique les mécanismes de l'ego qui sabote le bonheur de Maëlle en la maintenant dans des émotions toxiques.
Maëlle réalise alors que pour sortir de ce cercle vicieux, elle n'a qu'une seule solution : rester dans le moment présent. C'est, en effet, en prenant conscience de ses pensées et en les remplaçant par des vibrations positives, qu'elle pourra reprendre le contrôle sur sa vie et avancer vers ses vrais désirs. Un travail de longue haleine mais qui en vaut la peine pour accéder enfin à la sérénité.
Malgré sa déception, la jeune femme entrevoit le chemin à parcourir. Si cette rencontre avec Matteo doit se faire, alors rien ne pourra l'empêcher. À elle de rester ouverte et confiante, le reste n'appartient pas à son ressort.
Une leçon de vie qui résonne en elle tandis qu'elle poursuit son périple intérieur dans la magnificence de l'Himalaya.
Chapitre 9 - Carte de visite
9.1 Confondre l'être et l'avoir
Après une journée éprouvante dans la forêt tropicale et la bambouseraie, le groupe atteint le village de Bamboo Lodge. Maëlle profite d'un moment de détente avec Nishal, savourant une bière face au coucher de soleil époustouflant sur l'Annapurna.
Le dîner est l'occasion pour Shanti de poursuivre sa réflexion sur les valeurs qui régissent la vie de Maëlle. Pour lui, l'argent est au cœur du système occidental, dictant le respect, l'amour, la reconnaissance. Un formatage qui pousse à confondre l'être avec l'avoir, à ne donner que par intérêt. Un fonctionnement aux antipodes de la vie simple et solidaire des habitants de l'Himalaya.
9.2 Les valeurs fondamentales de Maëlle mises à mal
Maëlle comprend mieux le sentiment de fragilité qui l'habite depuis le début du voyage. Loin de ses repères, elle se retrouve nue, dépouillée des apparats derrière lesquels elle se protège d'habitude. Une vulnérabilité qui lui révèle son essence profonde. Le plus déroutant, lui fait remarquer Shanti, ce sont les réactions des gens quelle rencontre :
"Il est impossible d’appliquer ton mécanisme de pensée, de stratégie et de défense. C’est pourquoi tu te sens désemparée. Nous construisons dès notre plus jeune âge une armure pour nous protéger. Nous la façonnons avec notre éducation et la position que la société attend de nous en oubliant nos besoins intrinsèques. En Occident, la valeur fondamentale sur laquelle repose tout votre système de compréhension, d’acceptation, de pouvoir, de reconnaissance, et d’amour est l’argent. Tes réflexes sont conditionnés autour de cet élément. Ce qui ne peut fonctionner ici."
Pour Shanti, la souffrance vient de notre peur de manquer. Il l'encourage à accepter son authenticité sans craindre le rejet :
"Alors pourquoi te sens-tu si fragile ? Parce que tu fais tomber un à un les masques que ton ego a placés devant tes yeux pour se protéger. C’est en acceptant cette vulnérabilité que tu sauras qui tu es. Tu te retrouves nue, sans carapace, mais tu ne t’affaiblis pas. Au contraire, tu retrouves l’essentiel."
Finalement, c'est en étant pleinement elle-même que Maëlle attirera l'amour et trouvera sa véritable force. Un défi vertigineux mais salvateur !
9.3 Un point sur des enseignements bouleversants
Une fois de retour dans sa chambre, Maëlle récapitule les enseignements de Shanti sur un bout de papier :
"Vivre l’instant présent avec des yeux neufs.Se rendre compte que seuls deux sentiments existent : la Peur ou l’Amour. Le seul coupable de notre souffrance, c’est nous.Ce qui peut sembler négatif ne l’est peut-être pas.Choisir ses priorités et s’assurer que ses pensées sont dans cet axe, en observant ses automatismes.Rassurer son enfant intérieur lorsqu’il panique.Distinguer les messages qui émanent du cœur de ceux qui viennent de l’ego.Supprimer les armures, qui ne protègent qu’en surface, mais finissent parétouffer.Revenir à l’essentiel.S’envoler légère en étant soi-même."
Chapitre 10 - Réalité tronquée
10.1 Shanti et ses enseignements de sagesse
Malgré une nuit agitée, Maëlle se réveille motivée pour cette nouvelle journée de trek.
Avec Shanti, elle savoure le spectacle grandiose du lever de soleil sur l'Annapurna. Quand son guide lui demande quels sont ses objectifs du jour, elle évoque avec enthousiasme l'arrivée au but du voyage, la rencontre avec Jason et la découverte de la méthode promise.
Shanti la ramène à plus de sagesse : seul le chemin compte, pas la destination. Son unique objectif à lui est d'être heureux à chaque instant.
La journée les mène à travers la fameuse forêt de rhododendrons. Mais Maëlle est déçue : pas une fleur à l'horizon en cette saison ! C'était moins spectaculaire que prévu. Shanti l'invite alors à un exercice : les yeux fermés, il lui décrit avec détails ces arbustes et leurs magnifiques fleurs. Et soudain, par la magie des mots, la forêt s'anime de mille couleurs devant les yeux ébahis de la jeune femme.
Une leçon sur la réalité et la perception s'ensuit. Shanti explique que nous ne voyons le monde qu'à travers le filtre de notre vécu, de notre éducation. Notre vérité n'est que partielle et subjective, à l'image de la description d'un téléphone vue sous différents angles. Il faut rester humble face à nos certitudes.
10.2 Un diagnostic intéressant
Arrivés à Deurali, Maëlle tombe malade, terrassée par des maux de ventre et une grande fatigue. Elle craint le mal des montagnes.
Mais pour Shanti, ces symptômes révèlent surtout le conflit intérieur qui tiraille la jeune femme, entre ses priorités et ses peurs. Son corps tire la sonnette d'alarme. Si elle veut jouer la plus belle symphonie de sa vie, elle doit laisser enfin parler son cœur, sans chercher à tout contrôler. Épuisée mais pensive, Maëlle s'endort sur ces paroles.
Au matin, quel n'est pas son étonnement de se réveiller en pleine forme ! En communion avec la beauté des sommets au lever du soleil, elle ressent une plénitude inédite. Son esprit apaisé, son corps détendu, elle prend enfin conscience de ce mécanisme de vie prodigieux en elle qui œuvre sans relâche à son bien-être. Une équipe fabuleuse - cœur, corps, mental - avec qui elle compte bien faire désormais la paix.
Un moment de grâce et de gratitude sur le chemin de la réconciliation avec elle-même ! Comment avait-elle pu passer à côté d’elle-même pendant toutes ces années, pensa-t-elle.
Chapitre 11 - Belle énergie
11.1 Le pouvoir de nos mots intérieurs
L'objectif est proche ! Maëlle et son groupe attaquent la dernière ascension vers le camp de base de l'Annapurna. Une rencontre avec un couple de Français aux propos intolérants gâche le déjeuner et vide Maëlle de son énergie.
Shanti lui explique comment se préserver de ces personnes "énergivores" animées par la peur. La clé ? Rester dans des pensées bienveillantes, en lien avec l'autre plutôt que dans la volonté d'avoir raison.
"Les pessimistes, les négatifs, ceux qui veulent imposer leur point de vue, d’autres qui contredisent tout ce qui est dit, ou ceux qui se victimisent sont des gens énergivores. Ils sont animés par la peur. Tu peux éviter ce genre de situation. Il suffit d’être attentif. Ce type de comportement est facilement repérable et ton corps est un bon indicateur. Lorsque tu sens des tensions, de la crispation, une frustration, tu sais que ton énergie diminue. (...) La colère est un sentiment vain qui ne nous soulage pas. Le bonheur consiste à être en harmonie avec nous. Seules nos pensées bienveillantes peuvent nous préserver de ces offenses."
Un exercice de visualisation permet à Maëlle de mesurer le pouvoir des mots sur son état intérieur.
Son guide l'encourage aussi à s'observer pour repérer les signes annonciateurs de pensées toxiques. Et avec de la pratique, formuler des intentions positives deviendra un réflexe salvateur.
11.2 L’arrivée, enfin !
Les derniers mètres sont un calvaire pour Maëlle à bout de souffle. Shanti l'invite alors à dédier cet ultime effort à tous ceux qui rêveraient d'être à sa place. Portée par ces êtres chers, Maëlle puise une force insoupçonnée pour atteindre le but.
À leur arrivée au sanctuaire, un homme se présente à eux. C'est Jason, celui qu'ils sont venus chercher de si loin.
Chapitre 12 - Un choix : deux portes
12.1 Une discussion si loin des croyances de Maëlle
Maëlle et son groupe ont enfin atteint le sanctuaire de l'Annapurna.
Jason, l'homme qu'ils sont venus chercher de si loin, les accueille. Malgré la fatigue, la jeune femme questionne le chercheur sur ses travaux. Mais sceptique, elle peine à croire que la peur soit à l'origine de maladies graves. Et qu'un simple changement d'état d'esprit puisse guérir.
Une discussion avec Ayati, une collègue de Jason, éclaire Maëlle sur ces recherches.
Le scientifique a découvert que seul l'état de confiance et d'amour pouvait renforcer le système immunitaire de patients tibétains traumatisés par l'exil.
En fait :
"La croyance réflexe alimente de nouvelles peurs de perdre ce que nous avons, de n’être jamais satisfaits, de devenir envieux de ce que le voisin a de plus. L’état de confiance au contraire affirme que plus nous donnons, plus riche est notre vie. Le bonheur d’offrir n’a rien de comparable. L’amour ne peut nous démunir, il se multiplie, jamais ne se divise. Lorsque nous partageons notre temps, un sourire, de l’argent, nous accédons à la source intarissable de l’univers. L’état de confiance repose donc sur l’abondance, il prend naissance en nous alors que la croyance réflexe se fonde sur la peur du manque et se nourrit de restes extérieurs.
12.2 Choisir entre deux portes : la Peur ou l'Amour
La clé ? Prendre conscience qu'à chaque instant, nous avons le choix entre deux portes :
Celle de la Peur, qui nous maintient prisonniers de notre ego et de ses croyances limitantes.
Celle de l'Amour, qui nous ouvre à notre vraie nature interconnectée.
"Je compris qu’il y avait en quelque sorte deux portes devant moi. J’avais le choix de pousser l’une ou l’autre à chaque instant. Soit j’empruntais celle qui me permettait l’accès à l’Amour, soit celle qui m’enfermait dans le prisme de la Peur."
Intriguée, Maëlle approfondit le sujet avec Jason.
Pour lui, sortir de l'illusion de la séparation est un défi car l'ego fera tout pour sauvegarder son emprise. Pourtant, la science le prouve : à l'échelle subatomique, la matière n'est que vibration d'énergie, essentiellement composée de vide. Preuve que tout est relié, y compris nos pensées.
12.2 Vibrations, perception et instant présent
Ainsi, puisque nous attirons ce que nous sommes, il suffit d'élever notre niveau vibratoire par des pensées d'amour pour accéder au champ infini des possibles et recréer l'harmonie en nous.
Une révélation qui ébranle les certitudes de Maëlle. Pour l'aider à expérimenter ce changement d'état, Jason l'invite à contempler le coucher de soleil sur l'Annapurna.
Subjuguée par la beauté du moment, Maëlle fait l'expérience de cette vibration du cœur où plus rien n'existe que l'instant présent. Son mental apaisé, elle se sent en communion totale avec la magnificence qui l'entoure, au-delà de toute perception habituelle du temps et de l'espace.
12.3 Un signe du destin
Quand la nuit tombe, c'est une silhouette familière qui vient tirer la jeune femme de sa contemplation. Emmitouflé dans sa parka, Matteo, le chercheur italien rencontré quelques jours plus tôt, se tient devant elle, couverture à la main. Sous le choc de ces retrouvailles inespérées, Maëlle s'évanouit, le cœur battant à tout rompre.
Le destin semble lui offrir une seconde chance de s'ouvrir à l'amour et à ses possibles insoupçonnés.
Chapitre 13 - L'unité absolue
13.1 Modifier ses schémas de pensée
Au sanctuaire de l'Annapurna, Maëlle retrouve Matteo.
Malgré son malaise initial, elle ne peut nier l'attirance qui opère entre eux. La jeune femme questionne le chercheur sur son parcours qui l'a mené de la neurologie à New York jusqu'à ces recherches au Népal sur l'impact des pensées sur la santé.
Avec Ayati et Jason, ils approfondissent le sujet. Pour eux, la réalité que nous percevons n'est qu'une infime partie de la vérité, déformée par nos filtres mentaux et émotionnels. Notre cerveau interprète le monde plus qu'il ne le voit objectivement, en fonction de nos expériences passées. Mais puisque cet organe est en constante évolution, nous avons le pouvoir de changer nos croyances limitantes en modifiant nos schémas de pensée.
13.2 Selon la science, la matière est sensible à nos pensées et émotions
Plus troublant encore, la matière qui nous compose, à plus de 70% d'eau, est sensible aux vibrations de nos pensées et de nos émotions. C'est ce que prouvent les travaux du Dr Masaru Emoto.
En effet, en photographiant des cristaux d'eau, ce dernier a démontré que les ondes positives d'amour et de gratitude génèrent des structures harmonieuses, tandis que les vibrations de haine et de colère produisent des formes chaotiques. Notre corps tout entier est donc le réceptacle de nos états intérieurs.
13.3 Les 4 étapes de la transformation selon "Kilomètre zéro" de Maud Ankoua
Dès lors, le processus de transformation repose sur un protocole en quatre étapes :
Prendre conscience qu'à chaque instant, nous avons le choix entre l'état de peur et celui d'amour.
Élever notre niveau vibratoire par des pensées bienveillantes pour accéder au champ infini des possibles.
Comprendre le fonctionnement de notre cerveau pour reprogrammer nos automatismes.
Prendre la mesure du pouvoir créateur de la pensée pour se reconnecter à notre vraie nature, au-delà des apparences.
Ébranlée mais curieuse, Maëlle est prête à tenter l'expérience de cette transformation intérieure.
Mais le lendemain, c'est un tout autre défi qui attend le groupe : une violente tempête de neige s'abat sur le sanctuaire, les obligeant à retarder leur départ.
Coupée du monde extérieur, la jeune femme doit prendre sur elle pour ne pas céder à la panique. Heureusement, la présence apaisante de Matteo à ses côtés l'aide à garder confiance. Entre eux, l'alchimie opère en douceur, portée par la magie des lieux et la promesse d'un nouveau départ.
Chapitre 14 - À partir de maintenant...
14.1 Maëlle veut expérimenter le processus de transformation avec Matteo
Au sanctuaire, la tempête fait rage, obligeant le groupe à retarder son départ. Malgré son inquiétude, Maëlle choisit de faire confiance et de profiter de ce temps suspendu pour approfondir le "processus de transformation" avec Jason.
14.2 Première étape : voir les choses différemment
Le chercheur lui explique que la première étape est d'être déterminé à voir les choses différemment, en prenant conscience de nos croyances limitantes façonnées par notre vécu, que "nous agissons par automatisme". En nous détachant de ces automatismes, nous nous offrons alors la liberté de percevoir la réalité telle qu'elle est, sans le filtre de la peur.
Aussi, l'ego fait tout pour maintenir son emprise en alimentant nos doutes et nos craintes, souligne-t-il :
"Une création commence par une idée à un moment précis et présent. Au plus profond de nous, nous savons que notre pensée résonne, et que le rêve n’est pas loin. Mais il est souvent difficile de passer à la réalisation. Pourquoi ? Parce que l’ego freine, il nous décourage. Ses arguments paraissent tellement sensés que saisis par le doute, nous préférons oublier nos aspirations."
Mais l'échec n'existe que dans le monde de l'ego. Ce que nous considérons comme des erreurs sont en fait des expériences nécessaires pour apprendre et grandir.
Aussi, en acceptant les épreuves, nous pouvons nous libérer des barrières de la peur et amorcer notre transformation.
Jason invite Maëlle à visualiser sa vie telle qu'elle la désire et à l'affirmer à voix haute, en commençant par "À partir de maintenant, je...".
Galvanisée, la jeune femme se déclare prête à faire confiance, à embrasser les opportunités et à assumer ses erreurs.
Le processus est enclenché.
14.3 Deuxième étape : accéder à son potentiel
Le deuxième stade est d'accéder à son plein potentiel.
Pour cela, il faut se reconnecter à cette petite voix intérieure, cette flamme qui nous rappelle que nous sommes reliés à une dimension qui nous dépasse. En acceptant ce qui est, sans jugement, et en étant attentif aux signes et aux coïncidences, nous pouvons entendre ce que notre cœur veut vraiment créer.
C'est ainsi de cet espace illimité que naît la vraie guérison.
En élevant notre niveau de conscience, nous augmentons nos fréquences vibratoires et renforçons notre système immunitaire. Tout est une question de perception. Un nouveau monde de possibles s'ouvre alors à nous, dès l'instant où nous lâchons le contrôle pour faire confiance à ce qui arrive.
14.4 C'est parti pour la transformation !
Dans ce chapitre de "Kilomètre zéro" de Maud Ankoua, Maëlle fait donc face à un défi vertigineux mais libérateur, que la jeune femme est prête à relever. En se tournant vers les montagnes enneigées de l'Himalaya, elle s'exclame :
"À partir de maintenant, j’ai confiance en la vie, elle me présente les opportunités et je les saisis. (...) J’accepte de me tromper, l’erreur fait partie de la transformation. (...) J’attire ce que je pense, si mes pensées sont positives, le positif arrive à moi, si en revanche mes pensées sont négatives, le négatif arrive à moi. À partir de maintenant, je suis consciente des deux portes devant moi. À partir de maintenant, je suis moi !"
Chapitre 15 - Kilomètre Zéro
15.1 L’interprétation étrange d’un rêve intriguant
Au sanctuaire, la tempête s'est calmée. Maëlle peut enfin redescendre comme prévu. Pourtant, un détail la trouble : tous ses acolytes ont fait, la nuit dernière, le même rêve étrange d'une chasse au trésor dans l'Himalaya, comme un appel…
Pour Jason et ses amis, il faut y voir un signe ! Le signe d'un mystérieux sage qui se serait réfugié dans les montagnes et dont les théories révolutionneraient les relations humaines. Un homme qu'ils recherchent depuis des mois et que ce songe commun pourrait les aider à localiser.
Sceptique mais intriguée, Maëlle accepte de participer à une expérience : se connecter à son intuition à l'aube le lendemain pour "sentir" quelle direction prendre. Si les autres peinent à voir une indication claire, la jeune femme revoit en pensée le nom d'un lieu aperçu en rêve : Tshong.
Un jeune sherpa leur apprend qu'il s'agit d'un refuge non loin de leur position actuelle. Le groupe est convaincu : c'est là qu'il faut aller.
15.2 Accueillir ce qui vient avec confiance
Troublée, Maëlle hésite. Sa raison lui dicte de rentrer à Paris où ses responsabilités l'attendent.
Mais quelque chose la retient ici, une petite voix intérieure qui la pousse à tenter l'aventure. Sans parler de Matteo dont elle est en train de tomber amoureuse. Lorsque ce dernier la supplie de les accompagner, son cœur balance.
C'est finalement une discussion avec Shanti qui aide Maëlle à trancher. Pour son guide, le bonheur ne dépend pas d'un hypothétique résultat mais de l'instant présent, de ce "kilomètre zéro" sans cesse renouvelé. "Profite du chemin, ne cherche pas de résultat", lui dit-il. "Le bonheur est un état d’esprit, il ne dépend pas de ce qui se passera plus tard ni d’un fait extérieur. Il commence ici et maintenant."
Selon lui, s'acharner sur l'objectif fait manquer la beauté du chemin. Ce qui compte, c'est d'accueillir ce qui vient avec confiance :
"C’est un problème récurrent dans notre monde moderne, le résultat ! Se fixer une direction peut être utile, mais en se focalisant sur l’objectif, nous en oublions le voyage. Notre obsession du résultat engendre notre peur de l’échec. Nous souffrons de l’incertitude jusqu’au moment fatidique : soit nous atteignons notre but, en fixons un suivant et nous inquiétons de nouveau, soit nous n’y arrivons pas et nous effondrons dans les affres du naufrage en renforçant l’idée de notre faible valeur. L’objectif devient donc un traumatisme. Le résultat n’est qu’un fait, un bref instant entre deux voyages. Crois-tu que le bonheur dépend d’un moment aussi court ?"
15.3 Maëlle choisit d’écouter sa petite voix intérieure et de faire confiance en la vie
Libérée du poids de ses peurs, Maëlle choisit finalement d'écouter sa petite voix intérieure et de faire confiance à la vie. Qu'importe s'ils trouvent ou non ce sage au bout du chemin, l'essentiel est de savourer cette expérience unique au présent, avec les êtres qui la touchent. De profiter de chaque pas comme d'un cadeau sans se soucier d'une éventuelle désillusion.
"L'objectif est de prendre du plaisir à chaque seconde, ainsi le voyage sera une réussite. Le bonheur ne réside pas au kilomètre final qui n’existera jamais, mais au kilomètre zéro, qui commence à chaque instant" pense Maëlle.
C'est donc le cœur léger que la jeune femme s'apprête à prendre la route de Tshong aux côtés de Shanti, de Matteo et des sherpas.
Ce chapitre du livre "Kilomètre zéro" de Maud Ankoua se termine sur ce nouveau départ. Un départ sous le signe de l'amour et de la confiance retrouvée. Comme si le véritable trésor n'était pas tant celui qu'on cherche que celui qu'on porte déjà en soi et qui ne demande qu'à s'éveiller.
Chapitre 16 - L'intuition
16.1 Quand la carapace se fissure
Shanti et son équipe poursuivent leur périple dans l'Himalaya.
Lors d'une pause, Matteo et Maëlle se rapprochent et échangent sur le cheminement intérieur qui est en train de s'opérer en elle. Elle prend conscience que son identité professionnelle et sociale n'était qu'une carapace et que ce voyage la connecte à son essence profonde, même si elle ne sait pas encore où tout cela va la mener.
Après un déjeuner animé où Thim, l'un des jeunes porteurs lui apprend avec patience à manger avec les mains, Maëlle goûte un moment de complicité enfantine avec Matteo. Ils se joignent aux jeux insouciants d'écoliers népalais et de leur brebis, retrouvant leur âme d'enfant et une joie pure.
C'est l'occasion pour Shanti de lui glisser encore quelques sages paroles :
"Nous pensons que devenir adulte, c’est intellectualiser chaque chose. Nous en oublions de vivre. L’enfant habite l’expérience, il ne la considère pas. Que ferais-tu si tu laissais ton enfant intérieur se manifester en toi ?"
16.2 Une rencontre mystérieuse
Arrivés au village de Tshong, le groupe est accueilli par Gu-Lang, une vieille femme énigmatique. Pendant que les hommes vont faire un tour, Maëlle se repose puis discute avec Gu-Lang. Celle-ci lui affirme que "l'homme qu'elle est venue rencontrer l'attend", à son grand étonnement !
Vexée que Matteo tarde à rentrer et intriguée par les propos étranges de Gu-Lang, elle accepte de suivre Thi Bah, la nièce de la vieille Népalaise, à la recherche de ce mystérieux rendez-vous.
Après s'être perdues, Maëlle commence à perdre patience et à se demander ce qui lui a pris de croire en ces fantaisies. À un croisement, Thi Bah lui propose de se concentrer pour choisir leur chemin. Soudain, un aigle survole l'une des voies et semble leur indiquer la direction. Elles le suivent jusqu'à une petite maison isolée d'où s'échappe une odeur de feu de bois. La nièce frappe à la porte, convaincue d'être arrivée à destination, sous le regard dubitatif de Maëlle.
Ce seizième chapitre de "Kilomètre zéro" se termine sur fond de suspense autour de cette mystérieuse rencontre qui semble l'attendre.
Chapitre 17 - Cocktail
17.1 Les conseils amoureux de Chikaro pour Maëlle
Maëlle, perdue et tremblante, est accueillie par un vieux couple asiatique dans la petite maison isolée. L'homme, Chikaro, se dit japonais. Il lui révèle l'attendre suite à un rêve prémonitoire.
Lors de leurs échanges, ce dernier lui explique que le bonheur nécessite un véritable travail sur soi et une compréhension profonde de l'amour :
"Nous attendons de l’autre qu’il comble nos carences, n’est-ce pas ? Tant que nous ne travaillons pas sur nos besoins non satisfaits, nous projetons sur l’être aimé nos attentes, au point de l’idéaliser. Il se donne le rôle de répondre et d’alimenter nos dysfonctionnements. Nous entrons dans une relation de dépendance mutuelle qui finit souvent par une catastrophe lorsque la magie disparaît."
Chikaro souligne que pour aimer vraiment, il faut d'abord s'aimer soi-même et se libérer de ses peurs et blessures : "Pour se sentir aimé, il est indispensable de s’apprécier soi-même. Pour donner quelque chose, il faut le posséder."
17.2 L'amour, un cocktail biologique
Chikaro détaille les mécanismes biologiques qui se déclenchent lors d'un coup de foudre. Ce "cocktail magique" d'hormones euphorisantes finit par s'estomper pour laisser place soit à un amour mature, soit à la déception.
"Lorsque l’on tombe amoureux, douze régions de l’encéphale s’activent pour délivrer ces molécules chimiques euphorisantes. Un cocktail magique, proche de certaines drogues comme l’héroïne ou l’opium. C’est pourquoi nous nous sentons “pousser des ailes”. - Un cocktail magique ? - Oui, une surproduction d’hormones comme les amphétamines, stimulant l’activité cérébrale, diminuant le sommeil et la faim, ou la dopamine provoquant l’hyperactivité et l’ivresse. Mais aussi la phényléthylamine suscite l’euphorie, la NGF, une des protéines qui augmentent au début d’une relation et qui ne durent, au mieux, qu’un an, ou encore la lulibérine, l’hormone du désir, n’est-ce pas ?"
17.3 Les 3 clés pour nous reconnecter à l’amour
Chikaro partage ensuite trois clés pour pacifier ses relations :
Ne jamais se voir comme une victime,
Cesser les suppositions,
Arrêter de juger.
L'amour véritable est partout, inconditionnel, mais notre mental nous empêche souvent de le ressentir. En changeant notre regard sur le monde et les autres, nous pouvons nous reconnecter à cet amour.
Malgré ces conseils de sagesse, Maëlle peine à dépasser sa colère envers Matteo.
Ce chapitre de "Kilomètre zéro" de Maud Ankoua amène la jeune femme à réfléchir sur sa conception de l'amour. Les explications subtiles de Chikaro l'éclairent sur ses propres travers et lui indiquent une voie de transformation intérieure, même si le chemin s'annonce encore long et ardu.
Chikaro l'invite alors à remplacer ses pensées négatives par de la bienveillance. Alors qu'il s'apprête à illustrer son propos par une parabole zen, de violents coups à la porte les interrompent.
Chapitre 18 - Le miroir
18.1 La méprise de Maëlle envers Matteo
Matteo fait irruption dans la maison, essoufflé et inquiet pour Maëlle. Il lui explique que Nishal a été mordu par un chien et qu'ils l'ont amené chez un médecin.
Soulagée et honteuse d'avoir douté de lui, elle se tourne vers Chikaro qui lui chuchote les trois clés : ne pas se voir en victime, cesser d'interpréter, ne pas juger.
18.2 L'unité de toute chose
Matteo partage avec Chikaro ses recherches scientifiques démontrant l'unité de toute chose.
Le vieux Japonais approuve et souligne le paradoxe dans lequel nous vivons : nous croyons être tous les uns les autres séparés. Mais à tort, selon lui. Car nous n'avons, en réalité, "jamais quitté l'unité".
D'ailleurs, "la physique nous le démontre", ajoute-t-il : "nous ne sommes qu’énergie, cette concentration d’atomes qui fait de tout une immense vibration intelligente. C’est pourquoi toute action de notre part a une conséquence sur ce qui nous entoure et sur nous-mêmes".
18.3 L’autre est comme un miroir révélateur de soi
Matteo et Chikaro poursuivent leur conversation : selon eux, pour retrouver l'harmonie, il faut accueillir l'autre comme un miroir révélateur de soi.
"Lorsque je suis souriant, attentif, aimant, calme avec les autres, ils se sentent rassurés en ma présence. Ils ne cherchent plus à attaquer pour se défendre. Ils me renvoient un sourire, un geste amical. Quand je suis froid, soucieux, en colère, triste ou jaloux envers quelqu’un, leur insécurité m’adresse une image brutale. Mon comportement reflète mon état intérieur comme un miroir, renchérit Matteo."
De même, pour Chikaro, lorsque quelqu'un nous blesse, c'est le reflet d'une zone d'ombre en nous. L'autre n'est qu'une partie de nous-mêmes. Aussi, en changeant notre regard, en cherchant la similitude plutôt que la différence, nous pouvons nous libérer de l'ego et retrouver la paix.
18.4 Notre perception est illusoire
Le vieux sage compare enfin notre perception illusoire à un rêve dont nous pensons qu'il est la réalité. Pour nous réveiller de ce "rêve", nul besoin de mourir. Il suffit de prendre conscience. Chaque contrariété est un enseignement sur ce que nous devons travailler en nous.
Ainsi, une personne qui nous agace reflète souvent un trait que nous refusons de voir en nous. À l'inverse, quelqu'un qui nous attire incarne un potentiel que nous aimerions développer. En considérant l'autre comme un cadeau, un révélateur, nous pouvons grandir en conscience.
"Lorsque je souffre face à la remarque d’une personne, je peux sortir de cette ornière en visualisant la douleur autrement, en me concentrant sur la similitude avec mon interlocuteur et non plus sur la différence. Se sentir similaire à l’autre nous permet d’abolir le mécanisme de dominant/dominé. Supérieur/inférieur."
18.5 Retour au village
En rentrant au gite, Maëlle raconte ses mésaventures à Shanti qui l'a attendue dans la nuit. Elle lui résume les précieux enseignements de Chikaro :
"Il [Chikaro] m’a donné trois clés de compréhension pour sortir de la souffrance : la première est que nous ne sommes jamais victimes du monde que l’on voit. En identifiant nos peurs, nous nous rendons compte qu’elles tronquent la réalité de notre perception puisqu’elles ne sont qu’illusions. Nous sommes donc victimes de notre perception. La deuxième clé est de cesser toute supposition face à une situation. En attendant d’avoir des explications tangibles, il faut bannir toute interprétation intermédiaire. La troisième clé est de ne rien juger de ce qui se produit. En nous libérant de la critique et en acceptant l’autre dans son ensemble, la connexion entre les êtres devient indestructible, n’est-ce pas ?"
Maëlle avoue ensuite à Shanti sa méprise au sujet de Matteo. Shanti acquiesce en murmurant : "L'autre est notre miroir !" Maëlle plonge alors son regard dans celui de Matteo et y contemple son reflet.
Chapitre 19 - Une zone d’ombre
19.1 Une belle nuit d’amour
Au réveil, Maëlle savoure ces moments de complicité avec Matteo. Malgré la blessure infectée de Nishal, le groupe reprend la descente vers Gandrung. Le soir, Matteo prodigue des soins à Nishal pendant que les autres visitent le village.
Maëlle réalise qu'elle est tombée amoureuse de Matteo.
Ils passent alors une nuit intense et fusionnelle, s'abandonnant l'un à l'autre. Au petit matin, ils contemplent ensemble le lever du soleil, conscients que leur séparation approche.
19.2 Un travail sur soi pour sortir des schémas toxiques
Lors d'une pause déjeuner, un incident se produit : une citerne d'eau tombe du toit, provoquant la panique d'une touriste occidentale. Bien que pas touchée, celle-ci se met alors à débiter ses plaintes de façon théâtrale à Maëlle. Cette réaction enferme la jeune femme dans un profond malaise.
Shanti aide alors Maëlle à comprendre pourquoi cette attitude l'a autant affectée.
Il lui explique que ce qui nous agace chez l'autre est souvent le reflet d'une zone d'ombre en nous, quelque chose qu'on refuse de voir.
La réaction épidermique de Maëlle pourrait ainsi être liée au fait qu'elle a dû écouter et porter les plaintes de sa mère durant son enfance, suite au départ de son père.
Aussi, Shanti l'encourage à identifier ses blessures pour mieux les dépasser et laisser s'exprimer son potentiel. Il lui conseille de chercher les similitudes avec les autres plutôt que les différences. C'est un travail sur soi au quotidien, mais qui permet de sortir des schémas nocifs.
Maëlle comprend que cette femme était finalement un cadeau, un miroir pour éclairer une souffrance enfouie.
Malgré la tristesse du départ imminent, elle savoure ses derniers instants complices avec Matteo avant de regagner Pokhara.
Chapitre 20 - Trahison
20.1 Trahisons et cœur brisé
Maëlle savoure ses derniers instants de complicité avec Matteo avant son départ.
Mais en lisant par hasard des SMS sur le téléphone de ce dernier, elle découvre qu'il échange avec une certaine Laura et avec Romane, son amie, à propos d'un mystérieux paquet qu'il devait récupérer.
"Le téléphone de Matteo vibra. Je tendis la main machinalement et déchiffrai un SMS en italien : "Tu m’as tellement manqué, j’ai hâte de te retrouver demain. Rentre vite. Je t’aime. Laura", suivi d’une rangée d’icônes de cœurs rouges. Mon cœur se mit à cogner. Qui était cette Laura ? Je regardai, tremblante, le téléphone et me trouvai face à l’inimaginable. En dessous du texto de cette femme, je vis apparaître le nom de Romane, mon amie. J’entrai dans la conversation et lus, stupéfaite, ses échanges avec Matteo depuis plusieurs jours."
Se sentant trahie, Maëlle s'enfuit, le cœur brisé.
"Je bondis du lit sans prendre le temps de lire la conversation avec Laura. Je m’habillai, furieuse, me dirigeai vers la salle de bains le mobile à la main et le balançai violemment contre la porte de la douche en hurlant ma douleur. "Comment avez-vous pu me faire ça tous les deux ?""
Torturée par mille questions, Maëlle s'enfuit sans vouloir écouter Matteo. Quand elle revient dans la chambre, l'Italien est déjà parti.
Il a laissé derrière lui le fameux paquet transmis par Jason, contenant les travaux de recherches à rapporter à Romane. Celui-ci se trouve toujours dans le sac à dos de la jeune femme. Après cette trahison, Maëlle est prise de doutes sur ce que pouvait réellement contenir ce paquet. Elle décide de l'ouvrir et trouve, à l'intérieur... un simple carnet vierge.
Cette découverte vient encore ajouter de la confusion aux mille hypothèses qui tournent à présent dans sa tête.
20.2 La colère de Maëlle
Refusant d'écouter les explications de Matteo via une lettre remise par Thim, la jeune femme déchire le message de rage.
Shanti tente de raisonner Maëlle. Il l’invite à ne pas tirer de conclusions hâtives sans avoir tous les éléments. Il lui conseille de contacter Romane. Mais Maëlle tombe sur sa messagerie. Elle lui laisse un message colérique.
Shanti lui fait prendre conscience que sa souffrance vient surtout de ses propres projections et illusions brisées. Il l'encourage à sortir de son rôle de victime pour retrouver la paix intérieure.
20.3 S'aimer soi-même et faire confiance à la vie
Maëlle peine à relativiser, submergée par un sentiment de trahison et de solitude. Shanti lui explique que pour pouvoir aimer vraiment, il faut d'abord s'aimer soi-même et faire confiance à la vie.
"Sais-tu qu’il existe une personne dans ce monde qui ne t’abandonnera jamais ? La seule qui sera toujours près de toi, c’est toi ! Prends soin de toi, regarde-toi avec affection, en comprenant tes faiblesses et tes forces sans te juger. Commence par t’aimer du plus profond de ton être et tu pourras chérir quelqu’un sans peur. Tu te sens seule, parce que tu te délaisses. Aie confiance en la vie. Tu as émis tes souhaits, sois sûre que la matrice universelle œuvre pour toi. Tu vis ce que tu dois vivre, tu rencontres les bonnes personnes au bon moment pour atteindre tes objectifs. Tu es aimée bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Tu es sur ton chemin."
Shanti conte ensuite à Maëlle une parabole sur un vieil homme réalisant à la fin de sa vie que Dieu l'a toujours accompagné, même dans ses moments les plus sombres. Ces paroles apaisent un peu Maëlle.
20.4 Le réconfort de Shanti, Nishal et Thim
Avant de reprendre l'avion vers Katmandou, elle fait ses adieux émouvants à Nishal et Thim. Ce dernier lui offre son précieux collier de kyanite, censé ouvrir le chemin du cœur. En échange, il ne demande à Maëlle qu'un sourire. Touchée par ce geste, elle serre la pierre contre elle, y puisant un peu de réconfort.
La découverte des messages a ébranlé la confiance de Maëlle et ravivé ses blessures. Malgré le soutien de Shanti, la jeune femme peine à présent à dépasser sa colère et son sentiment d'abandon.
Ce chapitre de "Kilomètre zéro" de Maud Ankoua se termine sur l'énigme encore entier du paquet et des véritables intentions de Matteo et Romane, laissant Maëlle dans la confusion la plus totale. Seul le cadeau sincère de Thim est parvenu à l'émouvoir et à adoucir quelque peu sa peine au moment de quitter le Népal.
Chapitre 21 - Le pardon
Sur le chemin du retour entre Katmandou et Pokhara, Shanti aide Maëlle à comprendre que sa souffrance vient de ses pensées. En les observant consciemment, elle réalise qu'elles sont la cause de son mal-être.
De retour chez Maya, Maëlle lui raconte son périple et sa déception amoureuse. Maya sort alors une vieille lettre de son grand-père sur le pouvoir du pardon. Elle explique à Maëlle que pardonner est la clé du bonheur, car cela permet de se libérer de la peur et des jugements.
Maëlle comprend que son ego cherche des excuses pour renvoyer la faute sur les autres, alors qu'en réalité, la douleur vient d'elle-même. Maya souligne que si l'on considère que la séparation est une illusion, il n'y a rien à pardonner. Le véritable pardon consiste à réaliser qu'il n'y a pas eu de mal, puisque la souffrance provient de nos propres blessures non résolues : le pardon, souligne-t-elle, "n’est plus un acte généreux de notre part envers l’autre pour ce qu’il aurait fait de mal, mais la compréhension qu’il n’y a pas eu de mal, car la douleur ne vient pas de lui, elle vient de nous-mêmes".
Maëlle résume les étapes de cette prise de conscience : assumer sa responsabilité, sortir de la position de victime, accueillir l'enseignement de la situation, choisir l'amour plutôt que l'ego. Elle réalise que le pardon inconditionnel ouvre la porte de l'unité et de la joie.
Emplie d'une énergie nouvelle, elle savoure cet instant présent, ce "kilomètre zéro" où tout s'efface dans la perfection. Les conseils lumineux de Maya lui permettent de transmuter sa peine en une opportunité de grandir intérieurement.
Chapitre 22 - L’envol
Apaisée, Maëlle savoure sa renaissance intérieure. Malgré la trahison, elle se sent aimée et confiante. Ce voyage lui a offert un précieux cadeau : la découverte du bonheur en elle.
L'heure du départ arrive. Les adieux avec Shanti sont émouvants. Il la rassure : leur lien d'amour est éternel. Il l'encourage à transmettre cet enseignement.
Maëlle ressent pour la première fois l'unité avec l'autre. Leurs cœurs ne font qu'un.
Chapitre 23 - Un nouveau départ
23.1 Le retour à paris de Maëlle, pleine d’énergie positive
De retour à Paris le jour de ses 35 ans, Maëlle savoure son appartement et sa nouvelle sérénité.
Malgré les messages inquiets de sa famille durant son absence, elle choisit de prendre du temps pour elle plutôt que de les rejoindre.
En se promenant dans Paris, elle observe les passants avec bienveillance et tente de leur transmettre son énergie positive. Sa colère envers Romane et Matteo refait surface mais elle décide consciemment de lui laisser la place de s'exprimer puis de la transmuter.
23.2 Tout s’éclaire
Au rendez-vous avec Romane, celle-ci lui explique, affaiblie par la maladie, qu'elle a orchestré ce voyage initiatique pour que Maëlle se réveille à l'essentiel avant qu'il ne soit trop tard. Elle voulait lui offrir "la liberté de choisir en conscience" :
"Tu te démolis comme je l’ai fait pendant des années, alors j’ai inventé cette histoire pour que tu puisses toi aussi vivre ces enseignements et te réveiller avant d’avoir à subir ce que je vis. Je savais que tu n’y serais jamais allée si je ne t’y avais pas obligée. (…) Je voulais t’offrir pour ton anniversaire la liberté de choisir en pleine conscience."
Quant à Matteo, il n'était là que pour la protéger. Les messages que Maëlle avait surpris venaient en réalité de sa sœur Laura, dont il s'occupe depuis 3ans suite à un grave accident.
Romane remet alors à Maëlle une lettre de Matteo, qui lui déclare son amour sincère et l'invite à le rejoindre à Milan.
Émue aux larmes, Maëlle mesure l'amour que lui porte son amie malgré son combat contre la maladie. Romane lui prend la main et l'encourage alors à vivre pleinement cet amour naissant :
"Je t’aime, mon amie, n’en doute pas. Matteo est un homme extraordinaire, tout comme toi. Rejoins-le. Ne laisse pas la peur t’emprisonner, c’est le moment de devenir libre, c’est le moment de vivre !"
Épilogue
Après avoir fêté son anniversaire avec Romane, Maëlle s'envole pour Milan rejoindre Matteo.
Dans l'avion, elle découvre le message touchant de son amie dans le carnet finalement "vide" que lui avait fait ramener Romane du Népal. Celle-ci l'invite à partager son expérience.
Émue, Maëlle commence à écrire son récit, débutant par son arrivée à Paris, au tout début de sa carrière.
Et pour finir
Dans la toute dernière partie de son livre "Kilomètre zéro", Maud Ankoua conclut en nous invitant à créer un monde meilleur main dans la main, en transmettant l'Amour et en inspirant chacun à trouver sa voie, pour relier nos lumières autour de la Terre :
"J’aime à croire qu’un jour, nous saurons marcher les uns avec les autres. Je me suis dit que si chacun donnait la main à quelqu’un d’autre, alors ensemble, nous pourrions faire de ce monde un lieu meilleur où il fait bon vivre dans une douce harmonie. (…) Si vous croyez comme moi que le bonheur est un choix, alors il est de notre responsabilité d’aider ceux qu’on aime à se réaliser ! Prenez quelqu’un par la main et enseignez-lui l’Amour, devenez son "Shanti", aidez-le à trouver son chemin et proposez-lui de tenir la main d’une autre personne en ne lâchant plus jamais la sienne. Très vite, nos mains se relieront autour de la Terre pour faire de cette planète l’œuvre que nous aurons réalisée. N’essayez pas de convaincre les autres, montrez-leur l’exemple, inspirez-les, c’est en rayonnant que votre lumière guidera leurs pas…"
Conclusion de "Kilomètre zéro" de Maud Ankoua
Les 3 grandes idées forces qui émergent du roman initiatique "Kilomètre zéro" de Maud Ankoua
- Un parcours de transformation intérieure
Tout au long de son trek dans l'Himalaya, Maëlle, personnage clé du récit de Maud Ankaoua, vit une véritable métamorphose.
Guidée par les enseignements de sagesse de Shanti et ses rencontres inspirantes - comme celle de Chikaro - elle apprend à s'ouvrir à son intuition, à dépasser ses peurs et ses croyances limitantes pour se reconnecter à son cœur et à son essence profonde.
Un cheminement intérieur qui l'amène (et nous amène) à réaliser que le bonheur ne dépend pas de l'extérieur mais de notre regard sur la vie.
- L'amour comme clé de la guérison
Au fil des pages, Maud Ankaoua veut nous montrer que l'amour véritable est la voie royale vers la paix intérieure et la guérison.
Que ce soit à travers l'histoire d'amour naissante entre Maëlle et Matteo, le soutien indéfectible de Romane ou la bienveillance inconditionnelle de Shanti, le roman illustre le pouvoir transformateur de cet amour qui nous relie tous au-delà des apparences.
Une force qui nous invite à pardonner, à lâcher le contrôle pour faire confiance à la vie.
- Le pouvoir de nos pensées
"Kilomètre Zéro" met également en lumière l'impact de nos pensées sur notre réalité.
Comme l'expliquent Jason et Matteo dans leurs recherches, notre mental est souvent le prisonnier de l'ego et de ses peurs, nous maintenant dans l'illusion de la séparation.
En prenant conscience de ce mécanisme et en choisissant délibérément des pensées plus élevées, ancrées dans l'amour et la gratitude, nous avons le pouvoir de transformer notre vie et d'accéder à notre plein potentiel.
Que vous apportera la lecture de "Kilomètre Zéro" de Maud Ankoua ?
Le livre "Kilomètre Zéro" de Maud Ankaoua est certes un roman, mais un roman initiatique, un roman dit de développement personnel. Il vous transportera dans la magie de l'Himalaya tout en faisant écho à votre propre vécu, pour une expérience aussi dépaysante qu'inspirante.
En effet, le parcours initiatique de Maëlle vous fera découvrir, en même temps qu'elle, de précieux enseignements pour apprendre à vivre en conscience, avec authenticité. Vous aurez ainsi accès à de multiples clés pour dépasser vos conditionnements, guérir vos blessures et vous ouvrir à l'amour inconditionnel en vous et autour de vous. Tout cela, à travers une histoire émouvante et pleine de sagesse mais toujours ancrée dans la réalité moderne de tout un chacun.
Je recommande la lecture "Kilomètre Zéro" de Maud Ankaoua à ceux qui cherchent à s'éveiller à une forme de spiritualité tout en passant un agréable moment d'introspection, de narration et d'émotions.
Points forts :
Une quête initiatique inspirante qui nous transporte dans la magie de l'Himalaya.
De précieux enseignements de sagesse pour apprendre à vivre en conscience et cultiver le bonheur.
Une histoire touchante qui allie développement personnel, amour et spiritualité.
Points faibles :
Le rythme du récit peut parfois sembler un peu lent, notamment dans les passages plus introspectifs.
Un genre "déjà-vu" et certaines parties initiatiques du récit parfois prévisibles, heureusement compensés par un style résolument moderne.
Ma note :
★★★★☆
Avez-vous lu "Kilomètre zéro"? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Maud Ankoua "Kilomètre zéro"
Visitez Amazon afin d'acheter le livre de Maud Ankoua "Kilomètre zéro"
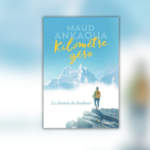 ]]>
]]>