Résumé de "Born to run | Né pour courir " de Christopher McDougall : l’auteur, journaliste passionné de course à pied, nous embarque dans un récit épique et palpitant, à la recherche du mystérieux Caballo Blanco et de la tribu des Tarahumaras, ces coureurs de fond mythiques extraordinaires vivant au fin fond des canyons mexicains. À travers sa quête fascinante sur les secrets de la course naturelle et joyeuse, il nous montre que l'humanité est biologiquement née pour courir. Entre aventure, science et philosophie, il nous invite finalement à redécouvrir notre nature première de coureurs, le minimalisme en running et l’esprit de dépassement de soi.
Par Christopher McDougall , 2010 (version originale), 2022 (version française), 440 pages.
Titre original : "Born to Run: The hidden tribe, the ultra-runners, and the greatest race the world has never seen", 2010, 306 pages.
Chronique et résumé de "Born to run | Né pour courir " de Christopher McDougall
Chapitre I - La recherche du fantôme
Le livre "Born to run | Né pour courir" commence par une "quête" presque irréelle : celle d’un homme surnommé Caballo Blanco, le "Cheval Blanc", que l’auteur Christopher McDougall tente de retrouver dans les confins de la Sierra Madre mexicaine.
Après plusieurs jours à suivre une piste aussi floue que poussiéreuse, il finit par tomber sur lui dans un hôtel perdu au milieu de nulle part.
Cet homme, dont personne ne connaît ni le vrai nom, ni l’âge, est entouré de mystère. Une figure énigmatique à mi-chemin entre la légende et l’ermite. Il vit au cœur des Barrancas del Cobre - les canyons du Cuivre - aux côtés des Tarahumaras, une tribu indigène qui a fui le monde moderne pour se réfugier dans ces montagnes escarpées et quasi inaccessibles.
Les Tarahumaras, selon McDougall, sont des coureurs d’un autre monde. "Une tribu quasi mythique de superathlètes tout droit sortis de l’âge de pierre" capables de prouesses physiques hors normes. À les écouter, aucun être vivant ne peut rivaliser avec eux sur de très longues distances : ni cheval, ni guépard, ni même un marathonien olympique. Leur endurance est telle qu’on raconte plein d’histoires fabuleuses à leur propos : celle d’un Tarahumara, par exemple, qui, à force de course, a réussi à épuiser un cerf… avant de le capturer à mains nues.
Chapitre II - Une simple question médicale
Le deuxième chapitre de "Born to run | Né pour courir" s’ouvre sur une douleur aux pieds que ressent un jour Christopher Mc Dougall. Une douleur banale mais qui va pourtant bouleverser sa vie.
Cette douleur amène Christopher à consulter. Le Dr Joe Torg, éminent médecin du sport, lui diagnostique un problème au niveau de l’os cuboïde. Le verdict tombe avec cette phrase assassine : "Le corps humain n'est pas fait pour ce genre d'agression".
McDougall est désemparé. Comment a-t-il pu se blesser en courant, lui qui a pratiqué sans problème bien d’autres des sports plus extrêmes et plus brutaux ? Il découvre alors avec stupeur qu’il est, en fait, loin d’être un cas isolé : près de 80 % des coureurs se blessent chaque année, malgré l’essor des chaussures de course ultra-tech.
Intrigué, Christopher McDougall s’informe auprès d'autres médecins spécialistes. Tous le découragent : courir, selon eux, est mauvais pour le corps. Mais alors, se demande-t-il, pourquoi les animaux comme les chevaux sauvages, les antilopes ou les loups peuvent-ils courir sans jamais souffrir de blessures ? Où est le problème ?
C'est à ce moment-là que sa découverte des Tarahumaras éveille sa curiosité.
Cette tribu mexicaine extraordinaire qui vit en quasi-autarcie et en harmonie totale intrigue Christopher Mc Dougall : pas de criminalité, d'obésité, de dépression ni de maladies cardiaques. Plus surprenant encore, leur hygiène de vie contredit tout ce qu’on lui a appris et qu’on enseigne aux coureurs occidentaux : ils boivent beaucoup d’alcool, mangent peu de protéines, ne s’échauffent jamais, et pourtant, ils peuvent courir deux jours d’affilée sans fléchir.
Pour McDougall, c’est une énigme. Et le début d’un long voyage.
Chapitre III - À la recherche des fantômes
Dans le 3ème chapitre de "Born to run | Né pour courir", l’aventure prend un tournant plus concret - et plus risqué. En effet, Christopher McDougall décide de partir à la recherche des légendaires coureurs Tarahumaras, là où peu d’étrangers osent s’aventurer : dans les profondeurs vertigineuses des Barrancas del Cobre. Il trouve Salvador Holguín, un chanteur de mariachi à mi-temps, employé municipal à l’occasion, pour l’accompagner. L’homme a le sourire facile, et reste étonnamment optimiste malgré son aveu peu encourageant : "Je suis à peu près sûr de connaître le chemin... En fait, je n'y suis jamais allé".
Christopher et Salvador s’enfoncent ensemble dans une région aussi sublime qu’hostile, un dédale de montagnes et de ravins où la beauté brute de la nature côtoie la brutalité des cartels. Car ici, ce sont les Zetas et les New Bloods qui contrôlent le territoire, deux groupes de narcotrafiquants aussi impitoyables que rivaux.
L’auteur relate la tension, palpable, notamment lorsqu’un pick-up aux vitres fumées surgit au détour d’un virage, moteur grondant et regards invisibles. Il réalise que le danger est omniprésent dans cette région où "six corps sont découverts chaque semaine".
Mais le danger n’est pas seulement humain. La nature elle-même semble vouloir tester leur courage. Le chapitre se termine par leur arrivée au bord d'un immense canyon : un gouffre monumental s’ouvre sous leurs pieds. Christopher est saisi par le vide, son regard happé par des oiseaux minuscules qui tournoient, loin en contrebas dans l’abîme. "L'à-pic semblait interminable" confie-t-il.
Salvador, impassible, le rassure : les Rarámuris (le vrai nom des Tarahumaras) empruntent toujours ce chemin, déclare-t-il, en désignant le sentier qui longe le précipice. Et puis, ajoute-t-il, avec une pointe d’humour, "c’est mieux par là. C’est trop raide pour les narcotraficantes". "J’ignorais s’il y croyait vraiment ou s’il cherchait à me redonner courage. Quoi qu’il en soit, il savait mieux que moi ce qu’il en était" termine l’auteur.
Chapitre IV - Face à face avec Arnulfo Quimare
Après des heures de marche harassante à flanc de montagne, Salvador s'arrête soudainement, pose son sac, essuie son front et lance à Christopher McDougall :
"On y est. (…) C’est là que vit le clan Quimare".
"Je ne comprenais pas ce qu’il disait. Aussi loin que portait le regard, c’était exactement comme la face cachée de la planète inconnue que nous parcourions depuis des jours" écrit l’auteur. Car en effet, autour d’eux, rien. Aucun signe de vie. Juste des rochers, de la poussière, des cactus et le silence des hauteurs.
Jusqu’à ce que soudain, ils l’aperçoivent : une petite hutte en briques crues, blottie dans la roche comme si elle avait été sculptée dans la montagne elle-même, camouflée sous un petit monticule et invisible jusqu’à ce que les deux hommes soient littéralement dessus.
Et là, à leur grande surprise, Arnulfo Quimare les attend déjà. Ce n’est pas n’importe qui : c’est le coureur le plus respecté des Tarahumaras, presque une légende vivante. Il se tient là, calme, impassible, comme s’il les avait vus arriver depuis des heures.
Christopher, emporté par l’excitation, enchaîne aussitôt deux maladresses : il s’approche pour se présenter sans s’annoncer à distance, ignorant l’importance du respect de l’espace chez les Rarámuri. Puis se met à mitrailler Arnulfo de questions directes, brisant le tempo lent et mesuré de cette culture millénaire. Mais Arnulfo ne se formalise pas. Au lieu de le rembarrer, il se mure dans le silence puis partage avec eux des citrons doux fraîchement cueillis.
L’auteur est fasciné par la prestance de son hôte. Arnulfo ne ressemble pas à un athlète moderne, mais plutôt à une force de la nature. Ses muscles "ondoyaient sous sa peau comme du métal en fusion". Dans sa tunique traditionnelle, le taharuma incarne à la fois l’élégance brute et la puissance.
Cette rencontre est une révélation pour Christopher McDougall. Il comprend cette méfiance viscérale que les Tarahumaras, pétris de contradictions, nourrissent envers les étrangers : "ils fuient les étrangers, mais sont fascinés par le monde extérieur" écrit-il. Des siècles de persécutions, de fuites, d’intrusions ont creusé entre eux et le reste du monde un fossé de silence et de prudence.
Christopher McDougall vient d’y poser un pied… mais il sait qu’il lui reste encore un long chemin à parcourir pour comprendre vraiment ce peuple.
Chapitre V - Sur les traces du Caballo Blanco
Dans l’école poussiéreuse de Muñerachi, perdue au cœur des montagnes, Christopher McDougall écoute avec attention les paroles d’Ángel Nava López, un enseignant tarahumara à la voix calme et au regard perçant. Il lui raconte une étrange apparition, devenue légende.
Ainsi, dix ans plus tôt, de jeunes bergers étaient revenus affolés de la montagne, affirmant avoir aperçu une créature bizarre : une forme humaine géante, squelettique, pâle, comme un spectre, avec des mèches incandescentes jaillissant de son crâne. Elle courait très vite et disparut dans les broussailles.
Les anciens l’avaient d’abord désignée comme un "ariwara", une âme errante. Mais cette silhouette étrange, en réalité, était le Caballo Blanco :
"Le Caballo blanco, m’expliqua Angel, était un homme blanc, grand et maigre, qui baragouinait un langage à lui et qui surgissait de la montagne sans crier gare, se matérialisant sur le sentier pour débouler dans le village".
Ángel se souvient de sa première vraie rencontre avec lui. Un jour, le vagabond blanc mystérieux débarqua à l’école sans prévenir, vêtu d’un short miteux, d’une vieille casquette de base-ball et d’une paire de sandales. Il parlait un espagnol approximatif, mais suffisamment pour se faire comprendre et se présenter : "- Hoooooolaaaaaa ! Amigooooooooos !" Le Cheval Blanc venait d’entrer dans leur vie.
Au fil des années, Ángel apprit à mieux connaître cet homme atypique. Il vivait seul, dans une cabane isolée, mangeait peu, ne possédait presque rien. Il avait choisi de vivre à la manière des Tarahumaras, avec une humilité rare. Ce qui le nourrissait, c’était la "korima", ce système d’échange basé sur le partage sans contrepartie : on donne sans attendre de retour. Une forme de solidarité pure, qui lie les membres d’une même communauté bien au-delà de l’économie.
Mais la conversation de Christopher avec Ángel prend ensuite une tournure plus sombre. Ce dernier évoque Yerbabuena, un village autrefois célèbre pour ses grands coureurs. Tout changea le jour où une route fut construite. Les voitures ont remplacé les jambes, la course est devenue inutile, les traditions se sont effondrées… et les coureurs ont disparu. Une tragédie discrète, mais poignante.
Ce récit résonne en McDougall comme une mise en garde. Un siècle plus tôt, l’explorateur Carl Lumholtz avait déjà pressenti cette érosion lente mais inexorable de la culture tarahumara, rongée par les assauts du progrès. Le Caballo Blanco n’est peut-être pas seulement un coureur légendaire : il est aussi un témoin de cette frontière fragile entre deux mondes.
Chapitre VI - Le mythe devient réalité
Le soleil commence à décliner lorsque Christopher McDougall et Salvador Holguí quittent le village d’Ángel. Ils doivent atteindre le sommet du canyon avant la nuit, mais à mesure que leurs pas les éloignent, un doute s’insinue. Et si le Caballo Blanco n’était qu’un mythe, une fable ingénieuse inventée pour protéger les Tarahumaras des curieux venus d’ailleurs ? Un fantôme bien pratique, qu’on évoque pour détourner les regards étrangers.
Avant leur départ, ils assistent à une scène de vie typique du quotidien des enfants tarahumaras. En effet, des élèves, par équipe, s’élancent sur un sentier accidenté pour un rarájipari, ce jeu ancestral où l’on pousse une balle en bois à coups de pied, parfois sur des dizaines de kilomètres. C’est brutal, chaotique, imprévisible, mais fascinant. McDougall est hypnotisé par la foulée extraordinaire fluide d’un jeune garçon de douze ans, Marcelino Luna :
"Ses pieds dansaient frénétiquement entre les pierres, mais toute la partie supérieure de son corps était paisible, presque immobile. En le voyant seulement au-dessus de la taille, on aurait juré qu’il était chaussé de patins à roulettes" note l’auteur, admiratif.
Ángel lui révèle alors que Marcelino est le fils de Manuel Luna, grand champion de rarájipari. Ce jeu, explique-t-il, est "le jeu de la vie" pour les Tarahumaras :
"On ne sait jamais à quel point ce sera dur. On ne sait jamais quand ça va s'arrêter. On ne peut pas le contrôler. On peut seulement s'adapter."
Juste avant de reprendre la route, Ángel tend à Christopher une gourde remplie d’un liquide étrange : "une substance visqueuse, comme un gâteau de riz sans riz plein de bulles mouchetées de noir qui - j’en étais pratiquement certain - étaient des œufs de grenouille à demi incubés" décrit l’auteur.
C’est de l’iskiate, indique l’enseignant. Une boisson énergétique traditionnelle faite de graines de chia trempées, un élixir local aussi humble qu’efficace. Christopher McDougall ne le sait pas encore, mais cette potion maison au "goût incroyable" et "agréablement acidulé" deviendra rapidement un allié précieux sur les chemins escarpés à venir.
Chapitre VII - Face à face avec le Cheval Blanc
Il est là. Enfin. Après des jours de pistes nébuleuses et de récits à la frontière du mythe, Christopher McDougall retrouve le Cheval Blanc - Caballo Blanco - dans un petit hôtel décrépit au fin fond de la Sierra Madre. Pour briser la glace, il évoque quelques connaissances communes, et Caballo, d’abord méfiant, finit par relâcher la tension. Il l’invite à le suivre.
Direction une petite échoppe rustique, au mobilier bancal et à l’odeur de maïs grillé. Là, entre deux cuillerées de haricots, Christopher McDougall observe enfin, de près, ce personnage qui le hante depuis des semaines. Le spectacle est à la hauteur de la légende. Caballo est imposant, osseux, sec comme un tendon, mais dégage une puissance animale."Faites fondre Terminator dans un bain d'acide et vous obtenez Caballo Blanc" souffle l’auteur.
Son vrai nom, Christopher l’apprend ce soir-là, est Micah True. Ancien boxeur devenu coureur errant, Micah a renoncé à tout pour s’enfoncer dans les canyons, s’y fondre, jusqu’à adopter le mode de vie des Tarahumaras. Il court chaque jour comme d’autres prient : en silence, en communion avec la terre, léger comme "un chasseur du néolithique", les poches vides, les jambes infatigables.
La soirée s’étire. Caballo parle, se confie, s’enflamme. Jusque tard dans la nuit, il raconte son histoire, ses dix années d’exil volontaire, sa fascination pour les traditions Rarámuris qu’il connaît intimement, et "un plan, un plan audacieux. Un plan dont je faisais partie, comme je devais le réaliser petit à petit" conclut mystérieusement l’auteur.
Chapitres VIII, IX et X - La légende de Leadville
La suite de "Born to run | Né pour courir" est une histoire qui tient autant de l’exploit sportif que du conte moderne.
Tout commence avec Rick Fisher, photographe baroudeur au charisme ravageur, doté d'un talent exceptionnel pour l'orientation. Fasciné par les Tarahumaras, il est convaincu qu’ils ne sont pas seulement de bons coureurs : ce sont, à ses yeux, les meilleurs du monde. Et il décide de le prouver au monde entier.
Son plan : les faire participer à l’un des ultramarathons les plus redoutables de la planète, le Leadville Trail 100.
Christopher McDougall décrit cette épreuve mythique de 160 kilomètres, créé par Ken Chlouber, comme un véritable monstre : "quatre marathons d'affilée, dont deux dans le noir, avec deux fois 800 mètres de dénivelé au beau milieu."
Elle se déroule à 3 000 mètres d’altitude, dans les montagnes du Colorado, au cœur d’une ancienne ville minière ravagée par la crise. Leadville, vidée de son activité, s’est reconstruite autour de cette course extrême. Une renaissance par la souffrance. Un symbole de résilience.
En 1992, Fisher débarque avec une équipe de coureurs tarahumaras. C’est un échec complet. Trop de pression, trop d’incompréhensions culturelles, trop de tout. Mais Fisher ne renonce pas. Il revient l’année suivante avec un autre groupe. À leur tête, un personnage improbable : Victoriano Churro, 55 ans, silhouette fluette, visage buriné, "foulard rose et bonnet de laine enfoncé jusqu’aux oreilles" avait l’allure d’un vieux "lutin préretraité".
Et là, le miracle opère.
Étonnamment, ces coureurs en sandales faites de pneus usés déjouent tous les pronostics et pulvérisent les favoris américains. Les Tarahumaras grimpent les cols et avalent les kilomètres comme s’il s’agissait d’une balade. Leur foulée est légère, leur souffle inaltérable. Ce ne sont pas des compétiteurs : ce sont des coureurs-nés.
"On dirait que le sol avance avec eux, commenta un spectateur sous le charme. C’est comme un nuage ou une nappe de brouillard qui se déplace dans la montagne."
Dans une ville où l’endurance est devenue symbole de survie, les Tarahumaras offrent alors au public une leçon d’humilité et de grâce. Leur victoire ne tient pas à la rage de vaincre, mais à une joie tranquille :
"La situation était celle qu’ils connaissaient depuis l’enfance, avec les vieux rusés devant et les jeunes loups derrière. Ils étaient sûrs de leurs pieds et d’eux-mêmes. C’étaient les fils du Peuple qui court."
Chapitre XI - Une nouvelle rivale entre en scène
Après la victoire éclatante des Tarahumaras, Fisher est aux anges : "Je vous l'avais dit !" s'exclame-t-il. Les Tarahumaras sont les meilleurs coureurs de la planète. Et cette fois, tout le monde l’a vu. ESPN achètent les droits télévisés, leurs caméras se braquent sur Leadville. Les sponsors affluent : Molson, Rockport, et d'autres encore flairent le phénomène. Les médias s’emballent. La question tourne sur toutes les lèvres : qui pourra rivaliser avec ces coureurs venus d’un autre temps ?
La réponse arrive de là où personne ne l’attendait : dans la silhouette discrète d'une femme au regard doux, "assez petite, assez mince, assez terne".
Cette femme, c’est Ann Trason. Elle a 33 ans, elle est professeure de sciences dans l’enseignement supérieur. Dès qu’elle enfile un dossard, Ann, sous ses airs réservés, ordinaires et "assez insignifiante derrière sa frange châtaine", se cache, en réalité, une véritable légende de l'ultrafond. Christopher McDougall la décrit avec humour et admiration :
"La voir bondir sur la ligne de départ, c’est comme assister à la métamorphose d’un petit reporter binoclard en superhéros."
L’auteur revient en détail sur le parcours incroyable de cette ultramarathonienne d'exception.
Elle court, dit-il, non pas pour la gloire, mais parce qu’elle aime ça, simplement, "pour sentir le vent dans ses cheveux".
Pourtant, son palmarès parle d’un autre monde : record du monde sur 50 miles, 100 km, 100 miles, 14 victoires à la Western States dans la catégorie féminine, et une capacité hors norme à courir des distances folles. Ann ne court pas comme on affronte un ennemi. Elle court parce que c’est, s’amuse-t-elle, "très romantique" :
"On ne se lance pas comme ça dans une séance de cinq heures. Il faut se couler dedans comme on se coule dans un bain, jusqu’à ce que le corps ne résiste plus aux chocs, mais commence à les apprécier. Si on se détend suffisamment, le corps s’habitue tellement au rythme des foulées qu’on ne se rend même plus compte qu’on avance. Et c’est quand on parvient à cette semi-lévitation douce et fluide que le clair de lune et le champagne font leur apparition."
Face aux Tarahumaras, cette nouvelle rivale ne vient pas pour les défier, mais pour incarner une autre forme de grandeur : celle d’une femme qui, sans chercher à dominer, finit par émerveiller.
Chapitre XII - La confrontation se prépare
À mesure que la course approche, l’air se charge d’électricité. L’atmosphère est tendue, presque irréelle, comme avant une grande bataille. Rick Fisher, fidèle à lui-même, fait une entrée théâtrale, escorté de deux nouveaux visages tarahumaras : Juan Herrera et Martimano Cervantes, drapés dans de longues capes blanches. On dirait des chamans ou des magiciens descendus de leur montagne pour jeter un sort à la compétition.
Mais Fisher ne se contente pas de cette arrivée spectaculaire. Il veut du drame, du spectacle. Alors, pour attiser l’intérêt médiatique, il souffle aux journalistes une provocation bien calculée : les Tarahumaras trouveraient "honteux de perdre face à une femme". Une manière de pimenter l’enjeu, de créer une fausse "guerre des sexes" autour du duel annoncé avec Ann Trason. Ce qu’il ne dit pas, c’est que la culture tarahumara est profondément égalitaire, et que ce genre de rivalité n’a aucun sens pour eux. Chez les Rarámuris, on court pour célébrer, pas pour vaincre.
En réalité, Fisher est en terrain glissant. Victoriano et Cerrildo, ses deux stars de l’année précédente, ont refusé de revenir. Alors il est parti en quête de nouveaux champions, grimpant de village en village, promettant monts et merveilles : "une tonne de maïs et une demi-tonne de haricots" pour les familles, si les coureurs acceptent de représenter leur communauté.
Mais ce qu’il ne comprend pas, ou feint d’ignorer, c’est que l’esprit de compétition à la sauce occidentale est étranger aux Tarahumaras. Pour eux, courir n’est pas un duel, c’est "une célébration de l'amitié", un acte collectif. En opposant les villages les uns aux autres, en transformant une course en guerre, Rick Fisher joue à un jeu dangereux. Il trahit sans le savoir ce qu’il prétend défendre.
Et pendant ce temps, Ann Trason se prépare. Silencieusement. Sans cape, sans promesse, sans folklore. Mais avec cette intensité calme qui fait les vraies légendes.
Chapitre XIII - L'œil expert du Dr Vigil
Dans les coulisses de cette confrontation hors norme, un homme observe en silence, avec l’œil aiguisé du scientifique et la passion d’un maître d’orchestre. Le Dr Joe Vigil, légende vivante de l'entraînement de fond et chercheur en course à pied, est là. Rien ne lui échappe.
Christopher McDougall nous brosse le portrait de ce coach exceptionnel, issu d’une petite ville poussiéreuse du Nouveau-Mexique, devenu une référence mondiale. Joe Vigil a réussi à transformer l'équipe moribonde d'Adams State en machine à gagner. Décrochant titre sur titre, il a alors mené l'équipe américaine aux Jeux olympiques de Séoul, toujours guidé par une obsession : l’excellence fondée sur la science, l’éthique, et le cœur.
Mais ce jour-là à Leadville, ce ne sont ni les médailles ni les records qui l’intéressent. Deux mystères l’obsèdent :
Le premier : pourquoi les femmes brillent-elles autant en ultramarathon ? Les chiffres parlent d’eux-mêmes. À Leadville, 90 % des femmes terminent la course, contre seulement 50 % des hommes. Comment expliquer cette ténacité, cette capacité à tenir sur la durée, au-delà de la force brute ?
La seconde question que se pose l’entraineur est : comment ces coureurs d’ultrafond, et en particulier les Tarahumaras, peuvent-ils enchaîner des distances démentielles sans se blesser ? Pas de tendinites, pas de fractures de fatigue, pas d’abandons en pleurs sur le bas-côté. Leur foulée est légère, fluide, presque ancestrale. Comme si leur corps savait quelque chose que les autres ont oublié.
Vigil n’est pas là pour juger ou applaudir. Il est là pour comprendre. Et ce qu’il est sur le point de découvrir pourrait bien changer à jamais notre manière de courir.
Chapitre XIV - Le duel commence
À Leadville, la course démarre à un rythme effréné. Dès le coup de pistolet, la course s’élance dans un grondement de pas et de souffle. Et en tête de peloton, comme une flèche lancée à toute allure : Ann Trason.
Pas question d’observer ou de temporiser. Elle adopte une stratégie osée, presque provocante : prendre la tête dès le départ. Une audace qui surprend, bouscule, force le respect. Derrière elle, les Tarahumaras semblent détendus… trop peut-être. Mais alors qu’on les croyait soumis aux règles des sponsors, ils s’arrêtent discrètement au bord du chemin, ôtent leurs chaussures Rockport flambant neuves, et enfilent leurs vieilles huaraches en pneu. Le vrai départ, pour eux, commence ici.
Mile après mile, Ann creuse l’écart, guidée par une volonté féroce, un calme intérieur qui frôle l’obsession. Mais la tension monte d’un cran à la mi-course, lors d’un point de contrôle médical. Là, face à Martimano, elle lance avec une ironie tranchante :
"Demande-lui ce que ça lui fait de se faire battre par une femme".
La réplique fuse, sèche, calculée. C’est un sacrifice risqué mais potentiellement gagnant, commente Christopher McDougall. Un coup à la manière du “Queen’s Gambit” aux échecs : on renonce à la prudence pour créer une rupture, pour imposer son rythme et faire vaciller l’adversaire.
Ann ne court plus dans l’ombre. Elle embrasse la lumière, la peur, l’intensité. Elle sait que cette course se joue autant dans les jambes que dans la tête, et elle vient de placer un pion au cœur de la stratégie.
Chapitre XV - La révélation de Vigil
Installé au bord du sentier, Joe Vigil observe. Il regarde les Tarahumaras avaler les kilomètres avec une légèreté presque irréelle, comme s’ils ne forçaient jamais, comme si courir était aussi naturel que respirer. Et soudain, il comprend.
Leur secret ne se trouve pas dans leur foulée, ni dans leur diététique, ni même dans leurs fameuses sandales. Leur secret est intérieur. Il est dans leur joie.
C’est une révélation. Vigil, le scientifique méthodique, le coach rigoureux, réalise que ce que les coureurs américains ont perdu, ce n’est pas une technique : c’est un état d’esprit. C’est la joie de courir. Un plaisir simple, brut, presque enfantin.
Il pense à Emil Zátopek, le légendaire coureur tchèque qui s'entraînait seul dans la nuit, en forêt, chaussé de lourdes rangers, juste parce qu’il aimait ça. Zátopek, tout comme les Tarahumaras, courait par amour du mouvement, pas pour la victoire.
Et puis les Tarahumaras "n'oublient jamais le plaisir de courir" et pourquoi ils le font. Ce n’est ni pour dominer, ni pour fuir. Ils courent parce que c’est leur manière d’être au monde.
Et Vigil va même plus loin. Il entrevoit un lien entre cette perte de la course et les maux modernes : l’obésité, la violence, la dépression, la maladie. Peut-être que tous ces déséquilibres sont les signes d’une rupture plus profonde, celle qui nous a fait quitter notre condition originelle de “Peuple qui court”.
Alors il se fixe une mission, presque une croisade : ramener l’humain moderne à sa nature première de coureur. Pas en vendant des chaussures ou des plans d’entraînement, mais en réapprenant à courir avec le cœur, avec le sourire, avec l’âme. En faisant des Tarahumaras non pas des curiosités, mais des guides. En transposant leur sagesse dans notre société contemporaine.
Chapitre XVI - La victoire des Tarahumaras
À mi-parcours de la course de Leadville, la tension est à son comble.
Ann Trason mène toujours la course, mais les Tarahumaras sont sur ses talons, accompagnés de leurs pacers. Parmi eux, un hippie barbu repère un changement inquiétant : Martimano ralentit, grimace, boite légèrement. Il se plaint du genou. Mais ce n’est pas une simple blessure, dit-il. C’est un sort.
Pour lui, la douleur est le résultat de la confrontation avec "la bruja", la sorcière, comme il appelle Ann depuis leur échange tendu à la caserne de pompiers. Ce moment aurait déclenché quelque chose. Une mauvaise énergie. Un déséquilibre.
Alors que Martimano reste en arrière, Juan Herrera poursuit la course, seul, concentré, silencieux. On lui murmure à l’oreille de chasser "la bruja comme un cerf". Alors Juan s’exécute, avec la détermination d’un coureur pour qui la fatigue n’existe pas.
Malgré une lanière de sandale qui se rompt en pleine course (mais réparée à la hâte à l’aide d’un bout de lacet, un geste aussi humble que génial), Juan rattrape Ann dans les derniers kilomètres. Et c’est là que le moment de bascule survient :
"Elle se figea sur place, au milieu du chemin, trop surprise pour faire le moindre geste, tandis que Juan la contournait d'un bond, sa cape blanche flottant derrière lui, avant de disparaître" dans le sentier, avalé par la nuit.
Juan franchit la ligne en 17 heures et 30 minutes, établissant un nouveau record de l'épreuve, suivi par Ann puis par Martimano et les autres Tarahumaras.
Mais la joie de la victoire est de courte durée : Rick Fisher explose. Il provoque une scène déplorable, accusant les organisateurs d'avoir "truqué" la course et exigeant plus d'argent des sponsors.
La scène est honteuse, brutale, déplacée. Ce qui devait être une célébration devient un règlement de comptes public.
Les Tarahumaras, témoins silencieux de cette mascarade, réagissent comme ils l'ont toujours fait face à l'hostilité et l’absurdité du monde moderne : "ils regagnèrent leurs canyons et s'évanouirent comme un songe, emportant leurs secrets avec eux", laissant derrière eux des records, des légendes… et un profond silence.
Plus jamais aucun ne reviendra à Leadville.
Chapitre XVII - Les confidences de Caballo
Retour au présent dans ce nouveau chapitre…
Le récit de Caballo Blanco touche à sa fin. Assis dans la lumière douce du matin, il lance simplement : "C'était il y a dix ans, et je suis ici depuis."
Caballo raconte à Christopher McDougall comment, après Leadville, il a suivi les Tarahumaras dans les profondeurs des Copper Canyons, abandonnant son ancienne vie, laissant derrière lui l’agitation du monde moderne pour embrasser une vie dépouillée, proche de la terre. Il ne cherchait pas une fuite, confie-t-il. Il cherchait un lieu. "J'avais décidé de trouver le meilleur endroit au monde pour courir et c'était là."
Lentement, douloureusement parfois, il a adopté le mode de vie des Tarahumaras. Fini les chaussures dernier cri : il s’est mis à courir en huaraches (sandales minimalistes). Fini les gels énergétiques : il se nourrit depuis de pinole, un mélange de maïs grillé et d’eau. Il a appris à écouter son corps, à se fondre dans le rythme de la nature. Et il s’est métamorphosé.
Aujourd’hui, il est plus fort et plus rapide que jamais. Il court des distances inimaginables. Ce que des chevaux mettent trois jours à parcourir, lui le fait en sept heures, seul, léger comme un souffle.
Touché, Christopher lui demande de lui enseigner ces techniques. Le lendemain, à l’aube, les voilà alors qui s’élancent ensemble sur les sentiers poussiéreux de Creel. Caballo parle peu, mais ses mots résonnent profondément :
"Pense facile, léger, fluide et rapide. Commence par facile, parce que, si le reste ne vient pas, c'est déjà pas si mal."
Mais Caballo ne se contente pas de courir. Il rêve. Et son rêve est fou : organiser une course unique au monde, au cœur des canyons, entre les meilleurs Tarahumaras et les plus grands ultrarunners américains. Pas pour l’argent. Pas pour les caméras. Pour l’esprit.
Il a même contacté Scott Jurek, le roi incontesté de l’ultrafond aux États-Unis pour l’inviter. S’il accepte… alors peut-être que le monde découvrira enfin ce que signifie vraiment courir libre.
Chapitres XVIII-XIX - Scott Jurek entre en scène
Curieux d’en savoir plus sur son énigmatique compagnon, Christopher McDougall mène l’enquête sur Caballo Blanco. Il interroge les rares personnes qui l’ont croisé, comme Don Allison du magazine "Ultrarunning", mais les réponses sont vagues, presque légendaires. Caballo reste insaisissable, comme un esprit errant des canyons.
Pendant ce temps, le Dr Joe Vigil, lui aussi transformé par son expérience avec les Tarahumaras à Leadville, a finalement renoncé à ses projets d’étude dans les Copper Canyons. Trop isolés, trop complexes. Mais il a gardé leurs principes essentiels : simplicité, joie, légèreté. Et il les a transmis à une autre étoile montante de la course : Deena Kastor, devenue médaillée olympique grâce à cette philosophie venue du fond des canyons.
Mais le récit bascule quand entre en scène Scott Jurek. Christopher McDougall retrace l’itinéraire étonnant de ce coureur hors normes...
Enfant du Minnesota, Scott grandit dans une famille marquée par la maladie de sa mère. Surnommé "Jerker" à l’école à cause de sa maladresse, rien ne le prédestinait à devenir un athlète exceptionnel. Pourtant, à force de volonté, de solitude, et d’heures passées à courir dans les bois enneigés, il se forge un corps et un mental à toute épreuve.
Le résultat ? Sept victoires consécutives à la Western States. Une domination sans précédent dans l’ultramarathon.
Mais c’est à la Badwater, une course infernale dans la fournaise impitoyable de la Vallée de la Mort, que Scott devient une légende. Après un départ désastreux, il s’effondre au 96e kilomètre, incapable de bouger. Il reste "étendu raide pendant dix minutes". Soudain, il se relève. Et repart. Il termine la course, pulvérise le chrono, et établit un nouveau record.
C’est ça, Scott Jurek. Pas un surhomme. Mais un homme qui se relève quand tout dit qu’il ne le peut pas. Là où d'autres champions d’ultra, comme Dean Karnazes, cherchent les projecteurs, les sponsors et les talk-shows, Scott fuit la lumière. Il court pour le dépassement, pas pour la gloire.
Alors quand il reçoit une lettre étrange, presque poétique, signée Caballo Blanco, l’invitant à venir courir une course secrète, au cœur des Copper Canyons, contre les meilleurs coureurs tarahumaras, il n’hésite pas longtemps.
Le défi est fou. L’endroit est inconnu. Les règles sont floues. Mais Scott sent que cette invitation est différente. Et c’est précisément pour ça qu’il ne peut pas dire non.
Chapitre XX - Les préparatifs de la course
Neuf mois plus tard, l’appel de Caballo a fait son chemin. Christopher McDougall est de retour au Mexique, prêt à participer à la course la plus improbable de sa vie.
Caballo, fidèle à son style errant, a passé des semaines à parcourir les canyons pour prévenir les Tarahumaras un par un, sans jamais vraiment savoir qui viendrait ni combien répondraient à l’appel.
Mais ce qui est encore plus incertain, ce sont les Américains. Qui oserait répondre à une invitation aussi floue, dans un endroit aussi reculé ?
À l’aéroport d’El Paso, Christopher McDougall voit débarquer Jenn Shelton et Billy Barnett, deux jeunes ultrarunners à l’allure désinvolte. Ils ressemblent moins à des athlètes d’élite qu’à des "fugueurs en route pour Lollapalooza".
Jenn, "cheveux blé mûr rassemblés en couettes", déborde d’énergie. Billy, vague cousin hippie de Chewbacca, l’air d’"un yéti qui aurait pillé votre tiroir à sous-vêtement", porte un short trop large et semble avoir dormi que par accident ces trois derniers jours. Ils ont mis leurs études entre parenthèses, dépensé le peu qu’ils avaient, juste pour répondre à l’appel du désert.
McDougall leur annonce alors une surprise : Scott Jurek est déjà là, au bar de l'hôtel. Les yeux s’écarquillent. Le mythe est à portée de main. Et comme pour briser la tension, Christopher glisse une suggestion à moitié sérieuse, à moitié désastreuse : "Peut-être que, si vous le faisiez boire, il se dévoilerait un peu."
Il ignore encore que ce conseil, lancé sur le ton de la blague, va très vite lui échapper des mains.
Chapitre XXI - Les premiers rassemblements
L'équipe d'ultrarunners commence à se former dans un hôtel d'El Paso.
McDougall retrouve Scott Jurek, paisible, posé, en train de siroter une bière comme si de rien n’était, sans grand discours ni ego. À l’opposé, déboulent Jenn Shelton et Billy Barnett, nos deux électrons libres qui semblent sortis d’un road trip improvisé, plus proches de Kerouac que de Garmin.
Autour d’eux, d’autres visages complètent l’équipe : Eric Orton, l'entraîneur personnel de l’auteur, Luis Escobar, photographe bourlingueur et coureur d’ultra passionné, et son père, Joe Ramirez, solide, discret, observateur.
Mais alors que la soirée aurait pu s’achever calmement sur une note d’anticipation avant le départ, les choses dérapent. Jenn et Billy décident de "fêter l’aventure" à leur manière. Boissons, rires, virée improvisée… Ils reviennent complètement ivres. Résultat ? Jenn plonge dans la fontaine de l’hôtel en robe de soirée, et ressort avec un œil au beurre noir. Billy vomit dans la baignoire, l’air hilare.
À l’aube, ils doivent pourtant prendre la route pour Creel. Aucun retard n’est permis. Le rendez-vous avec Caballo et les Tarahumaras ne les attendra pas.
Malgré l’état de certains, l’équipe prend alors le départ d’un voyage qui ne ressemble à aucun autre.
Chapitre XXII - L'histoire de Jenn et Billy
Pour comprendre ce duo fantasque que sont Jenn et Billy, McDougall fait un retour en arrière.
Leur histoire commence à Virginia Beach en 2002. Deux maîtres-nageurs, Jenn et Billy donc, se rencontrent sur une plage battue par les vagues. Ils ont en commun le surf, la littérature beat, le goût de l’absurde et de l’intensité. Bukowski, Kerouac, l’instinct. Ils vivent comme ils courent : sans plan.
Un jour, sur un coup de tête, ils s’inscrivent à une course de 50 miles en montagne, sans préparation, sans équipement. Juste pour voir. Et ils y prennent goût.
Jenn, en particulier, révèle un talent brut, presque sauvage. Pour sa toute première course de 100 miles, elle termine deuxième au classement général, battant le record féminin de trois heures. Puis elle frappe encore plus fort : 14h57 à la Rocky Raccoon 100, meilleure performance mondiale féminine.
Mais ce qui fait de Jenn une coureuse à part, ce n’est pas seulement son chrono : c’est sa joie pure de courir. La lumière qu’elle dégage quand elle court. L’auteur décrit une photo d’elle, emblématique où, après 30 miles, Jenn affiche un sourire éclatant : "Elle semble en pleine extase, comme si rien sur Terre ne pouvait égaler ce qu'elle fait ici et maintenant" écrit-il.
Pour elle, poursuit-il, courir n'est pas une question de performance mais une quête spirituelle : "J'ai commencé à courir des ultras pour devenir quelqu'un de bien... un putain de Bouddha qui apporte la paix et la joie au monde."
Et au fond, c’est peut-être ça, le vrai moteur de toute cette histoire : retrouver ce feu sacré, ce sourire en pleine course, cette joie de courir qui rend tout le reste supportable.
Chapitre XXIII - La nouvelle dévastatrice
L’équipe arrive enfin à Creel, la porte des Barrancas. Caballo Blanco les attend. Mais ce qui aurait pu être une réunion pleine de promesses tourne au malaise quand apparaît Barefoot Ted.
Dès les premières minutes, Ted monopolise la conversation. Il parle sans arrêt, débitant anecdotes, théories et opinions avec une énergie inépuisable. Caballo, homme du silence et de la solitude, lutte visiblement pour supporter ce flot de paroles et se referme à vue d’œil. Christopher McDougall assiste alors impuissant à ce clash de tempéraments : l’un carbure à l’extériorisation, l’autre à la résonance intérieure.
Et c’est dans cette atmosphère tendue que Caballo lâche la bombe : Marcelino est mort.
Le jeune prodige tarahumara, celui dont la foulée semblait voler au-dessus des pierres, a été assassiné, probablement par des narcotrafiquants. Une exécution, dans un endroit qui, malgré une si grande beauté, n’apporte aucune protection.
Christopher McDougall est bouleversé. Il se souvient de Marcelino, de sa grâce, de sa lumière, de son talent exceptionnel. Cette nouvelle tragique brise quelque chose dans le groupe, une innocence peut-être.
Malgré cette tragédie, Caballo garde espoir que d'autres coureurs tarahumaras comme Arnulfo et Silvino participeront à la course. Mais Christopher doute. Il sait à quel point les Tarahumaras sont discrets, prudents, méfiants vis-à-vis des étrangers.
La nuit tombe, et le groupe s’installe dans de modestes chalets de montagne. Mais même là, le silence est impossible : Ted parle encore, inlassablement, même en partageant sa chambre avec Scott Jurek, dont la patience est mise à rude épreuve.
Chapitre XXIV - Premières tensions dans l'équipe
Le lendemain matin, l’air est glacial, mais l’énergie est là.
Scott Jurek et Luis Escobar réveillent Christopher McDougall à l’aube pour une petite course de mise en jambes. Bientôt, toute l’équipe suit. Toute, sauf Caballo, visiblement lessivé par une nuit d’insomnie, rongé par l’inquiétude.
Pour Caballo, Creel est un cauchemar : la laideur du tourisme de masse, la corruption rampante, et une nature qu’on assassine à coups de béton. Cette ville, dit-il, incarne tout ce qu’il a fui. Mais les sentiers font leur œuvre. En courant parmi les pins odorants et les aiguilles craquantes, Caballo finit par rejoindre le groupe, comme si l’effort, une fois encore, l’avait reconnecté à lui-même.
Il remarque alors quelque chose de surprenant : McDougall a changé. Plus affûté, plus léger. Onze kilos envolés. La métamorphose due à l’entraînement avec Eric Orton est visible. Caballo, discret mais impressionné, lui glisse un mot d’encouragement.
Mais la sérénité est de courte durée…
La matinée prend, en effet, un tour conflictuel lorsque Ted exhibe fièrement ses Vibram FiveFingers (des "chaussures pieds nus" minimalistes). Caballo blêmit : "Tu n’as pas de vraies chaussures ?" lui demande-t-il. Ted hausse les épaules : il n’a que des tongs.
Et là, Caballo explose : "Ici, c'est pas les San Gué-bri-olz ! Les épines de cactus sont comme des lames de rasoir. Tu t'en mets une dans le pied et on est tous foutus."
La tension monte. Même l’intervention apaisante de Scott a du mal à désamorcer la situation. Les visages se ferment, les esprits s’échauffent.
De retour aux chalets, Caballo disparaît. McDougall le cherche partout, redoutant qu’il n’ait abandonné l’expédition. Et puis, il l’aperçoit, perché sur le toit du bus, silhouette solitaire et déterminée, prêt à partir pour les profondeurs des canyons.
Chapitre XXV - Les trois dures vérités sur les chaussures de course
Dans ce chapitre de "Born to run | Né pour courir", Christopher McDougall change de rythme. Plus qu’un récit de course, c’est une mise en accusation en bonne et due forme.La cible ? Les chaussures de running modernes.
Il s’appuie sur les travaux du Dr Daniel Lieberman, chercheur à Harvard, spécialiste de l’évolution humaine. Selon lui, nos pieds ne sont pas faits pour les baskets épaisses et ce sont elles qui détraquent nos pieds.
"Beaucoup des blessures du pied et du genou dont nous souffrons sont dues en fait aux chaussures qui affaiblissent nos pieds."
L'auteur détaille ces "dure vérité" en trois constats implacables :
Les meilleures chaussures sont les pires : une étude suisse met en évidence que les coureurs chaussés de modèles à plus de 95 $ se blessent deux fois plus que ceux portant des chaussures à moins de 40 $. Autrement dit : plus on paie, plus on casse.
Les pieds aiment être maltraités : les recherches démontrent que l'amorti excessif perturbe l'équilibre naturel du pied. "Plus la chaussure a d'amorti, moins elle protège" lance Christopher McDougall. Nos pieds sont conçus pour s’autoréguler, s’équilibrer, pas pour être enfermés dans un coussin.
Les humains sont faits pour courir sans chaussures : de nombreux experts, comme Alan Webb (recordman américain du mile) et le Dr Gerard Hartmann (kinésithérapeute des plus grands marathoniens), affirment que les exercices pieds nus renforcent les pieds, améliorent la posture et réduisent les blessures.
Christopher McDougall raconte comment Nike, confronté aux preuves scientifiques de l'inefficacité de ses produits, a finalement créé la Nike Free, une chaussure minimaliste commercialisée avec le slogan paradoxal "Courez pieds nus !"
Ironie suprême : l’industrie a réussi à transformer une vérité dérangeante en argument marketing. On enferme à nouveau le pied… pour lui faire croire qu’il est libre.
Chapitre XXVI - La randonnée qui tourne mal
Ce chapitre nous replonge dans le récit.
Le groupe de coureurs entame un trajet vertigineux. La route en lacets qu’il emprunte, taillée à flanc de falaise et ainsi accrochée au vide comme un fil de poussière, s’enfonce à 2400 mètres de profondeur. Au bout de ce serpentin, nichée au fond du canyon : Batopilas, une ancienne ville minière oubliée du monde, où le temps semble s’être arrêté.
C’est là que vit Caballo Blanco, dans une petite hutte de pierre et de terre, construite de ses mains avec des galets remontés un par un depuis la rivière. L’homme conduit le groupe vers cette modeste demeure : un abri spartiate, rugueux, taillé à l’image de son occupant : solitaire, résilient, en marge.
Le lendemain matin, Caballo propose une "petite sortie" d'entraînement. Un sommet voisin, juste pour se dérouiller.
Jenn et Billy, encore vaseux de leur soirée, insistent pour venir, malgré la gueule de bois et le ventre vide. Le groupe part avec une quantité d'eau minimale : Caballo assure qu’ils trouveront de l’eau en chemin. Une source fraîche, dit-il. Inutile de s’encombrer. Mais Christopher décide d’emporter, sur les conseils prudents d’Eric Orton, eau et ravitaillement. Une intuition salvatrice.
Car bientôt, la vérité s’impose : il n’y a pas d’eau. Les sources que Caballo espérait trouver sont à sec. Le soleil tape fort, la pente est raide, et les kilomètres s’enchaînent. Déshydratés, les coureurs doivent redescendre au plus vite.
Et puis, le drame. Dans la confusion des lacets, Jenn et Billy se perdent dans la montagne. Isolés, désorientés, ils n’ont ni eau ni nourriture. Jenn chancelle. La panique monte. McDougall décrit leur peur grandissante :
"Elle [Jenn] était prise de vertiges, comme si son esprit s'était détaché de son corps. Ils n'avaient rien avalé d'autre que la barre énergétique partagée six heures plus tôt et pas bu une goutte depuis midi."
Soudain, dans leur détresse, au détour d’un rocher, les jeunes coureurs tombent sur une mare d’eau croupie, trouble, infestée de moustiques. Repoussante. Mais vitale.
Sans choix, ils remplissent leurs gourdes dans l’eau nauséabonde, trinquent tragiquement avec ironie : "J'ai toujours su que tu finirais par me tuer" lâche Billy avant de la boire pour survivre. Mais Jenn craque : "C'est pour de vrai, Billy... On va mourir ici. On va mourir aujourd'hui."
Mais le destin en décide autrement. Par hasard, Eric et McDougall croisent leur chemin. Ils les retrouvent, choqués, hagards, brûlés par le soleil, vidés, mais vivants. Ils rentrent au village, tremblants, silencieux. L’excès d’insouciance a bien failli coûter cher.
Plus tard, alors que tout le monde tente de digérer l’événement, Caballo s’approche d’Eric, l’air à la fois sérieux et impressionné. Il désigne Christopher du menton, le regard chargé d’une admiration sincère : "C'est quoi ton secret, mec ? (...) Comment tu as retapé ce type ?"
Chapitre XXVII - La métamorphose d'un coureur
Avant d’atteindre les canyons, Christopher McDougall a dû traverser un autre territoire difficile : celui de ses propres limites. Il revient ici sur ce tournant décisif, un an plus tôt, lorsqu’il croise la route d’Eric Orton.
Frustré, bloqué, usé par les blessures à répétition, malgré ses tentatives pour courir "à la Caballo", McDougall se sent à bout. C’est là qu’Eric lui tend la main : il accepte de l’entraîner, mais en échange, il lui demande de lui présenter Caballo.
Le pacte est scellé.
Le travail commence par une rééducation complète de sa manière de courir. Exit les foulées lourdes et les frappes de talon. Eric le guide vers un geste plus naturel, plus souple, plus humain.
Ils croisent aussi Ken Mierke, un kinésithérapeute qui a développé l'Evolution Running, une méthode inspirée de l'observation des coureurs kenyans. Mierke explique alors à Christopher que "les meilleurs marathoniens mondiaux courent comme des élèves de maternelle" : des appuis légers, une cadence rapide, une liberté presque animale. Pas de forçage. Pas de crispation.
Côté nutrition, changement de cap total. McDougall adopte une alimentation inspirée des Tarahumaras : pinole (maïs grillé et moulu), graines de chia, haricots, et beaucoup de légumes verts. Sur les conseils du Dr Ruth Heindrich, il tente même… la salade au petit-déjeuner. Et contre toute attente, ça marche.
Les effets de sa transformation se font sentir partout, dans tous les aspects de sa vie. Son corps fond : 11 kilos en moins. Mais surtout : plus de douleurs. Et ce n’est pas tout, raconte-il :
"Ma personnalité changeait elle aussi. Le côté râleur et la mauvaise humeur que j'imputais à mes gènes italo-irlandais s'estompaient au point que ma femme m'en fit la remarque : "Si c'est dû à l'ultra, je veux bien nouer tes lacets", me dit-elle."
Enfin, le plus grand changement concerne sa relation à la course elle-même. Un matin, courant presque nu dans un champ, il atteint un état de grâce : "une telle impression de facilité, de légèreté, de fluidité et de vitesse que j'aurais pu courir jusqu'au matin."
Finie l’angoisse des longues sorties. Courir est devenu un plaisir, un besoin, comme si son corps retrouvait sa fonction première. Grâce à la méthode d’Eric, combinant technique minimaliste, renforcement musculaire et alimentation saine, McDougall est devenu ce qu’il n’aurait jamais osé imaginer : un ultrarunner. Un vrai. Capable de courir cinq heures d’affilée sans douleur.
Et, dans un éclair de certitude, il le ressent profondément : "Je me sentais né pour courir. Et, selon trois scientifiques iconoclastes, je l'étais bel et bien."
Chapitre XXVIII - La science du "né pour courir"
Dans ce nouveau chapitre de "Born to run | Né pour courir", dense et foisonnant, l’auteur étudie les fondements scientifiques de notre nature de coureurs. Pour cela, il nous emmène là où la biologie, l’anthropologie et l’évolution se rencontrent afin de répondre à une question essentielle : et si nous étions réellement nés pour courir ?
En fait, tout commence avec David Carrier, un jeune biologiste qui, en disséquant un lièvre, fait, un jour, une découverte intrigante : un système biomécanique relie respiration et locomotion. Intrigué, il pousse la réflexion plus loin : et si cette mécanique était aussi présente chez l’être humain ? Et si notre espèce avait évolué spécifiquement pour courir ?
Pour le Dr Dennis Bramble, son professeur, cette théorie est absurde. Les humains, rappelle-il, sont "nuls" en course comparés aux félins ou autres prédateurs. Pourtant, une question s’impose malgré tout : pourquoi l'évolution nous aurait-elle privés de force et de vitesse sans compensation ? Autrement dit, si l’évolution nous a privés de crocs, de griffes, de vitesse… alors qu’a-t-elle mis à la place ?
David Carrier et Dennis Bramble se mettent alors à décortiquer ensemble le corps humain.
Et ce qu’ils découvrent est fascinant : le tendon d’Achille, absent chez les primates, agit comme un ressort. La voûte plantaire amortit et relance. Les fessiers massifs, loin d’être décoratifs, stabilisent la foulée. Et surtout, le ligament nuchal, qui ancre la tête et la maintient droite pendant la course, n'existe que chez les animaux coureurs… et chez nous.
En somme, toutes ces caractéristiques, absentes chez nos cousins primates, sont exactement ce dont on a besoin pour courir de longues distances. "L’être humain a une foulée plus longue qu’un cheval" réalise Bramble, stupéfait. Notre corps n’est pas conçu pour la vitesse explosive, mais pour l’endurance.
Encore plus incroyable : contrairement aux autres mammifères qui ne peuvent respirer qu'une fois par foulée, "les humains sont libres de choisir leur rythme respiratoire". Là où un cheval ou un chien doit respirer à chaque pas, nous, pouvons courir sans caler notre respiration sur nos foulées. Un atout vital pour courir longtemps.
Et ce n’est pas tout. Notre peau, sans fourrure, couverte de glandes sudoripares, nous permet de transpirer en continu, même sous une chaleur écrasante. Un guépard, lui, doit s’arrêter dès que sa température grimpe trop (40°C).
Le Dr. Lieberman de Harvard apporte la pièce manquante du puzzle en remettant au goût du jour une hypothèse : celle de la chasse à l'épuisement, autrement dit la capacité à poursuivre une proie pendant des heures sous le soleil, jusqu’à ce que l’animal, incapable de se refroidir, s'effondre d'hyperthermie. "Si vous êtes capable de courir 10 kilomètres un jour d'été, vous êtes un fléau mortel pour le règne animal" résume Christopher McDougall.
Le chapitre atteint son apogée lorsque l’auteur nous raconte comment Louis Liebenberg, un mathématicien sud-africain, a finalement confirmé cette théorie en chassant aux côtés des Bochimans du Kalahari.
En effet, l’équipe de chasse dont il fut participant traqua pendant des heures un koudou sous un soleil accablant, jusqu'à ce que l'animal finisse par s’écrouler, vaincu par la chaleur. Pour l’auteur, cette pratique ancestrale, toujours vivante chez certains peuples indigènes, témoigne de notre nature première.
Mais alors, si nous sommes conçus pour courir, pourquoi tant de gens détestent ça ?
La réponse, Bramble l’a formulée avec lucidité : nous avons "un corps taillé pour la performance, mais un cerveau constamment à la recherche de l'efficacité". Un paradoxe biologique en somme : ce que notre corps sait faire, notre esprit nous persuade d’éviter de le faire. En d’autres termes : notre formidable évolution nous a donné les outils pour courir, mais notre cerveau, programmé pour économiser l'énergie, nous en dissuade. Ceci explique pourquoi tant de gens détestent courir malgré leur potentiel naturel.
L’auteur nous en fait une démonstration la plus étonnante avec l’histoire de ce coureur qui, à 64 ans, retrouve les performances de ses 18 ans.
"On ne s'arrête pas de courir parce qu'on vieillit", conclut l'auteur, "on vieillit parce qu'on arrête de courir".
Chapitre XXIX - La rencontre avec les Tarahumaras
L’aube n’est pas encore levée, et déjà Caballo frappe à la porte de Christopher McDougall. Le moment tant attendu est arrivé : aujourd’hui, ils doivent rencontrer les Tarahumaras.Mais rien n’est certain. Après des mois d’attente, viendront-ils vraiment ? Et surtout, les Américains seront-ils à la hauteur de ces coureurs légendaires, qui semblent jaillir d’un autre temps ?
Caballo est nerveux. Pas à cause du défi physique, non. Il redoute le bruit. L’agitation. L’ego. Il redoute Barefoot Ted, ce moulin à paroles qu’il compare, sans ironie, à un avertisseur de voiture. "S'il saoule les Rarámuri de paroles, ils vont vraiment se sentir mal", confie-t-il à McDougall, hanté par les souvenirs de Rick Fisher, dont les manières tapageuses avaient déjà fait fuir certains d’entre eux.
Le petit groupe s’engage le long de la rivière, guidé par la lumière bleutée de la lune décroissante. Les chauves-souris dansent au-dessus de leurs têtes, l’air est encore frais, les pas s’enchaînent dans un silence respectueux. Caballo mène l’allure à un rythme soutenu, comme s’il voulait s’assurer que seuls ceux qui en sont dignes atteindraient le rendez-vous.
Au point de rencontre convenu, les heures passent sans que personne n’apparaisse. Tout est désert. Puis, soudain, les voilà. McDougall raconte avec émotion : "À peine avais-je eu le temps de ciller, qu'ils avaient surgi de la forêt pour se matérialiser sous nos yeux". Parmi eux, se trouvent Arnulfo Quimare et son cousin Silvino Cubesare, mais aussi Manuel Luna, le père de Marcelino, l'adolescent assassiné.
Christopher est ému. Il s’approche de Manuel, la gorge nouée : "Je connaissais votre fils. Il a été d'une grande bonté avec moi, un véritable caballero." Manuel, d’une voix douce lui répond : "Il m'a parlé de toi. Il voulait venir."
Le moment est suspendu, solennel, mais détend l’atmosphère :
"Les émouvantes retrouvailles entre Manuel et Caballo mirent tout le monde à l’aise. Les autres membres de l’équipe de Caballo passaient des uns aux autres, échangeant le salut tarahumara qu’il leur avait appris, ce frôlement fugace du bout des doigts à la fois moins brutal et plus intime qu’une vieille poignée de main énergique."
Caballo reprend la parole. Il présente chaque membre du groupe non par son nom, mais en lui attribuant un totem animal : Luis devient "El Coyote", Eric "El Gavilán" (le faucon), Billy "El Lobo Joven" (le jeune loup), et Jenn "La Brujita Bonita" (la jolie sorcière).
Ce dernier surnom déclenche quelques sourires chez les Tarahumaras, en souvenir de la "bruja" Ann Trason, qu’ils avaient affrontée à Leadville.
Et puis vient le tour de Scott Jurek. Caballo le nomme "El Venado" (le cerf). Un silence suit. Même le stoïque Arnulfo semble surpris. Est-ce un message codé ? se demande l'auteur. Un message rappelant la stratégie de chasse utilisée contre Ann Trason lors de la course de Leadville, où le cerf symbolisait la proie à traquer ?
L'atmosphère, déjà chargée d'émotions, est alors interrompue par Barefoot Ted qui se présente lui-même. Il bondit en mimant un chimpanzé et se proclame "El Mono", tout en agitant ses grelots pour les faire tinter (un accessoire qu’aucun Tarahumara ne porte).Les Rarámuris, médusés, le regardent, muets d’étonnement.
Le groupe reprend enfin sa marche. Mais Silvino reste, comme dans le jeu de balle traditionnel où il surveille ses coéquipiers, en retrait en arrière, silencieux : "Par habitude" dit-il simplement. Mais Eric, lui, voit autre chose. Il observe Arnulfo qui scrute attentivement Jurek : "Peut-être que la course a déjà commencé" murmure-t-il.
Chapitre XXX - La grande course commence
Dans le 30ème chapitre de "Born to run | Né pour courir", Christopher McDougall nous embarque au cœur d'Urique à la veille de la course. Le paisible village niché au fond du canyon s’anime comme un stade en pleine ébullition.
En effet, ici, l’événement qui oppose les légendaires coureurs tarahumaras aux ultrarunners américains fait vibrer tout le monde : enfants, anciens, commerçants, tous vivent au rythme de la rumeur des pas à venir. Ce n’est plus seulement une course. C’est un festival d’âmes et de légendes.
Dans les rues, chaque coureur est devenu un personnage. Chacun d’entre eux est désormais connu par le totem que Caballo lui a attribué : "Partout où nous allions, nous étions hélés : Hola, Brujita ! Buenos días, señor Mono !".
Les paris vont bon train. Certains jurent par Arnulfo, le héros local, invincible sur ces terres. D’autres parient sur Scott Jurek, le coureur venu du froid, mystérieux "Cerf" à l’allure tranquille.
Christopher McDougall observe la similarité frappante entre ces deux hommes issus de cultures diamétralement opposées : "Ils avaient abordé leur discipline aux deux extrémités de l'Histoire et s'étaient rencontrés au milieu", note-t-il après les avoir vus courir côte à côte.
L’un vient du cœur du Mexique ancestral, l’autre des sentiers battus de l’ultra américain moderne. Et pourtant, dans leur foulée, dans leur silence, dans leur manière de flotter plutôt que de forcer, on ne distingue plus le champion moderne du coureur indigène. Ils sont devenus frères d’allure.
Et derrière la légende sportive, Christopher McDougall perçoit une vérité plus profonde chez Scott Jurek : contrairement à ce que l’on pourrait croire, à son image de compétiteur acharné, Scott n’est pas ici pour battre les autres, ni pour dominer. Il a compris ce que les Tarahumaras savent depuis toujours : on ne court pas pour nous mesurer les uns aux les autres. On ne court pas les uns contre les autres. On court les uns avec les autres. La course n’est pas une rivalité,c’est une communion. Un lien. Un acte d’amour partagé plus qu'une simple performance.
Alors, le soir venu, Caballo lève son verre. Il porte un toast à ces "Más locos", ces fous, ces illuminés "qui voient des choses que les autres ne voient pas". Ces rêveurs assez audacieux pour croire qu’on peut courir ensemble autrement et qui sont aujourd’hui réunis pour vivre ensemble quelque chose d'extraordinaire : la plus grande course de tous les temps.
"- (…) La course de demain sera l’une des plus grandes de tous les temps et qui pourra la voir ? Seulement les dingues. Seulement les Más locos.
Aux Más locos ! crièrent les coureurs attablés en trinquant avec leurs bouteilles de bière. Caballo blanco, le vagabond solitaire des Hautes Sierras, sorti de son isolement, était désormais entouré d’amis. Après des années de déceptions, douze heures le séparaient de la réalisation de son rêve.
Demain, vous verrez ce que voient les fous. Le coup de pistolet sera tiré à l’aube, parce qu’il faudra courir longtemps.
VIVE CABALLO !"
Chapitre XXXI - Le duel des champions
Le grand jour est là.À l’aube, les rues d’Urique s’éveillent en fête, habillées de guirlandes de fleurs fraîches, bercées par les accords des mariachis. Les regards brûlent d’impatience.
Les coureurs s’alignent sur la ligne de départ, des Tarahumaras silencieux aux Américains fébriles, tous conscients que ce qu’ils s’apprêtent à vivre n’aura rien d’ordinaire.
Le parcours, imaginé par Caballo, est une épreuve démoniaque : 80 kilomètres de chemins escarpés, près de 2000 mètres de dénivelé, une boucle sauvage à travers les canyons. Pas de bitume. Pas de répit.
Au coup de pistolet, les Tarahumaras d’Urique partent à un train d'enfer, leurs sandales claquant contre les pierres. Arnulfo, Silvino, Scott se détachent, filant dans un silence concentré.
McDougall, plus sage, reste en arrière, décidé à courir pour lui, à son rythme. Le paysage est sublime, mais la tension monte. Au détour d’un sentier, il aperçoit un serpent corail lové sur la piste. Son sang se glace. Finalement, l’animal est mort, mais l’adrénaline est bien réelle. Ici, tout peut arriver.
De son côté, Jenn Shelton, la "Brujita", livre une bataille sans merci. Après une chute brutale, le genou meurtri, le bras ensanglanté, elle voit les Tarahumaras la dépasser sans un regard pour elle. Mais elle se relève. Et court.
"Elle était sur le point de s’évanouir. Sa rotule semblait cassée et l’un de ses bras était en sang".
Et pourtant, elle revient. Elle remonte, et atteint la quatrième place, portée par cette force obscure qu’ont ceux qui refusent d’abandonner.
Le sommet de la course approche. Et là, contre toute attente, Arnulfo et Silvino prennent la tête, dépassant Scott. Ce dernier se lance alors dans une poursuite acharnée. Le Cerf devient chasseur. Il revient sur eux, avec cette foulée fluide et précise, forgée par des années d’ultrafond, mais guidée aujourd’hui par quelque chose de plus grand : le respect.
La dernière ligne droite est magistrale. Les trois hommes ne luttent plus les uns contre les autres, mais dans une même cadence, une même offrande.
Arnulfo franchit la ligne en premier, suivi de Scott puis de Silvino. Et dans un geste de respect d’une élégance rare, Scott s’incline devant Arnulfo.Un instant suspendu. La foule exulte. Ce n’est pas une défaite. C’est un hommage.
Bien plus tard, McDougall franchit la ligne à son tour, après douze heures de lutte, les jambes tremblantes mais le cœur gonflé. Il est accueilli par la communauté comme un frère. Pas comme un héros, mais comme un coureur. Un des leurs.
Chapitre XXXII - L'histoire de Caballo
Dans le dernier chapitre de "Born to run | Né pour courir", le mystère autour de Caballo Blanco s’efface enfin : le Cheval Blanc tombe le masque. Et ce qu’il révèle n’est pas un mythe, mais un homme. Complexe, bouleversant, profondément libre.
Il s’appelait Michael Randall Hickman.
Fils d’un sergent des Marines, élevé dans la rigueur et la discipline, il choisit pourtant une voie radicalement différente. Boxeur amateur, il se faisait appeler Gypsy Cowboy, un surnom à mi-chemin entre la poussière des rings et la quête d’un ailleurs. Il mettait K.O. ses adversaires lors de matchs clandestins pour payer ses études en religions orientales. Et pourtant, le jeune homme sensible qu’il était pleurait après ses combats, incapable de faire la paix avec la violence.
À Maui, il rencontra Smitty, un ermite des montagnes qui courait la nuit, pieds nus sur les sentiers volcaniques. Ce fut une révélation. Michael découvrit que courir pouvait être une prière, une manière de disparaître tout en se retrouvant.
Il prit alors un nouveau nom : Micah True. Un hommage au prophète Michée, porteur de vérité, et à un chien fidèle rencontré sur la route. Il cherchait un sens.
Il traversa ensuite une rupture amoureuse douloureuse suivie d’un accident grave à vélo. Il eut alors cette révélation :
"Peut-être que je ferais mieux de trouver un sens à ma vie. Je l'ai cherché partout, mais je ne l'ai trouvé qu'en courant".
Alors il devint ce que personne n’attendait : Caballo Blanco, un coureur sans maison, sans fortune, mais riche d’espace et de silence. Il se perdit volontairement dans les canyons du Mexique, où il trouva ce qu’il avait toujours cherché : une tribu, une cause, sa liberté.
Et puis, la boucle se referme.
Seulement quelques semaines après la grande course, McDougall nous apprend que Caballo s’est éteint, lors d’une sortie en solitaire. Son cœur, après avoir tant donné, s’est arrêté doucement. Il est retrouvé mort sur un sentier, seul, comme il avait choisi de vivre.
Ce jour-là, comme un ultime clin d’œil du destin, des témoins affirment avoir vu un groupe de chevaux sauvages s’arrêter à distance. Parmi eux, un cheval blanc.
Conclusion de "Born to run | Né pour courir " de Christopher McDougall
Quatre idées clés à retenir du livre "Born to run | Né pour courir"
1 - L'être humain est biologiquement programmé pour être un coureur d'endurance exceptionnel
Christopher McDougall nous démontre, preuves scientifiques à l'appui, que notre anatomie tout entière est conçue pour la course de fond.
Le tendon d'Achille qui agit comme un ressort, les fessiers massifs qui stabilisent la foulée, notre capacité unique à transpirer pour réguler la température : tout nous destine à être des prédateurs d'endurance.
Contrairement aux idées reçues, nous ne sommes pas des coureurs médiocres, mais des machines biologiques parfaitement adaptées à la chasse à l'épuisement.
Une révélation qui bouleverse notre perception de nos propres capacités physiques.
2 - Les chaussures modernes sont davantage un problème qu'une solution
L'auteur porte un regard critique implacable sur l'industrie des chaussures de running.
Plus surprenant encore, les études révèlent que les coureurs utilisant des chaussures haut de gamme se blessent deux fois plus que ceux portant des modèles basiques. Les Tarahumaras, avec leurs simples sandales en pneu, nous enseignent qu'un pied libre et fort constitue la meilleure protection.
Cette approche minimaliste remet en question des décennies de marketing sportif.
3 - La course doit retrouver sa dimension de plaisir et de communion
Au cœur du récit de Christopher McDougall se trouve ce message fondamental : nous avons perdu la joie de courir.
Les Tarahumaras ne courent pas pour battre des records, mais par amour du mouvement et esprit de communauté. "Born to run" nous montre que lorsque la course redevient célébration plutôt que souffrance, elle révèle son potentiel transformateur.
Cette philosophie s'oppose radicalement à notre approche occidentale obsédée par la performance et la compétition.
4 - L'aventure humaine authentique existe encore dans notre monde moderne
À travers son périple dans les canyons mexicains et sa rencontre avec des personnages hors du commun comme Caballo Blanco, l'auteur nous prouve que l'aventure véritable demeure possible.
Cette quête nous rappelle qu'au-delà des technologies et du confort moderne, l'essence de l'humanité réside dans le dépassement de soi et la connexion à nos instincts primitifs.
Qu'est-ce que la lecture de "Born to run | Né pour courir" vous apportera ?
Au-delà de la dimension purement sportive de la course à pied , "Born to run" est un ouvrage qui vous reconnecte à ce que votre corps sait faire depuis toujours, mais que vous aviez peut-être oublié. À travers son enquête palpitante, Christopher McDougall vous amène en effet à mieux connaître votre potentiel, qui se trouve, selon lui, bien au-delà du simple effort physique.
Avec lui, vous vous libérez aussi des idées reçues sur la performance, des diktats technologiques, des chaussures trop épaisses et des stratégies trop complexes. Vous redécouvrez la course comme un art simple, naturel et joyeux, où chaque foulée devient un pur plaisir et un acte de liberté.
Mais "Born to Run | Né pour courir" est aussi un livre de transformation personnelle. Il vous invite à écouter votre corps plutôt qu’à le contraindre, à chercher le plaisir plutôt que la douleur, à comprendre que la véritable puissance vient de l’alignement entre le corps, le souffle et l’esprit.
Et surtout, il vous montre que l’excellence ne réside pas dans ce qu’on ajoute, mais dans ce qu’on retrouve : une forme de pureté, d’humilité, d’authenticité. À l’arrivée, ce n’est pas seulement votre manière de courir qui change, mais votre rapport à l’effort, à la nature, aux autres… et à vous-même.
Pourquoi lire "Born to run" ?
"Born to run" mérite sa place dans votre bibliothèque pour deux raisons majeures :
D'abord, il révolutionne votre compréhension du corps humain et de ses capacités insoupçonnées, vous donnant envie de tester vos propres limites avec un regard neuf.
Ensuite, il livre un récit d'aventure authentique et captivant qui vous transporte dans un univers où l'exploit sportif rejoint la quête existentielle.
Cette lecture s'impose comme un antidote salutaire à notre époque de surconsommation technologique. Il nous rappelle que nos plus grandes victoires naissent souvent de la simplicité et du retour aux sources.
Points forts :
Le récit d'aventure captivant mêlant enquête journalistique et épopée humaine.
Les révélations scientifiques intéressantes sur notre nature de coureurs et le running en général.
La remise en question, à mes yeux salutaire, de l'industrie du running moderne.
La philosophie inspirante qui se dégage au-delà de la course à pied.
Points faibles :
Certains passages scientifiques peuvent ralentir le rythme narratif.
L'idéalisation parfois excessive de la culture tarahumara.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu "Born to run | Né pour courir " ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Christopher McDougall "Born to run | Né pour courir"
Visitez Amazon afin d'acheter le livre de Christopher McDougall "Born to run | Né pour courir "
 ]]>
]]>Résumé de "Walden ou la vie dans les bois" de Henry David Thoreau : dans une Amérique secouée par la révolution industrielle, Henry David Thoreau fait un choix radical : il décide de partir vivre seul, pendant près de deux ans, dans les bois, dans une cabane qu’il construit lui-même au bord de l’étang de Walden. Son but ? Se libérer des contraintes sociales, faire l'expérience d'une existence sobre et autosuffisante, et se reconnecter à l’essentiel, au rythme paisible de la nature.
Par Henry David Thoreau, 1854 (réédition 2017), 156 pages.
Titre original : "Walden", 1854, 330 pages.
Chronique et résumé de "Walden ou la vie dans les bois" de Henry David Thoreau
Chapitre 1 - Économie
Dans le premier chapitre de "Walden ou la vie dans les bois", l'auteur, Henry David Thoreau nous plonge directement dans son expérience de vie solitaire, en marge de la société, près de l'étang de Walden.
Il pose le décor et présente les circonstances de son installation : "Je vivais seul, dans les bois, à un mille de tout voisinage, en une maison que j'avais bâtie moi-même, au bord de l'Étang de Walden, à Concord, Massachusetts, et ne devais ma vie qu'au travail de mes mains. J'habitai là deux ans et deux mois."
Thoreau explique que s'il écrit à la première personne, contrairement à l'usage courant dans la littérature de l'époque, c'est parce qu'il souhaite partager son expérience personnelle de manière sincère. Il estime d'ailleurs que tout écrivain devrait se raconter lui-même en livrant un récit authentique de sa propre vie plutôt que de simplement rapporter la vie des autres.
Ce témoignage, il le destine avant tout à celles et ceux qui se sentent insatisfaits, enfermés, dans une vie qui ne leur ressemble pas, ou qui peinent à gagner leur vie.
Il décrit, avec un regard critique, ses concitoyens autour de lui, à Concord, semblables à des pénitents modernes. Leurs existences laborieuses, usantes et répétitives, lui rappellent les austérités des brahmines de l’Inde. Pour lui, ces hommes s’épuisent dans des tâches bien plus rudes que les douze travaux d’Hercule, sans jamais en voir la fin.
1.1 - La servitude moderne
L'héritage empoisonné : devenir esclaves de ses biens
Henry David Thoreau dépeint avec acuité le sort des jeunes fermiers de son époque : bien loin d'être une chance, hériter d'une terre, d'une maison ou de quelques bêtes est, selon lui, un piège. Car ces derniers se retrouvent alors esclaves de leurs possessions. Il relate à leur propos : "Je vois des jeunes gens, mes concitoyens, dont c'est le malheur d'avoir hérité de fermes, maisons, granges, bétail, et matériel agricole ; attendu qu'on acquiert ces choses plus facilement qu'on ne s'en débarrasse."
Ainsi, selon lui, ces héritages, censés représenter une sécurité, deviennent un fardeau qui les empêche de mener une vie d'homme véritable.
Le travail aliénant : l'homme réduit à une machine
L'auteur dénonce aussi ici le poids du travail excessif et incessant qui grignote le temps, l’énergie et l’âme. À force de trimer sans relâche, l'homme perd la capacité de cultiver "les plus nobles relations d'homme à homme". Son labeur constant le transforme en simple machine. Il devient une mécanique, un rouage de plus dans une société lui laissant à peine le temps pour ce qu’il a de plus fin : ces qualités humaines qui, comme une fleur sur un fruit, ne peut éclore que dans la délicatesse et l'attention.
L'endettement et l'auto-asservissement : une servitude invisible
Thoreau s'attarde ensuite sur la pauvreté et l'endettement qui affligent nombre de ses contemporains.
Il décrit avec compassion mais sans complaisance cette "vie basse et rampante" menée par ceux qui vivent à crédit, toujours au bord du gouffre, luttant pour survivre, ceux qui sont constamment, selon ses termes "sur les limites, tâchant d'entrer dans une affaire et tâchant de sortir de dette".
Prises dans les dettes (que Thoreau nomme "æs alienum", qui signifie littéralement "l'airain d'autrui"), ces personnes, poursuit l'auteur, consacrent finalement leur existence à des manœuvres souvent dégradantes pour s'en sortir, s’épuisent dans des combines et des compromis qui les rabaissent.
Pour Henry David Thoreau, l'esclavage ne se limite pas à celui des Noirs dans les champs de coton du Sud. Il existe, dit-il, une forme bien plus sournoise d’asservissement qui touche tous les hommes, y compris ceux du Nord : celle qu’on s’impose à soi-même.
Il l'écrit sans détour : "Il est dur d'avoir un surveillant du sud ; il est pire d'en avoir un du nord ; mais le pis de tout, c'est d'être le commandeur d'esclaves de vous-même."
Dans ce monde moderne, l’existence de la plupart des hommes, selon Henry David Thoreau, est faite de "tranquille désespoir" : une vie de résignation, où l’on s’habitue au renoncement jusqu’à le confondre avec la normalité. Et ce mal, loin d’être marginal, traverse les villes comme les campagnes, sans distinction de classe.
1.2 - Les fondements d'une vie authentique
L'essentiel à vivre : la vie ramenée à ses besoins primaires
Pour Henry David Thoreau, "le nécessaire de la vie" se limite au "Vivre, Couvert, Vêtement et Combustible". En d'autres termes, les vrais besoins de l’homme tiennent en quatre mots : se nourrir, se loger, se vêtir et se chauffer.
L'auteur examine ici ces nécessités de base sous l'angle de la "chaleur vitale" qui, selon lui, constitue l'essence même de la vie animale. Il développe une analogie entre le corps humain, qu'il compare à un fourneau, et la nourriture qui serait le combustible entretenant cette chaleur.
Le confort moderne : une illusion qui étouffe l'esprit et affaiblit l'âme
Puis Thoreau s’attaque au luxe et au confort superflu, qu’il juge non seulement inutiles, mais nuisibles à l’âme. Il rappelle que "les anciens philosophes, chinois, hindous, persans et grecs" vivaient tous avec moins que les pauvres de son époque, tout en rayonnant d’une richesse intérieure que nul bien matériel ne saurait égaler.
Pour lui, seule une personne qui choisit délibérément une certaine forme de pauvreté peut réellement observer la vie humaine avec justesse et lucidité :
"Nul ne peut se dire impartial ou prudent observateur de la vie humaine, qui ne se place sur le terrain avantageux de ce que nous appelons la pauvreté volontaire."
Besoins réels Vs désirs fabriqués : choisir la voie de l'élévation
Henry David Thoreau établit enfin une distinction claire entre les besoins réels et les désirs artificiels créés par la société.
Il soutient qu'une fois satisfaits les besoins fondamentaux, l'homme devrait aspirer à s'élever spirituellement plutôt que de continuer à accumuler des biens matériels :
"Lorsqu'un homme est chauffé (...) que lui faut-il ensuite ? Assurément nul surcroît de chaleur du même genre (...). Une fois qu'il s'est procuré les choses nécessaires à l'existence, s'offre une autre alternative que de se procurer les superfluités ; et c'est de se laisser aller maintenant à l'aventure sur le vaisseau de la vie."
1.3 - L'expérience personnelle de Thoreau
Décidé à mener une expérience de vie autonome, Henry David Thoreau se lance, en mars 1845, dans une aventure concrète : il emprunte une hache en mars, part abattre quelques pins et construit lui-même une maison au bord de l’étang de Walden.
Il raconte alors ici, avec précision, son travail de charpentier : les journées passées dans la forêt à couper, tailler et assembler le bois, emportant avec lui simplement du pain et du beurre pour son repas de midi.
Dès la mi-avril, l'ossature de sa maison est en place. Pour finir l’ouvrage, Thoreau achète une vieille cabane appartenant à un Irlandais, James Collins, récupère les planches et les transporte à la main jusqu’à l'étang.
Il creuse ensuite une cave dans le flanc d’une colline, dresse la charpente avec l’aide de quelques connaissances, et emménage le 4 juillet, jour symbolique d’indépendance. Sa maison, à ce moment-là, est encore rudimentaire : un toit, des murs de planches, mais pas de cheminée. Celle-ci ne sera construite qu’à l’automne.
1.4 - Le coût réel de l'existence
Henry David Thoreau présente ensuite un compte-rendu minutieux des dépenses qu'il a engagées pour sa maison et sa vie à Walden.
Les planches lui coûtèrent 8 dollars et 3 cents, les bardeaux 4 dollars, et l'ensemble des matériaux pour sa maison s'éleva à 28 dollars et 12 cents. Il détaille également ses dépenses alimentaires pour 8 mois (riz, mélasse, farine de seigle, etc.) qui s'élèvent à 8 dollars et 74 cents. Au total, en incluant vêtements et autres menus achats, il dépensa 61 dollars et 99 cents sur cette période.
L'auteur tire de cette expérience un enseignement essentiel : vivre simplement est non seulement possible, mais étonnamment accessible. Il confie :
"J'appris de mes deux années d'expérience qu'il en coûterait incroyablement peu de peine de se procurer sa nourriture nécessaire même sous cette latitude ; qu'un homme peut suivre un régime aussi simple que font les animaux, tout en conservant santé et force."
Thoreau raconte, en effet, avoir vécu de manière presque frugale (s'être nourri, par exemple, parfois simplement d'un plat de pourpier cueilli dans son champ, ou de maïs bouilli avec un peu de sel), mais avoir, pour autant, gardé santé et énergie intactes.
1.5 - Réflexions sur le vêtement
Henry David Thoreau consacre une réflexion entière au vêtement, qu'il considère principalement sous l'angle pratique de la conservation de la chaleur vitale.
Il raille ceux qui s'inquiètent excessivement de leur apparence vestimentaire. Jamais un homme n’a perdu son estime pour avoir un vêtement rapiécé, affirme-t-il. Un accroc non raccommodé ? Cela ne révèle rien d’autre, au pire, qu’un brin d’"imprévoyance".
L'auteur pousse plus loin sa pensée en développant une métaphore : nos vêtements sont comme l’écorce d’un arbre. Les habits extérieurs ne sont qu’une fine pellicule, une sorte d'épiderme. Les vêtements plus épais, eux, correspondent au tissu cellulaire. Et nos chemises, enfin, sont comme le liber, cette couche vivante qui protège le tronc.
Pour Thoreau, l’homme devrait s’habiller avec sobriété de manière à rester toujours prêt à "poser la main sur lui-même (même) dans les ténèbres". Autrement dit, à vivre dans un état d’authenticité et de préparation permanent.
1.6 - Le logement et l'architecture
L'auteur propose aussi une réflexion profonde sur l'habitat. Il considère que la vraie question n'est pas l'apparence extérieure des maisons mais leur raison d'être fondamentale.
Il invite à réfléchir plus sérieusement à l'agencement de l'habitat : "Il vaudrait la peine de construire avec plus encore de mûre réflexion (...) en se demandant, par exemple, où une porte, une fenêtre, une cave, un galetas, trouvent leur base dans la nature de l'homme."
Henry David Thoreau critique l'architecture de son temps, trop soucieuse d’apparence et de fioritures. À ses yeux, la véritable beauté d'une maison provient de la simplicité dictée par les nécessités réelles et la personnalité de celui qui l'habite, non des décorations et ornements superflus. Il va jusqu’à comparer les maisons modernes à des tombeaux, dans lesquels les hommes "fixés sur la terre ont oublié le ciel".
1.7 - La philanthropie remise en question
Pour terminer le premier chapitre de "Walden ou la vie dans les bois", Thoreau aborde la question de la philanthropie.
Il avoue sans détours n'avoir jamais pris part aux "entreprises philanthropiques" et se montre sceptique face à ceux qui s'y engagent sans avoir réglé leurs propres problèmes : "Je n'ai jamais entendu parler de réunion philanthropique où l'on ait sincèrement proposé de me faire du bien, à moi ou à mes semblables" ironise-t-il.
Pour lui, il y a une grande différence entre la vraie charité et sa simple mise en scène. Il affirme ne pas se satisfaire de la "droiture" ou de la "bienveillance" chez un homme, qu’il compare à la tige et aux feuilles d’une plante. Ce qu’il recherche avant tout, c’est "la fleur et le fruit de l’homme", autrement dit ce qui naît d’une intégrité profonde, authentique, vécue dans la cohérence.
Il conclut avec une image empruntée au "Goulistan", un recueil persan de sagesse : celle du cyprès, arbre toujours vert, qui ne porte pas de fruits mais reste toujours florissant. Il en fait le symbole des esprits libres, détachés des dogmes religieux comme des obligations sociales imposées.
À travers le premier chapitre de "Walden ou la vie dans les bois", dense et riche en réflexions, Henry David Thoreau pose les fondements philosophiques de son expérience à Walden. Il y développe sa critique de la société industrielle naissante et présente son alternative : une vie simple, autonome et délibérément vécue, où la richesse se mesure en temps et en liberté plutôt qu'en possessions matérielles.
Chapitre 2 - Où je vécus, et ce pourquoi je vécus
2.1 - La quête d'un lieu idéal
Dans le second chapitre de "Walden ou la vie dans les bois", Henry David Thoreau Thoreau nous raconte comment il a choisi l’endroit où établir sa retraite, et surtout, pourquoi il a fait ce choix. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu, mais d'une intention profonde : vivre autrement.
L'auteur commence par décrire comment, à certaines périodes de sa vie, il contemplait tout endroit comme un site potentiel pour une maison.
Il parcourait alors mentalement les terres des fermiers environnants, les estimait, non pour en faire l’acquisition réelle, mais pour en apprécier les possibilités, rêver à ce qu’elles pourraient offrir. Il imaginait chaque ferme alentour comme un éventuel lieu de vie : "en imagination j’ai acheté toutes les fermes successivement, car toutes étaient à acheter, et je sus leur prix" écrit-il. Cette habitude lui valut d'être considéré comme une sorte de courtier en immeubles par ses amis, bien qu'il ne concrétisât jamais ces acquisitions.
La seule fois où il frôla la propriété, ce fut avec la ferme de Hollowell. Il s'y voyait déjà, et alors qu'il avait déjà commencé à faire des préparatifs pour s'y installer, l'épouse du propriétaire changea d'avis. Loin d'en être contrarié, Thoreau trouva cette expérience enrichissante : "Je découvris par là que j'avais été riche sans nul dommage pour ma pauvreté".
2.2 - L'installation à Walden : un refuge choisi, un acte volontaire de recentrage
C’est finalement au bord du petit étang de Walden qu’Henry David Thoreau s’installe. Il décrit ce lieu paisible, à une courte distance de Concord et du fameux champ de bataille qui a marqué l’histoire de la région.
La première semaine, l'étang lui apparait comme suspendu en l'air, tel un lac de montagne. Henry David Thoreau souligne que son isolement, loin de l'oppresser, lui procurait au contraire un sentiment de liberté et d'appartenance à l'univers entier.
C’est là que Thoreau nous révèle le cœur de sa démarche, les motivations profondes de son installation dans les bois :
"Je gagnai les bois parce que je voulais vivre suivant mûre réflexion, n'affronter que les actes essentiels de la vie, et voir si je ne pourrais apprendre ce qu'elle avait à enseigner, non pas, quand je viendrais à mourir, découvrir que je n'avais pas vécu".
2.3 - La simplicité contre le tumulte du monde
Henry David Thoreau appelle alors à une vie authentique et délibérée. Il critique la précipitation et la complexité de la vie moderne.
Selon lui, la simplicité constitue la clé d'une existence éveillée : "De la simplicité, de la simplicité, de la simplicité !" s'exclame-t-il, en nous exhortant de réduire nos affaires à l'essentiel.
Pour le philosophe, la vie américaine ressemble à une Confédération germanique "faite de tout petits États, aux bornes à jamais flottantes", fragmentée et confuse.
Enfin, Thoreau conteste l'agitation perpétuelle de ses contemporains, leur obsession pour les nouvelles et leur incapacité à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Pour lui, ce que la plupart appellent "la vie" n’est souvent qu’un reflet superficiel, un masque posé sur une réalité plus vaste, plus discrète.
Le chapitre s'achève sur une métaphore :
"Le temps n'est que le ruisseau dans lequel je vais pêchant. J'y bois ; mais tout en buvant j'en vois le fond de sable et découvre le peu de profondeur. Son faible courant passe, mais l'éternité demeure".
Chapitre 3 - Lecture
Dans le troisième chapitre de "Walden ou la vie dans les bois", Henry David Thoreau médite sur la valeur des livres et l'art de la lecture authentique.
3.1 - Lire, c'est toucher à l'éternel
Pour Thoreau, lire les grands textes et y découvrir une forme de vérité, c’est "dialoguer avec l’éternité" :
"En accumulant la propriété pour nous-mêmes ou pour notre postérité, en fondant une famille ou un État, ou même en acquérant la renommée, nous sommes mortels ; mais en traitant avec la vérité, nous sommes immortels, et n’avons lieu de craindre changement plus qu’accident.
Dans un long passage après cet extrait, Henry David Thoreau suggère, en gros, que la sagesse contenue dans les œuvres classiques transcende les siècles et garde "intacte sa lumière".
3.2 - Lire vraiment, une discipline exigeante
Installé à Walden, Thoreau pensait avoir trouvé l’environnement idéal pour la lecture profonde. Mais, admet-il, le premier été fut avant tout consacré aux tâches manuelles : "Je ne lus pas de livres le premier été ; je sarclai des haricots." Il garda toutefois l'"Iliade" d'Homère sur sa table, même s'il ne la feuilletait que rarement.
Pour Henry David Thoreau, les livres héroïques, c'est-à-dire ceux qui élèvent l’âme, méritent une lecture à la hauteur de leur exigence, à la hauteur de la noblesse des œuvres elles-mêmes.
Le philosophe distingue le langage parlé, "quelque chose de bestial" que l'on acquiert sans effort, inconsciemment, du langage écrit qui représente "notre langue paternelle", plus élaborée et significative, qui demande patience et rigueur. Cette distinction explique pourquoi les grands textes classiques demeurent difficiles d'accès pour le commun des mortels.
Henry David Thoreau critique vivement les lectures faciles et la paresse intellectuelle de la plupart de ses contemporains. Il déplore :
"La plupart des hommes sont satisfaits s'ils lisent ou entendent lire, et ont eu la chance de se trouver convaincus par la sagesse d'un seul bon livre, la Bible, pour le reste de leur vie végéter et dissiper leurs facultés dans ce qu'on appelle les lectures faciles."
Il méprise particulièrement les romans populaires et superficiels qui abondent à son époque.
3.3 - Pour une vie entière d'apprentissage
Enfin, dans un long passage amer, l'auteur partage son désenchantement et son inquiétude face au peu d'intérêt que montrent ses concitoyens pour les grands livres.
Il confie rêver d'un monde où les villages seraient des lieux d'apprentissage, des universités, et où les habitants continueraient à s'instruire tout au long de leur vie, à cultiver leur esprit avec autant d'ardeur que leur terre :
"Nous dépensons plus pour presque n’importe quel article d’alimentation destiné à faire la joie sinon la douleur de notre ventre que pour notre alimentation mentale. Il est temps que nous ayons des écoles non communes, que nous ne renoncions pas à notre éducation lorsque nous commençons à devenir hommes et femmes. Il est temps que les villages soient des universités, et les aînés de leurs habitants les "fellows" d’universités, avec loisir - s’ils sont en effet si bien à leur affaire - de poursuivre des études libérales le reste de leur vie."
Chapitre 4 – Bruits
Dans le chapitre 4 de "Walden ou la vie dans les bois", Henry David Thoreau nous rappelle qu’à force de rester le nez dans les livres, nous risquons d’oublier un autre langage, plus ancien, plus immédiat : le langage fondamental que parle la nature, sans détour, sans métaphore.
4.1 – La musique du rail et de l’étang : une symphonie de sons sauvages et modernes
Il nous invite donc à tendre l’oreille à ce que les choses et les événements murmurent à qui sait écouter.
Depuis sa cabane, il décrit avec lyrisme la symphonie des sons qui l’environnent : le vol silencieux des busards, les battements d’ailes des pigeons sauvages, le chant des oiseaux, et, au loin, le grondement régulier du train. Ce dernier bruit, "le roulement des wagons" sur les rails, lui rappelle que la civilisation n’est jamais bien loin.
Henry David Thoreau brosse un portrait très vivant du chemin de fer, comparant la locomotive tantôt à "un cheval de fer", tantôt à "un dragon jeteur de feu". Malgré la critique qu'il fait de la modernité, il trouve une certaine poésie dans cette machine. "Je guette le passage des wagons du matin dans le même sentiment que je fais le lever du soleil, à peine plus régulier" écrit-il, fasciné par sa ponctualité et la vaillance des hommes qui entretiennent ce système par tous les temps.
Mais ce sont les sons de la nature qui occupent une place privilégiée dans son univers sonore. Le chant grave et lancinant des "whip-pour-wills" qui entonnent "leurs vêpres durant une demi-heure" accompagne ses soirées comme un office religieux. Les hiboux, avec leur cri profond, donnent à ses nuits ce qu'il appelle "un chant de cimetière on ne peut plus solennel." Et les grenouilles de l'étang, joyeuses et bruyantes, lui évoquent "d'anciens buveurs et fêtards" qui célèbrent la tombée du jour sur les rives de l'étang de leurs croassements rythmés.
Chez lui, aucun bruit domestique : pas de chien, de chat, de vache, de cochon, ni de poule, "de sorte que cela vous eût paru manquer de bruits domestiques" note-t-il avec humour. Mais cette absence est compensée, poursuit-il, par la richesse des sons naturels : "La libre Nature venant battre à votre seuil même."
4.2 - La plénitude par la double écoute : culture et nature en harmonie
Notons que ce chapitre, en écho au précédent sur la lecture, incarne parfaitement l’équilibre que cherche Henry David Thoreau : entre culture et nature.
D’un côté, il vénère les grands livres classiques comme des sources de sagesse éternelle ; de l’autre, il trouve une profonde satisfaction dans la contemplation du monde vivant. Il ne rejette pas la modernité et la civilisation en bloc - sa fascination pour le chemin de fer en témoigne - mais il appelle à rétablir une relation plus directe, plus consciente, avec la nature et les grandes œuvres humaines.
C’est dans cette double écoute (aux livres et aux bruits) que, selon lui, l’homme trouve sa plénitude : en prêtant attention à la fois à la voix des plus grands esprits humains et à celle, plus discrète mais tout aussi primordiale, de la terre.
Chapitre 5 – Solitude
Dans le 5ème chapitre de son ouvrage, Henry David Thoreau partage ses réflexions sur la solitude qu’il vit au bord de l’étang de Walden : non comme un isolement pesant, mais comme une communion profonde avec la nature.
5.1 - Un avec le paysage : la solitude habitée, fusion avec la nature
Loin de se sentir seul, il évoque en effet ces moments où "le corps entier n'est plus qu'un sens", entièrement absorbé par la beauté de son environnement. Lorsqu’il se promène le long de la rive caillouteuse, il ne se perçoit plus comme un être séparé, mais comme une partie vivante du paysage. Il ressent une connexion profonde avec les éléments qui l'entourent.
5.2 - Quand l’absence devient présence : la nature comme compagne
Bien qu’il vive à un mille de tout voisinage, le philosophe remarque que son espace n’est jamais totalement fermé, et reste traversé de lumière et d’horizons : "l’horizon n’est jamais tout à fait à nos coudes" écrit-il. Sa cabane, reculée dans les bois, voit rarement passer un voyageur la nuit, et pourtant, cette absence de présence humaine ne lui pèse pas. Il confie même : "Je ne me suis jamais senti solitaire, ou tout au moins oppressé par un sentiment de solitude", à une exception près, survenue quelques semaines après son arrivée.
Mais même ce moment de doute s’est finalement dissipé sous la bienveillance infinie de la nature qui lui a révélé "une société si douce et si généreuse" qu’elle a rendu insignifiants les avantages du voisinage humain. Plus qu'un simple cadre de vie, la nature est devenue une présence familière et rassurante qui lui a ainsi fait comprendre à quel point la présence humaine pouvait être secondaire, parfois même superflue, face à la richesse du vivant.
5.3 – Loin des hommes, proche du monde : une solitude intérieure féconde et peuplée
Henry David Thoreau va plus loin encore en partageant une réflexion sur la dualité humaine.
Il affirme alors que nous avons la capacité, grâce à la pensée, de nous tenir à distance de nous-mêmes : une distance intérieure "saine", féconde, qui nous permet de mieux nous observer, de nous approfondir. Cette relation intérieure, selon lui, peut être plus enrichissante que la proximité avec ses semblables et bien des interactions sociales.
Pour illustrer son propos, il se compare aux éléments qui l’entourent : "Je ne suis pas plus solitaire que le plongeon dans l'étang, que l'étang de Walden lui-même". Ainsi, pour l’auteur, la nature devient miroir, sœur, confidente. Et lorsque l’hiver s’installe, son imagination peuple ses soirées d’étranges visiteurs : un vieux colon et une vieille femme, figures mystérieuses et poétiques, personnifications des forces anciennes de la forêt.
Chapitre 6 - Visiteurs
6.1 - Une cabane pour trois : solitude, amitié, société
Bien qu’il ait choisi une vie retirée, Henry David Thoreau confie son goût pour la compagnie des autres : "je crois que tout autant que la plupart j'aime la société" admet-il.
Il illustre cet intérêt pour la relation humaine en décrivant avec humour l'agencement symbolique de sa maison : sa cabane contient trois chaises. Chacune représente un degré de socialisation : "une pour la solitude, deux pour l'amitié, trois pour la société."
6.2 – Loin du raffinement : l’hospitalité en forêt
L’auteur en profite pour égratigner les demeures démesurées de son époque, où les habitants, dit-il, finissent par ressembler à "la vermine qui les infeste".
À l’inverse, sa modeste cabane, exiguë, impose une proximité immédiate. Il fait d’ailleurs remarquer que cette promiscuité peut aussi entraver et gêner les conversations profondes. Il observe, en effet, que "le parler réservé, réfléchi, demande plus de distance entre les interlocuteurs". Cela a même conduit parfois, à ce que lui et ses visiteurs, doivent écarter leurs sièges jusqu'aux coins opposés de la pièce pour mieux échanger.
Pour les occasions spéciales, il préfère de loin son "salon de choix" : la clairière de pins qui s’étend derrière sa maison. Là, au cœur de la nature, il accueille ses visiteurs sans protocole. Il s’amuse d’ailleurs du décalage entre ses habitudes d’hospitalité et les conventions sociales. Chez lui, pas de festin : "l'abstinence" est selon lui "le plus convenable et sage des procédés".
6.3 – Dans la peau du vivant ou la sagesse des corps
Parmi les visiteurs marquants qu’il reçoit, Henry David Thoreau s’arrête sur la figure d’Alexandre Thérien, un bûcheron canadien. Sans grande instruction, Thérien incarne, pour lui, une sagesse brute enracinée dans le corps et la terre, dépourvue d'éducation formelle mais emplie de contentement. "En lui c'était l'homme animal surtout qui se trouvait développé" lance le philosophe, admiratif de sa robustesse et de sa joie de vivre simple. Cet homme au rire franc, dont le corps est "coulé dans le moule le plus grossier" possède une authenticité qui force le respect de l’auteur.
6.4 - Pèlerins et passants : Walden comme lieu d’appel intérieur
Henry David Thoreau conclut ce chapitre en distinguant les badauds curieux superficiels des "honnêtes pèlerins", ces visiteurs venus aux bois non par simple curiosité, mais "en quête de liberté" : enfants, ouvriers du chemin de fer, pêcheurs, chasseurs, poètes….
Chapitre 7 - Le champ de haricots
Henry David Thoreau nous plonge ici au cœur de son quotidien de cultivateur, où les haricots occupent une place presque symbolique. Ses rangs, alignés sur près de sept mille cumulés et attendant impatiemment le sarcloir, sont devenus les compagnons fidèles de son été à Walden.
7.1 - Sarcler pour exister : le travail comme quête de sens
L'auteur s'interroge sur le sens profond de cette activité agricole qu’il qualifie de "petit travail d'Hercule" : à mesure qu’il sarcle, Thoreau découvre des pointes de flèches enfouies dans la terre, traces d'un "peuple éteint" amérindien. Ainsi, il réalise que ce geste humble du jardinage le relie à une mémoire plus vaste, à un sol cultivé bien avant lui. Son champ devient un trait d’union entre le sauvage et le civilisé, "un chaînon reliant les champs sauvages aux champs cultivés".
7.2 - La terre : mémoire et présence, communion avec le vivant et les anciens
Mais l’expérience est aussi sensorielle, presque mystique. Tandis qu’il travaille, la grive-brune chante, les chordeilles planent, les buses majestueuses décrivent leurs cercles dans le ciel. Ces présences transforment son travail manuel en expérience contemplative. "Ce n'était plus des haricots que je sarclais ni moi qui sarclais des haricots" murmure-t-il. Pour Thoreau, c’est un peu comme une transcendance de l'activité physique : comme s’il n’était plus un simple homme des champs, mais un être pleinement présent au monde.
7.3 - Contre l’avidité : retrouver le sacré de la terre
L’auteur finit ce chapitre en détaillant minutieusement les chiffres de son entreprise agricole : 14,72 dollars de dépenses pour 23,44 dollars de recettes. Mais cette comptabilité ne l’enthousiasme guère. Ce qu’il questionne, en réalité, c’est la manière dont l’agriculture s’est vidée de son caractère sacré, dégradée par l'avarice et transformée en simple activité de profit. Il dénonce ainsi la logique utilitariste de l’agriculture moderne, et appelle à un rapport désintéressé, respectueux et universel du sol. À ses yeux, "le loyal agriculteur" devrait renoncer à toute revendication sur les fruits de son sol, et accepter que la terre ne nourrisse pas l’homme seul, mais toutes les créatures.
Chapitre 8 - Le village
8.1 - Le village, théâtre des mœurs humaines
Après une matinée passée à lire ou à travailler dans son champ, Henry David Thoreau aimait se rendre de temps à autre au village voisin. Il y allait pour le plaisir d’entendre "un peu des commérages qui là sans cesse vont leur train", lesquels, pris "en doses homéopathiques", se révélaient rafraîchissants à leur manière.
Avec humour, il compare sa façon d’observer les villageois avec celle dont il étudie les animaux sauvages : "De même que je me promenais dans les bois pour voir les oiseaux et les écureuils, ainsi me promenais-je dans le village pour voir les hommes et les gamins."
Aux yeux de l’auteur, le village est comme une grande salle de nouvelles où certains habitants semblent uniquement occupés à absorber et diffuser rumeurs et racontars. Ces personnages, qu'il observe souvent "assis sur une échelle" ou "appuyés contre une grange" et qu’il surnomme "les moulins rudimentaires", commencent par concasser grossièrement les ragots, explique-t-il, avant de les relayer.
8.2 - Naviguer dans le monde pour revenir à soi
Errer entre les pièges sociaux du village demande, selon le philosophe, autant d’agilité que manœuvrer un bateau dans une mer changeante. Thoreau se compare ici à un marin quittant un salon brillant pour retrouver "son bon petit port dans les bois", à travers des "nuits noires et tempétueuses".
Ces moments d’errance et d’égarement au village et pour rentrer, loin d’être négatifs, lui inspirent une réflexion plus profonde. Il s’agit, pour lui, d’un miroir de l’égarement existentiel : "Ce n'est que lorsque nous sommes perdus... que nous commençons à nous retrouver". Se perdre physiquement dans le monde, en somme, peut ouvrir un chemin vers soi, un chemin spirituel.
8.3 - Simplicité et confiance : une autre société possible
Henry David Thoreau relate enfin brièvement son arrestation (pour avoir refusé de payer l’impôt) et sa nuit passée en prison, sujet qu’il développera davantage ailleurs.
Il clôt le chapitre par une observation sur sa cabane, qui, bien que jamais fermée à clé même en son absence, ne fut jamais cambriolée. À ses yeux, cette simplicité volontaire éloigne naturellement le crime : "si tout le monde devait vivre aussi simplement qu'alors je faisais, le vol et la rapine seraient inconnus" assure-t-il.
Chapitre 9 - Les étangs
Dans ce long chapitre contemplatif, Henry David Thoreau célèbre la beauté et la pureté des étangs qui bordent sa retraite, Walden en particulier, joyau silencieux de son quotidien.
9.1 - Les eaux de Walden comme refuge du monde
L'auteur commence par décrire ses échappées "vers des bois nouveaux et des pâtures neuves" après avoir "usé jusqu'à la corde tous [ses] amis du village". Il évoque ses expériences de pêche nocturne et ses promenades en barque sur les eaux tranquilles de l'étang, moments de paix profonde et privilégiés pour contempler et communier avec la nature.
L'écrivain peint un portrait de l'étang de Walden avec un soin quasi scientifique, mêlé d’une sensibilité poétique rare. Il décrit sa profondeur remarquable et sa pureté cristalline. "C'est un puits clair et vert foncé", observe-t-il, dont l'eau est si transparente qu'on peut "aisément distinguer le fond à vingt-cinq ou trente pieds de profondeur."
Cette transparence permet à Thoreau de développer une méditation sur la perception et les couleurs que prend l'eau selon différentes conditions de lumière.
9.2 - Pour une toponymie vivante
Le philosophe s’insurge ensuite contre le pouvoir qu’ont les propriétaires terriens de baptiser les lieux naturels selon leur bon vouloir. Il s’indigne que l’Étang de Flint porte le nom d’un "fermier immonde et stupide" plutôt que celui d’un animal, comme celui des "poissons qui nagent dedans, des oiseaux... qui le fréquentent, des fleurs sauvages qui croissent sur ses rives".
En somme, il plaide pour une toponymie poétique et respectueuse, en lien avec les forces vives du lieu.
9.3 - Permanence des lacs de lumière, impermanence de l’homme
Au fil des pages, l'auteur évoque aussi d’autres étangs voisins : l'Étang Blanc, jumeau plus petit de Walden, l'Étang de la Oie et Fair-Haven, qu'il appelle affectueusement "ma région des lacs".
Malgré les changements causés par les activités humaines autour de Walden (les bûcherons l’ont entamé, le chemin de fer l’a traversé), il admire sa permanence essentielle : "il demeure, lui, immuable, telle eau sur laquelle tombèrent les yeux de ma jeunesse ; tout le changement est en moi."
Le chapitre se termine sur une métaphore lumineuse : l’auteur compare ces étangs à "de grands cristaux à la surface de la terre, des Lacs de Lumière" dont la pureté transcende toute valeur marchande : "ils sont trop purs pour avoir une valeur marchande, ils ne renferment pas de fumier" lance l’auteur, opposant ainsi leur clarté intemporelle aux logiques utilitaires de la société.
Chapitre 10 - La ferme Baker
Dans le chapitre 10 de "Walden ou la vie dans les bois", Henry David Thoreau nous emmène dans ses promenades solitaires dans la nature, dans ses excursions à la recherche de lieux secrets de la forêt, dans ses déambulations comme autant de pèlerinages mystiques. Il y reçoit des visions et signes spirituels.
10.1 – Dans les bois, le sacré se manifeste en silence
Le philosophe y raconte comment ses pas le portaient souvent vers "des bouquets de pins, dressés comme des temples", vers des bois de cèdre où les baies givrent en hiver, ou encore vers des marais où l'usnée pendait en guirlandes. Plus que des savants, ce sont les arbres qu'il visitait - le bouleau noir, le hêtre, le tilleul - comme autant de temples naturels majestueux méritant respect et vénération.
L'écrivain partage une expérience mystique : un jour, il se retrouve "juste dans l'arc-boutant d'un arc-en-ciel", baigné dans un véritable "lac de lumière". Dans cette splendeur céleste, un visiteur qui le croise ce jour-là lui déclare que les ombres des autres hommes ne portent pas de halo autour d’eux : une remarque que Thoreau reçoit comme un signe silencieux d’élection spirituelle, de proximité avec quelque chose de plus grand que lui.
10.2 - Sous l’orage, deux mondes se rencontrent : vivre libre ou vivre dur
Thoreau raconte aussi comment un après-midi, parti pêcher dans les environs de la Prairie Plaisante, près de la Ferme Baker, il est alors surpris par un orage. Cherchant refuge dans une cabane abandonnée, il y trouve une famille irlandaise installée : John Field, sa femme et leurs enfants.
Touché par leur pauvreté, l’auteur décrit leur lutte et leurs efforts laborieux pour subsister avec une certaine tendresse teintée de lucidité. Il tente alors, le temps d’un échange, de leur transmettre sa philosophie : vivre simplement pour vivre libre. Il leur explique ainsi comment en réduisant ses besoins, il peut vivre plus librement :
"je ne consommais thé, café, beurre, lait, ni viande fraîche, et qu'ainsi je n'avais pas à travailler pour me les procurer" partage-t-il.
Mais ses paroles semblent glisser sur eux. John Field, malgré toute sa bonne volonté, reste prisonnier d’un mode de vie qu’il n’imagine même pas pouvoir remettre en question. Henry David Thoreau note avec tristesse :
"ils luttent avec un écrasant désavantage, - vivant, John Field, hélas ! sans arithmétique, et manquant ainsi le but". Pour le philosophe, ce manque de recul, d’analyse, d’audace, maintient cet homme dans ses chaînes invisibles.
10.3 – Le message du “Bon Génie” : foi, audace et liberté
Mais alors que l’orage s’éloigne et qu’il regagne les bois, Henry David Thoreau croit entendre la voix de son "Bon Génie" : "Jouis de la terre, mais ne la possède pas". Et ce murmure de continuer : "C'est par défaut de hardiesse et de foi que les hommes sont où ils sont, achetant et vendant, et passant leur vie comme des serfs." En d’autres termes : si les hommes vivent enfermés dans une vie de peine et de commerce, c’est par manque de foi et de courage. Ils achètent, vendent, peinent et végètent comme des esclaves, alors qu’il suffirait parfois d’oser vivre autrement pour être libre.
Chapitre 11 - Considérations plus hautes
11.1 - Une dualité intérieure entre instincts et élévation
Un jour, en rentrant de sa pêche, Henry David Thoreau est saisi d'une impulsion animale à la vue d'une marmotte : "J'étais sur le point de m'en saisir pour la dévorer crue" s’étonne-t-il.
Cette expérience le confronte à sa double nature : l'une aspirant à une"vie plus élevée" spirituelle, l'autre enracinée dans une"vie sauvage, pleine de vigueur primitive". L'auteur admet vénérer l’un comme l’autre de ces deux instincts qui coexistent en son être.
11.2 - L’instinct végétarien comme évolution intérieure et comme destinée humaine
Henry David Thoreau revient ensuite sur son passé de chasseur et de pêcheur, activités qu’il a pratiquées dans sa jeunesse.
Ces expériences, explique-t-il, ont forgé, chez lui, un lien intime avec la nature. "Les pêcheurs, chasseurs, bûcherons, et autres, qui passent leur vie dans les champs et les bois... se trouvent souvent en meilleure disposition pour l'observer" affirme-t-il. Pourtant, avec le temps, l’auteur réalise qu’il se détache peu à peu de ces activités : "chaque année me trouve-t-elle de moins en moins pêcheur".
Une transformation intérieure s’opère, une forme de désintoxication du besoin de tuer.
Cette réflexion le conduit à aborder la question du végétarisme, qu’il considère comme une étape naturelle de l’évolution humaine. Il est convaincu que l’humanité, dans son développement, renoncera un jour à se nourrir d’animaux, tout comme les peuples primitifs ont abandonné l’anthropophagie :
"Je ne doute pas que la race humaine, en son graduel développement, n'ait entre autres destinées celle de renoncer à manger des animaux, aussi sûrement que les tribus sauvages ont renoncé à s'entre-manger."
À ses yeux, le rejet de la viande n’est pas une posture morale acquise, mais un instinct profond, encore enfoui chez beaucoup : "la répugnance à la nourriture animale est non pas l'effet de l'expérience, mais un instinct".
11.3 - Nourrir le corps, élever l’âme
Henry David Thoreau en profite enfin pour critiquer le luxe culinaire, qu’il associe à un appauvrissement de l’esprit. Il défend une nourriture simple, en accord avec la nature et les besoins véritables du corps. La simplicité alimentaire, selon lui, nourrit aussi la clarté morale.
Le chapitre s’achève sur une méditation : la pureté de l’âme, déclare l’auteur, s’épanouit comme une fleur. "La chasteté est la fleuraison de l'homme" et les grandes vertus "génie, héroïsme, sainteté, et le reste, n'est que les fruits variés qui s'ensuivent." Ainsi, l’éveil spirituel, comme celui d’une plante, naît d’un enracinement profond, d’un travail invisible, jusqu’à éclore dans la lumière.
Chapitre 12 - Voisins inférieurs
Dans ce nouveau chapitre, Henry David Thoreau nous fait découvrir la communauté animale qui l'entoure, ses "voisins inférieurs" avec lesquels il entretient une relation privilégiée.
12.1 - Les compagnons discrets d’une vie silencieuse
Ces animaux sauvages partagent son quotidien, non par la parole, mais par une forme de présence silencieuse et attentive. Il évoque, par exemple, un vieux compagnon de pêche, sourd et mutique, avec qui il prend ses repas dans une "harmonie continue, beaucoup plus plaisante à se rappeler que si c'eût été la parole qui l'eût entretenue".
Aussi, dans sa cabane, l’écrivain scrute les souris qui viennent lui rendre visite. L’une d’elles, particulièrement audacieuse, devient presque familière : elle grimpe sur ses chaussures, explore ses vêtements, et vient même manger dans sa main.
Il décrit également les oiseaux qui nichent autour de lui - un moucherolle, un merle, une gelinotte et sa couvée - et s’émerveille de leur comportement. Il observe, fasciné, comment les petits de la gelinotte se dissimulent au sol, la tête enfouie sous une feuille, dans un camouflage parfait dicté par l’instinct.
12.2 - Épopées minuscules : les fourmis en guerre
Le récit le plus saisissant de ce chapitre est la description d'une guerre miniature éclatant entre deux espèces de fourmis : les rouges et les noires.
Henry David Thoreau la contemple, fasciné, comme un chroniqueur antique relatant une bataille épique : "les légions de ces Myrmidons couvraient collines et vallées de mon chantier", écrit-il,"et le sol était déjà jonché des mourants et des morts". Cette bataille sauvage, conclut-il, sans trêve ni stratégie, surpasse en intensité et en courage, la Bataille de Concord de l'histoire américaine dans ses plus infimes manifestations.
12.3 - Cache-cache sur l’étang : la malice du vivant
Le chapitre se clôt sur un épisode à la fois ludique et symbolique : un jeu de cache-cache entre Thoreau et un plongeon sur l’étang.
L’oiseau, rusé et insaisissable, échappe sans cesse à Thoreau, plongeant et réapparaissant toujours là où on ne l’attend pas. Malgré son "rire presque démoniaque" qui trahit sa présence, il garde toujours une longueur d’avance : "Si longue était son haleine, si inlassable lui-même, qu'aussi loin qu'il eût nagé, il replongeait cependant immédiatement ; et alors nul génie n'eût su deviner le tracé de la course."
À travers cette galerie d’animaux familiers ou farouches, l’auteur célèbre la vitalité, la ruse et l’héroïsme discret du monde naturel. Une vie intense, à hauteur de fourmi comme de plongeon, palpite à chaque recoin de Walden.
Chapitre 13 - Pendaison de crémaillère
13.1 - L’automne et l’auto-suffisance joyeuse
À l’arrivée de l’automne, Henry David Thoreau se prépare à affronter l’hiver.
Il décrit ses récoltes de provisions simples : canneberges des marais, pommes sauvages, châtaignes qu’il ramasse en forêt, "sac sur l'épaule" avec "dans la main un bâton pour ouvrir les bogues".
Il découvre aussi la noix de terre (Apios tuberosa), surnommée "la pomme de terre des aborigènes", un cadeau discret de la nature qui, selon lui, pourvoit généreusement aux besoins humains sans qu’il soit nécessaire de l’exploiter.
13.2 - La cabane comme cœur, le foyer comme preuve de vie
L’auteur héberge brièvement un poète. Il se réjouit de voir la suie s’accumuler au fond de l’âtre et de voir s’édifier ce foyer qui devient le cœur de sa maison, comme une preuve vivante de la maison qui prend vie :
"J'avais un couple de vieux chenets pour tenir le bois au-dessus du foyer, et rien ne me sembla bon comme de voir la suie se former au dos de la cheminée que j'avais construite."
Cette construction inspire au philosophe une réflexion sur l'essence de la maison idéale : non pas un espace fragmenté en diverses pièces froides et spécialisées, mais un lieu unique, brut et chaleureux : "un hall primitif, vaste, grossier, solide, sans plafond ni plâtrage" où "le voyageur fatigué peut se laver, manger, causer, dormir", bref vivre pleinement, explique-t-il.
L’auteur critique ici l’architecture moderne, qui éloigne les individus les uns des autres, et ironise : "L'hospitalité est l'art de vous tenir à la plus grande distance."
13.3 - Le feu, l’hiver, et la chaleur intérieure
Le chapitre s’achève alors que l’étang commence à geler.
L’auteur observe avec fascination la glace se former, les bulles d’air emprisonnées dans l’épaisseur translucide. L'arrivée de l'hiver l'incite à se réfugier davantage dans sa cabane, où il entretient un bon feu à la fois tant dans son foyer que dans son cœur ("bon feu dans ma maison comme dans ma poitrine" écrit-il).
Il va chercher du bois mort en forêt, considérant ce feu comme un véritable compagnon. Plus tard, lorsqu’il remplacera d’ailleurs la cheminée par un fourneau plus pratique, il s’en désolera : celui-ci "dissimulait le feu, et c'était comme si j'eusse perdu un compagnon" s’attriste-t-il.
Dans cette relation intime avec les éléments, Henry David Thoreau résume sa philosophie : une vie simple, enracinée, et fidèle aux rythmes naturels. Même le feu, pour lui, ne se réduit pas à une source de chaleur : c’est une présence, un lien, un rappel que vivre pleinement, c’est vivre en relation avec ce qui nous entoure.
Chapitre 14 - Premiers habitants et visiteurs d'hiver
14.1 - L’hiver comme célébration sauvage et silencieuse
L’hiver, rude, s’installe autour de l’étang de Walden, mais Henry David Thoreau, loin de s’en plaindre, savoure les tempêtes de neige comme de joyeuses fêtes sauvages, et les soirées au coin du feu comme des bénédictions heureuses et silencieuses.
Même lorsque les chemins disparaissent sous la neige, il continue de s’aventurer dans les bois. Il se fraye alors un passage à travers "la plus épaisse neige des bois", parfois aidé par le vent qui pousse des feuilles de chêne dans ses traces.
14.2 - Mémoire des oubliés : les anciens habitants de Walden
Dans cette blancheur silencieuse, le philosophe se tourne vers l’histoire des lieux.
En véritable archéologue des mémoires humaines, il reconstitue la vie de ceux qui ont précédé la sienne sur ces terres.
Il évoque Caton Ingraham, esclave affranchi qui vécut près de son champ de haricots. Puis Zilpha, femme de couleur, dont la maison fut brûlée durant la guerre de 1812, et dont un ancien habitant se rappelait qu'elle murmurait tristement au-dessus de sa marmite : "Vous n'êtes que des os, des os !"
Plus bas sur la route, il se souvient de Brister Freeman, "un nègre adroit", jadis esclave, dont les pommiers qu'il planta continuent de produire des fruits. Sur sa tombe, dans le cimetière, Thoreau lit son épitaphe : Sippio Brister. Il parle aussi de son épouse Fenda, diseuse de bonne aventure, décrite comme une femme "forte, ronde, noire, plus noire que nul des enfants de la nuit".
L’écrivain s'attarde sur d'autres anciens occupants : la famille Stratton, le malheureux Breed, victime de "l'æs alienum" (le rhum bon marché de la Nouvelle-Angleterre), Wyman le potier, et enfin Hugh Quoil, ancien soldat à Waterloo, mort sur la route selon la rumeur, peu après l'arrivée de Thoreau dans les bois.
De tous ces habitants et habitations, il ne reste plus que des pierres, quelques empreintes dans la terre et des lilas vivaces qui continuent de fleurir "comme au premier printemps". Ces vestiges poussent Thoreau à s'interroger : pourquoi ce petit village a-t-il décliné alors que Concord a perduré ? N’avait-il pas l’étang de Walden, la source de Brister, et le souffle du vent pour lui ?
14.3 - La saison des rencontres et des pensées partagées
Malgré le froid et l'épaisseur de la neige, Henry David Thoreau reçoit quelques visiteurs dans sa cabane durant son hivernage. Un poète vient partager avec lui de longues veillées de conversation.
Mais c'est surtout sa rencontre avec Bronson Alcott, philosophe venu du Connecticut, qui marque l'esprit de l'auteur. Thoreau le décrit comme "une Immortalité", un homme drapé de bleu, "ayant pour toit véritable le ciel". Leurs conversations, s’amuse à dire l’auteur, ont élargi et même fini par faire craquer les murs de la cabane, tant l’espace lui-même peinait à contenir la grandeur de leurs idées.
L'auteur évoque également un autre visiteur, Ralph Waldo Emerson, avec qui il passa de "solides moments".
Et enfin, celui qu’il appelle "le Visiteur qui ne vint jamais", attendu avec une patience presque sacrée, comme le recommanda le "Purana de Vichnou". Une attente pleine de foi, offerte au silence comme on tend les bras vers l’invisible.
Chapitre 15 - Animaux d'hiver
15.1 - L’étang gelé, nouveau territoire de contemplation
Avec l’arrivée du grand froid, les étangs figés sous la glace deviennent pour Henry David Thoreau de nouveaux chemins et offrent alors des perspectives inédites.
En traversant l’étang de Flint, le philosophe contemple les monts Lincoln qui se dressent autour de lui "à l'extrémité d'une plaine de neige". Le paysage familier s’est transformé en terrain d'exploration silencieux. Walden est devenu sa "cour" d’hiver, son domaine glacé.
15.2 – Les chants du gel et la symphonie du sauvage
L'écrivain naturaliste observe une colonie de rats musqués dans l'Étang de l'Oie. Il s’émerveille des sons nocturnes mystérieux qui peuplent ses longues nuits d’hiver. Le cri désolé mais mélodieux d’un duc résonne comme la "lingua vernacula du Bois de Walden".
Une nuit, il surprend une scène sauvage : un grand-duc accueille une oie sauvage, venue probablement de la baie d’Hudson, d’une formidable "voix discordante", un cri rauque et menaçant, comme pour chasser cet intrus de son territoire glacé.
Les sons de l’hiver composent une symphonie étrange : la glace qui gémit doucement dans son sommeil, le sol qui craque sous l’effet de la gelée, les aboiements "âpres et démoniaques" des renards dans leurs courses nocturnes. Ces derniers, écrit-il, lui apparaissent comme des "hommes rudimentaires", des créatures primitives, tapies dans leurs terriers, à la lisière de l’évolution.
15.3 - Farandole d’animaux et réflexions sur l’appartenance au monde
Chaque matin, un écureuil rouge vient réveiller Henry David Thoreau. L’auteur le guette avec amusement, notant ses manœuvres comiques pour venir chercher les grains de maïs jetés près de sa porte. Il décrit avec humour et minutie les déplacements saccadés du petit animal "fantasque" : "il n'en ai jamais vu aller au pas", dit-il, rapportant comment l'écureuil avance par à-coups, fait des pirouettes, s'arrête soudainement, puis repart avec son épi de maïs plus grand que lui dans une parade burlesque.
Les geais, les mésanges et diverses souris des champs complètent cette joyeuse ménagerie hivernale à ses côtés.
Les lapins aussi viennent visiter la cabane. Ils inspirent alors au philosophe une réflexion presque métaphysique : "Qu’est-ce qu’un pays sans lapins ni gelinottes ?" questionne-t-il. Car pour lui, ces êtres simples et farouches sont les véritables enfants de la terre, aussi enracinés dans l’Antiquité que dans le monde moderne. Et ils incarnent une nature pure, intacte, toujours présente malgré le passage du temps.
Chapitre 16 - L'étang en hiver
16.1 - Le silence du monde comme réponse à l’âme
Un matin d’hiver, Henry David Thoreau s’éveille avec l’étrange impression qu’une question existentielle lui a été posée pendant son sommeil. La réponse, silencieuse mais éclatante, lui apparaît à travers la fenêtre : l’étang, gelé, devient miroir du ciel et de l’esprit. Et c’est la Nature elle-même, paisible et sereine, "en qui vivent toutes les créatures" qui lui renvoie, "sans nulle question sur ses lèvres", l’image d’un monde plein et suffisant.
L'auteur décrit ensuite sa démarche quasi rituelle pour se procurer de l'eau en hiver. Il doit percer la glace qui recouvre l'étang sur "un pied ou un pied et demi" d'épaisseur. En s'agenouillant pour boire, il plonge alors le regard dans ce qu'il appelle "le tranquille salon des poissons" et découvre un miroir inversé du ciel : "le ciel est sous nos pieds tout autant que sur nos têtes".
16.2 - L’étang mesuré, sondé, compris
Avec une précision scientifique, il raconte comment il a entrepris de sonder l'étang pour en déterminer la profondeur exacte. Il réfute ainsi les légendes locales prétendant que Walden n'aurait pas de fond.
Grâce à une méthode rigoureuse, il mesure une profondeur maximale de cent deux pieds : une donnée qui confirme qu'il s'agit bien d'un étang "profond et pur en manière de symbole".
Il observe aussi les pêcheurs qui viennent braver le froid, installés sur la glace avec leurs lignes et un maigre casse-croûte. Leur connaissance intuitive des éléments l’impressionne : "leur vie elle-même passe plus profondément dans la Nature que n'y pénètrent les études du naturaliste".
16.3 - La futilité des efforts humains face au cycle inaltérable de la nature
Mais l’événement majeur de la vie hivernale de l’étang, c’est la grande récolte de glace. Une centaine d’ouvriers venus de Cambridge, principalement Irlandais, sous la supervision de contremaîtres Yankees, viennent extraire l’eau solidifiée de Walden, transformant ainsi l’eau de l’étang en marchandise. Ils découpent la glace en blocs massifs et édifient une gigantesque "pile de trente-cinq pieds de haut".
Cette structure, d'abord semblable à "un puissant fort bleu ou Walhalla" de glace, prend, avec le temps, l'apparence d'une "vénérable ruine, chenue, bâtie de marbre azuré" couverte de mousse et empreinte d’une étrange majesté.
Cette récolte suscite chez Thoreau une réflexion sur la nature éphémère de l'entreprise humaine et la vanité de l’effort humain.
Malgré le travail acharné, les charrettes, les cris, les outils, le tas de glace ne finira par fondre complètement qu'en septembre 1848, retournant ainsi à l'étang la plus grande part de ce qui lui avait été pris. Sans lutte, sans plainte et dans le calme inflexible du cycle de la Nature.
Chapitre 17 - Le printemps
17.1 - La glace se fissure, la terre s’éveille
Le dernier chapitre de "Walden ou la vie dans les bois" s’ouvre sur une renaissance : l’hiver cède doucement la place au printemps, et Thoreau, témoin attentif de cette métamorphose, décrit avec une précision presque amoureuse la fonte progressive de la glace. Il observe l’étang se criblant d’alvéoles, se fissurant lentement avant de libérer ses eaux. D’année en année, il note la date exacte de cette débâcle, remarquant que Walden, plus profond et immobile que ses voisins, se libère toujours plus tard.
17.2 - Beauté fractale de la nature et principes de vie
Mais c’est un phénomène plus subtil encore qui l’émerveille : les motifs que dessinent le sable et l’argile en ruisselant sur les talus dégelés. À ses yeux, ce ne sont pas de simples écoulements, mais une véritable "végétation" minérale, produisant des "feuilles ou pampres gonflés de sève" et "des ramilles pulpeuses". La matière semble soudain animée par un souffle créateur. "Ce n'était plus des haricots que je sarclais ni moi qui sarclais des haricots", écrit-il, rappelant que dans chaque geste ou phénomène naturel peut se révéler un principe supérieur.
Ces figures de sable l’amènent à méditer sur les formes organiques. Il perçoit des analogies profondes entre les nervures d’une feuille et la structure du corps humain, entre les plis du monde minéral et l’anatomie du vivant, voyant dans ces écoulements de sable les mêmes principes organiques qui façonnent la vie.
"La feuille suspendue là-haut voit ici son prototype", affirme-t-il, suggérant que même le globe terrestre, dans sa rotation, "se surpasse et se transforme, se fait ailé en son orbite".
17.3 – Une renaissance
Avec les premiers chants d’oiseaux, le retour de l’eau vive qui ruisselle et les bourgeons qui s’ouvrent, le printemps devient, chez Henry David Thoreau, bien plus qu’une saison : c’est une régénération morale. Le 29 avril, il aperçoit un faucon dont le vol lui évoque la noblesse ancienne de la fauconnerie, toute de grâce et de poésie.
Ce renouveau est aussi intérieur : dans un "riant matin de printemps tous les péchés des hommes sont pardonnés", écrit-il. Cette saison représente "la création du Cosmos sorti du Chaos", où même le voisin connu hier comme "un voleur, un ivrogne, ou un sensuel" apparaît transformé, travaillant sereinement sous le soleil nouveau.
17.4 - L’appel à une vie sauvage pour un éveil authentique
En refermant ce dernier chapitre, Henry David Thoreau élargit sa réflexion à l’ensemble de la société. L’existence au village, dit-il, "croupirait sans les forêts et les prairies inexplorées" qui l'entourent. Il nous faut, soutient-il, une vie enracinée dans "le tonique de la nature inculte", une vie rythmée par ses forces brutes et ses mystères féconds. La nature "abonde en vie", et c’est à son contact que l’homme se régénère.
Ainsi s’achève le séjour de l’écrivain de deux ans à Walden, qu’il finit par quitter le 6 septembre 1847.
Mais l’essentiel est ailleurs : "Walden" n’est pas tant le récit d’une retraite que celui d’un éveil. Un rappel que la liberté véritable ne se trouve ni dans les possessions ni dans le confort, mais dans une vie délibérément choisie, en lien profond avec la nature, et avec soi-même.
Conclusion
- Sortir des ornières, voyager sans bouger, entrer et oser l’inconnu à l’intérieur de soi
Dans cette méditation finale, Henry David Thoreau nous invite à regarder au-delà des limites que nous nous imposons.
Il compare notre tendance à rester confinés dans nos habitudes à la domestication de notre esprit :
"On prétend que si sur nos fermes on abat les clôtures de bois pour empiler des murs de pierre, voilà des bornes désormais fixées à nos existences, et nos destins arrêtés."
Derrière cette image, il nous alerte, en fait, sur les dangers de la routine et de la conformité.
Plutôt que de courir vers des horizons lointains, Henry David Thoreau nous exhorte à explorer notre monde intérieur.
Pour souligner cette idée, il cite : "Direct your eye right inward, and you'll find at thousand regions in your mind yet undiscovered. Travel them, and be Expert in home-cosmography". Ce qui signifie, en français :
"Dirige ton œil droit en toi, et vois mille régions en ton âme encore à découvrir. Parcours-les, et sois expert en cosmographie-du-chez-soi."
L’auteur affirme que les royaumes intérieurs que nous portons en nous sont plus vastes que l'empire terrestre du Czar, et que la véritable exploration commence par une plongée dans l’inconnu de soi-même.
- Marcher vers ses rêves avec audace, vivre de manière délibérée et avoir foi en la vie imaginée
Il explique avoir quitté les bois pour les mêmes raisons qui l’y avaient conduit : sentir qu'il avait "plusieurs vies à vivre". Sentir le départ du moment venu. Sa crainte était, ajoute-t-il, de tracer un sentier trop battu, là où il avait cherché à s’affranchir des ornières de la tradition : "que doivent être usées autant que poudreuses donc les grand'routes du monde" écrit-il, dénonçant les sillons profonds de l’habitude et du conformisme.
Mais finalement, de son séjour à Walden, le philosophe tire et partage une leçon essentielle :
"Si l'on avance hardiment dans la direction de ses rêves, et s'efforce de vivre la vie qu'on s'est imaginée, on sera payé de succès inattendu."
Et s’il nous arrive de bâtir des châteaux en l’air, qu’importe :
"Si vous avez bâti des châteaux dans les airs, votre travail n'aura pas à se trouver perdu ; c'est là qu'ils devaient être. Maintenant posez les fondations dessous."
- L’aurore devant nous : authenticité, humilité et espérance
Henry David Thoreau termine "Walden ou la vie dans les bois"par un plaidoyer pour l'authenticité et l'humilité. Ainsi, nous ne devons pas nous effrayer de la pauvreté, assure-t-il, car "la pureté qu'aime les hommes ressemble aux brouillards qui enveloppent la terre, non pas à l'éther azuré qui est au-delà".
Il nous laisse sur une note d'espoir, comparant notre humanité à une cigale qui attend d'éclore. Le monde est encore à vivre, et l’aurore est devant nous : "Le soleil n'est qu'une étoile du matin."
Conclusion de "Walden ou la vie dans les bois" de Henry David Thoreau
Quatre idées clés du livre "Walden ou la vie dans les bois" qu'il faut retenir
Idée clé n°1 : La simplicité volontaire libère l'homme des chaînes du matérialisme moderne
Henry David Thoreau démontre que réduire ses besoins au strict nécessaire - se nourrir, se loger, se vêtir, se chauffer - permet d'échapper à l'esclavage du travail excessif et de l'endettement.
Son expérience concrète à Walden, où il dépense seulement 61 dollars en deux ans, prouve qu'une existence frugale peut procurer plus de liberté que l'accumulation de biens.
Cette sobriété choisie devient ainsi un acte de résistance face au consumérisme naissant et une voie vers l'indépendance véritable.
Idée clé n°2 : La nature apporte une sagesse supérieure à celle de la civilisation industrielle
L'auteur révèle comment la contemplation quotidienne de l'étang, des saisons et des animaux nourrit l'âme humaine bien mieux que les distractions sociales.
Thoreau trouve dans les cycles naturels, les sons de la forêt et l'observation des "voisins inférieurs" une source inépuisable d'enseignements. Cette communion avec la nature lui permet de retrouver son rythme authentique, loin de l'agitation perpétuelle du village et de ses conventions artificielles.
Idée clé n°3 : L'introspection et la solitude révèlent notre véritable nature
Le philosophe découvre que la solitude n'isole pas mais connecte à l'essentiel.
Dans sa cabane, il développe cette capacité à "se tenir à distance de soi-même" qui permet l'auto-observation et la croissance intérieure. Cette retraite volontaire devient un laboratoire d'expérimentation de soi, où chaque geste quotidien - sarcler, lire, contempler - participe d'une quête de sens profonde.
Idée clé n°4 : Vivre délibérément signifie choisir ses priorités plutôt que subir celles imposées par la société
Henry David Thoreau prône une existence délibérément choisie plutôt que subie.
Il s'agit de "n'affronter que les actes essentiels de la vie" pour éviter de découvrir, au moment de mourir, qu'on "n'avait pas vécu".
Cette philosophie de l'authenticité implique d'avoir le courage de suivre ses propres convictions, même si cela signifie s'écarter des sentiers battus du conformisme social.
Qu'est-ce que la lecture de "Walden ou la vie dans les bois" vous apportera ?
"Walden ou la vie dans les bois" est une lecture qui vous amènera à repenser votre rapport au temps, au travail et au bonheur.
Henry David Thoreau vous montre comment distinguer vos besoins réels de vos désirs fabriqués par la société, et vous invite par-là, à simplifier votre existence pour gagner en liberté intérieure.
Vous découvrirez aussi comment la nature peut devenir votre alliée pour retrouver sérénité et perspective face aux tensions du monde moderne.
Enfin, ce témoignage vous encourage à oser l'expérimentation : comme Thoreau l'a fait avec sa cabane, vous pouvez tester de nouveaux modes de vie, explorer vos propres "régions intérieures" et construire votre propre définition du succès.
Pourquoi lire "Walden ou la vie dans les bois" d'Henry David Thoreau
"Walden ou la vie dans les bois" est un livre qui transformera votre regard sur ce qui constitue véritablement la richesse et qui vous encourage à poursuivre vos rêves les plus audacieux.
Il reste d'une actualité saisissante face aux questionnements contemporains sur le minimalisme, l'écologie et la recherche de sens.
D'abord, parce que Thoreau partage un modèle concret d'alternative au mode de vie consumériste, prouvant par l'exemple qu'il est possible de vivre mieux avec moins. Ensuite, parce que sa philosophie de l'authenticité résonne particulièrement aujourd'hui, dans une époque où beaucoup cherchent à échapper aux injonctions sociales pour retrouver leur propre voie.
Points forts :
Le témoignage authentique d'une expérience de vie alternative concrète et reproductible.
La philosophie intemporelle sur la simplicité volontaire et l'authenticité.
Le style poétique et contemplatif qui allie profondeur et beauté littéraire.
La critique pertinente du matérialisme qui résonne encore aujourd'hui.
Points faibles :
Certains passages philosophiques peuvent paraître abstraits ou trop métaphoriques.
Le contexte historique du XIXe siècle rend parfois les exemples moins directement transposables.
L’écriture employée n’est pas toujours très facile d’accès.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu "Walden ou la vie dans les bois" ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Henry David Thoreau "Walden ou la vie dans les bois"
Visitez Amazon afin d'acheter le livre de Henry David Thoreau "Walden ou la vie dans les bois"
 ]]>
]]>Résumé de "La vie sans principe" de Henry David Thoreau : cet essai philosophique partage une critique incisive de la société américaine du XIXe siècle. Il dénonce l'obsession pour le travail et l'argent et nous appelle alors à repenser notre rapport au travail, à l'argent et au temps. Il propose une réflexion profonde sur l'art de vivre, la nécessité d’embrasser une vie authentique et de préserver notre liberté morale face aux pressions de la société mercantile.
Par Henry David Thoreau, écrit en 1854, 1ère édition en 1863 (après la mort de Thoreau), cette réédition proposée est de 2018, 128 pages.
Titre original : "Life Without Principle"
Note : L'introduction, la postface et la partie "Repères chronologiques" de cet ouvrage n'ont pas été écrites par Henry David Thoreau mais par Michel Granger. Professeur de littérature américaine, Michel Granger est un spécialiste et traducteur français particulièrement connu pour son travail autour de Henry David Thoreau. Il est ainsi à l'origine des traductions en français de plusieurs œuvres majeures de Thoreau (comme "La vie sans principe" ici résumé ou encore "Marcher") et de leur contextualisation.
Chronique et résumé de "La vie sans principe" de Henry David Thoreau
- Introduction de "La vie sans principe" par Michel Granger
Dans l’introduction de l’ouvrage, rédigée par Michel Granger (voir note plus haut), nous apprenons d’abord que "La vie sans principe" est un essai majeur de Henry David Thoreau initialement conçu comme une conférence qu'il a donnée entre 1854 et 1862. Pour Michel Granger, ce texte, malgré sa pertinence remarquable, n'a pas reçu l'attention qu'il méritait à son époque.
L’auteur de l’introduction retrace ensuite l'évolution de cet essai à travers ses différents titres.
D'abord intitulé "Gagner sa vie" en 1854, puis "Le lien entre l'emploi d'un homme et sa vie élevée", il devient "Quel sera le profit ?" : une référence biblique interrogeant le sens de gagner le monde au prix de son âme.
Face à une réception mitigée, Henry David Thoreau le renomme "Une vie gaspillée" en 1859, avant d'opter pour "La loi plus élevée". Finalement, peu avant sa mort en 1862, il choisit "La vie sans principe" sur suggestion de son éditeur.
1.1 - Résister au "tyran économique"
Michel Granger souligne qu’avec cet essai, Henry David Thoreau adopte une posture résolument critique face à la société américaine du XIXe siècle.
En effet, l’essayiste philosophe y dénonce l'envahissement du monde des affaires, la tyrannie du commerce, l'inhumanité du capitalisme industriel et l'obsession de l'accumulation. Il prend notamment l'exemple de la ruée vers l'or en Californie pour illustrer cette "fièvre délirante" de l'enrichissement.
L’auteur nous fait remarquer que cette critique reste étonnamment actuelle au XXIe siècle.
1.2 - Un "professeur de morale"
Au cœur de cet essai se trouve une question fondamentale : comment mener une vie honorable sans renoncer à ses principes moraux ? Michel Granger explique que Henry David Thoreau y développe son "art de vivre", une véritable économie de l'existence basée sur l'autonomie et la recherche d'une vie juste, loin des sentiers battus.
Regrettant l’absence de véritables professeurs d'éthique dans la société, Henry David Thoreau endosse ainsi, dans "La vie sans principe", le rôle de guide moral.
Finalement, son message, nous dit Granger, vise à encourager la réflexion autonome plutôt que la conformité aveugle. S'inspirant autant de la philosophie grecque que des textes orientaux, Henry David Thoreau recherche, en fait, une "vérité dure comme le granit", écrit-il.
1.3 - Contre l’insignifiance
Enfin, Michel Granger met en lumière l'importance que Henry David Thoreau accorde à la vie intellectuelle intense.
Il nous montre comment l'auteur valorise la quête de sens plutôt que l'accumulation matérielle. Pour Henry David Thoreau, "la vie bonne" consiste à "creuser en soi à la poursuite de sa propre richesse". Cette démarche nécessite solitude et autonomie, loin des conversations creuses et des distractions futiles de la société.
Cette introduction nous révèle ainsi la profondeur de la pensée de Henry David Thoreau, qui propose une véritable philosophie de vie en opposition au matérialisme de son époque.
En résumé, l'introduction écrite par Michel Granger, nous permet de comprendre que l'œuvre de Henry David Thoreau, fruit d'une longue maturation intellectuelle, propose une réflexion profonde sur la manière de vivre en accord avec des principes élevés, sans céder aux pressions d'une société obsédée par le profit matériel.
- La vie sans principe
2.1 - L'essence d'une vie authentique
Henry David Thoreau débute son essai par une réflexion sur l’authenticité. Il commence par relater une de ses expériences en tant que conférencier pour montrer combien il est important de parler de ses expériences personnelles plutôt que de sujets superficiels.
"Le plus grand compliment que j’aie jamais reçu", confie-t-il, "a été le jour où quelqu’un m’a demandé ce que je pensais et a prêté grande attention à ma réponse."
L’auteur de "La vie sans principe" poursuit en déplorant que la plupart des gens ne s’intéressent qu’aux aspects pratiques de sa profession d’arpenteur, sans chercher à connaître sa véritable nature et profondeur.
Dans cette même idée, il raconte avoir refusé une invitation à donner une conférence sur l’esclavage quand il a compris que ses hôtes voulaient en fait contrôler la majeure partie de son discours.
2.2 - La tyrannie du travail et des affaires
L’auteur de "La vie sans principe" dénonce ensuite avec véhémence l’obsession pour le travail et les affaires de la société dans laquelle il vit.
Il décrit ainsi un monde où "rien d’autre ne prime que le travail, encore le travail, toujours le travail". Henry David Thoreau s’insurge contre cette vision réductrice qui considère comme un drame qu’une personne soit inapte au travail, plutôt que de s’inquiéter de son bonheur ou de son épanouissement.
À travers l’histoire d’un homme transportant une pierre pour un riche voisin, l’essayiste montre comment un travail apparemment noble peut perdre toute dignité quand il sert de simples fins futiles. Même la nature, fait-il remarquer, est jugée uniquement sous l'angle de sa valeur productive : "On croirait qu’une ville ne s’intéresse à ses forêts que pour les abattre !", s’exclame alors l’auteur pour souligner cette obsession destructrice du profit.
2.3 – L’argent contre la vraie valeur
Pour Henry David Thoreau, gagner de l'argent conduit presque invariablement à une forme de corruption morale.
L’essayiste s’en prend ici aux moyens conventionnels de gagner sa vie : selon lui, les services les mieux rémunérés par la société sont souvent les plus dégradants. Et "si vous voulez faire de l'argent comme écrivain ou comme conférencier", observe-t-il, "il faut être populaire, ce qui signifie tomber en chute libre."
L'auteur insiste sur le fait qu'un homme ne devrait pas travailler simplement pour gagner sa vie, mais pour réaliser une œuvre qui ait du sens et qui contribue au bien commun.
Il met enfin en garde contre la tentation de sacrifier ses principes pour des gains matériels, évoquant l’histoire biblique d’Ésaü qui vend son "droit d'aînesse pour un plat de lentilles".
2.4 - La désastreuse ruée vers l'or Vs l’or véritable d’une vie simple, en harmonie avec la nature
Henry David Thoreau consacre ensuite une partie de son essai à critiquer la ruée vers l'or en Californie, qu'il considère comme le symptôme d'une société malade.
Il compare cette quête désespérée à une loterie immorale et décrit avec effroi les ravages physiques et moraux qu'elle provoque. Il raconte notamment avoir été hanté par les images de vallées défigurées par les chercheurs d'or, de puits fétides et d'hommes réduits à l’état de "véritables démons".
"Le chercheur d'or qui prospecte dans les ravines de montagne est autant joueur que son collègue qui fréquente les bars", affirme-t-il, soulignant que cette frénésie pour une richesse facile détruit non seulement l'environnement mais aussi l'âme humaine.
Pour Thoreau, cette recherche effrénée de richesse rapide représente l'antithèse d'une vie bien vécue. Le véritable or, confie-t-il, se trouve dans notre terre natale, et dans la simplicité d'une vie en harmonie avec la nature.
2.5 - Le rôle des éducateurs et de la morale
Le philosophe déplore aussi vivement l'absence de véritables professeurs de morale dans la société.
Il reproche aux prédicateurs d’enseigner la résignation plutôt que l'élévation morale, et s'inquiète de voir que la conversation ordinaire est devenue "creuse et vaine", dépourvue de toute profondeur spirituelle.
Aussi, pour Henry David Thoreau, préserver la "chasteté intellectuelle" et protéger l'esprit des influences triviales est capital. Il compare l'esprit à un temple qui devrait être préservé des intrusions vulgaires et des distractions insignifiantes.
2.6 - Politique et presse : arène publique et miroir des futilités
Henry David Thoreau expose ici sa vision négative de la politique et de la presse.
En effet, l’auteur de "La vie sans principe" considère la politique comme "superficielle et inhumaine". Pour lui, les institutions politiques sont des "bogues de châtaigne qui contiennent des fruits abortifs".
L’essayiste dénonce également les journaux qui remplissent l'esprit de nouvelles futiles. "Je ne sais pas pourquoi", écrit-il, "mais c'est trop pour moi de lire un journal par semaine."
Il nous alerte sur le risque de laisser notre esprit devenir une "arène publique" où circulent les commérages et les informations insignifiantes.
Il condamne particulièrement la façon dont la presse traite les affaires d'État en faisant des questions sérieuses un divertissement superficiel.
2.7 - La liberté véritable et ses implications
Un passage du livre est ensuite consacré à une analyse sur la nature de la liberté.
Henry David Thoreau fait remarquer que si l'Amérique s'est libérée politiquement, pour autant, ses citoyens restent "esclaves d'un tyran économique et moral".
Il pose une question essentielle : "Que signifie être né libre et ne pas vivre libre ?" Selon lui, la liberté politique n'a de sens que si elle permet d'accéder à une véritable liberté morale. Le philosophe fustige la société américaine qui se targue d'être libre mais reste enchaînée aux préjugés et aux conventions sociales.
2.8 - L'appel à une vie plus élevée
Pour conclure, Henry David Thoreau plaide pour une vie guidée par des principes plus élevés.
Nous devons, assure-t-il, cultiver notre humanité plutôt que de nous consacrer exclusivement aux affaires et au commerce. Pour l’essayiste, la vraie richesse d'une nation réside dans sa capacité à produire des "héros, saints, poètes, philosophes et rédempteurs" plutôt que des marchandises.
Ainsi, l’auteur de "La vie sans principe" nous appelle à rechercher la vérité plutôt que le profit, à cultiver notre esprit plutôt que nos champs, et à vivre une vie authentique plutôt que de suivre aveuglément les conventions sociales.
2.9 – La superficialité de la politique
Enfin, Henry David Thoreau termine en critiquant la superficialité et l'inhumanité de la politique, qu'il considère comme une nuisance qui émousse le sens moral, et rejette l'idée que cela puisse le concerner. Il refuse ainsi même de lire les journaux ou de s'engager avec les doléances des gouvernements :
"Ce qu’on appelle la politique est une chose comparativement si superficielle et inhumaine que je n’ai, pour ainsi dire, jamais honnêtement reconnu que cela me concerne en quoi que ce soit. Je me rends compte que les journaux ouvrent gratuitement certaines de leurs colonnes tout particulièrement à la politique ou au gouvernement ; c’est bien là tout ce qui les sauve, pourrait-on dire. Cependant, comme j’aime la littérature et, dans une certaine mesure, également la vérité, je ne lis jamais ces colonnes, de toute façon. Je ne tiens pas à émousser à ce point mon sens moral. N’ayant jamais lu un seul message présidentiel, je n’ai pas à m’en porter garant. C’est une bien étrange époque que celle où les empires, les royaumes et les républiques viennent mendier à la porte d’un simple particulier et s’installer à ses côtés pour débiter leurs doléances. Je ne peux pas prendre un journal sans trouver quelque lamentable gouvernement, aux abois et en fin de course, qui vient intercéder auprès de moi, lecteur, afin que je vote pour lui qui m’importune autant qu’un mendiant italien."
Thoreau qualifie la politique de "dyspepsie" sociale, un trouble qui empêche, selon lui, une société de fonctionner harmonieusement. Lui, nous invite alors davantage à nous féliciter mutuellement - tels des "eupeptiques" - de "l’éternelle et resplendissante beauté du matin", symbole de renouveau et de clarté, plutôt que de nous attarder sur nos "mauvais rêves" collectifs.
L’auteur fait aussi remarquer que la liberté politique conquise en Amérique n’a pas permis d’atteindre une véritable liberté morale. Vraie liberté qui, selon lui, consiste à vivre pleinement en accord avec ses principes, loin des distractions et des préoccupations futiles et superficielles que nous impose la société.
- Henry David Thoreau essayiste | Postface de Michel Granger
Dans cette postface, Michel Granger (présenté au début de ce résumé) nous propose une analyse détaillée de la pensée et de l'œuvre de Henry David Thoreau.
3.1 - Un écrivain émancipateur
Michel Granger commence cette postface en expliquant que Henry David Thoreau était avant tout un écrivain passionné. Ce dernier, indique-t-il, a scrupuleusement tenu un journal quotidien de 1837 à 1861 "afin de cueillir" cite-il, "le fruit de chaque jour qui passe".
Par ailleurs, sa littérature n'était pas destinée au simple divertissement mais visait à éduquer et émanciper l'individu. Henry David Thoreau considérait, en effet, ses contemporains comme "prisonniers d'habitudes, d'interdits intériorisés ou de traditions mutilantes". Son rôle d'écrivain était donc d'aider ses lecteurs à "mieux penser, à percevoir le monde de façon plus juste". Michel Granger souligne que cette approche s'inscrivait dans le contexte d'une littérature américaine encore naissante, qui cherchait à établir une culture lettrée distincte.
3.2 - Un intellectuel de Nouvelle-Angleterre
Contrairement à l'image d'ermite qu'on lui attribue souvent, Henry David Thoreau était profondément ancré dans le milieu intellectuel de son époque. Michel Granger rappelle qu'il était diplômé de Harvard et ami proche de l’essayiste et poète Ralph Waldo Emerson, qui lui permit d’accéder à sa bibliothèque.
L'auteur met aussi en lumière la position particulière de Henry David Thoreau : coincée entre une société américaine peu cultivée et une Europe dont il devait se distancer pour nourrir sa propre créativité.
Après ses études, Thoreau retourne à Concord, où il exerce divers métiers, celui notamment d'instituteur et d'arpenteur, tout en menant une intense activité intellectuelle. Finalement, cette situation particulière lui a apporté une double perspective : observer et critiquer la société tout en restant enraciné dans sa communauté.
3.3 - Le philosophe et l'art de vivre
Michel Granger met également en évidence la quête constante de Henry David Thoreau pour une vie authentique. Son approche philosophique reposait sur l'importance de "bien voir" et d'avoir un solide "point d'appui" dans le réel.
L'auteur explique que Henry David Thoreau cherchait à réformer l'éthique individuelle plutôt que la société dans son ensemble. Cette philosophie de vie impliquait un certain ascétisme, un rejet du superflu et une recherche constante de vérité. Cette quête se manifestait alors dans tous les aspects de la vie de Henry David Thoreau, de son expérience à Walden à ses longues marches contemplatives.
3.4 - D'objecteur de conscience à résistant actif
Cette partie aborde l'évolution significative de la pensée politique de Henry David Thoreau, de l'objection de conscience à une résistance plus active.
Si Henry David Thoreau privilégiait l'approche individuelle, il fut progressivement poussé à s'engager plus directement dans le débat public, notamment sur la question de l'esclavage.
Michel Granger montre, en effet, comment la situation politique des années 1850, et plus particulièrement la loi sur les esclaves fugitifs, a conduit Henry David Thoreau à dépasser sa position initiale de retrait pour adopter une posture plus militante. Cette évolution culmine avec son soutien à John Brown, un abolitionniste américain qui appela à l'insurrection armée pour abolir l'esclavage. Ce soutien marque ainsi le passage d'une résistance passive à l'acceptation d'une certaine forme de violence pour défendre ses principes.
3.5 - Le visionnaire de la nature : entre littérature et science
Enfin, Michel Granger revient sur la relation complexe et multifacette de Henry David Thoreau avec la nature.
Il montre comment celui-ci combinait observation scientifique rigoureuse et sensibilité poétique. Henry David Thoreau, affirme-t-il, développa une approche unique, mêlant documentation précise des phénomènes naturels (faits) et recherche d'une signification plus profonde (philosophie). Son projet d'établir un "almanach" de Concord témoigne notamment de cette volonté d'allier science et poésie.
Par ailleurs, selon Michel Granger, Henry David Thoreau a joué un rôle précurseur dans la préservation de l'environnement. Il note, en effet, sa conscience précoce de l'impact destructeur de la civilisation sur la nature.
3.6 – Conclusion de la postface
En conclusion, Michel Granger évoque combien la pensée de Henry David Thoreau est encore actuelle. Bien que certains aspects de sa philosophie puissent sembler à contre-courant de notre époque consumériste, ses questionnements sur la liberté, la justice et la conscience individuelle restent,en effet, étonnamment pertinents.
L'auteur nous invite ainsi à voir en Henry David Thoreau non pas simplement un moraliste intransigeant, mais un penseur dont la voix critique et la passion pour la nature peuvent encore nous aider à réfléchir sur notre rapport au monde contemporain.
4 - Repères chronologiques
La dernière partie de l’ouvrage est dédiée à une chronologie de la vie de Henry David Thoreau. En voici une synthèse.
Né en 1817 à Concord, dans le Massachusetts aux États-Unis, Henry David Thoreau fait ses études à Harvard jusqu'en 1837. Cette même année, il commence son Journal sur les conseils de l’essayiste et poète Ralph Waldo Emerson et modifie l'ordre de ses prénoms pour devenir Henry David. Après une expérience d'enseignement avec son frère John, il devient l'assistant d'Emerson en 1841 et collabore à la revue transcendantaliste Dial.
Le tournant majeur de sa vie survient en 1845 lorsqu'il s'installe dans une cabane près du lac Walden. Cette expérience durera jusqu'en 1847 et donnera naissance à son œuvre majeure "Walden", publiée en 1854 après plusieurs réécritures. Entre-temps, il publie "Une semaine sur les rivières Concord et Merrimack" (1849).
Les dernières années de sa vie sont marquées par une intense activité d'écriture et de conférences, son soutien à John Brown (un homme d’action américain qui luttait pour l’abolition de l’esclavage, mort par pendaison en 1859) et la préparation de ses manuscrits avec sa sœur Sophia.
Henry David Thoreau meurt de la tuberculose à Concord, sa ville natale, en 1862.
Conclusion de "La vie sans principe" de Henry David Thoreau
4 idées clés développées par Thoreau dans son livre "La vie sans principe"
Idée clé n°1 : La société mercantile nous prive de notre humanité
Henry David Thoreau critique vivement la domination et la tyrannie de l'économie et du travail sur la vie humaine. Il dénonce une société obsédée par l'enrichissement matériel, où "rien d'autre ne prime que le travail, encore le travail, toujours le travail".
Idée clé n°2 : Vivre une vie authentique selon ses principes exige de rompre avec les conventions
Pour Henry David Thoreau, la véritable richesse ne se trouve pas dans l’accumulation de biens matériels, mais dans la culture de soi. Il nous invite alors à préserver notre "chasteté intellectuelle" face aux distractions futiles et inutiles, et à orienter notre existence vers des principes moraux élevés, plutôt que vers la poursuite aveugle du profit.
Idée clé n°3 : L'individu doit reconquérir sa liberté morale
L'auteur se positionne en véritable professeur de morale, en nous encourageant à développer notre réflexion autonome plutôt qu’à nous conformer aveuglément aux conventions sociales. Comme un appel à l’éveil des consciences, il plaide en faveur d’une liberté véritable, qui ne se limite pas à l’indépendance politique, mais qui englobe également une pleine émancipation morale.
Idée clé n°4 : La nature nous enseigne une sagesse supérieure à celle du profit
Face à la frénésie de l’or et du commerce, Henry David Thoreau propose une toute autre forme de richesse : celle offerte par la nature.
Pour lui, "le véritable or" ne réside pas dans les mines de Californie, mais dans notre terre natale et dans une vie simple, en harmonie avec le monde naturel. Cette connexion à la nature constitue un antidote à la corruption morale engendrée par la société mercantile. Elle ouvre la voie à une existence plus authentique et alignée avec des valeurs profondes.
Pourquoi lire "La vie sans principe" ?
"La vie sans principe" propose une réflexion audacieuse sur le sens du travail et de la réussite.
Dès lors, à travers une prose incisive, la lecture de "La vie sans principe" vous amènera probablement à questionner vos choix de vie et à réfléchir à ce qui constitue, pour vous, une existence véritablement riche.
Le message de cet essai sur la nécessité de préserver notre intégrité morale face aux pressions économiques résonne avec une actualité saisissante dans notre monde contemporain.
Je vous invite alors à lire cet ouvrage de Thoreau pour son analyse percutante de notre rapport à l’argent et au travail. Mais surtout parce qu’il provoque naturellement une réflexion et une introspection profonde sur nos priorités et nos aspirations. La pensée de Thoreau, à la fois radicale et humaniste, fournit des pistes de réflexion particulièrement intéressantes pour repenser notre rapport au monde moderne. Elle est, malgré son époque, étonnamment criante d'actualité !
Points forts :
Une critique lucide et intemporelle de la société matérialiste.
Une réflexion profonde sur l'art de vivre et les valeurs essentielles.
Un appel enthousiaste et convaincant à l'autonomie intellectuelle et morale.
Points faibles :
Le ton que l’on peut trouver parfois moralisateur.
Une vision individualiste qui néglige parfois les solutions collectives.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu "La vie sans principe"? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Henry David Thoreau "La vie sans principe"
Visitez Amazon afin d'acheter le livre de Henry David Thoreau "La vie sans principe"
 ]]>
]]>Résumé de "Latitude zéro | 40 000 km pour partir à la rencontre du monde" de Mike Horn : dans ce récit d’aventure autobiographique, Mike Horn nous plonge au cœur de son tour du monde le long de l'équateur, une odyssée de 17 mois durant laquelle il traverse à pied, en bateau et à vélo 40 000 kilomètres de territoires inexplorés. Il y affronte, en solitaire, les océans déchaînés, la jungle impénétrable et les dangers humains, en démontrant une résilience extraordinaire face aux éléments les plus hostiles de notre planète. L’explorateur nous livre alors, au fil de son périple, une profonde réflexion sur la liberté et les limites humaines.
Par Mike Horn, 2004, 352 pages.
Chronique et résumé de "Latitude zéro | 40 000 km pour partir à la rencontre du monde" de Mike Horn
Prologue - Juin 2001
Avant d’entamer son récit, Mike Horn nous dévoile, dans ce prologue, ses souvenirs de l’expédition "Latitude zéro" qu’il s’apprête à nous raconter.
Ainsi, des années plus tard, en 2001, il garde de ces 17 mois de son expédition une empreinte profonde, "une sorte d’instant unique, d'une intensité époustouflante" écrit-il.
Au cours de ce périple, il confie avoir traversé, presque simultanément, toutes les expériences humaines possibles : la naissance et la mort, la tempête et l’accalmie, la joie et la tristesse. Mais au-delà du défi solitaire, cette aventure fut aussi collective, portée par les rencontres marquantes et les enseignements précieux de ceux qui l'ont accompagné et soutenu en chemin.
Chapitre I - Six coquillages | Le 2 juin 1999. Libreville
Le 2 juin 1999, Mike Horn se trouve sur une plage du Gabon, devant l'océan Atlantique. Il s'apprête à réaliser un exploit que personne n'avait jamais tenté auparavant : faire le tour du monde en suivant la ligne de l'équateur, en s'autorisant une marge de quarante kilomètres au nord et au sud.
Le principe, comme il l'explique, est simple mais paradoxal : avancer tout droit en tournant le dos à son objectif pendant les 20 000 premiers kilomètres, puis retrouver son point de départ lors des 20 000 suivants.
1.1 - Une équipe réduite mais soudée
Pour cette aventure extraordinaire, Horn s'est entouré d'une équipe extrêmement réduite de cinq personnes. Il présente chacun de ses membres avec respect et reconnaissance :
Martin Horn, son frère cadet, responsable de toute la logistique.
Claude-Alain Gailland, alpiniste suisse expérimenté qui l'avait déjà accompagné lors de sa descente de l'Amazone.
Alma, sa cousine, chargée de la mise à jour du site web.
Sebastian Devenish, photographe anglais élevé en Suisse.
Sean Wisedale, cameraman sud-africain.
L'aventurier souligne que cette équipe fonctionne comme un véritable collectif, chacun pouvant sortir de sa spécialité pour aider les autres. Sa femme Cathy joue également un rôle crucial en tant que coordinatrice, gérant les problèmes administratifs et assurant le lien entre Mike et le reste du monde.
1.2 - Les préparatifs et la mise à l'eau
Neuf jours avant le départ, l'équipe avait effectué l'inventaire du matériel et vérifié l'état du bateau. Mike Horn raconte comment son trimaran, arrivé par cargo de Miami, a été soigneusement assemblé et testé.
La veille du départ, l'explorateur fait face à deux problèmes de taille : son téléphone satellite grillé et une déchirure dans la coque après avoir heurté un tronc d'arbre immergé. Malgré ces contretemps, sa détermination reste intacte.
À 15h30, le jour du départ, Mike Horn et ses proches nagent jusqu'à la plage pour accomplir un rituel personnel. L'aventurier confie :
"Je m'accroupis dans le sable et le fouille du bout des doigts. J'en extrais six petits coquillages, que j'enferme soigneusement dans un carré de tissu."
Chaque coquillage symbolise une étape de son parcours : l'Atlantique, l'Amérique du Sud, le Pacifique, l'Indonésie, l'océan Indien et l'Afrique. Il se promet de les reposer exactement au même endroit à son retour.
1.3 - Le moment du départ
À 16 h, Mike Horn se jette à l'eau pour regagner son bateau, lève l'ancre, hisse ses voiles et part. Ses proches le suivent un moment sur deux hors-bord, puis le laissent seul. L'explorateur prend alors pleinement conscience de sa solitude face à 5 000 kilomètres d'océan. Il raconte avec émotion ce moment charnière :
"Je ne le sais pas encore, mais l'émotion que je ressens à ce moment précis - un mélange de trac, d'angoisse et d'exaltation - est plus forte que tout ce que j'éprouverai par la suite."
Paradoxalement, il se sent soulagé d'être enfin seul, mais s'interroge sur sa capacité à tenir le coup. Il réalise soudain l'ampleur du défi qu'il s'est lancé et fond en larmes.
1.4 - L'histoire du bateau : un miracle de générosité
Mike Horn remonte le temps pour nous raconter comment il a obtenu son bateau, élément vital de son expédition.
Malgré le soutien de ses sponsors principaux (Sector et Opel), il lui manquait, confie-t-il, les fonds nécessaires pour acquérir un trimaran. C'est Marc-Édouard Landolt, un banquier suisse rencontré lors d'un dîner, qui lui offre généreusement ce bateau après avoir été enthousiasmé par son projet.
L'aventurier relate ensuite les tests effectués à San Diego, où il choisit un modèle de huit mètres plutôt que de douze, moins par économie que par praticité. Le test du bateau s'avère mouvementé : l'équipage sauve huit immigrants mexicains de la noyade, ce que Steve Ravussin interprète comme un bon présage : "Ton bateau sera béni jusqu'à la fin de son existence."
En fin de construction, le transport du trimaran vers l'Afrique se complique sérieusement. Mike Horn apprend qu'aucun cargo ne quitte San Diego avant un mois, ce qui compromet tout son calendrier. Il décide alors, avec son frère, de traverser les États-Unis en camion pour rejoindre Miami, où un cargo part dans deux jours. Ce périple de 48 heures sans sommeil, ponctué d'incidents (dont un assoupissement au volant évité de justesse), se conclut par une course contre la montre pour placer le bateau démonté dans un conteneur avant la fermeture du port.
1.5 - L'apprentissage de la navigation
Mike Horn avoue son inexpérience maritime : toute sa pratique se résumait à trois jours de navigation sur le lac Léman et quelques expériences comme wincher sur des bateaux professionnels. Il relate avec humilité ses premiers pas de marin autodidacte, étudiant son manuel d'utilisation et apprenant à maîtriser les différentes voiles de son trimaran.
Il détaille son système de navigation nocturne, alternant pilotage automatique et manuel pour préserver l'énergie de ses batteries alimentées par panneaux solaires. Il maintient une vitesse moyenne de six nœuds, conforme à ses prévisions, mais doit rester constamment vigilant face aux changements météorologiques.
1.6 - Premières épreuves sur l'océan
L'aventurier raconte plusieurs incidents qui lui servent de leçons.
D'abord, son arrivée périlleuse aux îles São Tomé, où il s'endort trop longtemps et se réveille à quelques mètres d'une falaise. Ce n'est que grâce à un concours de circonstances miraculeux qu'il évite la collision.
Il relate ensuite comment il manque de tomber à l'eau pendant qu'il fait la vaisselle à l'arrière du bateau, retenant le plat-bord de justesse. Ces expériences lui enseignent que "le danger existe même quand il n'y a pas de danger."
Plus tard, il affronte trois tempêtes tropicales en approchant des côtes brésiliennes, et doit naviguer dans une zone dangereuse où flottent des conteneurs perdus par les cargos. Une nuit, sa drisse cède et son gennaker tombe à l'eau. Dans sa tentative de récupération, il risque d'être emporté par les vagues, n'étant pas attaché à son bateau.
1.7 - L'arrivée au Brésil
Après 19 jours de traversée (record pour un bateau de cette taille), Mike Horn sent la terre avant de la voir, grâce à "une odeur de glaise fraîche". Il entre dans l'embouchure de l'Amazone, dont les eaux boueuses repoussent l'océan sur près de 180 kilomètres.
Arrivé à l'île de Marajó, il est accueilli par Martin, Sebastian et Sean. Il poursuit ensuite jusqu'à Macapá, où l'attendent sa femme Cathy et ses filles Annika et Jessica. Il décrit la ville comme "poussiéreuse, sale et surpeuplée", constamment menacée d'être engloutie par la jungle.
L'explorateur se heurte alors à la bureaucratie brésilienne : inspections sanitaires, contrôles douaniers et taxes diverses. Il confie sa frustration devant ces formalités qui lui semblent "plus pénibles encore à traverser que l'Atlantique."
1.8 - Le début de l'enfer vert
Après quelques jours à Macapá, Mike Horn reprend son périple, naviguant sur le fleuve aussi loin que possible en compagnie de sa famille qui le suit sur un bateau à moteur. Lorsque le cours d'eau devient trop étroit, il dit adieu à Cathy et ses filles, poursuit en VTT jusqu'à la fin d'une route de terre, puis se retrouve face à la jungle vierge.
Ce premier chapitre de "Latitude zéro" se termine sur ce moment critique où l'aventurier hésite avant de s'engager dans 3 600 kilomètres de forêt tropicale que personne n'avait jamais traversée à pied. Malgré la peur qui le paralyse momentanément, il surmonte ses doutes :
"Je mets une bonne demi-heure à retrouver mon énergie et ma motivation. Peu à peu, je cesse de considérer la forêt vierge comme un ennemi monstrueux."
Finalement, il tire sa machette et s'enfonce dans la jungle, concluant avec ces mots : "La jungle m'avale. Je disparais dans la nuit verte."
Chapitre II - Le cri du caïman
Dans le deuxième chapitre de "Latitude zéro", Mike Horn poursuit son incroyable périple en s'enfonçant de plus en plus dans la jungle amazonienne.
Chaque pas est une immersion dans l’inconnu. Après avoir traversé l'Atlantique, l'aventurier affronte désormais un environnement tout aussi hostile mais radicalement différent : la forêt tropicale la plus dense du monde, qu'il compte traverser à pied sur près de 3 600 kilomètres.
2.1 - Les premiers pas dans l'enfer vert
Mike Horn pénètre dans la jungle avec une priorité : avancer suffisamment pour couper définitivement "le cordon invisible" qui le relie encore à Martin et Sean. Il raconte qu'il progresse comme un forcené, taillant sa route à coups de machette dans cette végétation si épaisse que la lumière peine à y pénétrer.
"Je ne pense qu'à une chose : avancer aussi vite que possible pour franchir le point de non-retour, couper les ponts et supprimer la tentation du retour en arrière."
La progression est incroyablement lente : quelques mètres par minute seulement. L'explorateur s'oriente à la boussole, se dirigeant plein ouest à 270 degrés (avec une légère correction pour la variation magnétique). Il confie qu'il s'efforce de trouver le bon rythme, le bon allongement pour chaque pas, tout en s'adaptant à ce milieu qui semble le rejeter comme une greffe.
Mike Horn nous dévoile sa philosophie d'adaptation : il ne se considère pas comme un intrus mais comme un élément qui doit s'intégrer à la jungle. Son objectif n'est pas de combattre cet environnement mais de se faire accepter par lui.
2.2 - Le sac à dos : une maison sur le dos
L'aventurier décrit en détail son fidèle compagnon de route : son sac à dos, véritable prolongement de lui-même et bouée de sauvetage dans cet environnement hostile. Ce n'est pas un modèle standard mais une création sur-mesure qu'il a conçue en collaboration avec la marque italienne Ferrino.
Ce sac présente des caractéristiques exceptionnelles :
Fabriqué en Cordura, un nylon ultra-résistant et imperméable,
Équipé de trous d'évacuation d'eau au fond,
Doté de filets latéraux pour accéder rapidement aux bouteilles d'eau,
Muni d'un "camel pack" intégré (vessie d'eau avec tuyau d'accès facile),
Fermé par des zips incassables plutôt que du velcro (qui aurait absorbé l'humidité),
Conçu spécifiquement pour ses 48 kilos d'équipement.
Mike Horn explique que chaque objet a sa place exacte, ce qui lui permet de faire et défaire son sac les yeux fermés ou dans l'urgence. À l'intérieur, des conteneurs hermétiques protègent son équipement électronique : panneau solaire, lampe frontale, caméra vidéo et téléphone satellite.
L'aventurier mentionne avoir abandonné son ordinateur, trop lourd et encombrant, ne gardant que le téléphone satellite pour communiquer avec sa famille. Il avoue que ces communications sont parfois douloureuses : "Dès que j'entends la voix de ma femme et de mes enfants, j'ai envie de tout laisser tomber et de rentrer chez moi."
2.3 - Une tenue adaptée aux conditions extrêmes
Tout comme son sac, ses vêtements ont été minutieusement choisis.
Sa chemise à manches courtes possède des coutures placées en arrière des épaules pour éviter les frottements douloureux avec le sac. Le tissu synthétique évacue l'humidité vers l'extérieur, gardant sa peau relativement sèche.
Ses chaussures sont peut-être l'élément le plus crucial de son équipement. Contrairement aux recommandations reçues, il a opté pour des modèles légers de type jogging plutôt que de lourdes chaussures montantes. Il décrit leurs caractéristiques uniques :
Des chaussures fermées comme des chaussettes en néoprène élastique,
Des trous percés juste au-dessus de la semelle pour évacuer l'eau,
Des semelles rigides mais souples à l'extrémité pour adhérer aux obstacles,
Un système de cache pour les lacets.
2.4 - Installer son campement dans la jungle
Après quatre heures d'avancée, épuisé, Mike Horn prépare son premier bivouac. Il partage sa technique pour installer son hamac entre deux arbres soigneusement choisis, à environ 1,50 mètre du sol pour se protéger des prédateurs terrestres.
Pour choisir les bons arbres, l'explorateur utilise une astuce apprise d'un Indien : une corde de longueur précise lui permet de sélectionner des troncs trop minces pour qu'un jaguar ou un puma puisse y grimper. "Quand l'arbre est trop mince, les pattes de l'animal se croisent et il glisse", explique-t-il.
La première nuit est particulièrement éprouvante. Les moustiques l'assaillent dès le coucher du soleil et, contrairement à ses prévisions, une pluie torrentielle le trempe entièrement. Il raconte cette mésaventure avec humour : "Pour une première nuit dans la jungle, ça ne pouvait pas démarrer plus mal."
2.5 - Les techniques de survie
Dès le matin, Mike Horn partage une règle de base : ne jamais laisser d'objets au sol pour éviter qu'ils ne soient dévorés par les fourmis. Il raconte comment il suspend systématiquement son sac à un arbre pour cette raison.
Le dixième jour, l'aventurier explique comment il se transforme en prédateur pour se nourrir. Il révèle sa technique de chasse au collet :
Choisir une tige souple et solide enracinée dans le sol.
La courber et la maintenir en tension avec un système de déclenchement sensible.
Ajouter un lasso en fil de nylon.
Attendre patiemment que le gibier déclenche le piège.
L'explorateur capture ainsi un petit singe, puis un cochon sauvage. Il ne cache pas la dimension difficile de cette épreuve : "C'est peut-être cruel, mais quand il s'agit de survivre, ces notions passent au second plan."
Mike Horn décrit également comment il conserve sa viande par fumage, en plaçant des lamelles de viande au-dessus de braises recouvertes de bois mouillé : cette technique élimine l'humidité et empêche les bactéries de se développer.
2.6 - L'adaptation à l'environnement
L'aventurier détaille sa consommation d'eau quotidienne : 14 litres par jour dans cette chaleur étouffante (40°C, 95 % d'humidité). Il précise qu'il ne produit quasiment pas d'urine tant il transpire.
Pour s'approvisionner en eau, Mike Horn taille les lianes, véritables réservoirs naturels : "Plus la liane est longue, plus elle contient d'eau." Il sélectionne celles dont le "jus" n'est pas trop amer et se réjouit de leur eau "délicieuse, d'une limpidité de cristal et d'une pureté de source montagnarde."
Au fil des jours, il adopte un rythme régulier, marchant environ huit heures par jour et évitant de faire des haltes avant la fin de sa journée de marche : "Je commence à savoir par expérience que si je pose mon sac à dos, je ne le remettrai pas."
2.7 - L'épreuve du marécage
Au 17ème jour, Mike Horn fait face à son premier obstacle majeur : un marécage de 600 mètres de large qu'il est impossible de contourner. Il révèle sa stratégie pour le traverser :
Enfiler des vêtements longs pour se protéger.
Pratiquer un exercice mental de "pensée positive" pour se rendre "invulnérable".
Avancer en coupant les herbes-lames coupantes comme des rasoirs.
L'épreuve est terrible. L'aventurier raconte : "Chaque pas est un calvaire. Chaque coup de machette me coûte un morceau de peau." Il décrit ses mains devenues "une plaie dont le sang ruisselle" au point qu'il n'arrive plus à tenir sa machette.
Épuisé, il s'endort debout à plusieurs reprises et replonge dans l'eau croupie. La traversée, qu'il pensait faire en quelques heures, lui prend finalement près de 10 heures pour seulement 600 mètres. Cette expérience devient son "Rubicond, un point de non-retour" : il sortira de cette jungle en se dirigeant vers l'ouest, ne serait-ce que pour ne jamais avoir à refaire ce qu'il vient de vivre.
2.8 - Face aux dangers de la jungle
Le 35ème jour, Mike Horn fait une erreur qui aurait pu lui être fatale : marchant de nuit à la lampe frontale, il est mordu au petit doigt par un serpent qu'il n'a pas vu. D'abord indifférent à cette égratignure, il réalise rapidement que quelque chose ne va pas : "Tout devient flou. La tête me tourne."
Il décrit avec précision l'évolution de son état :
Son visage devient insensible.
Sa main gonfle "comme un ballon de foot américain".
Sa chair autour de la morsure pourrit et part en lambeaux.
Il reste paralysé dans son hamac pendant plusieurs jours.
L'aventurier admet avoir eu peur pour la première fois : "Ce n'est plus de moi que les choses dépendent. Je vais peut-être mourir, peut-être pas, mais dans les deux cas je ne pourrai rien y faire."
Après cinq jours de convalescence, Mike Horn reprend sa progression, mais cette expérience lui enseigne une "règle d'or" : toujours regarder où l'on s'apprête à poser la main.
Il raconte avec une certaine légèreté sa rencontre avec une araignée tropicale qu'il laisse délibérément marcher sur sa main - "peut-être pour me redonner une dose de confiance en moi-même" lâche-t-il.
2.9 - La beauté au cœur de l'enfer
Malgré les épreuves, Mike Horn s'émerveille constamment devant la splendeur de cette nature primitive. Il évoque avec poésie les orages tropicaux : "Les cris et les bruits s'apaisent... il y a comme une attente. Un grondement de tonnerre étouffé, au loin..." Il décrit la jungle fumante qui sèche après la pluie et les arcs-en-ciel qui jaillissent dans les clairières "comme une fabuleuse colonne de lumière peinte."
Le 41ème jour, l'aventurier écoute avec ravissement le chant d'une rivière et s'y jette avec euphorie : "Si le bonheur absolu existe, il doit ressembler à ce que j'éprouve à cet instant précis." Il combat la légende des piranhas mangeurs d'hommes, expliquant qu'ils ne deviennent dangereux que dans certaines conditions bien précises.
À propos de l'eau du fleuve, il affirme : "Contrairement à une autre légende, l'eau des rivières amazoniennes est d'une pureté de cristal." Il boit directement à la source sans jamais tomber malade, bien qu'il dispose d'un filtre Katadyn Water Filter pour les cas douteux.
2.10 - Le passage à la pirogue
Après deux mois dans la jungle, Mike Horn décide de changer de stratégie.
Ayant atteint le rio Japura, il troque la marche pour la navigation et acquiert une pirogue auprès d'un Indien. Ce changement de mode de déplacement constitue à la fois un soulagement et un nouveau défi : il doit maintenant lutter contre le courant inverse.
L'explorateur présente sa nouvelle technique de chasse - la pêche au harpon - qu'il pratique la nuit à la lampe frontale. Il perçoit les yeux des poissons brillant sous la surface et les frappe avec précision. Il explique aussi comment il pêche des piranhas, qu'il utilise ensuite comme appâts pour attraper d'autres espèces.
Mike Horn partage également sa technique pour éviter les caïmans. Il les appâte la nuit en imitant leur cri caractéristique - "Hgwôââ ! Hgwôââ !" - puis choisit minutieusement les petits spécimens : "Dans le caïman, seule la partie en forme de losange située entre le bas du dos et le milieu de la queue est comestible."
2.11 - L'émerveillement permanent
Au-delà des défis physiques, Mike Horn souligne l'exceptionnel voyage sensoriel qu'il vit. Il confie : "Je marche là où personne n'a jamais marché. Tous les jours de cette parenthèse irréelle dans ma vie, j'entends et je vois des choses qu'aucun homme ou presque n'a vues ou entendues avant moi."
L'aventurier s'extasie devant les papillons "grands comme des assiettes", les orchidées aux parfums uniques et les plantes carnivores qui se referment comme "un rideau de scène mortel" sur les insectes. Il décrit la "symphonie" des bruits de la jungle, entre cris d'oiseaux, jacassements de singes et feulements de lynx.
Il ajoute avoir appris à "voir derrière une porte fermée" et à "entendre avant qu'il soit trop tard" développant ses sens à un niveau presque animal.
Cette immersion complète lui fait avouer : "J'ai fini par aimer la jungle, et je crois intimement qu'elle a fini par me le rendre."
2.12 - La sortie de la jungle amazonienne
Après 108 jours d'expédition, Mike Horn atteint enfin Vila Bittencourt, le poste frontière brésilien. Il est désormais aux portes de la Colombie, pays qu'il devra traverser malgré les avertissements des militaires sur les dangers liés aux narcotrafiquants.
En quittant le Brésil, l'aventurier éprouve une étrange nostalgie : "J'ai l'impression d'avoir quitté pour toujours le jardin d'Éden..." Mais il sait que d'autres défis l'attendent, "des dangers bien humains" cette fois, peut-être plus redoutables encore que ceux de la nature sauvage.
Ce chapitre 2 de "Latitude zéro" se termine sur cette transition vers un nouveau territoire et de nouvelles menaces, nous laissant en haleine pour la suite de cette extraordinaire odyssée le long de l'équateur.
Chapitre III - La mer promise
3.1 - L'arrivée triomphale sur les côtes équatoriennes
Après sa victoire sur l'Amazonie et les Andes, Mike Horn arrive enfin sur les plages de Pedernales, en Équateur. Tandis qu'il se jette dans les vagues, sa famille et son équipe célèbrent avec lui ce moment extraordinaire, même si personne ne peut vraiment partager l'intensité de ce qu'il ressent après six mois d'expédition.
3.2 - Des retrouvailles familiales sous contrainte
Un contretemps l'attend cependant : son bateau est bloqué à 300 kilomètres au sud, retenu par les douanes équatoriennes de Guayaquil. Ces "vacances forcées" lui offrent un moment privilégié avec Cathy et ses filles. L'explorateur sait que ces instants sont précieux, car une fois reparti, il ne reverra pas sa famille avant trois mois.
3.3 - Les épreuves du trimaran pendant son absence
Lorsque son trimaran est enfin libéré, Mike Horn apprend ses péripéties : pendant qu'il traversait la jungle, le bateau a subi de graves avaries et a dû être envoyé à San Diego pour réparations complètes. En effet, Martin, son frère, raconte qu'après avoir perdu la carte marine dans l'embouchure de l'Amazone, ils ont heurté un tronc flottant. Plus tard, lorsqu'une grue portuaire soulevait l'embarcation, un câble s'est rompu et le bateau s'est écrasé sur le quai.
3.4 - Un départ teinté de mélancolie
Le 12 décembre, Mike Horn décide de partir malgré une crise de malaria qui l'affaiblit considérablement. Il confie : "Une mélancolie s'exprime malgré nous au travers d'une amertume presque agressive."
Son départ est moins triomphal que prévu, sans l'enthousiasme qui avait marqué son départ de Libreville. Et tandis que la marée soulève son bateau du sable, Mike Horn fait une erreur critique : il oublie de visser le compteur de vitesse au fond de la coque. Dès les premiers chocs avec les vagues, le dispositif saute et l'eau s'engouffre par un trou de vingt centimètres. L'habitacle est à moitié inondé.
3.5 - Des défaillances techniques en série
À peine a-t-il fait quelques kilomètres que d'autres problèmes surgissent : les deux pilotes automatiques, le téléphone satellite intégré, la radio et l'ordinateur de bord tombent en panne.
Il doit faire escale aux îles Galápagos, où Sebastian lui apporte du matériel de rechange depuis la Suisse, après avoir failli se retrouver au Mexique à cause d'une confusion d'aéroports.
3.6 - Solitude et émerveillement sur l'océan
Mike Horn décrit ensuite avec sensibilité son Noël et son passage à l'an 2000, seul sur l'océan : "Je ne ressens aucun regret, aucune tristesse d'être ainsi à l'écart de toutes ces réjouissances. Contrairement à tant d'autres, je suis seul, je suis libre, et je fais ce que j'ai choisi de faire."
Mais sa traversée est ponctuée d'incidents : nouvelles crises de malaria, blessure au doigt, panne de pilote automatique.
L'aventurier raconte comment, malgré ses difficultés, il reste attentif aux beautés de l'océan : dauphins aux "yeux pleins d'innocence", oiseaux plongeant en masse, changements subtils de couleur de la mer.
3.7 - Le cap symbolique de mi-parcours
Au quarante-cinquième jour, son GPS devient "fou" et il comprend pourquoi : il se trouve exactement à mi-parcours de son tour du monde, à égale distance de son point de départ et d'arrivée. Cette prise de conscience le remplit à la fois d'euphorie et d'angoisse.
3.8 - L'arrivée à Halmahera et la dure réalité
Après 79 jours de mer, Mike Horn aperçoit enfin les côtes d'Halmahera, sa première île indonésienne.
Dans un élan d'enthousiasme, il plonge spontanément vers cette terre tant désirée, avant de réaliser qu'il n'est pas attaché et que son bateau continue sa route sur pilote automatique. In extremis, il parvient à s'accrocher à un câble.
Cette victoire sur le Pacifique est pourtant ternie par une nouvelle inattendue : la guerre a éclaté à Halmahera entre djihadistes et chrétiens. Martin et l'équipe, venus à sa rencontre, ont failli être exécutés par des extrémistes avant d'être sauvés par l'armée.
L'explorateur termine le chapitre 3 de "Latitude zéro" sur une note amère : "Après la solitude et la liberté de l'océan, voici la terre des hommes."
Chapitre IV - Tempêtes au paradis
4.1 – Contourner l’enfer de la guerre
Mike Horn entame ce nouveau chapitre dans des conditions périlleuses : nous retrouvons, en effet, l’aventurier en train de naviguer de nuit à travers le détroit de Patinti tandis que son équipe a été mise à l’abri par les militaires sur l'île de Bacan.
Aveuglé par l'obscurité et propulsé à grande vitesse par des vents puissants, il risque de s'écraser sur l'île. Grâce à l'intervention de Martin qui le guide par téléphone à l’aide d’une carte détaillée, il évite de justesse les rochers.
Mike Horn finit par retrouver Martin, Seb et Sean, tous secoués par les atrocités dont ils ont été témoins ces derniers jours. Sans autre moyen de transport à cause du conflit, Mike Horn les embarque avec lui sur "Latitude zéro".
Face à la guerre qui fait rage dans la région, l'aventurier doit aussi revoir son itinéraire. Escorté par l’armée, l’équipage se dirige alors vers l’archipel des Célèbes. Mike Horn a décidé de contourner Sulawesi en bateau plutôt que de traverser l'île à pied comme initialement prévu, et de traverser sa partie la plus étroite à vélo, parcourant 50 kilomètres en une journée.
4.2 - Le paradis de Bunaken, entre coraux et cocotiers
"Je suis passé à côté de l’enfer, pour jeter l’ancre au paradis". C'est en effet à Bunaken, minuscule île paradisiaque abritant un parc naturel et une réserve marine, que Mike Horn connaît un moment de répit.
Il décrit ce lieu comme "une carte postale" avec ses cocotiers ondulant dans le vent et ses paysages sous-marins féeriques. Avec son équipe, il profite de ces eaux transparentes pour nettoyer la coque de son trimaran tout en s'émerveillant des beautés naturelles et de ce havre de paix qui contrastent radicalement avec les zones de guerre qu'ils viennent de quitter.
4.3 - La fureur de l'océan
Malheureusement, cette tranquillité est brutalement interrompue par une tornade en route pour les Philippines. En quelques minutes, des vents déchaînés et d'énormes vagues frappent l'île. Le bateau de Mike Horn, bien qu'amarré et ancré, est arraché à ses attaches et projeté contre une jetée de béton. L'aventurier raconte comment son flotteur gauche "explose littéralement" sous le choc.
Dans un acte désespéré, Mike Horn se jette à l'eau pour tenter de sauver son embarcation. Malgré les appels des Indonésiens qui l'encouragent à abandonner son navire, il s'obstine : "Je ne veux pas renoncer. Il n'en est pas question. Je refuse de laisser l'ouragan me priver de ma victoire, détruire mon bateau et tous mes espoirs en même temps…". Cette détermination lui coûte une blessure sérieuse lorsque le bateau l'écrase contre le béton.
Après plusieurs heures de lutte contre les éléments, Mike Horn parvient finalement à mettre son bateau hors de danger.
4.4 - À travers la jungle de Bornéo
L'aventurier poursuit son périple vers Samarinda, sur la côte est de Bornéo (Kalimantan), où Steve Ravussin l'attend avec un kit complet de réparation. Après avoir remis son embarcation en état, Mike Horn s'enfonce dans la jungle de Bornéo, qu'il traverse en combinant vélo et pirogue.
Contrairement à ses attentes, ce n'est pas l'enfer qu'il redoutait. Les routes forestières créées par les multinationales du bois lui facilitent le parcours, bien que transformées en bourbiers par la pluie incessante. Mike Horn observe avec tristesse les ravages causés par le déboisement et les incendies qui ont détruit une grande partie de cette forêt autrefois préservée.
4.5 - La gentillesse et l’hospitalité des Dayak
Durant cette traversée, il rencontre les Dayak, qu'il décrit comme "le peuple sans doute le plus amical et le plus fraternel" de son voyage. Acceptant leur hospitalité, il partage leur dortoir communal. Il décrit la scène avec amusement :
"Je passe la nuit au milieu d’un véritable nid humain. Dans l’abandon du sommeil, une grand-mère sans âge laisse aller sa tête sur mon épaule, une aïeule pose son bras ridé en travers de ma poitrine… Ceux qui dorment tête-bêche par rapport à moi m’envoient leurs pieds dans la figure… des fesses d’enfant replacent soudain mon oreiller…
Il poursuit :
Par crainte de réveiller quelqu’un, je n’ose pas bouger, malgré l’inconfort de ma situation. Pour tout arranger, je suis plus grand que mes compagnons de chambrée et mes pieds, dépassant de la moustiquaire, la soulèvent. Ce dont les maudites bestioles profitent aussitôt pour se ruer sous le filet. Le résultat est presque immédiat. Sans se réveiller pour autant, chacun et chacune commence à se gifler le visage dans un réflexe destiné à écraser les moustiques. Au martèlement de la pluie sur le toit et au bruit des ronflements s’ajoute celui de milliers de paires de claques résonnant dans l’obscurité."
Au moment de quitter les Dayak, l’aventurier devra repousser son départ de deux jours pour soigner un jeune homme dont le pied infecté risquait l'amputation.
4.5 – La suite de l’épreuve indonésienne avant celle de l’océan Indien
À Pontianak, ville "peut-être la plus décrépite, la plus répugnante, la plus… pourrie, à tous les sens du terme, qu’il m’ait été donné de traverser" écrit-il, l'aventurier retrouve son bateau et sa famille.
Il affronte ensuite le redoutable détroit de Singapour, où le trafic maritime est le plus dense au monde. Il atteint finalement Sumatra, qu'il traverse à vélo tandis que son frère Martin transporte le bateau par voie terrestre puis maritime.
Ce quatrième chapitre s'achève à Padang, où ils surmontent des problèmes administratifs grâce à l'aide d'un quartier-maître indien. Mike Horn peut alors poursuivre son improbable périple…
Chapitre V - L'œil du cyclone
5.1 - Face à l'immensité de l'océan Indien
À Padang, Mike Horn se retrouve face à l'océan Indien, conscient des 5 500 kilomètres qui l'attendent jusqu'aux côtes africaines. Cette traversée s'annonce particulièrement périlleuse car la mousson approche, période redoutée des marins les plus aguerris. "Quand je jette un coup d'œil sur ma carte météo, je suis parcouru d'un frisson : d'énormes dépressions tournent au-dessus de cet océan comme des patineuses folles", lance l'aventurier.
Malgré ces signes inquiétants, Mike Horn quitte Padang avec Martin, Claude-Alain et Sean. Trois jours plus tard, il remarque que son flotteur gauche, celui qui avait été endommagé à Bunaken, se remplit d'eau à nouveau. L'examen révèle que les réparations effectuées n'ont pas tenu et que l'eau s'infiltre par de nouvelles fissures. Mike comprend qu'avec cette avarie, il ne peut pas affronter l'océan Indien. Il va devoir faire escale aux Maldives pour réparer correctement son bateau.
Lorsqu'ils atteignent l'île de Siberut, le temps se dégrade considérablement. Sean et Claude-Alain quittent le navire pour rejoindre Padang par ferry. Martin, lui, décide de rester aux côtés de son frère pour l'aider à maintenir le trimaran à flot.
5.2 - La lutte acharnée contre les éléments
Les jours suivants transforment le voyage en cauchemar alors que Mike et Martin tentent de rejoindre le Sri Lanka puis les Maldives. Le flotteur prend l'eau de plus en plus vite et nécessite des pompages constants. Pour compliquer la situation, le mauvais temps empêche toute réparation en mer. Les deux frères doivent se relayer jour et nuit pour pomper, affrontant des vagues monstrueuses qui menacent de faire chavirer l'embarcation.
Mike Horn raconte comment, à plusieurs reprises, ils ont frôlé la catastrophe. Une nuit, une vague géante les frappe par le travers, couchant complètement le bateau sur le côté. "Un moment, j'ai cru que c'était fini" admet-il. Par miracle, le trimaran se redresse, mais la situation reste désespérée.
Après plusieurs jours de lutte acharnée, ils aperçoivent enfin l'archipel des Maldives. Mike Horn évoque avec soulagement leur arrivée à Malé, la capitale, où ils peuvent enfin amarrer leur navire malmené et procéder aux réparations essentielles.
5.3 - La fenêtre providentielle : naviguer dans l'œil du cyclone
Pendant leur séjour aux Maldives, l'aventurier apprend qu'un répit météorologique de quelques jours s'annonce, créant une fenêtre de navigation idéale pour traverser l'océan Indien. "C'est l'œil du cyclone", explique-t-il, "une période calme entre deux systèmes dépressionnaires majeurs. Si nous ne saisissons pas cette opportunité, nous resterons bloqués ici pendant des semaines."
Les réparations s'effectuent en un temps record, et Mike Horn prévoit de repartir au plus vite. Toutefois, Martin doit rentrer en Suisse pour des obligations professionnelles. L'explorateur se retrouve donc seul pour affronter l'une des traversées les plus redoutables de son périple.
Le jour du départ, Mike Horn découvre avec consternation que son GPS principal est tombé en panne. Comme si cela ne suffisait pas, son téléphone satellite refuse également de fonctionner. Il devra naviguer à l'ancienne, en utilisant son sextant et en se fiant aux étoiles.
5.4 - Défier l'océan en solitaire
L'océan se montre d'abord clément, offrant des conditions de navigation idéales. Mike Horn profite de cette accalmie pour préparer son bateau aux tempêtes qu'il sait inévitables. Il décrit méthodiquement comment il sécurise chaque élément de son embarcation, vérifie les points d'amarrage et prépare ses rations de survie.
Ce n'est qu'une question de jours avant que l'œil du cyclone ne se referme et que l'océan ne dévoile sa face la plus terrible. Les premières tempêtes le frappent avec une violence inouïe. Des vagues hautes comme des immeubles de quatre étages s'abattent sur son trimaran. Mike Horn relate comment il s'attache en permanence pour éviter d'être emporté par-dessus bord.
Durant cette traversée éprouvante, l'aventurier connaît des moments de solitude intense et de doute. Il note dans son journal : "Il y a des moments où je me demande si j'ai eu raison de me lancer dans cette aventure. Mais aussitôt, je me reprends. Ce n'est pas le moment de flancher."
Après vingt-huit jours de navigation en solitaire, Mike Horn aperçoit enfin les côtes africaines. L'émotion le submerge quand il réalise qu'il a réussi à traverser l'océan Indien malgré les conditions extrêmes et son bateau endommagé.
"En touchant la terre ferme des Seychelles, j'ai eu le sentiment d'avoir remporté la plus grande victoire de toute mon expédition" conclut l'explorateur, conscient que ce passage représentait probablement le défi le plus périlleux de tout son tour du monde.
Chapitre VI - Le pire, c'est l'homme
6.1 - L'Afrique : un continent aux mille visages
Mike Horn entame le sixième chapitre de son récit "Latitude zéro" en soulignant que la traversée de l'Afrique équatoriale, bien que relativement courte en distance par rapport au reste de son voyage, s'avère être la plus "dense" de toutes.
Cette dernière étape, rapporte-il, regroupe à elle seule toutes les variétés d'environnements - désert, montagne, jungle, lacs et fleuves - et cumule les dangers inhérents au continent africain, parmi lesquels l'instabilité politique figure en tête de liste.
L'aventurier quitte Lamu, sur la côte kenyane, avec l'intention de suivre une route qui longe la frontière somalienne vers Garissa. Malgré les avertissements des autorités concernant les "shifters" (nomades armés) qui terrorisent la région, Mike Horn décide, contre toute prudence, d'emprunter cet itinéraire. Pour échapper aux contrôles policiers, il contourne de nuit les barrages et s'enfonce dans des territoires déconseillés.
Il raconte alors comment il doit sans cesse se cacher à la vue des patrouilles militaires et des convois. Le sable envahissant la piste, il avance péniblement, souvent contraint de porter son VTT. À plusieurs reprises, il évite de justesse des embuscades. Un jour, il aperçoit des hommes armés en plein milieu de la route et se dissimule dans les buissons pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'ils partent.
6.2 - Le défi du mont Kenya : l'ascension impossible
Après avoir atteint la région du mont Kenya, l'explorateur décide de gravir cette montagne de 5 199 mètres, bien qu'elle ne se trouve pas exactement sur l'équateur. La malchance s'en mêle lorsque son équipement d'alpinisme, qui devait lui être livré par avion, est volé par un manutentionnaire à l'aéroport de Nairobi.
Mike Horn partage sa réflexion à ce moment-là : "J'ai désormais le choix entre contourner le mont Kenya et reprendre ma route sur l'équateur, ou... y aller quand même, avec le peu d'équipement dont je dispose. Cette dernière solution est évidemment totalement déraisonnable. Mais si j'étais raisonnable, je ne serais pas là..."
Sans surprise, l'ascension, réalisée sans casque ni crampons, et avec un équipement minimal, s'avère particulièrement périlleuse. À 200 mètres du sommet, le groupe est, de plus, contraint de passer la nuit dans une petite cavité rocheuse par -15°C, sans sacs de couchage adaptés.
Mais le lendemain, le groupe atteint enfin le sommet et peut alors admirer un panorama exceptionnel sur toute l'Afrique.
6.3 - Sur les eaux tumultueuses du lac Victoria
Après cette victoire sur la montagne, Mike Horn poursuit sa route à vélo vers les rives du lac Victoria.
Il raconte avec tendresse sa rencontre avec un jeune Massaï à qui il offre un tour de vélo, et son arrivée à Kisumu où il retrouve sa famille venue le soutenir.
À Kisumu, l'aventurier se procure un canot traditionnel Sese pour traverser le lac Victoria, véritable mer intérieure. Son périple manque de tourner au drame quand une tempête fait chavirer son embarcation en pleine nuit : "Le vent se déchaîne et des vagues monstrueuses surgissent de l'obscurité. J'essaie vainement de rétablir l'équilibre. Mon canot se remplit d'eau un peu plus à chaque vague... Je suis assis sur une embarcation en train de sombrer en pleine tempête."
Le navigateur passe huit heures à se battre contre les éléments, à retourner son canot, à utiliser son sac à dos comme bouée et à vider l'eau embarquée. Il parvient finalement à remettre son embarcation à flot et atteint, six jours plus tard, les rives de l'Ouganda.
6.4 - Le Congo : dans l'enfer de la guerre civile
En Ouganda, Mike Horn fait la connaissance d'Alison Porteous et Tim Cooper, deux anciens reporters de guerre anglais qui l'accueillent sur leur île paradisiaque du lac Victoria. Ces nouveaux amis l'aident à préparer sa traversée du Congo, pays déchiré par la guerre civile. Ils lui suggèrent de se créer un "alibi" officiel pour franchir la frontière.
L'explorateur raconte :
"Je contacte aussitôt Cathy, qui m'écrit elle-même de faux certificats et de fausses lettres de recommandation. Sous des formes et des signatures variées, ces divers documents expliquent tous que je suis un scientifique, chargé de recherches par un laboratoire."
6.5 - Survivre aux prédateurs humains
La traversée du Congo s'annonce alors comme le défi le plus dangereux de toute son expédition.
Dès son arrivée à la frontière, à Kasindi, les problèmes commencent : son visa émis par le consulat de Genève pose problème car la zone frontalière est tenue par les rebelles du FLC (Front de libération du Congo), opposés au gouvernement de Kinshasa. Considéré comme un espion potentiel, Mike Horn est emprisonné quatre jours avant d'être relâché, avec pour ordre de retourner à Kampala..
Déterminé à poursuivre, Mike revient en Ouganda et obtient des lettres de recommandation du gouvernement ougandais ainsi que des contacts directs avec les chefs rebelles congolais, dont Jean-Pierre Mbemba et Lumbala. Moyennant des pots-de-vin, il reçoit finalement les autorisations nécessaires pour traverser les territoires contrôlés par les différentes factions rebelles.
6.6 - Traque, menaces et survie : une traversée du Congo sous haute-tension
L'aventurier décrit avec effroi la violence omniprésente dans le pays :
"Des siècles de colonialisme, des décennies de subventions occidentales et de touristes mettant systématiquement la main au portefeuille ont fini par leur donner le réflexe de la mendicité. Ou pire..."
Il compare son expérience avec les Amérindiens d'Amazonie, chez qui il pouvait laisser ses affaires sans surveillance pendant des jours, alors qu'au Congo, il doit constamment rester sur ses gardes.
Pendant son périple congolais, Mike Horn va ainsi faire face à de multiples dangers et va frôler la mort à plusieurs reprises.
Il est d’abord poursuivi par des pirates de la jungle, des ex-Faz (Forces armées zaïroises). Il doit alors utiliser ses talents de survie pour leur échapper en créant des cercles de distraction dans la forêt.
Il est ensuite arrêté par un commandant psychopathe qui le menace d'exécution et le torture psychologiquement avant que des policiers n'interviennent.
À Bafwasende, il est à nouveau détenu, mais parvient à impressionner ses geôliers lors d'un incident nocturne :
"Je vois la panique sur son visage, pendant qu'il cherche partout sa kalachnikov. Je rentre dans ma cabane et ressors l'instant d'après, l'arme bien en main, le canon pointé droit sur son abdomen. Le garde se décompose. Au lieu de quoi, je retourne l'arme et la lui tends."
Ce geste de clémence lui vaut un changement d'attitude de ses gardiens. Grâce à l'intervention d'un officier ougandais, il est finalement libéré.
La traversée du Congo de l’explorateur est ponctuée d'arrestations arbitraires, de rackets, de menaces de mort et d'actes de violence dont il est témoin ou victime. Il raconte comment des soldats congolais le dépouillent de presque tous ses biens, ne laissant que sa caméra et son téléphone satellite après qu'il leur ait fait croire que ces appareils pouvaient exploser si on manipulait un mauvais bouton.
À un moment particulièrement critique, il se retrouve dans une confrontation avec un commandant ivre qui organise une sorte de "duel au soleil" et le menace avec une kalachnikov :
"Arrivé devant lui, j'empoigne le canon de son arme et me l'appuie moi-même contre le front. Dans un état second, je hurle : - Vas-y, connard ! Tue-moi ! Allez, vas-y, abruti ! Sale con ! Pauvre merde ! Sans couilles ! Minable !"
Cette réaction inattendue déstabilise son agresseur qui finit par le reconduire en cellule plutôt que de tirer. Il est sauvé par l'intervention de policiers, puis par l'aide des militaires ougandais qui arrêtent et punissent sévèrement son tortionnaire.
6.7 – Petit intermède, mais le périple extrême congolais continue
Mike Horn connaît un moment de répit lorsqu'il atteint Bwadolite, le quartier général de Jean-Pierre Mbemba. Il y est accueilli en héros car personne ne croyait qu'il parviendrait jusque-là vivant.
Il profite de ce séjour pour visiter les châteaux luxueux de l'ancien dictateur Mobutu Sese Seko, dont il décrit avec dégoût l'opulence indécente contrastant avec la misère environnante.
L'aventurier retrouve son frère Martin à Bwadolite, mais leur tentative de continuer ensemble se complique quand les avions de Kabila bombardent la ville. Dans la confusion, ils s'échappent et poursuivent leur route en pirogue sur la rivière Oubangui vers Bangui, en République centrafricaine.
Durant leur périple tantôt sur le fleuve, tantôt à travers la jungle, dans cette région en proie au chaos, les deux hommes se font systématiquement arrêter, rançonner, dépouiller, poursuivre. Ils échappent maintes fois aux soldats.
"Les uniformes, les armes et les yeux qui n’expriment que la mort resurgissent… Sans cesse, on nous arrête, on nous demande nos papiers, on nous somme d’expliquer notre présence… (…) Systématiquement, on nous réclame de l’argent, on nous rançonne, on tente de nous dépouiller… on envisage même de nous fusiller."
Arrivés à Bangui, les deux aventuriers se séparent. Mike se lance seul à travers la République centrafricaine à vélo. Après plus de dix jours de piste sablonneuse où il lui est quasiment impossible de pédaler, il retrouve son frère Martin à Bayanda, avec Sebastian, le photographe de l’aventure (Sean rejoindra aussi le trio un peu plus loin).
Mike Horn poursuit son expédition en pirogue sur la rivière Sangha jusqu'à Ouesso. Mais alors qu’il s’apprête à sortir du territoire centrafricain et d’entrer au Cameroun, il raconte comment, épuisé par la violence permanente, il finit par répondre agressivement à un douanier corrompu :
"Furieux, je l’empoigne par le col et le soulève de derrière sa petite table. Dans un réflexe, Martin s’empare du soldat et l’immobilise en lui faisant un tour de clé. Face contre face, j'annonce au douanier : - Vous n'êtes qu'un voleur, et je ne vous donnerai pas un sou ! Et si vous insistez, je vous casse la gueule !"
6.8 - La dernière frontière : vers la mer promise
Mike Horn et son équipe foncent désormais vers la frontière gabonaise.
Pour éviter les derniers contrôles, l'aventurier s'enfonce une dernière fois dans la jungle, son vélo attaché sur le dos.
À Madjingo, il franchit enfin la frontière du Gabon, dernier pays de son périple. Accueilli chaleureusement par un vieillard à la crinière blanche surnommé le "président", Mike Horn ressent un profond soulagement. Pour la première fois depuis des mois, personne ne lui demande d'argent ni ne le menace.
6.9 - Les derniers kilomètres : entre soulagement, euphorie et vertige de l’après
"C'est à la fois le moment le plus heureux de toute mon expédition, et le plus triste. Soudain, je me sens vide. Après Libreville, je fais quoi ? Je vais où ? Que vais-je faire de mes journées ? Ce but, cette terre promise dont j’ai rêvé pendant dix-sept mois et que j’ai eu tant de mal à atteindre, est là, à portée de main… et je n’en veux plus."
Il poursuit, pensif :
"J’ai presque peur de devoir me réhabituer à la vie "normale". J’ai oublié ce que c’était que d’ouvrir un robinet pour en faire couler de l’eau chaude, de fermer une porte pour s’isoler, d’utiliser des toilettes avec une chasse d’eau, de tourner la clé de contact d’une voiture."
6.10 - Le rituel final : la boucle est bouclée
À Libreville, l'aventurier retrouve sa famille, ses amis et son équipe. Puis il traverse l'embouchure du fleuve Gabon et atteint Nyonié, village situé juste sous l'équateur.
Après avoir répondu aux questions des journalistes, il effectue seul la dernière étape symbolique de son voyage : au petit matin, il remonte la plage jusqu'à l'endroit exact d'où il était parti dix-sept mois plus tôt.
Dans un geste rituel chargé d'émotion, il sort de sa poche le petit sac contenant les six coquillages qu'il avait ramassés au début de son périple. Il les replace un par un dans le sable, chacun symbolisant une étape de son tour du monde : l'Atlantique, l'Amérique du Sud, le Pacifique, l'Indonésie, l'océan Indien et l'Afrique.
Le chapitre et le livre se concluent sur cette image poétique et symbolique, résumant toute la philosophie de l'aventurier :
"Je suis parti pour ce tour du monde en imaginant que je sortais de chez moi par l'entrée principale et que je rentrerais, un jour, par l'entrée située derrière la maison. Je viens enfin de pousser la porte..."
À travers ce dernier chapitre, Mike Horn démontre que dans toutes les épreuves qu'il a traversées - océans déchaînés, jungles hostiles, montagnes glacées - l'homme reste le danger le plus imprévisible et le plus redoutable.
Pourtant, c'est aussi grâce à la bonté de certains hommes et femmes rencontrés en chemin qu'il a pu accomplir son extraordinaire exploit : faire le tour du monde en suivant la ligne de l'équateur.
Cahier photos
À la fin de son récit, Mike Horn partage un cahier photographique qui illustre les moments clés de son extraordinaire périple autour du monde.
Ces images sont organisées par continent. À l’image des coquillages reposés dans le sable, chacun de ces continents représente une étape du tour du monde de Mike Horn : l'Atlantique, l'Amérique du Sud, le Pacifique, l'Indonésie, l'océan Indien et l'Afrique.
Ces illustrations saisissantes, accompagnées de légendes détaillées, nous offrent ici un témoignage visuel émouvant des défis affrontés, des paysages traversés et des rencontres qui ont marqué ses dix-sept mois d'expédition le long de l'équateur.
Conclusion de "Latitude zéro | 40 000 km pour partir à la rencontre du monde" de Mike Horn
Quatre enseignements clés du livre "Latitude zéro" qu'il faut retenir !
- Face aux éléments incontrôlables, la capacité d'adaptation devient la première ressource de survie.
Toute l’aventure de Mike Horn témoigne de sa capacité exceptionnelle à s'adapter à des environnements extrêmes et changeants.
Au cœur de la jungle amazonienne, il apprend à chasser au collet et à se nourrir comme un prédateur local. Sur l'océan Indien, privé de GPS et de téléphone satellite, il navigue à l'ancienne dans des tempêtes monstrueuses. Au Congo, il se fait passer pour un chercheur médical afin de traverser des zones de guerre.
À chaque étape, l'aventurier démontre que la survie dépend avant tout de l'intelligence situationnelle et de la faculté à s'ajuster immédiatement aux circonstances. Cette adaptabilité n'est pas innée, elle s’acquiert. Chez Mike Horn, elle s’est notamment développée grâce à son expérience militaire et grâce à une préparation minutieuse - son sac à dos sur-mesure et ses chaussures spéciales en témoignent.
- L'aventure solitaire extrême met en lumière à la fois la vulnérabilité et la résilience profonde de l'être humain.
Au fil de son récit, Mike Horn ne cache pas les moments où il atteint ses limites physiques et mentales. Lorsqu'il est mordu par un serpent en Amazonie et paralysé pendant cinq jours, quand son bateau est fracassé par une tornade à Bunaken, ou face au canon d'une kalachnikov au Congo, l'aventurier fait face à sa propre fragilité.
Il confie même avoir fondu en larmes au moment de quitter le Gabon, submergé par le trac et l'angoisse. Pourtant, c'est précisément dans ces moments de vulnérabilité extrême qu'il puise des ressources insoupçonnées, transformant sa peur en courage et ses échecs en apprentissages.
Son périple devient ainsi une exploration des limites humaines autant qu'un voyage géographique.
3 : La nature sauvage, malgré sa dureté, reste plus prévisible et moins cruelle que la société humaine.
L'un des points les plus frappants de "Latitude zéro" réside dans la comparaison entre les dangers naturels et ceux causés par l’homme.
Mike Horn observe que même les prédateurs les plus redoutables de l'Amazonie obéissent à des schémas prévisibles, tandis que les comportements humains, particulièrement dans les zones de conflits africains, sont marqués par une violence arbitraire.
Cette réflexion culmine dans le titre évocateur du dernier chapitre - "Le pire, c'est l'homme" - où l'aventurier réalise que sa traversée du Congo en guerre, avec ses barrages, ses extorsions et ses menaces d'exécution, représente un danger bien plus grand que toutes les tempêtes ou les prédateurs de la jungle.
- L'accomplissement personnel nécessite une détermination solitaire mais aussi des connexions humaines.
Bien que son périple soit essentiellement solitaire, Mike Horn insiste sur le rôle essentiel des rencontres humaines et du soutien dont il a bénéficié dans sa réussite.
Les amitiés nouées avec les Dayak de Bornéo, l'hospitalité des Pygmées congolais, l'aide providentielle d'Alison et Tim Cooper en Ouganda, ou encore le soutien logistique de son frère Martin constituent un réseau indispensable.
L'aventurier démontre ainsi que même l'exploration la plus solitaire dépend d'une communauté de soutien et que l'autonomie absolue est un mythe. Le rituel final des six coquillages, replacés exactement là où il les avait pris au départ, symbolise cette boucle qui le ramène non seulement à son point de départ géographique, mais aussi à l'humanité qu'il avait temporairement quittée.
Les cinq pépites de "Latitude zéro" de Mike Horn
- Un souffle d’évasion dans un monde de plus en plus anxiogène
Dans un monde saturé de connexions, de surstimulations et d’informations oppressantes qui nous accaparent et nous éloignent souvent de l’essentiel, la lecture de "Latitude zéro" est une véritable bouffée d’oxygène !
À travers son périple, Mike Horn nous rappelle la valeur de la déconnexion, de l’instant présent et du contact direct avec la nature, des choses que notre quotidien hyperconnecté tend à nous faire oublier. Son voyage extrême contraste avec notre mode de vie moderne qui nous enferme souvent dans une routine digitale et un environnement anxiogène.
En partageant ses défis, ses émerveillements et sa quête de dépassement de soi, l’aventurier nous invite finalement à redécouvrir un rapport plus brut, plus authentique et plus libre au monde.
- Une aventure hors du commun
"Latitude zéro" est aussi un récit d’aventure passionnant ! Mike Horn nous embarque dans un tour du monde fascinant le long de l’équateur. L’écriture immersive de l’aventurier nous fait voyager dans les endroits les plus improbables et nous fait vivre son combat contre les éléments et son dépassement personnel, comme si nous y étions !
- Une leçon de vie inspirante
Mais bien plus que cela, "Latitude zéro" est une véritable leçon de vie condensée. La vision du monde de Mike Horn et son expérience face aux défis les plus extrêmes de notre planète nous enseignent des valeurs essentielles : la persévérance dans l'adversité, l'adaptabilité constante, et la capacité à transformer les obstacles en opportunités d'apprentissage.
Un parcours qui invite finalement à appliquer ces principes dans notre quotidien pour surmonter nos propres difficultés.
- Un recalibrage de notre perception des obstacles
"Latitude zéro" nous aide à relativiser nos problèmes en les mettant en perspective avec des défis véritablement existentiels. Lorsque nous hésitons à sortir de notre zone de confort, repenser à Mike Horn traversant un marécage amazonien aux herbes coupantes pendant dix heures ou affrontant un commandant congolais ivre et menaçant peut devenir un puissant moteur de motivation !
- Un appel à l’inconnu et à l’imprévisible
À une époque où les algorithmes et les GPS dictent nos choix et nos déplacements, "Latitude zéro" nous rappelle la valeur de l’inconnu et de l’imprévu.
Nous ressortons de cet ouvrage avec une conscience plus affûtée de nos propres ressources intérieures et une nouvelle appréciation du monde sauvage. Il nous rappelle avec force combien cette nature indomptée et sa beauté brute tranche avec la monotonie parfois suffocante de notre quotidien surprotégé.
Pourquoi lire "Latitude zéro" de Mike Horn ?
"Latitude zéro" est une perle rare ! C’est un ouvrage qui mérite d'être lu tant pour le récit palpitant d’une aventure hors du commun, que pour la sagesse qu'il distille à travers l'expérience brute du terrain.
Aussi, je le recommande vivement pour toutes les raisons développées ci-dessus ainsi que pour les deux raisons essentielles suivantes :
D'abord parce qu'il constitue un témoignage authentique de ce que signifie repousser les limites du possible et habiter pleinement notre humanité dans un monde de plus en plus aseptisé.
Ensuite parce qu'il offre une perspective unique sur notre planète, révélant à la fois sa beauté sauvage et sa fragilité face aux actions humaines, le tout à travers le regard sincère d'un homme qui a véritablement embrassé chaque centimètre de l'équateur terrestre.
Points forts :
Un récit d'aventure exceptionnel relatant un exploit jamais réalisé auparavant.
Une immersion totale dans des environnements extrêmes et variés à travers plusieurs continents.
Un témoignage authentique sur la résilience humaine face aux défis les plus redoutables.
Une écriture et des descriptions captivantes qui nous transportent au cœur de l'action et des paysages.
Le regard humble et plein d’humanité de l’auteur.
Points faibles :
L'aspect technique de la navigation ou de la survie peut parfois sembler complexe pour les non-initiés ou ceux qui sont moins intéressés.
Certains passages peuvent peut-être paraître trop intenses pour des lecteurs sensibles.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu "Latitude zéro" ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin d'acheter le livre de Mike Horn "Latitude zéro"
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Mike Horn "Latitude zéro"
 ]]>
]]>Résumé de "Sauvage par nature | De Sibérie en Australie, 3 ans de marche extrême en solitaire" de Sarah Marquis : ce récit d’aventure retrace l'extraordinaire odyssée de Sarah Marquis qui, durant trois ans, a traversé seule, à pied, six pays d'Asie jusqu'en Australie. Une marche solitaire de 20 000 kilomètres à travers steppes, déserts et jungles où chacun des pas de la voyageuse, confrontée aux dangers extrêmes de la nature et des hommes, devient une véritable leçon de survie. Une reconnexion avec la vie sauvage qui nous enseigne aussi comment l'instinct primitif peut renaître chez l'humain moderne quand il est livré à lui-même.
Par Sarah Marquis, 2015, 264 pages.
Titre de l’édition anglophone : "Wild by Nature: From Siberia to Australia, Three Years Alone in the Wilderness on Foot", 2016, 272 pages.
Chronique et résumé de "Sauvage par nature | De Sibérie en Australie, 3 ans de marche extrême en solitaire" de Sarah Marquis
Introduction
Dans l’introduction de son livre "Sauvage par nature", l’auteure, Sarah Marquis nous plonge dans ses souvenirs d'enfance. Elle évoque avec tendresse une petite fille déjà différente des autres.
Elle raconte comment, dès l'âge de 8 ans, elle passait des heures avec les animaux plutôt qu'avec des poupées, et développait une soif insatiable d'aventures et de découvertes. L'aventurière nous décrit cette sensation devenue "évidence" qui l'a poussée vers l'exploration du monde.
"Ma vie était alors une aventure presque journalière. J’étais la plus heureuse des petites sauvageonnes du coin, même si beaucoup de choses me chiffonnaient. Je voulais comprendre. Plus encore, je voulais tout découvrir sans devoir choisir, sans but, sans préférences. Juste "tout". (…) Je rêvais éveillée d’autres contrées, d’autres arbres, d’autres animaux, d’un ailleurs où des oiseaux aux couleurs chatoyantes virevoltent dans les airs, où l’on rencontre des animaux qu’on appelle des bêtes… sauvages. (…) Ce que j’éprouvais au fond de moi était une sensation – si forte – qu’elle en était devenue "une évidence". J’allais devenir une découvreuse… Plus communément appelée une aventurière."
Sarah Marquis partage ainsi sa vision unique : "Plus je m'éloigne, plus je vois", explique-t-elle, tout en soulignant que sa vie a été faite de choix audacieux.
Elle conclut en dédiant son récit aux femmes du monde entier, pour celles "qui luttent encore pour leur liberté et pour celles qui l’ont obtenue mais qui ne l’utilisent pas". Elle nous invite ainsi à la suivre dans son extraordinaire périple : "Mettez vos chaussures. On part marcher."
Chapitre 1. Préparation
Dans le premier chapitre du livre "Sauvage par nature", Sarah Marquis est de retour dans les Alpes suisses après trois ans d'aventures.
Elle partage comment les traces de son périple sont indélébiles : ses instincts de survie persistent dans ses gestes quotidiens, comme un tatouage invisible gravé dans son corps et son âme.
1.1 - Avant un départ...
Puis, l'aventurière revient sur la genèse de son expédition singulière baptisée eXplorAsia : une traversée de six pays d’Asie, seule, à pied.
Elle se souvient :
"Une sensation indescriptible grandissait en moi jusqu’au moment où le départ se présenta à moi comme l’unique option. Je savais tout au fond de mon cœur que ce départ était alors la seule façon d’être fidèle à ce feu qui brûlait en mon for intérieur. Je le sentais faiblir, la flamme était moindre… il était temps de partir à la recherche du bois qui me permettrait de retrouver ma flamme de vie."
Deux années de préparation minutieuse furent nécessaires pour organiser cette expédition, souligne l’auteure.
Sarah Marquis détaille notamment la manière dont elle s’y est pris pour constituer une équipe fiable en vue de ce projet, avec un nouveau chef d'expédition - son frère Joël, qui l'avait accompagnée lors de ses précédentes explorations, ayant pris un autre chemin professionnel.
1.2 - Vevey-Suisse, juin 2010, une semaine avant le départ
À une semaine du départ, Sarah Marquis nous fait part de sa tristesse de devoir laisser D'Joe, son fidèle compagnon canin rencontré lors de son périple australien en 2002-2003.
Elle décrit également l'organisation méthodique de son matériel, avec notamment le choix crucial de ses chaussures - huit paires de la marque Sportiva, sa marque habituelle Raichle ayant cessé la production.
1.3 - Une femme en Mongolie (préparation)
La baroudeuse souligne ici combien il est important de comprendre la culture locale. Elle relate avec franchise les défis particuliers auxquels elle a dû faire face, notamment les comportements déconcertants des nomades mongols qu'elle a appris à interpréter sans jugement. "Ce n'est pas parce que je ne comprends pas une attitude que je dois la condamner", rappelle-t-elle sagement.
Sarah Marquis conclut le chapitre 1 de son livre "Sauvage par nature" en évoquant les risques sanitaires du pays et sa décision de ne faire que le vaccin contre le tétanos, faute de temps pour compléter le protocole contre la rage.
Épuisée par ces deux années de préparation, elle s'endort dans l'avion avant même le décollage, siège 24B, direction la Mongolie.
Chapitre 2. Mongolie, mes débuts…
Au début des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième chapitres de "Sauvage par nature", une carte détaillée montre l'itinéraire de Sarah Marquis à travers la Mongolie, depuis Suhhbaatar jusqu'au désert du Gobi, en passant par différents points de ravitaillement.
2.1 - Retour en Mongolie...
Sarah Marquis entame son périple péniblement sous une chaleur accablante de 40°C. Dès les premiers jours, elle ressent beaucoup de fatigue et prend une insolation.
C’est une rencontre inattendue avec un chevreuil dans une forêt dense de bouleaux qui va alors lui redonner l'énergie nécessaire pour poursuivre sa route. Ce moment magique lui rappelle une expérience similaire vécue en 2002 sur le Pacific Crest Trail, où elle avait observé un cerf majestueux traverser une rivière.
L'aventurière décrit ensuite sa progression difficile avec sa charrette de 50 kg et son sac de 17 kg. Son corps, insuffisamment préparé cette fois-ci par manque de temps, s'adapte lentement à l'effort.
2.2 - Eau, où es-tu ?
Face au défi de trouver de l'eau dans ces steppes arides, elle partage trois techniques de survie essentielles :
La condensation dans un trou creusé au sol et recouvert d'un plastique,
La récupération de la transpiration des feuilles,
La recherche d'eau sous le lit asséché des rivières.
Mais la meilleure façon de trouver de l’eau, finit-elle, est de "vider son sac des a priori, des théories" car "seule compte votre capacité à lire le décor".
Un souvenir de 2006 dans les Andes lui a appris une leçon fondamentale à ce propos : la sensibilité prime sur la logique pour lire un paysage. Sarah raconte en effet comment sa recherche obsessionnelle de végétation pour récolter de l’eau l'avait, en fait, empêchée de repérer une rivière pourtant très visible.
2.3 - Ce premier jour en Mongolie (suite)...
Le récit se poursuit sur la première rencontre de Sarah Marquis avec un nomade mongol, vêtu d'une tunique vert bouteille. Dans un échange silencieux mais riche en gestes, l'homme lui dessine une carte dans la poussière pour lui indiquer un point d'eau.
Cette rencontre authentique se termine sur une mélodie portée par le vent, tandis que le nomade s'éloigne à cheval.
2.4 - Le temple, le géant et le nourrisson
Sarah Marquis narre sa progression à travers une forêt de mélèzes détrempée, où elle croise un "ovoo", un cairn sacré traditionnel mongol de 5 mètres de haut. Par respect pour les croyances animistes locales, elle évite ce lieu d'offrandes et poursuit sa route vers un temple.
En chemin, l'aventurière est invitée dans une yourte par un couple de nomades. Elle y découvre avec émerveillement un nouveau-né, tout en s'initiant au "suutei tsaï", le traditionnel thé au lait salé. Cette scène paisible est interrompue par l'arrivée d'autres visiteurs, dont une jeune femme qui expose ses seins devant l'assemblée, provoquant le malaise de la jeune mère.
Après cet épisode déconcertant, Sarah Marquis se dirige vers le temple aux palissades rouge terre, où elle aperçoit un homme d'une taille exceptionnelle travaillant au sol. Le géant, intimidé, s'enfuit à son approche. Trouvant le temple en ruines, elle poursuit sa route jusqu'à un camp touristique composé d'une trentaine de yourtes alignées.
L'aventurière relate avec humour ses interactions avec les jeunes femmes du camp, marquées par des différences culturelles saisissantes : leur expression stoïque, leur curiosité pour son statut matrimonial, et leur réaction face à ses "grands yeux". Elle savoure enfin un moment de répit dans sa yourte, où elle peut se laver et manger un repas chaud.
Ce passage se termine sur une note dramatique, alors qu'un violent orage approche. "Le ciel s'est métamorphosé en un énorme nuage noir, boursouflé", écrit-elle, tandis qu'une jeune fille du camp vient démonter sa cheminée par précaution.
2.5 - Des semaines plus tard…
La fatigue et la peur s'accumulent pour Sarah Marquis, harcelée chaque nuit par des cavaliers qui rôdent autour de son camp. Épuisée, elle trouve refuge dans un abri à moutons où elle s'endort profondément.
C'est là que se produit une rencontre magique : elle observe, émue aux larmes, une huppe fasciée, cet oiseau qui la fascinait enfant et qu'elle n'avait jamais réussi à voir malgré des années de patience. "Des larmes coulent sur mes joues, des larmes de joie", confie l'aventurière.
Chapitre 3. Mongolie centrale
3.1 - Stratégie de survie, dangers et moments de contemplation
Sarah Marquis nous fait découvrir son arrivée dans un village fantôme de Mongolie centrale, guidée par le vol de grands rapaces au-dessus d'un col. Ce village de 200 âmes, qui en comptera plus de 5000 en hiver avec le retour des nomades, devient le théâtre d'une quête vitale : trouver de l'eau pour les 100 prochains kilomètres.
La baroudeuse partage sa rencontre musclée avec les habitants d'un bar local : une femme hostile et deux hommes ivres qui tentent de voler son équipement. Face à cette situation périlleuse, elle fait preuve de persévérance et de stratégie, jusqu'à ce qu'apparaisse un mystérieux "protecteur" qui l'aide silencieusement à remplir ses réservoirs d'eau.
Une fois le village quitté, Sarah Marquis affronte les éléments hostiles : "Le vent déshydrate, brûle. Associé à une température de 40°C (104°F), il peut être fatal".
Sa route prend un tournant dramatique lorsque les deux hommes ivres la poursuivent à cheval. Elle raconte comment elle parvient à les repousser grâce à une ruse audacieuse, qui va effrayer leurs chevaux et ainsi les déstabiliser.
L'aventurière termine cette journée éprouvante en trouvant un abri rocheux pour la nuit. Elle prend soin d'effacer ses traces sur le sol durci. Le lendemain matin, elle partage avec nous un moment de paix rare : "Ce moment est mien, il est magique, indescriptible". Elle révèle aussi un détail touchant de son quotidien : ses habits de nuit colorés et féminins contrastent avec sa tenue de jour masculine et couleur sable, nécessaire à sa sécurité.
3.2 - Ce même jour...
L'aventurière rapporte ensuite sa rencontre pour le moins tendue avec deux motards, dont l'un tente de lui vendre de la marijuana. Face à cette situation menaçante, elle applique sa stratégie d'évitement : "Ne jamais donner d'importance aux gens ou animaux dont vous ne désirez pas attirer l'attention".
Alors qu'elle traverse une plaine désertique pendant cinq jours, Sarah Marquis aperçoit des chèvres mongoles, connues pour leur précieux cachemire. Elle explique comment les nomades récoltent ce duvet fin au printemps, produisant "environ 2 700 tonnes par an".
3.3 - Fibre naturelle sinon rien
Cette observation lui rappelle son expérience lors de son expédition en Amérique du Sud, où elle a découvert les vertus des fibres naturelles. L'aventurière raconte y avoir troqué ses vêtements techniques contre de la laine d'alpaga pour mieux résister au froid intense.
En Mongolie, elle teste différentes laines locales :
La laine de yak, chaude mais qui gratte,
La laine de chameau, confortable pour les chaussettes de nuit,
Le cachemire, particulièrement adapté à l'effort physique.
Sarah Marquis apprécie particulièrement cette approche durable de l'élevage qui permet aux nomades de vivre de leur bétail sans tuer les animaux. "J'aime l'idée que via une simple tonte à la main ou un brossage, ces gens arrivent à vivre de leur bétail sans devoir tuer l'animal", confie-t-elle.
3.4 - Prince ou crapaud
Sarah Marquis nous plonge ici dans une traversée éprouvante d'une plaine d'argile sous une chaleur écrasante de 40°C.
Épuisée par les visites nocturnes de cavaliers, elle s'encourage à voix haute pour avancer, se dédoublant presque pour maintenir son moral : "Allez, Sarah Marquis ! Allez, Sarah Marquis, allez...". Elle segmente sa marche en intervalles de plus en plus courts, luttant contre l'épuisement physique et mental.
Une tempête spectaculaire la surprend alors qu'elle monte son camp. Luttant contre un déluge de grêle et une coulée de boue, elle parvient à sauver in extremis sa charrette et son équipement. "Je hurle : 'Mongolie ! Tu ne m'auras pas !'", s'exclame-t-elle, célébrant cette petite victoire face aux éléments déchaînés.
Le destin lui envoie alors de l'aide sous la forme d'un nomade à cheval qui la guide vers sa yourte, de l'autre côté d'une rivière en crue. La traversée périlleuse s'effectue grâce à l'intervention d'un jeune cavalier qui la hisse sur sa monture, alors que le niveau de l'eau monte dangereusement. Dans la yourte, l'aventurière observe la stricte division des tâches entre hommes et femmes, notamment lorsque la maîtresse de maison nettoie seule, pendant plus d'une heure, la boue qui a envahi leur habitat.
La nuit qui suit est particulièrement mémorable. Sarah Marquis se retrouve dans une situation tragicomique, coincée entre les avances insistantes d'un jeune homme d'un côté, et un énorme crapaud de l'autre. Elle choisit avec humour la compagnie du batracien, après avoir repoussé fermement son voisin trop entreprenant. L'arrivée tardive de voyageurs bruyants et leurs festivités jusqu'à l'aube parachèvent cette nuit surréaliste.
Son périple prend un nouveau tournant quand les inondations l'obligent à modifier son itinéraire. Un ami mongol francophone lui vient en aide, établissant un nouveau tracé et la conduisant en voiture jusqu'à un col situé à 78 km à l'ouest. Bien que ce détour rallonge son parcours de 50 km, c'est sa seule option pour éviter d'être bloquée pendant des mois.
Dans la steppe déserte qui suit, elle affronte des conditions extrêmes. Le vent incessant devient son principal adversaire, l'obligeant à passer ses nuits à maintenir sa tente au sol. L'aventurière trouve du réconfort dans la présence des chevaux sauvages qui l'accompagnent parfois sur des kilomètres, la faisant rêver de "galoper sans limites dans ces steppes ouvertes, sans charrette ni sac à dos".
Une nouvelle tempête apocalyptique la frappe alors, combinant pluie, sable et foudre dans un spectacle aussi terrifiant que grandiose. Après avoir retrouvé son réchaud et sa casserole projetés à 500 mètres, elle trouve refuge dans la yourte d'une famille de "vrais nomades". Elle y passe une nuit intense, partageant l'inquiétude d'une femme pour son mari parti surveiller le bétail dans l'orage. L'authenticité et la dignité de ces nomades la touchent profondément, particulièrement lors des retrouvailles silencieuses mais éloquentes du couple à l'aube.
Les jours suivants, Sarah Marquis développe de nouvelles stratégies de survie, apprenant à repérer les abris à bétail pour se protéger des orages quotidiens. Elle atteint finalement Khakhorin, épuisée et affamée, s'étant rationnée à un simple bol de riz quotidien divisé en deux repas. Dans un camp touristique, elle trouve enfin le repos dans une yourte, prenant le temps de méditer sur cette habitation traditionnelle qui l'a tant fascinée tout au long de son périple.
L'aventurière conclut ce passage en évoquant sa découverte progressive de la vie nomade, notamment à travers l'observation de gestes quotidiens comme la collecte d'excréments séchés pour le feu.
"J'ai aimé découvrir la vie des nomades de cette manière. En les regardant, en essayant d'interpréter leurs gestes. En découvrant un peu plus d'indices jour après jour", confie-t-elle, tout en soulignant l'importance de cette immersion progressive dans la culture mongole.
3.5 - La douche enfin…
Dans un bâtiment délabré de Khakhorin, Sarah Marquis savoure enfin une douche tant attendue. Avec ingéniosité, elle utilise sa casserole en titane pour mélanger l'eau bouillante à l'eau froide. Ce moment de grâce lui permet de retrouver la femme sous les couches de sueur accumulées. Épuisée, elle dort ensuite pendant 24 heures d'affilée.
3.6 - Steppe, tu ne m’auras pas…
L'aventurière reprend sa route vers le sud-ouest, admirant les paysages changeants de la steppe qu'elle compare à "un gâteau multicouche". Elle trouve une solution ingénieuse pour ses nuits anxiogènes : dormir dans les tuyaux d'évacuation sous les pistes. Même si ces abris sont peu confortables et parfois occupés par des carcasses d'animaux, ils lui offrent enfin des nuits paisibles.
Arrivée à Khujirt, elle fait une rencontre marquante avec une cuisinière qui, malgré l'hostilité apparente des autres villageois, lui offre secrètement un deuxième bol de riz avec un œuf.
Cette expérience lui rappelle la solidarité universelle entre femmes qu'elle a rencontrée tout au long de son périple : "La faim n'a pas besoin de traduction, la faim s'exprime dans un langage universel", conclut-elle avec gratitude.
Chapitre 4. Désert du Gobi
Dans le chapitre 4 de "Sauvage par nature", Sarah Marquis entame sa traversée du désert du Gobi, en suivant les lignes électriques qui pointent vers le sud.
4.1 - Des aventures dès le début de la traversée du désert de Gobi
L'aventurière savoure la perspective de 150 km sans contact humain, retrouvant enfin sa solitude tant appréciée.
Cette quiétude est brièvement interrompue par un arrêt dans un village poussiéreux, où elle fait face à l'hostilité d'une épicière au visage marqué par la violence. L'intervention d'un homme bienveillant lui permet finalement d'obtenir des provisions, bien qu'à prix majoré. L'atmosphère du village est pesante, marquée par des actes de violence gratuite entre adolescents à la station-service.
Elle trouve refuge pour la nuit chez une vieille dame malicieuse, mais son repos est perturbé par plusieurs incidents inquiétants : la visite impromptue de deux hommes en noir qui fouillent ses affaires, les cris d'un homme manifestement perturbé, et la présence d'un chien enchaîné qu'elle convainc la propriétaire de libérer pour la nuit.
Quittant ce "lieu de misère" aux premières lueurs de l'aube, Sarah Marquis s'enfonce dans le désert. Le sable devient progressivement son principal obstacle, engloutissant les roues de sa charrette. Elle rencontre des géologues qui la mettent en garde contre les "ninjas", des chercheurs d'or clandestins qui opèrent la nuit.
L'aventurière trouve finalement sa paix dans la solitude du désert, où elle découvre une vie discrète mais fascinante : des traces d'animaux dans le sable, un scorpion translucide, des chameaux qui broutent autour de sa tente. "Je suis au bon endroit au bon moment, c'est tout. Je le sens, je le sais...", livre-t-elle.
Cette sérénité est brutalement interrompue par une violente tempête. Face aux éléments déchaînés, Sarah Marquis vit une expérience mystique inattendue : "quelque chose se produit, je n'arrive pas à l'expliquer, c'est comme si mon corps ne m'appartenait plus, que j'étais la foudre, le sol, les nuages et le reste". Cette expérience transformatrice lui fait comprendre que sa destination n'est pas tant un point géographique qu'un état d'être, une connexion profonde avec l'environnement.
Cette partie se termine sur sa contemplation du désert, où elle réfléchit sur le vide qui l'entoure et son adaptation constante à cet environnement hostile. Pour elle, c'est peut-être là la clé pour maintenir vivant son feu intérieur : éviter les habitudes et rester en perpétuelle adaptation.
4.2 - Horloge interne
Sarah Marquis révèle sa capacité innée à s'orienter sans instruments, arrivant à positionner naturellement les points cardinaux.
Elle souligne aussi combien il est important de comprendre et respecter son corps, notamment à travers le sommeil naturel, synchronisé avec les rythmes de la nature.
L'aventurière partage sa philosophie du bien-être basée sur l'équilibre et la connexion avec l'environnement. Elle encourage à faire des petits changements quotidiens : marcher consciemment, observer les nuages, toucher les arbres. "Le seul luxe que je vois est du 'temps'", note-elle.
Cette approche, elle l'a perfectionnée lors de son expédition australienne de 2002-2003, où pendant 17 mois, elle a survécu dans l'Outback, poussant les limites de ses capacités physiques et mentales. Pour elle, le mouvement est essentiel : "je ne pense pas, je vis !"
4.3 - Ma première rencontre avec Canis lupus chanco
Sarah Marquis évoque le rapport complexe des Mongols avec le loup (Canis lupus chanco), à la fois respecté et redouté.
Elle raconte comment elle brouille délibérément les pistes lorsque les nomades l'interrogent sur ses rencontres avec les loups, consciente que ces animaux sont traqués pour leurs organes, prisés en médecine traditionnelle.
4.4 - Ils hurlent
L'aventurière nous fait ensuite vivre une nuit magique près d'une formation rocheuse mystérieuse dans le désert. Réveillée à 4 heures du matin par des hurlements de loups autour de sa tente, elle savoure cet instant privilégié : "Je suis si chanceuse de vivre ce moment... Merci, merci". Elle découvre leur refuge dans ces rochers et décide de garder secrète sa localisation pour protéger ces "survivants" de la cupidité humaine.
4.5 - La longue nuit de Mandal-Oovo
Après dix jours dans le désert, Sarah Marquis fait halte dans un village où elle trouve un hébergement précaire. Une nuit terrifiante l'attend : des hommes ivres tentent d'enfoncer sa porte, tandis qu'elle se barricade avec une commode, son spray au poivre à portée de main. "La peur au ventre, je ne ferme pas l'œil de la nuit", confesse-t-elle.
4.6 - 80ème jour d’expédition
Au 80ème d'expédition, épuisée par les épreuves - attaques nocturnes, sable, manque de sommeil - elle atteint enfin son point de ravitaillement.
Malgré sa fatigue, elle savoure un dernier moment de contemplation du désert avant de retrouver Gregory, son chef d'expédition.
4.7 - Une dent plus tard…
Après un ravitaillement réconfortant avec Gregory, une infection dentaire fulgurante force Sarah Marquis à être évacuée.
Grâce au soutien de ses sponsors, elle se rend à Tokyo pour se faire soigner. "La douleur me mange le dessous des chaussettes", écrit-elle.
Le traitement s'étend sur six semaines, durant lesquelles elle fait la navette entre un chalet à Hakuba et la clinique. Ses sponsors lui apportent un soutien indéfectible face aux complications et aux extrapolations médiatiques. Au bout de ces six semaines, elle repart avec une seule obsession : reprendre sa marche.
Chapitre 5. Désert du Gobi - 2ème tentative
De retour en Mongolie après son traitement au Japon, Sarah Marquis prépare sa deuxième tentative de traversée du Gobi, cette fois en plein hiver avec des températures de -33°C.
Au marché local, elle s'équipe pour affronter le froid extrême : théière en aluminium pour faire fondre la neige, pétards contre les loups et peaux de mouton.
Elle fait fabriquer des guêtres spéciales dans un atelier de couture de la banlieue d'Ulaan Baatar, et reçoit sa nouvelle tente après des semaines d'attente et une taxe douanière conséquente.
L'aventurière repart du camp touristique où la beauté du désert hivernal la fascine : "J'étais déjà tombée amoureuse du Gobi en été mais là, ma préférence va à l'hiver". Cependant, les conditions s'avèrent rapidement extrêmes, avec des températures nocturnes atteignant -40°C. Face à ces conditions qui menacent sa tente, elle doit prendre une décision difficile : interrompre sa tentative.
Face à l'échec de sa deuxième tentative, Sarah Marquis adapte son parcours aux conditions climatiques. Elle décide de réorienter son expédition vers le sud de la Chine, prévoyant de remonter le pays au lieu de le descendre.
Pendant une nuit intense de préparation, elle coordonne ce changement avec son équipe en Suisse.
Chapitre 6. Chine
Au début du 6ème chapitre du livre "Sauvage par nature", une carte schématique illustre l'itinéraire de Sarah Marquis depuis Kunming jusqu'au Sichuan, en passant par la réserve des pandas et traversant le fleuve Yangtsé.
6.1 - Kunming – Yunnan, janvier 2011
À Kunming, ville bouillonnante de 3 millions d'habitants, Sarah Marquis retrouve par hasard Mathias et Véronique, un couple de cyclistes rencontré précédemment en Mongolie. Ces derniers partagent leur expérience de la traversée de la Chine et lui procurent de précieuses cartes routières avant de poursuivre leur route vers le sud.
6.2 - Chinoiseries, cochonneries… C’est le nouvel an !
L'aventurière s'enfonce dans la campagne chinoise, découvrant un monde rural fascinant mais profondément différent de la Mongolie. Elle apprend à communiquer par gestes avec les locaux et à se repérer sans cartes topographiques, interdites en Chine. "Je laisse les regards se poser sur moi, les chiens me renifler, les hommes silencieux et maigres me dévisager avec suspicion", raconte-t-elle.
Sa progression la mène à travers des villages où elle assiste aux célébrations sanglantes du Nouvel An chinois : partout, des cochons sont sacrifiés dans une atmosphère festive mais brutale. Poursuivant sa route, elle atteint le fleuve Yangtsé le 3 février 2011, jour du Nouvel An, franchissant un impressionnant pont suspendu qui marque son entrée dans la province du Sichuan.
6.3 - Noire est sa peau, long est son nez…
Après dix jours dans les montagnes du Sichuan, Sarah Marquis découvre un passage spectaculaire taillé dans la roche, qu'elle emprunte avec sa charrette malgré les difficultés. De l'autre côté, elle arrive dans un village où sa présence provoque une panique générale : femmes et enfants s'enfuient en hurlant.
Le soir, alors qu'elle installe son camp, elle reçoit la visite d'un groupe mené par un chef à l'apparence singulière : "sa peau est si foncée qu'elle s'approche d'un noir marron" et son nez long et effilé évoque plus les traits africains qu'asiatiques. Après un face-à-face silencieux, le groupe repart, mais utilise la fumée d'un feu de bois vert pour la forcer à déguerpir dans la nuit.
Cette expérience l'amène à découvrir la richesse des 56 minorités ethniques qui peuplent ces montagnes (Yi, Lisus, Dais, Bais, Miaos...). Au fil des semaines, elle établit des liens particuliers avec les femmes de ces communautés, appréciant leur élégance naturelle et leur authenticité. "D'un seul regard et sans jugement, elles m'ont toujours identifiée avec le dénominateur qui nous unit : nous les 'femmes'", observe-t-elle.
Lors d'un marché dans son dernier village d'altitude, Sarah s'immerge dans l'atmosphère colorée des costumes traditionnels, observant notamment une jeune femme aux longs cheveux noirs préparée comme une princesse.
L'aventurière partage aussi ses réflexions sur son rapport à la nourriture, développant une approche en "trois dimensions" (avant, pendant, après) et évoquant ses expériences de la faim qui l'ont amenée à des hallucinations olfactives pendant ses expéditions.
6.4 – Une Chine hostile
Arrivée à Nina, Sarah Marquis découvre une Chine Han hostile, où une femme seule est considérée comme une prostituée. Elle est constamment surveillée et photographiée par des inconnus.
La marcheuse est bouleversée par la pollution extrême et la cruauté envers les animaux qu'elle observe quotidiennement : "Les cris de douleur de ces animaux à l'agonie me hantent encore", déclare-t-elle.
Un soir, elle fait une rencontre qui semble d'abord positive avec des écoliers souriants, mais qui se termine par le vol de son BlackBerry. Plus tard dans la nuit, deux hommes lui rapportent mystérieusement son téléphone, prétendant être des professeurs. Le lendemain, elle découvre qu'il s'agissait en réalité de paysans et que toutes ses photos de Chine ont été effacées de l'appareil, ne laissant que celles de Mongolie. Cette expérience révèle la surveillance subtile mais omniprésente exercée sur les étrangers dans cette région.
6.5 - Des schlurps et des splash…
Sarah Marquis décrit avec un humour grinçant les habitudes quotidiennes des Chinois dans les provinces reculées : leurs rituels matinaux bruyants, leurs crachats expressifs (qui, sur les murs des restaurants, signifient paradoxalement l'appréciation du repas), et le fameux "schlurp" qui accompagne la consommation de leurs bouillons.
L'aventurière compare les différences culturelles entre l'Amérique du Sud, où la corruption se réglait avec simplicité et chaleur humaine, et l'Asie, caractérisée par le principe de "garder la face". Elle développe une théorie intéressante sur la difficulté des Chinois à comprendre ses gestes mimés : leur écriture en caractères représentant des scènes complètes les empêcherait de percevoir des gestes isolés.
En voyage vers une réserve de pandas, elle vit une mésaventure avec une vieille femme qui inonde délibérément sa tente en détournant un canal d'irrigation. Forcée de continuer avec un équipement trempé par des températures négatives, elle trouve refuge dans une forêt de pins à 2500m d'altitude. Cette pause lui permet de sécher ses affaires et de réparer son réchaud, retrouvant un moment de paix.
Dans la réserve, elle fait une rencontre exceptionnelle avec un panda roux mais se trouve rapidement sous surveillance. Des agents spéciaux inspectent son campement, et elle est finalement arrêtée par des hommes en blouson noir. La voyageuse apprend plus tard que son arrestation était liée à l'immolation d'un moine dans un temple proche, les autorités voulant éviter la présence de témoins occidentaux.
Sarah Marquis est expulsée de Chine : elle a cinq jours pour quitter le pays. Dans une course contre la montre, elle rejoint Beijing via Chengdu, obtient un visa pour la Mongolie grâce à une coordination minutieuse entre son équipe et l'ambassade suisse, et s'envole pour Ulaan-Baator. "J'apprendrai plus tard que mon arrestation était d'ordre préventif", indique-t-elle, en révélant la tension politique sous-jacente dans cette région où "les moines s'immolent depuis des années en signe de protestation contre l'oppression du régime".
Chapitre 7. Désert du Gobi – 3ème tentative
7.1 - Début mai 2011 – Je repars
De retour dans le désert du Gobi pour sa troisième tentative, Sarah Marquis retrouve Degi, une employée du camp touristique qui l'accueille selon les traditions d'hospitalité mongoles. Dans ce pays le moins peuplé au monde (1,8 habitant/km²), l'hospitalité est une question de survie, à la bonne fortune des voyageurs qui n’ont alors aucun mal à trouver un refuge chaque soir.
Les deux femmes partagent un long moment de complicité autour d'un thé. L'aventurière apprécie particulièrement de pouvoir avoir une conversation approfondie en anglais, qui pour une fois dépasse les habituelles questions sur son âge et son statut marital. Degi devient sa "conseillère culturelle" et l'aide à décoder certaines mésaventures, comme l'incident du "fantôme" : un automobiliste terrifié à sa vue, la prenant pour le spectre d'une femme blanche errante selon une légende locale.
Sarah Marquis reprend ensuite sa route vers le sud, en direction du Parc national du Gobi Gurvan Saikhan. Dans ce paysage lunaire de dunes dures, elle fait une rencontre insolite avec un loup au pelage d'hiver gris souris, qui joue à cache-cache avec elle. Le climat devient plus rude, avec de la neige sur les montagnes et un vent violent qui l'oblige à chercher des dépressions dans le terrain pour s'abriter.
La marcheuse relate aussi sa rencontre cocasse avec un nomade malade qui lui fait des avances, avant de tenter de récupérer son chien qu'elle avait pris en amitié. Dans sa quête d'eau, elle découvre des trésors cachés : pétroglyphes, gazelles, mouflons et une riche biodiversité qui la fascine, malgré les conditions physiques éprouvantes.
7.2 - Un Kindle sans les mots…
Sarah Marquis raconte ensuite avec humour la mésaventure de son cadeau d'anniversaire : un Kindle vide de tout livre que son chef d'expédition lui apporte, et qui finira par fondre sous les températures extrêmes du désert. "À chaque fois que j'ai essayé d'améliorer ma vie de nomade, cela n'a pas fonctionné", constate-t-elle avec philosophie.
7.3 - Les pieds au chaud…
Mieux équipée pour cette troisième tentative, l’exploratrice affronte les célèbres dunes chantantes du Gobi, hautes de 300 mètres, dont le sable produit un vrombissement caractéristique au contact du vent. Il lui faut cinq jours pour les franchir, tirant sa charrette dans le sable profond, tout en admirant les chameaux qui trottinent avec aisance sur ces mêmes dunes.
Sarah fait de nouvelles rencontres variées : un immense nid de vautours, des géologues chinois en exploration clandestine, et les scientifiques d'un centre de recherche sur les léopards des neiges, avec qui elle participe à la pose de caméras. Elle vit aussi une brève tension avec des gardes-frontières, alertés par un mystérieux informateur local.
La traversée se termine par la partie la plus sauvage de son expédition, où elle endure des températures de 50°C et une déshydratation constante.
"Ce désert qui s'était refusé à moi par deux fois déjà... il acceptera mes pas à la troisième", lâche-t-elle en atteignant enfin Ekhiin Gol, sous le regard stupéfait des habitants.
Chapitre 8. Sibérie
Au début du 8ème chapitre du livre "Sauvage par nature", une carte montre l'itinéraire de Sarah Marquis en Sibérie, du lac Baïkal jusqu'à la frontière mongole, avec mention de la mort de son chien D'Joe le 28 octobre 2011.
Après avoir obtenu son visa russe, Sarah Marquis arrive à Irkoutsk où elle déjoue avec humour une tentative d'extorsion à la douane.
8.1 - Le 1er août 2011, Port Baïkal
Au bord du lac Baïkal, elle entame une progression périlleuse le long des voies ferrées, traversant 39 tunnels et 248 ponts. Elle découvre une nature majestueuse peuplée de phoques d'eau douce uniques au monde, les nerpas.
8.2 - Je sors d'un mauvais pas...
À Slyudyanka, elle fait face à une réalité plus sombre : pollution, pauvreté et danger. Grâce à l'aide de Natalia, son contact local, elle échappe à une tentative de vol et apprend à traverser rapidement les villages pour se réfugier dans la taïga. Cette forêt dense devient son refuge, malgré les nuées de moustiques et la présence d'ours.
8.3 - Mon D’Joe…
Sarah Marquis reçoit un SMS bouleversant concernant D'Joe, son chien resté en Suisse.
La santé de son fidèle compagnon s'est brutalement dégradée. Dans sa tente au cœur de la taïga, elle passe une nuit à sangloter avant de percevoir mystérieusement l'odeur caractéristique de son chien. D'Joe s'éteint moins d'une semaine plus tard.
La marcheuse atteint finalement Kyakhta, ville-frontière avec la Mongolie, jadis prospère grâce au commerce des fourrures et du thé. "Mission accomplie, la Sibérie est derrière moi", conclut-elle, avant de poursuivre son expédition vers le Laos.
Chapitre 9. Laos
Au début du 9ème chapitre du livre "Sauvage par nature", une carte retrace l'itinéraire de Sarah Marquis au Laos, de Botten à Packbeng, le long du fleuve Mekong. L’illustration indique deux incidents majeurs : une infection "dengue" lors de son trajet en canoë et une attaque nocturne par des trafiquants de drogue dans la jungle dense.
9.1 - Changement de décor et d'ambiance
En quittant la Chine pour le Laos, Sarah Marquis voit un changement radical.
L'atmosphère chaleureuse et accueillante du pays la frappe immédiatement : des visages souriants, des gestes discrets et bienveillants qui réchauffent son cœur éprouvé par son expérience chinoise. Elle observe la prédominance du bambou dans la culture locale, utilisé pour tout construire, des huttes aux outils.
Face à une jungle impénétrable, elle remarque que chaque habitant porte une machette à la ceinture et des tongs aux pieds. Sa première expérience culinaire laotienne la charme : on lui sert du riz cuit enveloppé dans une feuille de bananier, qu'elle savoure au bord de la route.
À Luang Namtha, ne voulant pas se contenter de marcher sur les routes, elle cherche une alternative pour explorer la jungle. Elle parvient à convaincre les locaux de lui louer un canoë en solo. Ce sera le début d'une nouvelle aventure sur la rivière Namtha.
9.2 - Les femmes aux pipes d’argent
Sarah Marquis rencontre les peuples des brumes, des tribus montagnardes vivant sur les crêtes. Elle découvre leur mode de vie authentique : femmes âgées fumant des pipes d'argent, cueillette de plantes sauvages et culture sur brûlis.
Ces rencontres sont empreintes d’une hospitalité touchante, malgré les différences culturelles évidentes.
9.3 - Un clic ou pas de clic !
La voyageuse fait le choix éthique de ne pas photographier ces peuples isolés, préférant garder une image mentale de ces moments authentiques.
Elle quitte finalement les montagnes pour rejoindre la route principale, en évitant habilement une zone interdite aux étrangers, avant d'atteindre le Mekong qui délimite la frontière avec la Thaïlande.
Chapitre 10. Thaïlande
Au début du chapitre 10 de "Sauvage par nature", une carte illustre le trajet effectué par Sarah Marquis à travers la Thaïlande, du Mekong jusqu'à Bangkok, en longeant la frontière birmane et passant par plusieurs villes importantes dont Chiang Mai.
10.1 - Accueil, convivialité et... infection parasitaire
À nouveau, la Thaïlande offre à Sarah Marquis un contexte totalement différent de ses expériences précédentes.
Elle découvre un pays accueillant où la convivialité et la générosité sont omniprésentes. Dans les montagnes, elle est fascinée par les temples et leurs bouddhas dorés, ainsi que par les moines méditant dans la forêt.
Épuisée, elle fait une halte à Chiang Mai où un diagnostic médical révèle une infestation parasitaire nécessitant un traitement intensif.
10.2 - Le riz à mes côtés
L'aventurière observe avec émerveillement le cycle complet du riz à travers son périple : de la plantation en Chine jusqu'au labourage en Thaïlande.
Elle décrit poétiquement les rizières en terrasses, où les buffles d'eau travaillent la terre boueuse. Ces paisibles créatures lui rappellent les vaches de son village natal :
"Ces scènes me rappellent le va-et-vient des vaches de mon village qui avaient le même horaire de sortie que les pendulaires encore endormis au volant de leur voiture. Ceux-ci pestant contre ces douces et lentes créatures que le bâton du fermier n’a jamais fait avancer plus vite… Ma mère a toujours trouvé cela rassurant, et à chaque fois que l’on était bloqués par les divers troupeaux qui traversaient notre petit village de cinq cents habitants, elle les observait avec émerveillement, comme si c’étaient des animaux exotiques. Pendant ce temps, à travers elle, j’apprenais peu à peu à voir au-delà des apparences."
10.3 - Ayutthaya-Wat Phu Khao Thong, le 6 mai 2012
Arrivant dans une région marquée par les inondations de 2011, Sarah Marquis atteint enfin le temple Phu Khao Thong.
Face à ce monument majestueux, elle laisse couler ses larmes d'émotion, réalisant qu'elle vient de traverser l'Asie à pied.
10.4 - Cargo, seule femme à bord
Seule femme parmi 22 membres d'équipage, Sarah rejoint l'Australie par cargo durant 13 jours de navigation. Un voyage symbolique qui lui rappelle tous ces migrants qui ont fait la traversée avant elle.
Chapitre 11. Australie du Nord
Une carte illustre l'itinéraire de Sarah Marquis en Australie du Nord, de Cairns à Darwin en passant par Alice Springs. Elle mentionne son arrivée par cargo à Brisbane après 13 jours en mer.
11.1 - Des larmes à l’odeur de café…
Le 28 mai 2012, Sarah Marquis débarque du cargo au port de Brisbane, aidée par un matelot philippin pour descendre ses lourds sacs qui contiennent sa charrette démontée.
Après avoir déposé ses affaires dans une pension, elle s'empresse de réaliser un rituel tant attendu : savourer enfin un véritable coffee latte. Pendant cinq heures, elle observe la foule depuis la terrasse d'un café, réalisant qu'elle peut enfin se fondre dans la masse, elle qui a passé deux ans à être dévisagée en Asie. "Je respire à nouveau, je suis parmi les miens" ressent-elle. Et pour la première fois en vingt ans, la voyageuse prend pleinement conscience de son appartenance à l'ethnie dite caucasienne.
À la banque, elle provoque l'incrédulité d'un jeune employé en lui annonçant son projet de marcher jusqu'à Darwin. Puis elle rejoint Cairns où elle prépare minutieusement son départ : nouveaux réservoirs d'eau, séances d'ostéopathie et massages pour son corps éprouvé.
L'accueil chaleureux des Australiens la touche profondément, en particulier celui de Rosy, la patronne de son hébergement qui accepte de garder une partie de son matériel, et de Georges, un chauffeur aborigène Yirrganydji qui la dépose à son point de départ en lui confiant que le bush la protégera.
Dès ses premiers pas dans cette nature familière, l'émotion la submerge : elle se sent enfin chez elle après deux ans en territoire hostile. La première nuit, exténuée tant physiquement qu'émotionnellement, elle fait un rêve prémonitoire de D'Joe, son chien décédé, sous forme d'un rapace prêt à s'envoler - ce sera la dernière fois qu'elle rêvera de lui.
Son parcours la mène dans des paysages variés où elle retrouve une solitude apaisante. Sur les hauteurs du Tablelands, elle vit une rencontre nocturne exceptionnelle avec un cassowary, le "roi de la rainforest", dont le cri puissant résonne dans la nuit. Dans les Misty Mountains, elle affronte l'humidité oppressante de la forêt tropicale, dormant chaque nuit au milieu de créatures invisibles, de sangsues et de serpents.
À Ravenshoe, sa quête pour retrouver un vieux chercheur d'or rencontré dix ans plus tôt la conduit dans des conversations animées avec les locaux. Une rencontre inattendue au bord d'un ruisseau avec un séduisant inconnu aux yeux bleus la confronte soudain à sa féminité longtemps mise en veille, provoquant un trouble qu'elle n'avait pas ressenti depuis des mois.
Le passage se termine sur son harmonie profonde avec la nature : ses journées deviennent une douce répétition où elle observe la faune, les termites, les fourmis. Cette immersion totale la conduit à une transformation intérieure : "la nature est rentrée en moi... Je suis elle, elle fait partie de moi". Cette connexion intense avec l'environnement marque l'aboutissement de ses deux années de marche.
11.2 - Queensland, le 16 juillet 2012
Sarah Marquis nous transporte ensuite au cœur du Queensland. Nous sommes en juillet 2012 quand Sarah trouve refuge sous un vieux pont. En s’installant alors dans le lit asséché de Crystal Creek, l'aventurière nous fait partager un moment de poésie : les grains de sable deviennent les narrateurs d'une histoire, lui murmurant les souvenirs d'une eau émeraude qui coulait autrefois.
Au fil des jours, l'exploratrice affronte des défis techniques et humains. Elle raconte comment sa charrette subit une avarie majeure, tous les rayons d'une roue se détendant simultanément. Une rencontre avec des chasseurs de cochons sauvages - qu'elle classe parmi les personnages les plus dangereux du bush - se transforme étonnamment en aide providentielle lorsqu'ils lui prêtent une clé à molette.
Cette panne la force à un détour imprévu par Normanton, où elle doit commander de nouvelles roues en Suisse. Sarah Marquis revient avec humour sur son retour temporaire à la civilisation à Cairns, "mes guêtres encore aux pieds, sans m'être lavée depuis des semaines".
De retour dans le bush, elle fait une rencontre surprenante avec Jonas, un jeune cycliste suisse qu'elle avait conseillé par mail avant son départ.
11.3 - Petits plaisirs et grande peur
L'aventurière nous dévoile ensuite ses petits plaisirs du quotidien, comme la dégustation minutieuse du nectar des fleurs de grevillea.
Cette partie de "Sauvage par nature" se termine sur une note qui fait froid dans le dos : des tirs mystérieux dans la nuit l’obligent à rester immobile jusqu'à l'aube. Le lendemain, elle découvre un campement de chasseurs de cochons sauvages, ce qui confirme ses craintes sur leur dangerosité : "Je vous l'avais bien dit, ils sont dangereux ces gars-là !" conclut-elle, avant de parcourir 33 kilomètres pour atteindre les chutes de Leichhardt.
11.4 - Serpent, poussière…
Dans cette dernière partie du chapitre 11 de "Sauvage par nature", Sarah Marquis nous plonge dans son périple à travers le Territoire du Nord australien. Quittant Burketown, la randonneuse s'engage dans une traversée exigeante de 483 kilomètres jusqu'à la prochaine communauté aborigène, soit plus de 16 jours de marche. Elle organise minutieusement ses ravitaillements, et demande à une amie de déposer un paquet de nourriture à mi-chemin, à Hells Gate.
Un matin du 29 août 2012, elle fait une rencontre stupéfiante : celle avec un python olive de près de 4 mètres. L'auteure décrit avec émerveillement la façon dont le serpent se dresse en forme de "Z", palpant l'air de sa langue. "Étrangement, je tombe en amour pour cette créature mystérieuse qui défie les lois du mouvement", écrit-elle, en se rappelant une fascination similaire lors de son expédition dix ans plus tôt.
Sarah Marquis poursuit sa route en territoire aborigène. Elle évite la communauté de Doomadgee. Une nuit, dissimulée sous un eucalyptus, elle entend des chevaux sauvages galoper avec frénésie et des aborigènes se bagarrer.
Sa solitude est interrompue par la rencontre d'un cow-boy au visage serein qui s'étonne de la voir seule dans le bush. Leur conversation révèle la sensibilité particulière de l'aventurière pour les détails infimes de la nature, comme sa curiosité envers un minuscule insecte gris jouant au mort.
Le long de sa route, elle doit relever des challenges quotidiens : trouver des points d'eau, éviter les serpents, supporter des températures avoisinant les 40°C. Un jour, elle découvre un green tree snake, actif en journée contrairement aux autres serpents australiens. Cette mésaventure lui rappelle l'importance d'être vigilante près des points d'eau, où la présence de grenouilles attire les serpents, qui à leur tour attirent les crocodiles.
11.5 - Le Nord sauvage
L'aventurière atteint les chutes de Leichhardt, un lieu impressionnant où se côtoient crocodiles marins et requins atteignant parfois 3,5 mètres. Elle y fait une rencontre touchante avec un chien noir portant un collier où il est écrit "Floraville". Ce moment de tendresse lui rappelle les massages qu'elle prodiguait à son fidèle D'Joe.
Dans sa progression à travers le Territoire du Nord, Sarah Marquis doit franchir des gués en restant vigilante. Elle dépeint comment les cow-boys d'autrefois utilisaient leurs fouets pour éloigner les crocodiles lors des traversées de rivières avec le bétail, une technique qui sauvait régulièrement des bêtes d'une mort certaine.
Son parcours la mène à Burketown, petit village de 200 habitants coincé entre les rivières Nicholson et Albert. C'est là qu'elle fait la connaissance de Peggy, une pêcheuse aveugle de 78 ans dont le courage et la joie de vivre l'inspirent profondément. Cette femme au corps fatigué mais aux yeux pleins d'étincelles de vie incarne pour l'auteure la résilience face aux épreuves.
Ce village isolé, menacé par les cyclones pendant la saison des pluies, devient le symbole d'une Australie en mutation : "L'Australie a tellement changé", observe Sarah Marquis, "il y a dix ans, on me considérait avec dégoût et incrédulité. Aujourd'hui on ne dit plus 'c'est impossible' à chaque fois que je raconte mon parcours... L'Australien s'est ouvert au monde pour le meilleur et pour le pire".
Chapitre 12. Australie du Sud
Une carte illustre le dernier tronçon du périple de Sarah Marquis en Australie, dessinant son parcours depuis Perth jusqu'à son "petit arbre" situé dans la plaine de Nullarbor, avec les coordonnées GPS précises de son point d'arrivée.
12.1 - Je passe par la case "docteur"
Bloquée à Perth par les pluies, Sarah Marquis fait face à un épuisement physique intense. Des analyses révèlent une carence en fer et une fatigue généralisée après deux ans et demi d'effort. Elle met en place un plan de récupération rigoureux : ostéopathie, massages et nutrition ciblée.
12.2 - Bibbulmun Track me revoilà
Après cet épisode de récupération, l'aventurière décide de repartir en suivant le Bibbulmun Track, un sentier de 1000 km qu'elle connaît bien.
"Je me réveille tôt, vers les 4 heures du matin, bien avant que le bush s’anime ; cela me permet de voir les kangourous qui s’extasient devant le lever du soleil, de surprendre dans les fourrés le blue wren. C’est un petit oiseau au pelage bleu turquoise. Je ne me lasse pas de voir, ou encore, plus important pour moi, de sentir la nature se réveiller. J’y puise l’énergie qui soigne mes blessures invisibles. Je veille à ce que ma marche s’accompagne de magnifiques rencontres animales. Ce qu’on néglige souvent, c’est l’aspect psychologique des choses, le lien entre le corps et l’esprit. Alors mes rencontres et la communion que j’ai avec la nature me nourrissent de manière différente. Soigner mon corps inclut aussi le psychique. (…) À toutes et à tous, je souhaite de faire un jour le Bibbulmun Track. Il n’y a pas de plus belle façon de découvrir ce pays."
12.3 - Un serpent et une plage turquoise
Un soir, elle rencontre un homme qui vit sur ce sentier. Il ne quitte ce sentier que pour voir son père et se ravitailler.
L'homme du sentier lui raconte une histoire étonnante : celle d'un serpent tigre occidental venimeux qu'il avait transporté à son insu dans son sac pendant trois jours après une nuit sur la plage de William Bay. Depuis, il ne dort plus qu'en tente.
Sarah poursuit son chemin jusqu'à Albany, où l'attend une surprise émouvante : la visite de sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis plus de deux ans. Ensemble, elles partagent des moments précieux, ponctuées d'aventures cocasses comme le vol des biscuits de sa mère par un kangourou.
12.4 - Deux pieds, un manche…
En ce début d'hiver austral, Sarah Marquis brave des conditions météorologiques difficiles sur la côte sud.
Les pluies incessantes et le froid marin mettent son corps à rude épreuve et provoquent des crampes dues à l'humidité. La situation s'aggrave quand le manche de sa charrette se brise. Elle est forcée de poursuivre avec un seul manche sur près de 250 kilomètres.
À Esperance, épuisée, elle trouve refuge dans un motel où elle se remet pendant deux jours. L'aventurière fait ensuite réparer sa charrette par un soudeur, mais la modification des manches perturbe sa posture habituelle, ce qui lui cause des douleurs musculaires intenses : "J'ai l'impression que j'ai été passée à tabac", souffle-t-elle.
Le retour du soleil lui apporte un réconfort inespéré, dévoilant une explosion de couleurs dans le bush. Sarah retrouve avec émotion les eucalyptus salmonophloia, ces arbres au tronc cuivré qu'elle avait découverts dix ans plus tôt. Malgré ses muscles douloureux, elle persévère et s'encourage chaque matin : "Je vais y arriver ! Je vais y arriver !"
Les derniers kilomètres sont particulièrement éprouvants. Un cow-boy rencontré plus tôt dans son périple la retrouve et l'aide à terminer son parcours en lui apportant nourriture et soutien.
Dans un final intense, Sarah atteint enfin son "petit arbre", celui sous lequel elle avait dormi lors de son expédition de 2002-2003 avec son chien D'Joe. "Je suis de retour, darling", murmure-t-elle en touchant l'écorce, laissant couler ses larmes d'émotion.
L'aventurière conclut son récit par une réflexion touchante : "Dire qu'un jour j'ai juste osé rêver de ce moment !"
Cette phrase finale résume toute la portée de son extraordinaire voyage de trois ans à travers l'Asie et l'Australie.
Cahier photos
En fin d'ouvrage, Sarah Marquis partage un recueil de clichés capturés tout au long de son périple.
Ces photographies témoignent des paysages extraordinaires, des rencontres authentiques et des moments clés qui ont jalonné sa traversée de la Mongolie, du désert de Gobi, de la Chine, de la Sibérie, du Laos, de la Thaïlande et de l'Australie.
Elles nous font ainsi revivre le récit de l’aventure hors norme de Sarah Marquis et constituent une véritable mémoire visuelle de cette folle traversée en solo de l’Asie en marchant.
Conclusion de "Sauvage par nature | De Sibérie en Australie, 3 ans de marche extrême en solitaire" de Sarah Marquis
Les quatre leçons clés qu'il faut retenir du livre "Sauvage par nature"
Leçon n°1 : La solitude choisie est une porte d’accès formidable vers la liberté intérieure et la redécouverte de soi
Dans son périple extrême, Sarah Marquis fait de la solitude non pas une épreuve mais une alliée précieuse.
L'exploratrice décrit, en effet, comment, loin de la frénésie sociale, elle a progressivement atteint un état de connexion profonde avec elle-même. Cette solitude délibérée lui permet de développer une acuité sensorielle hors du commun, d'entendre à nouveau sa voix intérieure et de renouer avec ses instincts primitifs.
Ne confie-t-elle pas "Plus je m'éloigne, plus je vois" en introduction ? Une phrase qui résume à merveille comment la distance avec le monde civilisé lui apporte paradoxalement une vision plus claire de l’essentiel.
Idée clé n°2 : La nature nous enseigne l'adaptation constante comme clé de survie et d'épanouissement
À travers ses innombrables défis - des tempêtes apocalyptiques du désert de Gobi aux forêts tropicales du Laos - Sarah Marquis fait face à l’imprévu à chaque instant. Mais plutôt que de subir, elle s’adapte. Et nous montre finalement que l'adaptation permanente est sans doute la meilleure réponse à l'adversité.
Qu’il s’agisse de trouver de l'eau dans des steppes arides, de dormir dans des tuyaux d'évacuation pour se protéger, ou de modifier complètement son itinéraire face aux conditions climatiques extrêmes, chaque difficulté devient une leçon, un obstacle, que l'aventurière transforme en opportunité d'apprentissage.
Mais pour elle, cette capacité d’adaptation constante est bien plus qu’une simple nécessité de survie : c’est un état d’esprit. "La clé pour maintenir vivant son feu intérieur", dit-elle. Une philosophie qui dépasse largement le cadre de l’aventure extrême mais résonne aussi avec nos propres défis du quotidien.
Idée clé n°3 : Notre corps recèle de capacités insoupçonnées qui ne demandent qu'à être éveillées
Le récit de Sarah Marquis révèle comment le corps humain, soumis à des conditions extrêmes, peut développer des capacités extraordinaires. L'aventurière raconte sa faculté innée à s'orienter sans instruments, sa résistance progressive aux températures extrêmes (de -40°C en Mongolie à +50°C dans le désert australien), et sa capacité à reconnaître instinctivement les plantes comestibles ou médicinales. Ce réveil des facultés primitives s'accompagne d'une transformation profonde : "La nature est rentrée en moi... Je suis elle, elle fait partie de moi", affirme-t-elle, décrivant une fusion qui transcende la simple adaptation physique.
Idée clé n°4 : Le dépassement de soi n'est pas une destination mais un voyage continu
Tout au long de son périple, Sarah Marquis nous montre finalement que le véritable accomplissement ne réside pas dans l'atteinte d'un objectif final mais plutôt dans la persévérance quotidienne face aux épreuves. Que l’exploit ne réside pas dans l’arrivée, mais dans chaque pas qui y mène.
S’encourager à voix haute pour traverser une plaine d’argile sous 40°C, recommencer après deux échecs dans le désert du Gobi, finir son périple avec un manche de charrette cassé... autant d’exemples où la force mentale triomphe de l’épuisement physique.
Son mantra, "Je vais y arriver ! Je vais y arriver !" devient un cri de résilience applicable à toutes les épreuves de la vie.
Qu'est-ce que la lecture de "Sauvage par nature" vous apportera ?
"Sauvage par nature" va au-delà du simple récit d'aventure : c'est une véritable plongée dans l'essence même de notre humanité.
En effet, en suivant les pas de Sarah Marquis, vous redécouvrirez les capacités insoupçonnées que nous portons tous en nous, mais que la vie moderne a endormies. Ce livre vous inspirera à reconsidérer votre rapport au temps, à l'effort et à la nature. Vous apprendrez à reconnaître la valeur du silence, de la lenteur et de l'observation pour mieux faire face aux défis quotidiens.
À travers les difficultés surmontées par l'auteure, vous développerez une nouvelle perspective sur vos propres obstacles. Sarah Marquis vous transmet ses techniques de survie physique et mentale qui, transposées dans votre vie quotidienne, deviendront de précieux outils de résilience. Ce récit vous rappellera aussi l'importance d'écouter vos instincts et de faire confiance à votre corps, dans un monde où nous sommes souvent déconnectés de nos sensations premières.
Pourquoi lire "Sauvage par nature" de Sarah Marquis ?
"Sauvage par nature" est un récit d’aventure captivant, immersif, un concentré d’adrénaline, d’émotions brutes et de liberté !
Au fil des pages, vous embarquez aux côtés de Sarah Marquis pour un voyage hors normes : des milliers de kilomètres à pied, en solo, au cœur des paysages les plus reculés de la planète. Mais au-delà de l’exploit physique, c’est une expérience intérieure puissante que vous vivrez à ses côtés.
Car ce livre ne se contente pas de raconter un périple. Il agit comme un miroir de nos aspirations les plus profondes, de nos propres désirs d’évasion, de simplicité, de retour à l’essentiel. Il éveille en nous des questions profondes, parfois oubliées : qu’est-ce que la vraie liberté ? Jusqu’où suis-je capable d’aller ? Quelle est ma vraie place dans ce monde ?
En partageant son incroyable périple et son cheminement, Sarah Marquis nous inspire aussi à adopter une relation plus consciente et harmonieuse avec notre environnement. À réapprendre à écouter la nature, à renouer avec nos instincts, à ralentir, à observer… et à nous recentrer.
Je recommande particulièrement ce livre à ceux qui :
Cherchent un souffle d'inspiration pour dépasser leurs propres limites, qu'elles soient géographiques ou mentales.
Ressentent le besoin de renouer avec la nature sauvage qui sommeille en eux, de se reconnecter à eux-mêmes, à l’essentiel.
Sentent au fond d’eux un appel à la liberté, à l’aventure, à l’authenticité.
"Sauvage par nature" est un livre qu’on ne lit pas seulement. On le vit. Et il continue de marcher avec nous, longtemps après avoir tourné la dernière page.
Points forts :
Un témoignage brut et authentique d'une aventure extrême à travers des territoires rarement explorés.
Une réflexion profonde et inspirante sur la relation entre l'humain moderne et son environnement naturel.
Des leçons de survie et d'adaptation qui peuvent s'appliquer dans notre quotidien.
Une écriture immersive qui nous fait vivre chaque étape du périple avec une intensité rare.
Points faibles :
Certains passages peuvent paraître un peu répétitifs, notamment dans la description des difficultés quotidiennes.
L'aspect technique de la préparation et de l'équipement aurait pu être davantage développé pour les lecteurs intéressés par la pratique de la randonnée extrême.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu "Sauvage par nature"? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Sarah Marquis "Sauvage par nature"
Visitez Amazon afin d'acheter le livre de Sarah Marquis "Sauvage par nature"
 ]]>
]]>Résumé de "La désobéissance civile" de Henry David Thoreau : dans ce manifeste qui traite des rapports entre l'individu et l'État, le philosophe naturaliste Henry David Thoreau pose les fondements de la désobéissance civile comme acte de résistance morale face à un gouvernement injuste. Il défend ainsi le droit et le devoir de désobéir aux lois infondées ou abusives au nom de la liberté de conscience.
Par Henry David Thoreau, 1ère édition 1849 (sous le titre original "Resistance to Civil Government"), cette réédition date de 2022, 60 pages.
Titre original : "On the Duty of Civil Disobedience"
Chronique et résumé de "La désobéissance civile" de Henry David Thoreau
"La désobéissance civile" est un court essai philosophique et politique du philosophe américain Henry David Thoreau. Dans cet ouvrage, l’auteur partage sa réflexion sur le rapport entre l'individu et l'État, notamment à travers le prisme de la désobéissance civile comme acte moral face à un gouvernement injuste.
L’ouvrage ne comporte ni chapitre ni partie, mais pour le résumer, nous le découperons en 5 sections. Ce découpage suit la progression logique de l'argumentation d’Henry David Thoreau, depuis sa vision critique du gouvernement jusqu'à celle d'un État idéal.
- Critique du gouvernement et réflexion sur sa légitimité
Dans la première partie de "La désobéissance civile", Henry David Thoreau expose sa vision critique du gouvernement et imagine un État idéal.
Il commence par affirmer son adhésion à la maxime selon laquelle "le gouvernement le meilleur est celui qui gouverne le moins", allant même jusqu'à suggérer qu'un gouvernement qui ne gouvernerait pas du tout serait l'idéal. Pour lui, le gouvernement n'est qu'un outil, une simple "utilité" qu’il juge souvent inefficace.
Henry David Thoreau émet trois critiques majeures à l’encontre des gouvernements :
L'abus de pouvoir : le gouvernement, censé être un intermédiaire au service du peuple, est, selon lui, facilement détourné de sa mission (Thoreau prend pour exemple la guerre du Mexique, qu’il considère comme une dérive autoritaire).
Le manque d'initiative : le philosophe reproche au gouvernement de ne jamais être à l’origine du progrès, se contentant de réagir au lieu d’agir.
L'obstruction au progrès : enfin, selon Henry David Thoreau, le gouvernement met souvent des "bâtons dans les roues" au développement naturel en imposant des obstacles inutiles.
Néanmoins, Henry David Thoreau ne se revendique pas anarchiste. En effet, il ne réclame pas la disparition du gouvernement, mais plaide plutôt pour "un meilleur gouvernement"., plus juste et en harmonie avec les principes moraux.
Le philosophe termine en appelant chaque citoyen à réfléchir au type de gouvernement qui mérite véritablement son respect. Il incite ainsi à une participation active et réfléchie à la vie civique.
- La responsabilité morale de l'individu
2.1 - Discussion sur le devoir de l'individu envers sa conscience vs envers l'État
Dans la suite de son argumentaire, Henry David Thoreau approfondit la relation entre l'individu et l'État, en particulier sur la question de la conscience morale face à l'autorité.
L'auteur commence par remettre en question le principe de la règle de la majorité. Selon lui, ce système n'est pas fondé sur la justice mais sur la simple force du nombre. La vraie question, écrit-il, est de savoir s’il ne pourrait pas plutôt exister un gouvernement dans lequel "ce ne seraient pas les majorités qui trancheraient du bien ou du mal, mais la conscience".
Car Henry David Thoreau croit en un principe qu’il juge fondamental : l'homme doit être guidé par sa conscience même si cela implique de s’opposer à l’autorité établie. Pour lui, cette responsabilité morale prime sur toute obligation envers l’État.
2.2 - Critique de la soumission aveugle à l'autorité
Pour illustrer sa réflexion quant au devoir de chacun qui devrait être guidé par sa conscience plutôt que par l’État, l’auteur de "La désobéissance civile" critique vivement le comportement des militaires qui agissent contre leur conscience. Il les assimile à des "machines avec leur corps".
Aussi, le philosophe distingue trois types de serviteurs de l'État :
Ceux qui servent avec leur corps (soldats, policiers).
Ceux qui servent avec leur intellect (législateurs, fonctionnaires).
Une élite qui sert avec sa conscience et finit souvent par résister à l'État.
Il conclut en observant que paradoxalement, "celui qui se voue corps et âme à ses semblables passe à leurs yeux pour un bon à rien, un égoïste, mais celui qui ne leur voue qu’une parcelle de lui-même est salué des titres de bienfaiteur et philanthrope."
- La résistance à l'injustice
Dans la suite de son ouvrage "La désobéissance civile", Henry David Thoreau développe une réflexion sur la résistance face à l'injustice, particulièrement dans le contexte de l'esclavage et de la guerre du Mexique, deux enjeux majeurs de son époque.
3.1 - La nécessité de se dissocier d'un gouvernement injuste
L'auteur affirme qu’il est moralement impossible de s’associer à un gouvernement qui tolère l’injustice, qualifiant au passage le gouvernement américain de "gouvernement de l’esclave".
Il reconnaît donc le droit universel à la révolution, c’est-à-dire "le droit de refuser fidélité et allégeance au gouvernement et le droit de lui résister quand sa tyrannie ou son incapacité sont notoires et intolérables".
Pour appuyer son propos, Henry David Thoreau compare la situation de son époque à celle de la Révolution américaine de 1775. Il souligne qu’à cette époque, l'esclavage d'une partie de la population et la guerre injuste contre le Mexique étaient des maux bien plus graves que les simples taxes sur les marchandises qui avaient provoqué la révolte contre l’Angleterre.
3.2 - La critique de l'opportunisme moral
Henry David Thoreau s'oppose vigoureusement à l’approche opportuniste défendue par Paley, selon laquelle l’obéissance civile devrait être basée sur un calcul coût-bénéfice. Pour Thoreau, certains principes moraux sont absolus et ne peuvent être compromis.
Il illustre son point de vue avec l’exemple d’une planche injustement arrachée à un homme qui se noie : rendre justice doit ici primer, même si cela implique de risquer sa propre vie, lance-t-il.
Dans cette même idée, Thoreau déclare avec force que "un peuple doit cesser de maintenir l’esclavage et de mener la guerre au Mexique, même au prix de son existence nationale".
Il critique ensuite particulièrement le Massachusetts, qu’il accuse de privilégier le commerce au détriment de l’humanité, mettant ainsi en lumière le conflit entre intérêts économiques et valeurs morales.
3.3 - L'action contre l'inaction
L'auteur pointe du doigt l'hypocrisie de ceux qui s'opposent en principe à l'esclavage mais n'agissent pas concrètement. Il observe qu'"il y a 999 défenseurs de la vertu pour un seul homme vertueux".
Henry David Thoreau critique particulièrement :
La passivité des citoyens qui se contentent de voter sans agir véritablement.
L'inefficacité du système démocratique traditionnel où le vote devient un simple jeu sans réel impact.
La subordination des questions morales aux intérêts économiques et au libre-échange.
L'attitude des "Membres Affiliés" qui préfèrent préserver leur sécurité personnelle plutôt que de défendre la justice.
3.4 - L'appel à la désobéissance active
Henry David Thoreau plaide avec ferveur pour une résistance active et immédiate face aux lois injustes.
Il rejette catégoriquement l'idée d'attendre que la majorité soit convaincue, arguant que "seul peut hâter l'abolition de l'esclavage celui qui, par son vote, affirme sa propre liberté".
Pour lui, toute action fondée sur un principe moral est, par essence, révolutionnaire. Elle ne se limite pas à transformer les institutions : elle modifie également les relations humaines et l’individu lui-même.
Thoreau critique sévèrement ceux qui dénoncent verbalement l’injustice tout en la soutenant indirectement, en payant des impôts par exemple, ou en obéissant passivement aux lois qu’ils réprouvent.
3.5 - La prison comme lieu de résistance
L'auteur conclut cette partie en développant plusieurs idées.
Ainsi, Henry David Thoreau :
Affirme que "sous un gouvernement qui emprisonne quiconque injustement, la véritable place d'un homme juste est aussi en prison".
Prône une forme de révolution pacifique pour s’opposer aux lois injustes à travers le refus de payer les impôts et la désobéissance civile active.
Soutient qu’un seul individu agissant en accord avec sa conscience peut avoir un impact bien plus grand qu’une majorité passive. Cette conviction culmine dans cette déclaration provocante qu’il adresse aux fonctionnaires complices du système : "Si vous voulez vraiment faire quelque chose, démissionnez !"
Partage une note profondément morale, dénonçant une "effusion de sang" non physique mais morale : "quand la conscience est blessée" écrit Thoreau. Une telle blessure, poursuit-il, tue "la dignité et l’immortalité véritable de l’être humain". Elle représente la plus grave des violences. Et c'est bien ce type de sang que l'essayiste dit voir couler dans la société de son époque.
- L'expérience personnelle de l'emprisonnement
4.1 - La valeur morale de la pauvreté
Dans ce passage, Henry David Thoreau partage ses idées sur la relation entre richesse et vertu morale.
L'auteur explique d’abord pourquoi, lui, préfère l'emprisonnement à la saisie de ses biens. Puis, il fait observer que les véritables opposants moraux à l'État sont souvent les plus pauvres, car ils ne consacrent pas leur vie à l'accumulation de richesses.
Selon lui, "plus on a d'argent, moins on a de vertu". Et l’argent corrompt de deux façons principales :
Il permet d’échapper aux vraies questions morales.
Il crée une dépendance vis-à-vis de l’État, qui soutient cet enrichissement.
L'auteur de "La désobéissance civile" fait enfin référence à l'enseignement du Christ sur l'impôt, qui suggère que ceux qui bénéficient du système de Jules César doivent aussi en accepter ses obligations. l'impôt, qui suggère que ceux qui profitent du système de Jules César doivent aussi en accepter ses obligations.
4.2 - Le conflit avec l'État et ses institutions
Dans cette partie de "La désobéissance civile", Henry David Thoreau analyse les tensions entre l'individu et les institutions étatiques.
Le philosophe fait d’abord remarquer que même ses concitoyens les plus "libres" restent enchaînés à l'État par deux grandes craintes :
La peur de perdre la protection gouvernementale.
La peur des conséquences matérielles de la désobéissance.
Il partage ensuite ses propres expériences de désobéissance civile :
Son acte de désobéissance face à la taxe d'Église qu’il a refusé de payer pour un pasteur dont il ne suivait pas les sermons.
"Voici quelques années, l’État vint me requérir au nom de l’Église de payer une certaine somme pour l’entretien d’un pasteur dont, au contraire de mon père, je ne suivais jamais les sermons. "Payez, disait-il, ou vous êtes sous les verrous." Je refusai de payer. Malheureusement, quelqu’un d’autre crut bon de le faire pour moi. Je ne voyais pas pourquoi on devait imposer au maître d’école l’entretien du prêtre et pas au prêtre, celui du maître d’école, car je n’étais pas payé par l’État. Je gagnais ma vie par cotisations volontaires. Je ne voyais pas pourquoi mon établissement ne présenterait pas aussi sa feuille d’impôts en faisant appuyer ses exigences par l’État à l’imitation de l’Église."
Cette expérience le conduisit à une déclaration formelle de non-appartenance à cette institution à laquelle il n'a pas choisi d'adhérer :
"À la prière du Conseil Municipal, je voulus bien condescendre à coucher par écrit la déclaration suivante : "Par le présent acte, je, soussigné Henry Thoreau, déclare ne pas vouloir être tenu pour membre d’une société constituée à laquelle je n’ai pas adhéré." Je confiai cette lettre au greffier qui l’a toujours ; l’État ainsi informé que je ne souhaitais pas être tenu pour membre de cette Église, n’a jamais depuis lors réitéré semblables exigences, tout en insistant quand même sur la validité de sa présomption initiale. Si j’avais pu nommer toutes les Sociétés, j’aurais signé mon retrait de chacune d’elles, là où je n’avais jamais signé mon adhésion, mais je ne savais où me procurer une liste complète."
Son refus de payer la capitation qui lui valut son emprisonnement pour non-paiement d'impôts
Henry David Thoreau insiste sur l’importance de l’autonomie morale. Il lance : "Il m'en coûte moins d'encourir la sanction de désobéissance à l'État qu'il ne m'en coûterait de lui obéir". Ainsi, pour lui, la liberté de conscience vaut plus que le confort matériel.
Enfin, le philosophe cite Confucius pour soutenir que la richesse devient honteuse sous un gouvernement injuste et ainsi renforcer son appel à la résistance contre les institutions oppressives.
4.3 - La méditation en prison
Dans ce passage introspectif, Henry David Thoreau transforme son emprisonnement pour non-paiement d'impôt en une réflexion profonde sur la nature du pouvoir et de la liberté.
Face aux murs épais de sa cellule, l'auteur s'indigne de la bêtise d'une institution qui réduit l'homme à sa simple dimension physique. Il écrit ce qu’il pensait alors : "si un rempart de pierre s'élevait entre moi et mes concitoyens, il s'en élevait un autre, bien plus difficile à escalader ou à percer, entre eux et la liberté".
Mais le penseur renverse la situation en affirmant que l'emprisonnement du corps ne peut rien contre la liberté de l'esprit.
Il termine par une critique acerbe de l’État, qu’il dépeint comme une entité peureuse et maladroite. Incapable d’atteindre les pensées de l’homme, l’État ne peut alors que s’en prendre à son corps.
4.4 - La dignité face à la contrainte physique
Henry David Thoreau affirme ensuite la supériorité de la conscience individuelle sur la force brute de l'État. Il déclare : "Je ne suis pas né pour qu'on me force. Je veux respirer à ma guise". Aussi, pour lui, l'État ne possède qu'une supériorité physique, aucune autorité morale ou intellectuelle.
Pour faire comprendre son idée, l’auteur de "La désobéissance civile" compare l'homme à une plante qui doit suivre sa propre nature pour prospérer : comme le gland et la châtaigne qui poussent selon leurs propres lois, chaque individu doit vivre selon sa conscience, même face à la contrainte sociale. Il refuse catégoriquement d'être "responsable du bon fonctionnement de la machine sociale". La dignité de l’homme réside dans son autonomie morale et intellectuelle.
4.5 - Le récit de la nuit en prison d'Henry David Thoreau
Cette partie du livre "La désobéissance civile" nous livre un témoignage vivant du séjour d’Henry David Thoreau en prison. Pour le philosophe, cette incarcération s’est transformé en une expérience d'observation sociale et de réflexion intérieure.
L'atmosphère de la prison est dépeinte par l’auteur avec un mélange de curiosité et de détachement. Il décrit la routine carcérale, ses codétenus, et particulièrement son compagnon de cellule, accusé d'avoir accidentellement incendié une grange. Il note avec ironie que ce dernier "se sentait chez lui et, satisfait d'être nourri et logé gratis, il s'estimait fort bien traité".
Aussi, Henry David Thoreau découvre, dans la prison, une micro-société avec ses traditions bien à elle, comprenant :
Des tentatives d'évasion minutieusement planifiées.
Des poèmes composés par les prisonniers.
Des histoires qui ne franchissent jamais les murs.
La nuit passée en prison, quant à elle, devient une expérience presque onirique : "c'était voyager dans un lointain pays" confie-t-il. Cette expérience carcérale lui montre sa ville natale sous un jour nouveau et "moyenâgeux".
De ces observations, l'auteur conclut que la prison dévoile, en fait, une face cachée des institutions de sa société : elle révèle leur fonctionnement à la fois oppressant et marqué par les inégalités et les absurdités de la société.
4.6 - Les leçons de l'emprisonnement
Pour finir, Henry David Thoreau décrit comment cette brève incarcération a profondément modifié la perception qu’il avait de sa communauté.
L'auteur commence par quelques observations sur la routine carcérale : le petit-déjeuner servi dans des gamelles, les conseils de son compagnon de cellule sur la conservation du pain, le travail aux champs des prisonniers.
Mais la véritable transformation se produit après sa libération. Le philosophe réalise alors que ses concitoyens vivent dans une autre forme d'emprisonnement : une prison morale.
Il pointe les points suivants :
Leur amitié est superficielle, "que pour la belle saison".
Ces derniers sont prisonniers de "leurs préjugés et leurs superstitions".
Ils se contentent d'une adhésion de façade à la morale, une "observance de surface" dit-il.
Le récit se termine sur une note d'ironie : lorsqu’il retrouve sa liberté, Henry David Thoreau reprend sa vie normale. Et alors qu’il cueille des airelles sur une colline, il remarque avec humour qu’"on ne voit l'État nulle part". Il suggère ainsi que la vraie liberté existe en dehors des structures étatiques.
- Conclusion et vision d'un État idéal
Dans cette conclusion, Henry David Thoreau expose sa vision d’un État idéal tout en revenant sur sa position personnelle à propos de la désobéissance civile. Il dresse alors une synthèse brillante de sa philosophie politique.
5.1 - La nuance dans la résistance
Henry David Thoreau commence ici par clarifier qu'il ne refuse pas tous les impôts. Il accepte de payer la taxe de voirie et de contribuer à l'éducation, car son but n'est pas une opposition systématique mais une désobéissance réfléchie et ciblée.
Comme il le précise : "Je désire simplement refuser obéissance à l'État, me retirer et m'en désolidariser d'une manière effective". Pour lui, ce n'est pas tant l'argent qui pose problème que l'usage qui en est fait et surtout, les implications morales de l'obéissance qu'il symbolise.
Sa démarche n’est donc pas une simple révolte, mais un acte profondément ancré dans une éthique personnelle et une réflexion sur la justice.
5.2 - La réflexion sur la résistance collective
L’auteur de "La désobéissance civile" analyse ensuite en détail les différentes réactions face à la désobéissance civile.
Il s’en prend aux individus qui paient leurs impôts par solidarité avec l’État ou par un souci mal placé pour le contribuable.
Selon lui, la force du nombre ne justifie pas l'injustice, même quand elle s'exprime sans hostilité.
Thoreau met en garde contre la tentation de céder à la pression sociale, qu’il compare à des phénomènes naturels tels que "la soif et la faim, les vents et les marées". Cependant, il insiste sur le fait qu’à la différence des forces naturelles, la pression sociale, elle, peut être résistée car elle émane d'êtres humains dotés de raison et capables de réflexion morale.
5.3 - La critique des institutions et des réformateurs
L'auteur de "La désobéissance civile" fustige ici les institutions et leurs défenseurs, particulièrement Webster, qu'il décrit comme un simple "Défenseur de la Constitution" plutôt qu'un véritable penseur.
L’essayiste déplore l'absence, en Amérique, d'un "homme doué d'un génie de législateur", capable de transcender les enjeux purement politiques pour aborder les véritables questions morales.
Thoreau cible également les réformateurs, qu’il accuse de manquer de perspective. Selon lui, ils sont si profondément enracinés dans les structures qu’ils cherchent à changer qu’ils ne parviennent pas à les analyser objectivement. Il les décrit, en effet, comme "si bien enfermés dans leurs institutions", qu'ils sont incapables de penser au-delà du système qu’ils tentent de réformer.
5.4 - La vision d'un État idéal
Henry David Thoreau conclut en esquissant sa vision d'un État véritablement libre et éclairé. Pour lui, trois conditions essentielles doivent être remplies :
La reconnaissance d'un pouvoir individuel supérieur à celui de l'État.
Le respect de l'individu comme base du gouvernement.
L'acceptation que certains citoyens puissent "vivre en marge, sans se mêler des affaires du gouvernement".
L’auteur voit l'évolution historique du gouvernement - de la monarchie absolue à la démocratie - comme un progrès vers un plus grand respect de l'individu.
Cependant, il ne considère pas la démocratie comme l'aboutissement final de cette évolution, mais comme une étape vers un État plus parfait.
Il termine sur une note d'espoir, imaginant un système étatique dans lequel la liberté individuelle serait pleinement respectée tout en maintenant les liens sociaux essentiels. Pour Henry David Thoreau, c'est dans cette direction que doit évoluer la démocratie : vers une reconnaissance toujours plus grande des droits individuels.
Ainsi, cette conclusion résonne comme un manifeste pour une nouvelle forme de gouvernement qui ne serait pas fondée sur la contrainte mais sur le respect mutuel entre l'État et les citoyens, chacun conservant son autonomie morale.
Conclusion de "La désobéissance civile" de Henry David Thoreau
Trois grandes idées à retenir de "La Désobéissance civile" d’Henry David Thoreau
Idée n°1 : La conscience individuelle prime sur l'autorité de l'État
Henry David Thoreau affirme que l’obéissance aux lois injustes est moralement inacceptable. Il soutient que la conscience individuelle doit guider l’action politique, au-delà même des principes démocratiques de la règle majoritaire.
Idée n°2 : La résistance non-violente constitue une arme politique efficace capable de transformer la société
À travers son expérience d'emprisonnement, Henry David Thoreau démontre comment le refus pacifique d'obéir aux lois injustes peut ébranler les fondements d'un système oppressif. En renonçant à payer ses impôts, il prouve qu'une action individuelle fondée sur des principes moraux peut avoir un impact significatif sur la société.
Idée n°3 : L'État doit reconnaître la primauté des droits individuels
La vision de Thoreau d'un État idéal, dans lequel le pouvoir individuel serait reconnu comme supérieur à celui du gouvernement, préfigure les évolutions modernes tendant vers une plus grande protection des libertés individuelles.
Pourquoi lire "La désobéissance civile" ?
"La désobéissance civile" est ouvrage philosophique qui vous invite à repenser votre rapport à l'autorité et vos responsabilités en tant que citoyen.
Aussi, ce livre vous aidera à développer une réflexion critique sur les institutions et fera découvrir des outils concrets pour résister pacifiquement à l’injustice.
Les arguments de Thoreau, d’une clarté et d’une force remarquables, résonnent particulièrement aujourd’hui, à une époque où les questions de justice sociale et de responsabilité individuelle sont au cœur des débats contemporains.
Je recommande vivement la lecture de "La désobéissance civile" pour son impact intellectuel, mais aussi pour son influence considérable sur les mouvements de résistance pacifique qui ont façonné notre monde moderne.
Points forts :
Une réflexion philosophique passionnante sur la relation entre morale individuelle et autorité étatique.
Un témoignage personnel qui donne corps aux principes théoriques.
L'influence historique majeure du concept de désobéissance civile de Thoreau sur les mouvements de résistance non-violente.
Une pertinence intacte pour les enjeux contemporains.
Points faibles :
Une vision parfois radicale du rôle de l'État qui peut paraître utopique.
Un contexte historique (esclavage, guerre du Mexique) qui peut sembler daté.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu "La désobéissance civile"? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin d'acheter le livre de Henry David Thoreau "La désobéissance civile"
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Henry David Thoreau "La désobéissance civile"
 ]]>
]]>Résumé de "Du burnout à digital nomade" de Stéphanie Desquerre : à travers un témoignage authentique et inspirant, Stéphanie Desquerre raconte comment elle a transformé son burnout vécu en Nouvelle-Zélande en une opportunité de renaissance. En combinant développement personnel, méditation et nomadisme digital, elle montre qu’il est possible de faire d’une dépression ou crise existentielle un véritable catalyseur de changement et de sens.
Par Stéphanie Desquerre, 2019, 182 pages.
Titre anglophone : "From burnout to digital nomad"
Chronique et résumé de "Du burnout à digital nomade | Comment faire de la dépression un outil puissant de transformation" de Stéphanie Desquerre
Préambule
Dans ce préambule, l’auteure, Stéphanie Desquerre présente son ouvrage "Du burnout à digital nomade" comme un témoignage brut, nourri par le journal intime qu’elle a tenu au fil des jours de son burnout. Elle souligne que ce livre est accessible à tous et vise à encourager une transformation intérieure et une meilleure connaissance de soi.
L'auteure prévient : son récit, marqué de répétitions et d'imperfections, reflète fidèlement la réalité d'un processus de guérison progressif. Si devenir digital nomade a été sa solution personnelle pour retrouver du sens, chacun doit trouver sa propre voie vers l’épanouissement.
Elle termine ce préambule en insistant sur un point important : le burnout ne connaît ni frontière ni contexte particulier. Il peut survenir n'importe où dans le monde. Et que vous soyez en France ou à l’autre bout du monde, tout réside dans la manière de l’affronter et de le surmonter.
Introduction
Pourquoi ce livre ?
Trois ans après avoir traversé un burnout, Stéphanie Desquerre confie que cette épreuve a radicalement changé sa vie.
Pour elle, la dépression n’est pas une fin, mais un point de bascule, un catalyseur qui pousse à la transformation et à porter un regard différent sur nous-mêmes. Avec ce livre, elle souhaite aujourd’hui transmettre son expérience pour aider d’autres personnes à vivre le burnout, "à traverser cette obscurité plus facilement".
Qu’est-ce qu’un burnout ?
Le burnout, qui signifie littéralement "brûler entièrement", est une forme de dépression liée au travail.
Stéphanie Desquerre nous apprend qu’une personne vivra en moyenne cinq à dix épisodes dépressifs au cours de sa vie.
C’est pourquoi, sans être psychologue, l’auteure précise vouloir partager son vécu, simplement, afin d’apporter quelques pistes de réflexion sur le sujet, convaincue que l'expérience personnelle peut aussi éclairer d'autres parcours.
Les causes et les symptômes de l’épuisement professionnel
Le burnout, observe l'auteure, résulte principalement d'une surcharge de travail et d'une dévalorisation professionnelle. Les symptômes sont à la fois émotionnels (stress chronique, démotivation, anxiété) et physiques (fatigue constante, insomnies, douleurs musculaires).
Épisodes de dépression
L'auteure fait remarquer qu'un véritable épisode dépressif se caractérise par des symptômes persistants pendant au moins deux semaines : humeur triste, sentiment de vide, perte d'intérêt pour ses activités habituelles et tout ce qui, auparavant, nous animait.
Portrait des personnes touchées par le burnout
Les profils les plus exposés au burnout partagent souvent des traits communs : perfectionnisme, difficulté à poser des limites, hypersensibilité, et une grande empathie. Stéphanie Desquerre se reconnaît dans ces descriptions et illustre ce portrait en évoquant son propre chemin en tant qu’empathe.
De vous à moi
Stéphanie Desquerre conclut cette introduction en comparant notre cheminement personnel à des "stations de train" où chacun avance à son rythme :
"La vie est un long apprentissage qui ne s’arrête jamais. Le rythme de notre évolution est comparable à des stations de train. Nous avons le choix de monter dans un train pour en explorer les stations suivantes et continuer d’apprendre, tout comme nous pouvons aussi décider de rester à la même station pendant un certain temps. Quoi que nous choisissions, le choix de rester à une même station de train peut durer autant de temps qu’on le souhaite, quelques jours comme plusieurs années. La vie nous proposera toujours de passer à l’étape suivante de notre évolution quoi que nous décidions, de manière voulue ou non voulue."
L’auteure présente alors son ouvrage comme un témoignage réconfortant, un message d'espoir et une main tendue dans ce parcours :
"Un burnout ou dépression est une opportunité de transformation mise sur notre chemin, pour nous rendre vers la station de train suivante, j’en suis convaincue. Il surgit au moment où nous avons le plus besoin de changements dans notre vie, des changements extérieurs mais surtout des changements intérieurs, que nous décidions d’en être conscient ou non. Parce que notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur, cet événement nous oblige à regarder de plus près et à noter les dysfonctionnements opérant en nous. Il ne tient qu’à nous de faire le choix du changement et de nous choisir nous, chose que je n’avais pas faite à l’époque et qui m’a amené à un épuisement général (professionnel, personnel, émotionnel, psychologique). Si vous décidez d’aller à votre rencontre, je vous fais la promesse que ce que vous trouverez au bout du tunnel vaudra vraiment la peine d’avoir traversé toute cette obscurité."
Ainsi, les trois premiers chapitres plongent dans l’histoire de Stéphanie, le quatrième explore sa transition vers le nomadisme digital, et le dernier se consacre aux clés de la guérison.
Chapitre 1. Mon Histoire
1.1 - Qui suis-je ?
Stéphanie Desquerre se présente comme une jeune femme de 28 ans vivant à Toulouse, avec une vie qui, sur le papier, semblait idéale : un emploi stable d’assistante auprès de trois chefs de projet, un salaire mensuel de 1 700 euros, et un appartement en plein centre-ville. Pourtant, confie-t-elle, une petite voix intérieure lui murmurait constamment qu’elle était en train de gâcher son temps.
L'auteure raconte aussi sa passion précoce pour les langues étrangères, née dès l'âge de neuf ans en traduisant des chansons anglaises. Elle revient sur ses multiples expériences à l’étranger : six mois en Angleterre, une année Erasmus en Espagne, suivie d’une année sabbatique. Ces voyages ont non seulement enrichi sa maîtrise des langues, mais aussi alimenté sa soif insatiable de rencontres et de découvertes culturelles.
1.2 - Constat : société, travail, relations
Stéphanie Desquerre décrit une baisse progressive de sa motivation au travail, qu’elle attribuait d’abord à l’absence de perspectives et de défis.
Côté vie sociale, tout semblait pourtant en place : des amis partageant ses valeurs essentielles – respect, gentillesse, écoute – et une vie bien remplie avec des activités comme la danse, le roller, et même chanteuse dans un groupe de rock depuis cinq ans.
Mais derrière cette façade dynamique et épanouie, un sentiment d’inachevé la hantait. Stéphanie confie qu’elle n’était pas heureuse. Ce mal-être était renforcé par une peur omniprésente, paralysante : celle de sortir de sa zone de confort et de regretter ses choix, un dilemme qui l’empêchait de franchir le pas vers le changement.
1.3 - Résolution
Un jour, un "ras-le-bol général", raconte Stéphanie Desquerre, la pousse à un acte impulsif : acheter un billet pour la Thaïlande.
Ces deux semaines de voyage sont un déclic pour la jeune femme. Les rencontres avec des voyageurs ayant osé sauter dans l’inconnu l’inspirent profondément. À son retour, elle prend une décision radicale : démissionner et partir vivre en Nouvelle-Zélande.
Cette décision, elle l’a prise seule, consciente que les craintes et les doutes de son entourage auraient pu la freiner. En seulement quatre semaines, elle boucle tout : déménagement, vente de sa voiture, démarches administratives. Mais au-delà de l’envie de voyager, ce départ symbolise pour Stéphanie une échappatoire : l’auteure confie qu’il était aussi motivé par un besoin de s'éloigner d'un système médiatique et politique dans lequel elle ne se reconnaît plus.
Elle conclut en partageant son mantra, celui qui l’a portée dans ce grand saut :
"Désormais, je partais du principe que si je ne faisais pas les choses maintenant, je ne les ferai sans doute jamais. C’est là que me vint mon petit slogan favori et mon premier blog : " We Only Got One Life !"
Chapitre 2. Travail, travail, travail
2.1 - L’aventure Nouvelle-Zélande commence
Premiers pas dans un domaine d’exception
À 29 ans, Stéphanie Desquerre entame une toute nouvelle vie en Nouvelle-Zélande. Installée dans une colocation multiculturelle en banlieue d’Auckland, elle partage son quotidien avec des "kiwis" (néo-zélandais), un Français et un Indien.
Malgré son manque d'expérience et quelques refus liés à son niveau d'anglais, Stéphanie décroche un poste de Wedding Planner dans un domaine prestigieux, une véritable chance qu’elle saisit avec détermination.
Ce lieu magique, que la jeune femme décrit avec entrain, est une propriété familiale nichée dans un écrin de nature idyllique : un restaurant classé parmi les dix meilleurs d’Auckland, une salle de réception luxueuse entourée d’une oliveraie, et un élégant chapiteau pour les cérémonies.
Manager sous tension
Très vite, Stéphanie est propulsée au poste de Pavilion Manager, assumant de grosses responsabilités : gestion d’une équipe de vingt personnes, coordination d’événements haut de gamme, et formation du personnel. Son supérieur, Martin, un Allemand exigeant, confie-t-elle, apprécie rapidement son professionnalisme et ses talents d’organisation, même si la pression qu’il impose peut parfois se révéler intimidante.
Stéphanie Desquerre décrit alors le rythme effréné de ses journées, travaillant entre 60 et 70 heures par semaine. À travers le récit d’une journée type, elle nous plonge dans la frénésie d’un mariage : les clients aux attentes élevées et aux demandes incessantes, les imprévus de dernière minute, la gestion d’une équipe parfois peu réactive, le tout dans une course contre la montre perpétuelle.
Avec des mariages réservés deux ans à l’avance et des tarifs reflétant un standing haut de gamme, la manageuse n’a pas le droit à l’erreur. Elle doit maintenir une excellence sans faille, sous une pression écrasante et constante, accentuée par l’attitude de Martin, dont le ton peut devenir "menaçant" sous l’effet du stress.
Malgré les succès professionnels, Stéphanie admet que cette vie ne lui laissait aucun espace, aucun répit personnel : "Vie sociale zéro et vie amoureuse zéro, je me consacrais uniquement à ma tâche et à rendre les gens heureux." Une existence gratifiante mais épuisante, où chaque instant était dédié à satisfaire les rêves des autres.
2.2 - Grande fatigue
Entre fatigue et opportunités professionnelles
Huit mois après son arrivée en Nouvelle-Zélande, Stéphanie Desquerre termine sa première saison de mariages, épuisée par le rythme de travail acharné qu’elle a dû maintenir. Elle décide alors de s’accorder une pause de trois mois dans l’Île du Sud, à Queenstown, avant de rentrer en France pour retrouver sa famille.
Stéphanie décrit son état d’esprit ambivalent à ce moment-là : elle se dit partagée entre l’excitation de découvrir de nouveaux horizons et une profonde lassitude.
Elle admet être "complètement vidée" par son investissement dans l'organisation des mariages. Toutefois, relate-t-elle, ses efforts ont porté leurs fruits puisqu’on lui propose de revenir travailler la saison suivante, avec un meilleur salaire et un visa renouvelé.
David, une histoire d’amour inattendue
Au milieu de ce chaos, une relation inattendue éclot.
David, le chef cuisinier du Pavillon, devient plus qu’un collègue. Stéphanie raconte comment leur collaboration professionnelle sous pression s’est transformée en histoire d’amour : "Durant ces huit mois de stress intense, David avait été l’élément inattendu qui m’avait permis de tenir le coup." Elle évoque leurs moments de complicité, leurs escapades en bateau, jusqu'à ce qu'ils tombent amoureux l'un de l'autre.
Mais à l’heure de partir pour Queenstown, David choisit de rester pour prendre du recul. Stéphanie, de son côté, partage sa tristesse de voyager seule. Cette séparation, confie-t-elle, fait ressurgir un sentiment pesant de solitude dans ce pays qui l'a épuisée.
Liberté retrouvée
Stéphanie Desquerre poursuit son récit en décrivant son installation dans la région de Wanaka, où elle trouve un nouveau poste de Pub Manager dans le village de Luggate.
Avec un rythme de travail plus léger (35 heures par semaine), elle commence enfin à explorer les merveilles de l’Île du Sud. De Milford Sound à Te Anau, en passant par les Catlins, Stéphanie savoure cette liberté retrouvée, "parfois seule, parfois accompagnée".
Elle partage plusieurs anecdotes inoubliables comme sa première expérience de ski ou une nuit de camping glaciale par zéro degré en face du Diamond Lake.
Une mésaventure, en particulier, reste gravée dans sa mémoire : lors d’un road-trip improvisé avec des Français, leur voiture manque de tomber en panne sèche dans une région isolée. Le groupe est sauvé in extremis par la générosité d’une famille locale, un souvenir rempli de rires, de joies et d’émerveillement, écrit-elle.
Finalement, à sa grande surprise, Stéphanie retrouve David à Wanaka pour trois semaines pleines de bonheur, avant une nouvelle séparation. Mais elle garde quand même espoir de le revoir une dernière fois avant son retour en France.
2.3 - L’espoir d’une période de récupération
Dans cette partie de "Du burnout à digital nomade", Stéphanie Desquerre revient sur une période difficile au pub de Luggate, marquée par des tensions grandissantes avec ses collègues.
Elle évoque le choc culturel et les frictions entre son style de management et la mentalité locale. La situation atteint son point de rupture lorsqu’un client l’humilie publiquement, un événement qui la pousse à quitter son poste plus tôt que prévu.
Cette expérience laisse des traces profondes : "Le sentiment d'avoir été salie, meurtrie malgré toute ma bonne volonté", confie-t-elle. Épuisée émotionnellement, Stéphanie décide de prendre du temps pour elle pour se reconstruire avant de rentrer en France. Elle choisit de faire du woofing dans une auberge, une parenthèse qui lui permet de se ressourcer et de retrouver un semblant de sérénité.
En tirant le bilan de ses 17 mois à l’étranger, Stéphanie réalise sa profonde transformation personnelle. Ces épreuves l’ont poussée à grandir, à mieux comprendre ses limites et à envisager l’avenir différemment. Malgré les difficultés, elle décide de reprendre son poste d'organisatrice de mariages, mais elle s’engage à faire passer sa vie personnelle en priorité : une promesse qu’elle se fait à elle-même pour ne plus s’oublier dans le tumulte de ses responsabilités.
2.4 - Retour en France
De retour en France pour deux semaines, Stéphanie Desquerre sillonne le pays, de Nice à Bayonne, renouant avec ses racines et ses proches. Elle décrit un sentiment mêlé de chaleur et de détachement : la joie des retrouvailles familiales et le réconfort de retrouver sa culture si familière, contrebalancés par la certitude qu’elle préfère vivre ailleurs.
Une conversation anodine avec un coiffeur au sujet du malaise social et économique en France l’a fait réfléchir. Il évoquait l’impression d’étouffement des Français, prisonniers de leur existence et du système, le sentiment de survie, d’être piégés, la perte d'espoirs et la négativité ambiante :
"Réfléchissant à ce qu’il venait de dire, je repensais aux raisons pour lesquelles j’avais quitté la France. Dans ma vie précédente, je m’étais sentie piégée tout comme le décrivait le coiffeur (…). Aujourd’hui, je me sentais toujours piégée dans ma vie, mais d'une manière différente. Dans cette nouvelle vie, j’avais décidé de vivre mes expériences en ayant la possibilité de prendre des directions différentes à ce que l’on attendait de moi. C'était le style de vie que j'avais créé et que je choisissais. En étant loin d’une société où le marketing, la technologie, la publicité sont les mots d’ordre, je m’étais dit que je préserverais une partie de ma liberté et de mes rêves. Pourtant, il faut le mentionner, peu importe le pays concerné, j'avais l'impression que le problème était partout. En toute honnêteté, je n'avais pas la solution à cette folie économique et politique dans laquelle chacun se sentait emprisonné, mais ma solution à moi était de continuer à voir d'autres horizons, d'autres réalités et de toujours apprendre sur les cultures et les gens qui m'entourent."
2.5 - Que m’arrive-t-il ?
De retour en Nouvelle-Zélande, Stéphanie Desquerre raconte sa descente progressive dans la dépression.
Ses journées interminables, son isolement social et la fatigue de devoir s’exprimer constamment en anglais finissent par éroder ses forces.
"Depuis plusieurs semaines, j'avais du mal à trouver l'équilibre des choses : un travail que je n'aimais pas, dans une langue qui n’était pas la mienne, soixante heures de travail par semaine, une vie sans amis et sans famille. J’avançais en pilote automatique depuis plusieurs mois, travaillant et travaillant sans relâche. (…) Je ne m’amusais plus, je ne riais plus, je ne décompressais plus. Rien ne semblait juste. (…) Je pleurais tous les jours. Un creux s’était formé au cœur de ma poitrine et je n’avais plus goût à rien."
La jeune femme plonge lentement mais sûrement dans une spirale dépressive.
"Pas d'amis, pas de vie sociale, pas de soirées, pas d'anniversaires, pas de week-ends, de longues journées au travail, pas de groupes de français pour décompresser dans ma langue maternelle. Même au travail, je n'arrivais pas à rire. Ce n’était pas drôle, rien n'était drôle. J’étais épuisée de toujours repousser mes limites. Cela faisait trop longtemps que ça durait."
Le coup de grâce survient lors d’une dégustation au restaurant. Une demande apparemment anodine de Martin, son supérieur, provoque un effondrement total. Stéphanie décrit ce moment avec une intensité palpable :
"Mon corps tout entier se mit à trembler. Mes bras le long du corps, les yeux hagards, les pensées confuses, mon cœur s’arrêta. Mon encéphalogramme était plat. Je ne pouvais plus parler. Je restais debout devant lui en plein milieu de la salle, la bouche fermée et le cœur serré. (…) J’étais à bout, je n’en pouvais plus."
Face à cette détresse physique et mentale, elle prend une décision radicale : démissionner sur un coup de tête.
Cet épisode marque un tournant dans son parcours, révélant l’urgence de s’arrêter pour se retrouver, après avoir ignoré trop longtemps les signaux de son propre corps.
2.6 - L’espoir d’un meilleur emploi
Après sa démission brutale et précipitée du restaurant, Stéphanie Desquerre rebondit rapidement et décroche un poste d'Operations and Events Manager dans une grande société de traiteur d’Auckland.
Sa première mission est un véritable baptême du feu : organiser un événement pour 1 200 personnes avec une équipe de trente serveurs, le tout sans préparation préalable. Bien qu’elle réussisse ce défi, elle avoue que l’ampleur de la tâche commence à éveiller des doutes en elle concernant sa capacité à occuper cette nouvelle fonction.
Et en effet, ce nouveau poste s’avère tout aussi intense que le précédent. Avec vingt événements par semaine et des journées de douze heures, la charge de travail est écrasante. L’auteure pointe, entre autres, les défis liés à la langue anglaise. Malgré son bon niveau, elle confie : "la langue était source de complications supplémentaires et m'empêchait de comprendre le problème rapidement".
Pour la jeune expatriée, chaque journée devient un marathon d’organisation. La logistique complexe et les barrières linguistiques lui demandent une énergie qu’elle peine à renouveler. Mais malgré cela, Stéphanie poursuit son chemin avec résilience, cherchant à transformer ce nouveau défi en une opportunité de prouver sa capacité à surmonter les obstacles.
2.7 - Morte de l’intérieur
Stéphanie Desquerre décrit ici sa chute dans la dépression, qui ne cesse de s’aggraver malgré quelques améliorations dans son emploi du temps. Elle compare son quotidien à celui d'une "guerrière sur un champ de bataille", où chaque jour est une lutte contre la perte de confiance et des questionnements permanents.
Le point de non-retour survient lorsqu’on lui refuse un congé pour assister au mariage de son père. Cette décision de son employeur agit comme un déclic. Stéphanie raconte sa réaction déterminée : "Terminées les décisions forcées qui ne m'apportent pas de bonheur !". Dans un geste libérateur, elle démissionne et rentre en France pour six semaines de ressourcement.
Ce retour aux sources lui permet de se poser et de réfléchir. Stéphanie réalise alors qu’elle a trop longtemps ignoré ses propres limites, incapable de dire non et de se préserver.
Dans un mélange d’excitation et de mystère, elle annonce un nouveau projet qui, selon ses mots, est "tout aussi insensé que réalisable".
2.8 - Réflexions existentielles
De retour à Auckland, Stéphanie Desquerre entame une profonde introspection.
Elle fait le point sur sa vie, dresse le bilan de sa situation actuelle : six mois de relation avec David, le lancement de sa première activité en tant que freelance, et un emploi à temps partiel comme assistante administrative. Si ces changements semblent positifs, concède la jeune femme, son esprit reste envahi par des pensées obsédantes qui lui laissent une sensation d'incomplétude.
Stéphanie analyse alors méthodiquement ce qui manque à sa vie, à son équilibre : des activités sociales, du sport, des hobbies. Mais au-delà de ces éléments, elle remet en question sa relation avec David, prenant conscience qu’un fossé émotionnel et intellectuel se creuse entre eux. Elle aspire à "un partenaire de vie davantage connecté à elle".
Bien que reconnaissant les avantages du bilinguisme, la barrière linguistique reste également une source d’épuisement pour Stéphanie. L’usage constant d’une langue étrangère limite, dit-elle, sa capacité à exprimer ses émotions les plus profondes, et renforce ainsi son sentiment d’isolement :
"J’étais une personne vivante, pleine d’émotions en tous genres, empathique et de surcroît sensible. Pour moi, mon monde émotionnel s’apparentait à un arc-en-ciel de couleurs, composé de nuances et de sous-catégories. Un mot ne pouvait pas en remplacer un autre, le sens devait être juste et exact pour traduire ce monde intérieur coloré. Mon choix de vocabulaire en français reflétait cette variété, ainsi que la complexité des émotions et des sentiments qui me traversaient."
Malgré une retraite de yoga récente qui lui a apporté un court répit, Stéphanie sent les projets communs avec David, comme leur voyage en Australie ou l’idée d’acheter un voilier, perdre progressivement leur sens. "J’étais maintenant perdue dans les méandres de mes pensées existentielles" lâche-t-elle.
Chapitre 3. Crise identitaire
3.1 - Perte de repères
Dans le chapitre 3 du livre "Du burnout à digital nomade" Stéphanie Desquerre raconte le virage radical qu’elle a pris dans sa vie : d'élégante organisatrice de mariage prestigieux, nous la retrouvons à présent réceptionniste bénévole dans un centre de yoga près d'Auckland. Elle écrit :
"Après cette période difficile de travail puis de grands questionnements, j’avais finalement fait le choix de prendre les choses en mains. Soyons honnête, je n’avais plus le choix : il fallait que j’aille mieux."
Ce centre de yoga ne lui est, en fait, pas inconnu : elle y pratiquait, nous révèle-t-elle, déjà des "voyages chamaniques", une expérience mystérieuse qui l’aidait à se sentir mieux.
Cependant, la réalité de sa nouvelle situation est une totale désillusion. Les conditions d’hébergement des bénévoles sont loin de ce qu’elle espérait : chambres délabrées, installations rudimentaires, un confort réduit au strict minimum. Face à cette dureté, un conflit intérieur la déchire : "Pourquoi je m’inflige ça ?" se demande-t-elle, partagée entre l’envie de fuir et celle de persévérer…
Mais Stéphanie confie également sa peur de rentrer en France dans cet état de fragilité. Elle ne veut pas se montrer vulnérable :
"Je ne savais pas si je pourrais être assez forte pour rentrer et faire face à ma famille et mes amis. Je ne voulais pas montrer ma souffrance et ce que j’étais devenu : une petite chose perdue sans plus aucune estime d’elle-même. J’avais honte et peur que l’on ne me comprenne pas. N’importe quelle autre solution l’emporterait."
La jeune femme se sent paralysée, incapable de prendre une décision constructive. Elle restera donc là pour traverser cette période de perte totale de repères, et qui sait, peut-être amorcer un nouveau départ :
"J’étais maintenant incapable d’avancer car je faisais une crise identitaire et je ne savais plus ce que je voulais. C’était peut-être une bonne raison pour rester ici, me poser et arrêter de m’éparpiller."
3.2 - Vivre dans un centre de yoga
Stéphanie Desquerre revient sur son installation et son quotidien dans ce centre de yoga, un centre spirituel situé sur un site maori sacré.
En échange de 24 heures de travail hebdomadaire, elle dispose d'une petite cabine et d'accès aux espaces communs. Le contraste entre le confort rudimentaire et la beauté paisible des lieux est saisissant, mais elle y trouve une certaine harmonie.
Cette immersion amène Stéphanie à une profonde réflexion sur nos conditionnements sociaux et à redéfinir ses besoins essentiels. À travers la méditation et les rencontres multiculturelles qui rythment sa vie au centre, Stéphanie commence à se reconnecter à elle-même.
Dans cet environnement paisible et dépouillé, elle observe alors un changement en elle : "Je reprenais goût aux plaisirs simples de la vie que j’avais oubliés" reconnaît-t-elle.
3.3 - La rencontre avec un digital nomade
Stéphanie Desquerre raconte ici une rencontre plus marquante que les autres : celle avec Fabrizio, un blogueur brésilien qui lui fait découvrir le monde des digital nomades. Fabrizio vit de son blog de voyage et de ses activités freelances, en travaillant en ligne depuis n’importe quel coin du globe.
Fascinée par ce mode de vie libre et nomade, Stéphanie découvre un univers qu’elle n’avait jamais envisagé. Elle est particulièrement impressionnée par l’ingéniosité de Fabrizio : en plus de ses revenus de freelancer, il obtient, grâce à ses 6 000 abonnés, des services gratuits en échange de contenus promotionnels pour son blog.
Cette rencontre agit comme un véritable déclic pour Stéphanie. Inspirée par l’exemple de Fabrizio, elle commence à envisager un nouveau projet :
"Ce fut pour moi le début d’une nouvelle décision : je commençais à réfléchir pour créer mon site internet et enfin lancer mon activité freelance que j’avais mis en pause, et les idées ne cessaient d'affluer."
Ce moment devient un tournant décisif dans son cheminement, une étape clé vers une vie en accord avec ses aspirations profondes.
3.4 - Episodes de dépression
Cette partie du livre "Du burnout à digital nomade" retrace l’évolution de l’auteure au sein du centre.
Nouvelles responsabilités, nouveau stress
Après 2 mois de bénévolat, Stéphanie devient responsable des bénévoles. Elle travaille alors 18 heures par semaine et complète ses revenus par du baby-sitting. Malgré ses craintes financières initiales, elle décide de considérer ses économies comme un investissement dans sa guérison et travaille à changer sa relation à l'argent.
Néanmoins, ses nouvelles fonctions s’accompagnent d’un stress grandissant.
Suite au départ du manager principal, elle se retrouve d'abord à gérer la réception avec une collègue, puis doit prendre en charge seule la supervision de trente bénévoles. Souvent jeunes et peu impliqués, ces derniers lui rappellent ses expériences éprouvantes dans l’événementiel. Elle se souvient : "je passais beaucoup de temps à réparer des problèmes et à apporter des solutions, plusieurs fois par jour au lieu de travailler sereinement."
La méditation comme refuge
Ce climat pesant accentue le besoin de solitude de Stéphanie. La vie en communauté devient une charge, chaque interaction sociale représente une intrusion dans son espace personnel. Pour y faire face, la jeune femme se tourne vers la méditation bouddhiste, en participant à deux ou trois séances par semaine.
La jeune apprentie nous livre ce qu'elle dit intérieurement pendant ces méditations à ses débuts maladroits :
""Il ne faut pas que je pense… cela va être difficile, pensais-je intérieurement, les yeux fermés, au beau milieu d’un cours de méditation. Les pensées et les émotions sont comme des nuages dans le ciel. Elles se dissipent et il ne faut pas s’y accrocher. Tels des nuages qui passent, mes pensées ne font que passer et ne me définissent pas. Je dois les observer sans les juger et les laisser partir… Plus facile à dire qu’à faire, commentais-je dans ma tête. Mince, je suis en train de penser !"
Peu à peu, Stéphanie découvre les bienfaits de cette pratique, qui lui procure des instants de paix et l’aide à mieux gérer ses émotions au quotidien :
"Comment les gens faisaient-ils pour méditer et avoir l’air si calmes ? Les pensées et les mots s’enchainaient dans ma tête sans que je ne puisse avoir aucun contrôle. Les événements de la journée défilaient dans ma tête et les questionnements sur la journée du lendemain faisaient irruption. Malgré le manque de résultats évident, je continuais dans la poursuite de mes efforts. (…). Au fur et à mesure des jours et des semaines, mon corps commença à se détendre et je réussis enfin à entrer dans un état méditatif. Je ressentis enfin la sensation dont on me parlait tant : un état de calme intérieur, un instant de paix sacrée. Au fil des semaines, le vacarme de mon mental diminua peu à peu. Méditer clarifiait mon esprit lorsque je pratiquais quotidiennement. La méditation me permettait de goûter à des moments de répit dans la journée, hors de mon mental envahissant. Lors des moments intenses de solitude et de doutes, qui revenaient trop souvent, je me recentrais sur moi, prenais une grande inspiration et je retrouvais immédiatement une forme de bien-être. Il était impressionnant de constater à quel point la méditation faisait une différence dans la gestion émotionnelle journalière de mes conflits intérieurs."
Un retour en France comme transition ?
À l’approche du Nouvel An, Stéphanie Desquerre prend une décision importante : rentrer en France pour six mois. Elle se sent enfin prête à retrouver sa famille, à faire la connaissance de son neveu né pendant son absence, et souhaite se consacrer pleinement à son projet de devenir Digital Nomade. Cependant, son humeur reste instable. Même sa relation avec David, transformée en une amitié profonde, et leurs projets communs de navigation ne suffisent pas à dissiper sa mélancolie.
Elle exprime également une fatigue sociale croissante. Les conversations répétitives en anglais, les questions incessantes sur son parcours, et les comportements individualistes autour d’elle l’épuisent. Elle mentionne notamment l’attitude d’une bénévole partie subitement en Australie sans prévenir.
Elle partage le poids de son isolement et ses pensées négatives :
"Malgré tous les efforts que je fais pour rester ouverte, j’ai l’impression de devenir aigrie (…). Je n’aime pas mon travail, je n’ai pas envie de parler, je n’ai pas d’activité extérieure à part celle de voir David sur son bateau et je n’ai pas d’amis."
Jusqu’à son départ, le moral de Stéphanie continue ainsi de fluctuer, alternant entre des moments de profond découragement et de brefs élans d'espoir.
La jeune femme pense aussi aux futurs projets qu’elle mènera en France : reprendre la danse, la musique, voyager seule, poursuivre son développement personnel, travailler en ligne.
Dans ce récit chargé d’émotions, celle-ci ajoute une touche d'autodérision : " Je vais continuer mon ascension dans ce monde et me créer des buts à atteindre. Et puis, si un jour j’en ai marre de tout, je prendrai un chien !".
3.5 - Un nouveau départ
Stéphanie Desquerre nous fait part des sentiments mitigés qu’elle éprouve au moment de quitter la Nouvelle-Zélande. Si elle se sent psychologiquement plus stable, notamment grâce à la méditation quotidienne, elle est consciente de sa fragilité : "j'avais l'impression de marcher avec des béquilles" écrit-elle en se remémorant cette période.
Ce départ est un déchirement. Stéphanie est heureuse à l’idée de retrouver sa famille en France, mais profondément attristée de laisser derrière elle David, qui est devenu son "confident", son "point de repère."
Malgré ces émotions contradictoires, l’appel de l’aventure continue de résonner en elle.
Stéphanie Desquerre conclut ce chapitre en évoquant ce tiraillement constant entre son besoin d’explorer le monde et la nostalgie des saveurs et des repères de sa culture française.
Un nouveau chapitre s’ouvre, teinté d’espoir et de découvertes, mais aussi d’une certaine mélancolie.
Chapitre 4. Une vie de digital nomade
4.1 - Retour aux sources
Stéphanie Desquerre commence le chapitre 4 de son livre "Du burnout à digital nomade" nous dévoilant une conversation qu’elle a, à son retour en France, avec sa sœur Samantha.
Cet échange laisse entrevoir le fossé qui les sépare.
Alors que Samantha revendique une vie stable et "parfaite", Stéphanie tente de lui expliquer son insatiable besoin de voyage et d’évolution, qu’elle décrit comme "un appel intérieur plus fort que tout". Elle compare cette vocation à celle du mari de sa sœur pour le métier de pompier : une certitude inexplicable, mais profondément ancrée.
Puis, face aux doutes et critiques de sa sœur sur son développement personnel, l’auteure explique comment cette démarche l'a pourtant aidée à surmonter sa dépression. À travers la lecture et l’introspection, elle a appris, assure-t-elle, à mieux se comprendre et à reprendre le contrôle de sa vie. Aussi, contrairement à Samantha, qui a trouvé son équilibre dans une vie familiale stable, Stéphanie, elle, a choisi de "remplir sa vie de projets au lieu d’attendre que les choses arrivent".
Mais le dialogue s’envenime et devient plus tendu. Il atteint son paroxysme lorsque Samantha avoue à sa sœur qu’elle n’a nullement envie de comprendre sa façon d’être et que, de toute façon, elle n’arrive pas à la respecter :
""- Ma vie est parfaite et je ne cherche pas à l’améliorer. J’ai mon confort, mes amis, j’habite où je veux. J’ai tout ce que je voulais et je ne peux pas me mettre à ton niveau pour essayer de te comprendre. (…) Je ne te respecte pas. Tu es la seule personne que je ne respecte pas. Je suis méchante parce que je suis comme ça. Je n’ai pas l’intention de changer." L’affirmation était précise, taillée et emplie d’une pointe de fierté. Disait-elle la vérité ou cherchait-elle simplement à me blesser ? Je ne le savais pas et je ne cherchais pas à le savoir."
Stéphanie se défend :
""- Dans ce cas, je regrette mais ça ne pourra pas fonctionner, dis-je avec une grande sérénité. Soyons honnêtes, ta méchanceté me rebute et je ne la supporte pas. Tu as toujours été comme ça, je le sais bien." Je ne te demande pas de changer ou de me comprendre, mais simplement d’éviter tes commentaires piquants et blessants."
Comme solution, Samantha propose alors d’en rester là et d’entretenir, avec sa sœur, une relation superficielle.
Stéphanie rejette cette idée avec fermeté. Pas question pour elle de se contenter d’une relation vide. Elle a besoin de liens authentiques, qui ont du sens et de la profondeur. Pour elle, l’amour et le soutien familial est essentiel, notamment parce que personne n’est à l’abri des coups durs.
Si cette dernière réflexion semble brièvement ébranler les certitudes de Samantha, et met fin à cette discussion mouvementée, reste que le repas, ce soir-là, "se passa sans accrocs, dans la plus grande superficialité".
4.2 - Création d’un business en ligne
Un nouveau départ : les débuts difficiles du freelancing
Une fois en France, Stéphanie Desquerre se lance dans une nouvelle aventure : la création de son entreprise d'Assistante Virtuelle. Dans cette partie du livre, elle revient sur les nombreux défis qu’elle a dû relever : concevoir un site internet bilingue, choisir un statut juridique, définir des services adaptés à une activité encore méconnue sur le marché français…
La jeune femme évoque aussi ses difficultés psychologiques. En effet, le retour au travail réveille, chez elle, des souvenirs douloureux. "Le simple mot 'travail' me faisait stresser", lance-t-elle, reconnaissant les séquelles persistantes de son burnout.
Habituée à la structure du salariat, la freelance a du mal à s’adapter à l’autonomie et aux incertitudes du travail indépendant.
Tournants déterminants et premiers succès
Dans ce parcours, Stéphanie Desquerre relate deux tournants décisifs :
Tout d’abord, son inscription à une communauté en ligne dédiée aux assistantes virtuelles, qui lui apporte un précieux soutien et des conseils pratiques.
Ensuite, le prêt généreux et inattendu du camping-car de sa grand-mère, qui lui permet de tester un mode de vie nomade tout en développant son activité professionnelle.
Malgré les obstacles, Stéphanie célèbre ses premiers succès : la signature de son premier client, un digital nomade basé en Thaïlande, et ses premières journées de travail nomade depuis Toulouse.
Enthousiaste, elle commence à envisager l’avenir avec audace, évoquant la possibilité de "Et pourquoi ne pas créer des formations en ligne un jour pour former de futures assistantes virtuelles". Consciente toutefois de son besoin de solidifier son expertise, elle décide d’avancer pas à pas, portée par l’envie de transformer ses défis en opportunités.
4.3 - Les premiers mois d’une digital nomade
Stéphanie Desquerre partage ses premiers pas en tant que digital nomade, installée dans le camping-car prêté par sa grand-mère.
Bien que parfois assaillie par des doutes, elle reste convaincue d’avoir fait le bon choix. Sa routine quotidienne s’articule entre travail sur son ordinateur et déplacements, ses journées n’étant pas encore entièrement remplies par son activité professionnelle.
La voyageuse évoque avec humour les réactions face à son mode de vie atypique.
Les jugements et incompréhensions fusent :
"J’attirais la curiosité. (…) Certaines personnes se mettaient aussitôt à me considérer comme une hippie, d’autres plutôt comme une aventurière. Ils m’imaginaient dans un van vivant à la roots, sans eau ni électricité, sans douche ni toilettes. J’étais loin de cet inconfort-là : le camping-car était tout confort, équipé d’une douche, d’un système de chauffage, d’une télévision satellite, de toilettes, d’électricité et d’assez de rangement pour une famille entière. La cuisine était spacieuse et les fenêtres ne manquaient pas. Je bénéficiais de quinze mètres carrés au sol, un vrai studio mobile !"
Ne se laissant pas affecter, la nouvelle nomade profite de ces premiers mois - bien que loin d’être parfait - comme un temps de découverte : de soi, des autres, et d’un mode de vie qui bouscule les normes tout en ouvrant la voie à une nouvelle liberté.
"Un jour, quelqu’un me fit la remarque suivante : "ah oui, t’es une vraie toi !". Je venais de lui expliquer que j’étais "itinérante en camping-car", ne sachant pas comment décrire mon nouveau mode de vie Digital Nomade. J’avais trouvé son commentaire assez blessant car cette situation ne me définissait pas, elle n’était que passagère. Je n’allais pas rester éternellement dans un camping-car, j’allais aussi vivre dans des appartements dans d’autres pays. Et finalement, quand bien même cette situation serait plus permanente, qu’est-ce que ça pouvait bien lui faire ? Certaines personnes avaient décidément la stigmatisation facile. Je me rassurais en pensant que les décisions que j’avais prises mettaient certainement les gens face à leur propre vie, leurs propres peurs et leur responsabilité, et je les dérangeais dans leur stabilité. Je me réconfortais en me disant qu’ils n’avaient pas le courage de faire de même et qu’ils étaient bloqués dans une vision très restreinte de leur réalité."
Le temps passant, la nomade digitale se met à trouver un réel plaisir dans cette singularité et à voir son choix de vie comme une opportunité d’apprendre à mieux s’écouter :
"Je commençais à aimer ce style de vie, finalement un peu en marge. J’aimais le fait que cela me rende différente, même dans mon propre pays. Auparavant, je me sentais différente, mais à l’étranger. J'explorais maintenant ce sentiment dans mon pays d'origine. Au-delà de ce ressenti, ce qui me plaisait le plus était le fait que j’apprenais à m’écouter : à écouter tout simplement mes envies et mes besoins."
4.4 - La société moderne en esclavage ?
Après ces trois ans à l’étranger, Stéphanie Desquerre propose une réflexion critique sur la société de consommation. Elle constate que le matérialisme a pris le dessus et a finalement fini par transformer les individus en "esclaves modernes" prisonniers de leurs possessions et d’une quête perpétuelle d’avoir plutôt que d’être.
Par ailleurs, son retour en France s’accompagne d’un choc culturel inversé. Elle est frappée par la négativité omniprésente dans les médias et par ce qu’elle perçoit comme une déconnexion profonde des valeurs essentielles. "Nos comportements sont déconnectés des valeurs intérieures qui apportent le vrai bonheur", écrit-elle, en appelant à un retour à l’authenticité et à l’essentiel.
Malgré ces observations, Stéphanie conclut sur une note positive, exprimant sa gratitude d’avoir écouté et suivi son instinct. Cet instinct l’a en effet mené vers le nomadisme digital bien loin, observe-t-elle, d’être une simple aventure : cette expérience lui a ouvert la voie vers une plus grande liberté et un sens renouvelé à sa vie, un chemin qu’elle estime en phase avec ses aspirations profondes.
4.5 - Avantages et difficultés du nomadisme
Stéphanie Desquerre analyse ensuite les multiples facettes du nomadisme digital.
Les avantages principaux du nomadisme digital :
La digital nomade met en avant une liberté totale : géographique, temporelle et même financière, et la possibilité rare d’allier travail et plaisir. Mais au-delà de ces bénéfices concrets, elle évoque une transformation intérieure : "Je suis devenue une personne consciente des différentes réalités qui forment notre monde" affirme-t-elle.
Les défis quotidiens de ce mode de vie :
Le nomadisme digital n’est pas sans ses défis. Stéphanie Desquerre détaille comme obstacles quotidiens : l’absence de logement fixe, l’effort permanent d’adaptation à de nouveaux environnements, et la solitude qui accompagne souvent cette liberté.
Elle observe que "les relations ne restent que temporaires" et que cela peut ébranler "toute la base de notre identité".
Ce bilan, à la fois honnête et nuancé, met en lumière les contrastes d’une vie nomade : un mélange de découverte, de liberté, mais aussi de sacrifices personnels.
4.6 - Une évolution continue
Stéphanie Desquerre clôt le chapitre 4 de son livre "Du burnout à digital nomade" en décrivant comment le fait de devenir digital nomade s’est finalement avéré être un véritable parcours de transformation personnelle.
En effet, bien plus qu’un simple mode de vie, le nomadisme digital, dit-elle, l’a guidée naturellement vers le développement personnel. La jeune femme a ainsi appris à mieux comprendre ses émotions, ses besoins, et les valeurs qui lui sont essentielles.
L’auteure établit un lien entre sa dépression passée et son cheminement actuel. Pour elle, la dépression n’est que "le début". C’est une opportunité pour l’introspection et la croissance intérieure :
"J’ai compris que le chemin vers la connaissance de soi commence avec la dépression. Ce n’est pas la fin, en réalité ce n’est que le début. J’ai compris que c’est en fait une invitation que la vie nous envoie pour entrer en nous et regarder ce qu’il s’y passe. J’ai compris que pour aller mieux, il faut comprendre ce que l’on a mal fait, ou que l’on aurait pu faire mieux, dans le respect de soi. J’ai compris qu’il existe des solutions, et que lorsqu’on les applique, ces solutions fonctionnent."
Grâce à ce processus, Stéphanie Desquerre dit avoir développé une nouvelle vision du monde, centrée sur "la beauté de ce qui nous entoure, sur des valeurs de liberté, de respect et de soutien".
Elle termine sur une note d’espoir et de résilience. Si son quotidien reste parfois difficile, elle a appris à faire de son mental un allié plutôt qu’un ennemi.
Elle rappelle enfin que la guérison demande patience et bienveillance envers soi-même. Et que dans ce processus, chaque étape, aussi imparfaite soit-elle, contribue à une évolution continue.
Chapitre 5. Transformation intérieure
5.1 - Hypersensibilité
Dans le dernier chapitre de son livre "Du burn-out à digital nomade", Stéphanie Desquerre commence par partager les effets radicaux de sa transformation après son burn-out.
Autrefois forte et extravertie, elle se découvre désormais hypersensible et introvertie. Cette évolution, bien que déstabilisante, lui laisse entrevoir une nouvelle perspective sur elle-même et sur ses limites.
Elle confie à quel point cette sensibilité impacte aujourd’hui sa vie professionnelle. Pour Stéphanie, ce blocage n’est pas un obstacle, mais une forme de protection naturelle, un mécanisme pour éviter de retomber dans les mêmes pièges :
"Ce burnout m’a marqué dans ma chair et il m’est aujourd’hui impossible de repartir dans un rythme effréné dicté par le travail. Je n’y arrive plus, c’est au-dessus de mes forces. Cette sensation que je ressens est comme un blocage mécanique qui m’empêche d’avancer à chaque fois que je dois faire quelque chose qui ne me convient pas. Je n’arrive plus à me forcer. Ce n’est pas de la paresse, il s’agit ici d’une autre sensation difficile à expliquer, une sorte de détachement puissant que je ne peux contrôler. Finalement serait-ce une ceinture de sécurité imposée par le corps et l’esprit, afin que nous ne puissions pas reproduire les mêmes erreurs ? Je le pense bien."
Cette hypersensibilité, bien qu’exigeante, devient ainsi un garde-fou pour orienter Stéphanie vers un mode de vie plus aligné avec ses besoins profonds.
5.2 - Reconnaître qu’on est en dépression
L’auteure insiste sur une étape essentielle du processus de guérison : accepter son état. "Vous n’allez pas bien, le monde n’a plus la saveur d’autrefois, la vie est devenue difficile, acceptez-le", conseille-t-elle. C’est le premier pas vers une transformation, un chemin exigeant mais profondément libérateur.
Ensuite, elle prévient : la guérison est possible mais elle nécessite patience et travail sur soi.
Pour exemple, son propre parcours : il lui aura fallu plus de trois ans pour s’en sortir, soit bien au-delà des six mois qu’elle espérait au départ.
Enfin, avec un ton honnête et bienveillant, elle adresse un message d’espoir à ceux qui souffrent de burnout :
"Réussir à enclencher cette transformation intérieure demande du temps, de la patience et de l’observation. Cela ne se fera pas en un jour, mais avec de l’amour envers vous-même et de l’écoute, vous y parviendrez.".
5.3 - Qu’est-ce que l’amour de soi ?
Nous reconnecter à notre Enfant Intérieur
Stéphanie Desquerre nous parle ensuite d’amour de soi à travers le concept de l’Enfant Intérieur. Elle explique que cette partie de nous, âgée symboliquement de 3 à 7 ans, représente "la partie la plus pure de nous, la partie innocente et authentique" de notre être :
"L'Amour de Soi, c’est tout d’abord réaliser que l’on a un Être qui vit à l’intérieur de nous. Cet Être Intérieur est en réalité un petit enfant. Un enfant qui a entre 3 et 7 ans. Et cet enfant, c’est vous lorsque vous étiez petit(e)… Est-ce que vous le voyez ? Cet enfant est ce que l’on appelle votre Enfant Intérieur. Et il existe toujours… L’Amour de Soi, c’est réaliser que l’on a une responsabilité envers cet Enfant Intérieur : la responsabilité de le protéger. Pour protéger cet Enfant Intérieur, il faut en premier lieu comprendre ce qu’il est réellement."
Cet enfant innocent que nous étions et qui vit toujours en nous "constitue notre essence et il continue d’exister dans notre cœur, dans nos ressentis, dans nos réactions, dans notre mémoire" fait remarquer l’auteure. Mais en grandissant, la société occidentale nous fait perdre contact avec cette essence fondamentale.
La digital nomade revient sur sa découverte de la méthode de l’Enfant Intérieur, une pratique qui consiste à établir un dialogue intérieur avec notre enfant intérieur via la visualisation.
Cette approche lui a permis, révèle-t-elle, de se reconnecter avec ses véritables émotions et besoins. Stéphanie Desquerre met ici en évidence le décalage souvent constaté entre notre perception de nous-mêmes (le Conscient) et nos comportements profondément et subtilement dictés par l'Inconscient.
L’amour de soi : un acte de bienveillance envers soi-même et les autres
Les signes du manque d’amour
L'auteure détaille ensuite les manifestations du manque d'amour de soi dans la vie quotidienne : l’incapacité à dire non, le dépassement constant de ses limites ou encore la négligence de ses propres besoins.
L’amour de soi est un équilibre à trouver et à cultiver
Elle insiste sur une distinction cruciale : l’amour de soi n’est pas de l’égoïsme. C’est un équilibre à trouver pour se respecter tout en respectant les autres.
Pour Stéphanie Desquerre, l’amour de soi est une relation à entretenir avec autant de soin que nos relations aux autres. C’est d’ailleurs devenu, pour elle, une priorité désormais : "lorsque je suis équilibrée, je peux alors être la meilleure personne pour le monde et les gens qui m’entourent" écrit-elle.
L’amour de soi, c’est "reprendre son pouvoir personnel"
Enfin, pour l’auteure, l’amour de soi est un cheminement vers une meilleure connaissance de soi et la capacité à poser des limites saines, un acte de bienveillance envers soi-même et les autres..
5.4 - Établir des limites saines
Autrefois, Stéphanie Desquerre pensait n'avoir aucune limite. Cette perception, elle l’associe à un perfectionnisme ancré dans un besoin de plaire et une peur du rejet. Des mécanismes, explique-t-elle, qui prennent racine dès l’enfance : "Pour obtenir la validation et le consentement de ses parents, l'enfant fera tout pour leur plaire".
Au fil de son cheminement, la jeune nomade a appris à reconnaître l’importance des limites personnelles.
Elle nous dévoile alors sa liste personnelle de limites, organisée en plusieurs domaines : respect, liberté de penser, limites émotionnelles, stabilité affective, intimité et travail. Pour elle, ces limites ne sont pas des barrières, mais plutôt "le respect que nous avons envers nous-mêmes", une manière de préserver notre bien-être et notre équilibre intérieur.
5.5 - Le rôle de la culpabilité
Dans cette partie du livre "Du burn-out à digital nomade", Stéphanie Desquerre analyse la culpabilité qu’elle voit comme une émotion inutile et paralysante, qui nous prive de notre pouvoir personnel.
Elle en retrace l’origine dans l’enfance, lorsqu’un entourage parfois maladroit invalidait nos émotions, nous apprenant ainsi à associer nos sentiments à un poids injustifié de responsabilité.
Pour surmonter cette émotion envahissante, l’auteure propose une approche centrée sur le concept de l’Enfant Intérieur : "Vous êtes uniquement responsable d'exprimer votre vérité et vos sentiments" indique-t-elle.
Elle partage un mantra qui l’a aidée dans son propre cheminement : "La culpabilité est une émotion inutile, elle ne sert personne." Cet état d’esprit lui a permis de se libérer progressivement de ce fardeau, en s’autorisant à vivre selon ses valeurs et ses besoins authentiques.
Enfin, Stéphanie Desquerre conclut sur le sujet en redéfinissant la culpabilité, non pas comme un poids à porter, mais comme un signal. Une invitation à prendre conscience de nos valeurs, à les ajuster si nécessaire, et à agir avec davantage de compassion envers soi-même et les autres.
5.6 - Yoga et méditation
Stéphanie Desquerre présente le yoga comme un puissant outil d’union entre le corps et l’esprit. Elle rappelle qu’il existe une trentaine de types de yoga, chacun offrant des bienfaits spécifiques. À travers sa propre pratique, elle a redécouvert une connexion intime avec son corps : "en pratiquant le yoga, j’ai repris possession de mon corps."
L’auteure poursuit en abordant la méditation : d’abord, elle déconstruit l’idée reçue qu’il s’agit de "faire le vide". Pour elle, méditer consiste plutôt à ramener son attention sur l’instant présent, en s’appuyant sur des ancrages comme la respiration. Pour elle, une pratique régulière, même de cinq minutes par jour, peut avoir des effets significatifs sur le stress et l'anxiété.
En combinant yoga et méditation, la jeune femme trouve ainsi un équilibre apaisant et durable, une meilleure harmonie intérieure.
5.7 - Écouter son corps
Stéphanie Desquerre décrit le corps comme une "source abondante d'informations sur notre état émotionnel et physique". Elle explique comment le yoga et la méditation l’ont aidé à réaliser que ses douleurs physiques étaient, en réalité, souvent des manifestations de tensions émotionnelles refoulées.
La jeune femme partage sa routine matinale, devenue un rituel essentiel pour préserver son équilibre. Chaque jour commence par un scan corporel au réveil, suivi des "Cinq Tibétains" (postures de yoga dynamiques) et d’une courte méditation. Stéphanie met également l’accent sur l’importance d’un rythme de sommeil régulier, expliquant que son corps ne manque jamais de la rappeler à l’ordre quand elle s’en écarte : "Lorsque je manque à cette écoute quotidienne, je suis rapidement rattrapée par mes démons."
Pour l’auteure, il est primordial de développer cette écoute corporelle quotidienne pour prévenir les rechutes de burnout et mieux gérer son bien-être. Porter une nouvelle attention à son corps a, nous dit-elle, non seulement transformé son rythme de vie, mais aussi modifié en profondeur ses habitudes et sa relation à elle-même. C’est, en somme, un vrai apprentissage vers une meilleure harmonie entre le corps et l’esprit.
5.8 - Comprendre les émotions
Cette partie du livre "Du burn-out à digital nomade" propose une analyse approfondie du système émotionnel.
La mécanique émotionnelle
Stéphanie Desquerre clarifie la différence entre les émotions, qui sont des réactions physiologiques immédiates, et les sentiments, qui sont des états affectifs durables nourris par nos pensées.
L’auteure identifie six émotions primaires (joie, peur, tristesse, colère, surprise, dégoût) et leurs nombreuses déclinaisons secondaires, toutes jouant un rôle essentiel dans notre équilibre psychologique.
La répression émotionnelle : un fardeau invisible
Elle met en garde contre la répression des émotions, expliquant qu’elles ne disparaissent pas, mais restent "stockées et enregistrées dans nos cellules". Cette accumulation peut provoquer des réactions disproportionnées lors d’événements futurs.
La solution, selon elle, est d’accepter et d’exprimer ses émotions plutôt que de les enfouir. Cette démarche implique de reconnaître notre vulnérabilité :
"Vous devez accepter d’être vulnérable. Vous devez affronter ce raz-de-marée d’émotions, pleurer, crier, courir, afin de les faire sortir de votre corps. Vous devrez le faire plusieurs fois, à chaque fois que le moment se présentera. Ne retenez rien, laissez-les venir, lâchez tout. Isolez-vous si vous le souhaitez. Et honorez ces larmes."
L’auteure appelle à trouver nos propres moyens personnels pour extérioriser ces émotions :
"Répétez cela autant de fois qu’il le faudra, pour la colère, la tristesse, la frustration, la peur, l’impuissance, la saturation, l’angoisse, l’écœurement, et toutes les émotions primaires et secondaires que vous rencontrerez. Toutes les manières sont bonnes pour faire sortir les émotions, trouvez celle qui est bonne pour vous : les larmes, une conversation (avec un ami, ou un professionnel), du sport, de la musique, de la méditation, etc. (…) Ne réprimez pas vos émotions, car elles continueront de vous triturer de l’intérieur et de vous faire du mal. Elles continueront de vous contrôler et de vous empêcher d’aller mieux. Ce travail est à faire consciemment, jour après jour, pour accélérer la guérison."
Pleurer pour guérir : une expérience libératrice
Partageant sa propre expérience de guérison, Stéphanie Desquerre raconte :
"Une tristesse profonde s’était installée en moi, que je n’avais pas exprimée. J’avais perdu ma joie de vivre, je ne riais plus, je ne jouais plus, je ne me reconnaissais plus. (…) Difficilement, je me suis mise à accepter de pleurer et d’être triste, car je ne pouvais plus retenir mes larmes, je n’en pouvais plus. Ainsi, je pleurais sur une musique douce, sans savoir pourquoi, longtemps après le début de mon burnout. Je pleurais lorsque je ressentais de la tristesse chez quelqu’un d’autre, car elle me renvoyait inconsciemment à la mienne. J’ai accepté de pleurer plusieurs fois, dans le cabinet d’une kinésiologue ou dans mon lit tard le soir. J’ai pleuré de toutes mes larmes, de tout mon cœur, en sachant consciemment que je le faisais pour libérer cette émotion. Puis au bout d’un moment, je ne saurais pas bien décrire cette sensation, la profondeur de ma douleur a commencé à diminuer. La sensation est devenue plus faible, comme supportable. Mes larmes ont commencé à s’espacer : plus je libérais l’émotion, plus la tristesse partait."
5.9 - Se reconnecter au moment présent
Stéphanie Desquerre explore le concept du moment présent, en s’appuyant notamment sur les enseignements d'Eckhart Tolle. Elle explique comment le burnout nous enferme avec un cercle vicieux de pensées négatives, accélérées par un mental hyperactif dont nous sommes prisonniers.
Une révélation clé, selon l’auteure, est la prise de conscience que "nous ne sommes pas notre mental". Et que le futur est une illusion, une projection mentale dépourvue de substance réelle.
Pour sortir de la souffrance, la solution que propose Stéphanie est alors d’observer nos pensées sans jugement, comme un spectateur détaché. Et de les accepter, d’accepter de s’ancrer dans le présent tel qu’il est :
"Plus on est à même de respecter et d'accepter le moment présent, plus on est libéré de la douleur".
Cette acceptation ne signifie pas la résignation, mais une manière de trouver la paix dans ce qui est, ici et maintenant.
Elle conclut en soulignant que cette transformation nécessite, en revanche, une pratique régulière et disciplinée. Ce peut être à travers la méditation, le yoga ou toute activité physique ou créative.
5.10 - Prévention de l’épuisement professionnel
Stéphanie Desquerre propose des pratiques simples à mettre en place au travail pour éviter de retomber dans les pièges de l’épuisement et donc prévenir le burnout :
Poser des limites professionnelles claires, en apprenant à reconnaître ses propres besoins et à préserver ses ressources.
Apprendre à déléguer et à dire non, deux compétences souvent négligées mais essentielles pour éviter de s’épuiser à vouloir tout contrôler.
Intégrer des pauses régulières dans la journée de travail, afin de recharger ses batteries
Adopter une routine d'exercice physique, bénéfique pour évacuer le stress accumulé.
Avec ces conseils simples mais efficaces, l’auteure nous encourage chacun à prendre soin de nous et à veiller à ce que nos exigences professionnelles ne compromettent pas notre bien-être personnel.
5.11 - Autres astuces au quotidien
Pour le quotidien, Stéphanie Desquerre liste d’autres habitudes simples telles que : adopter une routine matinale, célébrer les petites victoires, pratiquer la pensée positive, prendre nos distances avec les personnes toxiques, nous octroyer des temps de lectures inspirantes, des moments dans la nature ou encore faire des projets et revoir nos priorités de vie.
Le mot de la fin
Dans la conclusion de son ouvrage "Du burn-out à digital nomade | Comment faire de la dépression un outil puissant de transformation", Stéphanie Desquerre réaffirme que guérir d’un burnout passe nécessairement par un processus de transformation intérieure. Il s’agit d’un chemin jalonné de patience et de bienveillance envers soi-même qui s’accomplit étape par étape.
L’auteure partage aussi ici le concept bouddhiste d'impermanence, qui lui a permis de comprendre que sa dépression, bien qu'accablante, n'était pas éternelle.
Trois ans après son burn-out, Stéphanie témoigne de sa propre évolution : "Je suis une version de moi-même beaucoup plus forte et beaucoup plus équilibrée." Sa vie actuelle de digital nomade, bien qu’empreinte de défis, est désormais un équilibre entre plaisir et introspection, basé sur une écoute consciente de son monde intérieur.
Le livre se termine sur une invitation à embrasser le changement et à cultiver la sérénité en soi : Stéphanie Desquerre nous encourage, en effet, nous lecteurs, à nous écouter, à nous transformer, à nous choisir et à nous aimer. Et à apprendre à "naviguer à travers nous", car écrit-elle, c’est dans cette expérience que nous trouverons enfin la paix.
Conclusion de "Du burnout à digital nomade | Comment faire de la dépression un outil puissant de transformation" de Stéphanie Desquerre
Trois grands enseignements à retenir de ce livre
- Le burn-out n'est pas une fin mais un nouveau départ
Stéphanie Desquerre démontre avec conviction que le burn-out, bien que douloureux, peut devenir un formidable catalyseur de transformation personnelle.
À travers son parcours, de son effondrement en Nouvelle-Zélande à sa renaissance, l'auteure témoigne de la manière dont cette épreuve l'a poussée à se remettre en question et, finalement, à adopter un mode de vie plus authentique, lui permettant de reconstruire une vie plus alignée.
- La guérison d’une dépression passe par une véritable transformation intérieure
L’auteure souligne que la guérison ne se limite pas à un simple rétablissement, mais nécessite un travail intérieur en profondeur.
En se reconnectant à son Enfant Intérieur, en pratiquant la méditation et en acceptant ses émotions, elle rappelle l’importance de la patience, de la bienveillance envers soi-même, et de l’adoption d’outils quotidiens pour avancer sur le chemin du mieux-être.
- Devenir digital nomade libère des contraintes traditionnelles du travail et ouvre la voie vers plus de sens et de liberté
Stéphanie Desquerre présente le digital nomadisme comme une solution concrète pour retrouver du sens et de la liberté.
En partageant son expérience de création d’une activité d’assistante virtuelle, la jeune nomade digitale montre qu’il est possible de construire une vie professionnelle en harmonie avec ses valeurs et aspirations. Cela nécessite toutefois de bien redéfinir ce que représentent pour nous certaines composantes essentielles comme celle de la notion de succès ou encore d’épanouissement.
Pourquoi lire "Du burn-out à digital nomade"
"Du burnout à digital nomade" est une histoire de vie personnelle, pleine d’authenticité. Mais au-delà du récit, c’est aussi un livre de résilience qui combine inspiration et développement personnel pour nous montrer comment transformer les épreuves en opportunités de croissance.
Voici plus précisément deux raisons principales qui font de ce livre une lecture incontournable :
Sa grande sincérité et sa profondeur d’âme :
Stéphanie Desquerre se dévoile avec une authenticité désarmante, partageant des moments de vie marqués par sa vulnérabilité. Sans fard ni artifice, elle n’hésite pas à mettre en lumière les facettes humaines et fragiles de son parcours. C'est probablement ce qui fait que vous ayez vécu un burn-out ou non, la sincérité, les valeurs et l’intelligence d’esprit qui émanent de ce récit sauront vous toucher et résonner avec vos propres expériences.
Ses enseignements précieux sur la résilience et la croissance personnelle :
Au-delà d’un simple récit de vie, "Du burnout à digital nomade" est une véritable ode à la résilience. Stéphanie Desquerre réussit le pari de transformer son expérience douloureuse en un manuel d’espoir et d’action. Ce livre inspirera et encouragera donc quiconque souhaite donner un nouveau sens à sa vie personnelle et professionnelle. Vous y découvrirez nos incroyables capacités à évoluer, à grandir, et à rebondir face aux épreuves.
Conclusion : que vous soyez en plein burn-out, en quête de reconversion ou simplement à la recherche de plus de liberté dans votre vie professionnelle, le livre "Du burnout à digital nomade" vous insufflera certainement l’envie de vous reconstruire ou d’avancer vers vos objectifs de changement.
Points forts :
Un témoignage authentique et touchant qui résonne avec les réalités et questionnements de notre époque.
Des conseils pratiques et concrets pour sortir du burnout professionnel et personnel ou en éviter ses pièges.
Un contenu holistique alliant développement personnel, réflexion en matière de reconversion professionnelle et histoire de vie.
Un récit inspirant pour ceux qui envisagent de devenir digital nomade.
Points faibles :
Pas vraiment un point faible mais plutôt une mise en garde : ce récit de transformation inspire, donne espoir, réconforte et dégage des pistes pour amorcer un changement, mais ne se veut pas un ouvrage thérapeutique qui vous accompagnerait dans une démarche de soin pour sortir de la dépression.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu "Du burnout à digital nomade | Comment faire de la dépression un outil puissant de transformation"? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Stéphanie Desquerre "Du burnout à digital nomade | Comment faire de la dépression un outil puissant de transformation"
Visitez Amazon afin d'acheter le livre de Stéphanie Desquerre "Du burnout à digital nomade | Comment faire de la dépression un outil puissant de transformation"
 ]]>
]]>Résumé de "Steve Jobs" de Walter Isaacson : la biographie autorisée de l'un des entrepreneurs les plus doués du XXe siècle, qui a changé notre rapport aux technologies numériques — un best seller du New York Time ayant donné lieu à un film avec Michael Fassbender en vedette.
Walter Isaacson, 2011, 453 pages.
Titre original : Steve Jobs (2011).
Chronique et résumé de "Steve Jobs" de Walter Isaacson
Introduction — La genèse de ce livre
Walter Isaacson raconte que Jobs l'a appelé en 2004, en lui demandant d'écrire sa biographie. Au départ, l'écrivain refuse. Selon lui, la personnalité de Steve Jobs fait controverse et sa carrière n'est pas encore complètement établie.
Toutefois, lorsque Steve Jobs tombe malade du cancer pour la deuxième fois, Walter Isaacson accepte la mission en se disant que c'est maintenant ou jamais. En deux ans, il réalise une quarantaine d'entretiens et de conversations — avec le principal intéressé, bien sûr, mais aussi avec son entourage (amis, famille, collègue).
Selon l'auteur, ce livre est une biographie qui peut inspirer chacun d'entre nous, car elle "est pleine de leçons sur l'innovation, le caractère, le leadership et les valeurs".
1 — L'enfance : abandonné puis choisi
Steve Jobs a été adopté lorsqu'il était enfant.
Ses parents biologiques, Joanne Schieble et Abdulfattah Jandali, préfèrent l'abandonner car ils vivent une situation familiale compliquée. Ils ne sont pas mariés et le père de Joanne désapprouve fortement leur relation. Lorsque celle-ci tombe enceinte, la décision de se séparer de l'enfant est prise.
Mais le couple pose une condition : que les parents adoptifs aient étudié à l'université.
Bien que ce ne soit pas le de Clara et Paul Jobs, le petit Steve entre dans cette nouvelle famille. Ce sont des travailleurs et, surtout, ils promettent de s'investir complètement dans la vie de leur fils adoptif.
Dès son enfance, Steve Job sait qu'il est adopté : Clara et Paul lui disent même qu'il est, en fait, un enfant spécial parce qu'ils l'ont choisi. Ce sentiment d'élection est un puissant moteur de confiance en soi.
À l'école, l'enfant s'ennuie. Il trouve peu de sollicitations.
C'est en dehors de l'école, dans la Silicon Valley, qu'il découvre ses premiers hobbies. Il apprend les rudiments de mécanique avec son père, Paul, qui répare des voitures. Il se passionne aussi pour l'électronique au sein du Hewlett-Packard Explorers Club voisin.
Vivant au cœur de la révolution informatique, au moment même où les premiers ordinateurs y sont assemblés (par Hewlett-Packard, justement), Il tourne naturellement toute son attention vers ce nouveau domaine en plein boom.
2 — Un couple improbable : les deux Steve
Dans ce chapitre, Walter Isaacson relate la rencontre entre Steve Jobs et Steve Wosniak. Celui-ci a cinq ans de plus que l'autre Steve. Pourtant, ils font connaissance autour d'intérêts communs (l'électronique et l'informatique). Steve Wosniak est déjà à l'université mais Steve Jobs, lui, est toujours au lycée.
Un jour, les deux amis veulent répondre à une annonce trouvée dans un journal. Il s'agit de créer un dispositif permettant de passer des appels interurbains gratuitement. Au départ, ils voient cela comme une blague et comme un passe-temps. Mais ils réussissent pourtant à créer des "Blue Box" (boîtes bleues), puis à les vendre (pour 150 $/pièce).
C'est le début d'une fructueuse — et tumultueuse — relation d'affaires.
D'un côté, Steve Jobs, assez manipulateur et très ambitieux, plutôt tourné vers le design et le marketing (comme cela apparaîtra plus tard) ;
De l'autre, Steve Wosniak, plus calme, profondément geek et s'intéressant avant tout à la conception technique.
Un soir, dans une pizzeria de Sunnyvale, quelqu'un leur vole une Blue Box en les menaçant avec une arme à feu. C'est un choc. Mais cela ne décourage pas les amis de continuer à travailler ensemble et à développer d'autres projets.
Pour Steve Jobs :
« Sans les Blue Boxes, il n'y aurait pas eu de pomme. » (Steve Jobs, Chapitre 2)
3 — Tout lâcher : harmonie, ouverture, détachement…
À la fin de ses études secondaires, Steve Jobs se met en couple avec Chrisann Brennan, une jeune fille cool, artiste peintre. Ensemble, ils explorent les trips d'acide (LSD) et leur sexualité. Ils partagent même, durant tout un été, un petit studio, où ils expérimentent la vie commune.
Lorsque Steve Jobs entre à l'université, il est conscient de réaliser le souhait de sa mère biologique, qui souhaitait ardemment le voir faire des études supérieures. Pourtant, il s'ennuie vite et son caractère, qui devient de plus en plus affirmé, dérange.
Il quitte le Reed College (son université) rapidement. Il a l'impression de ne rien apprendre. Cela dit, il se consacre à quelques cours en élève libre, tels que la calligraphie. C'est également à cette époque qu'il se lie d'amitié (de courte durée) avec un adepte des spiritualités orientales et, notamment, de l'hindouisme.
4 — Atari et l'Inde : du zen et de l'art de concevoir des jeux
Après cette expérience universitaire, Jobs revient chez ses parents à Los Altos. En cherchant son premier emploi, il s'intéresse à la société de jeux vidéo Atari. Sa personnalité fait le reste : il convainc l'ingénieur en chef Al Alcorn qui lui offre un poste de technicien.
Steve Jobs est ainsi l'un des cinquante premiers employés d'Atari.
Mais ses excentricités ne font pas l'unanimité. Au niveau social, les manières du jeune homme ne laissent pas indifférent. Hippie, son comportement et son hygiène détonnent dans l'entreprise…
Après quelques mois seulement, il décide de partir pour l'Inde. Il veut y rejoindre un ami : Daniel Kottke.
À son retour, le chef d'Atari, Nolan Bushnell, le met au défi de développer une version solo du célèbre jeu de l'entreprise : Pong. Il recevra même un bonus, lui dit son supérieur, s'il peut minimiser les puces informatiques utilisées.
C'est là que Steve Jobs va faire appel à son vieux camarade, Steve Wosniak.
À l'époque, celui-ci travaille chez Hewlett Packard (également dans la Silicon Valley). En quatre jours seulement, les deux Steve créent le programme et parviennent à miniaturiser les puces !
Dans un entretien réalisé par Walter Isaacson, Steve Wosniak se souvient que Steve Jobs ne l'a pas rémunéré justement. En fait, alors qu'il avait reçu le bonus promis par Atari, il ne l'a pas partagé avec son ami. Toutefois, cela ne compromet pas leur collaboration.
5 — L'Apple I : allumage, démarrage, connexion
Dans ce chapitre, Walter Isaacson raconte l'histoire de la naissance d'Apple.
Il rappelle que la Silicon Valley est alors électrisée entièrement par le projet de développer et de démocratiser les ordinateurs qui sont encore, à l'époque, des machines réservées à quelques élites et passionnés.
Steve Wozniak est particulièrement fasciné par l'arrivée des microprocesseurs sur le marché. Il observe des amateurs créer leurs propres ordinateurs à partir de ces nouveaux composants et veut faire de même. C'est en y travaillant qu'il a l'idée de créer un ordinateur personnel qui pourrait être utilisé par tous.
C'est l'origine d'Apple I, l'ordinateur.
Steve Wozniak le construit avec l'intention d'en donner les plans de fabrication gratuitement, en s'inspirant de l'éthique des hackers. Toutefois, Steve Jobs parvient à convaincre Steve Wosniak qu'il sera plus profitable de les vendre.
C'est l'origine d'Apple Computers, l'entreprise.
Selon l'histoire racontée ici, le nom Apple aurait été donné tout simplement à la suite d'une visite de Steve Jobs dans une ferme de production de pommes.
L'entreprise est un succès ! En 30 jours seulement, Apple fait des bénéfices substantiels qui lui permettront de développer son activité de façon exponentielle.
6 — L'Apple II : l'aube d'une ère nouvelle
L'enthousiasme du succès initial doit maintenant faire place à une vision rationnelle et pragmatique. Bref, l'entreprise doit se solidifier de façon durable autour de produits phares.
Steve Jobs est ici à la manœuvre. Il se rend compte que le prochain ordinateur, l'Apple II, doit "être emballé dans un produit de consommation entièrement intégré". En somme, il faut que le client achète un produit complet, facile d'accès et au packaging attrayant.
Pour l'aider dans cette tâche, le jeune entrepreneur embauche Mike Markkula.
Cette approche s'avère être un grand succès, puisque l'Apple II se vend à plus de six millions d'unités dans le monde. L'entreprise à la pomme décolle pour de bon !
Selon Walter Isaacson :
"Plus que toute autre machine, [l'Apple II] a lancé l'industrie de l'ordinateur personnel;"
Encore une fois, la paire des deux Steve fonctionne.
Steve Wozniak fournit le talent et l'expertise techniques ;
Steve Jobs tient les rennes de l'entreprise et apporte ses idées sur l'expérience du consommateur et le design des produits.
7 — Chrisann et Lisa : celui qui a abandonné…
Retour sur l'histoire personnelle. La petite amie de Steve Jobs, Chrisann, tombe enceinte.
Le jeune homme, complètement tourné vers sa réussite professionnelle, refuse toute implication. Il va même jusqu'à refuser de reconnaître la paternité de la petite Lisa et accuser l'un de ses amis d'être le père.
Cette réaction met un terme à la relation entre les deux amants.
Plus tard, Chrisann réalise un test qui démontre la paternité de Steve Jobs. À partir de ce moment, celui-ci se décide à payer une pension alimentaire. Mais il agit contraint par les événements et ne s'implique toujours pas dans la relation avec sa fille.
Plus tard, Steve Jobs exprimera des remords face à la façon dont il s'est comporté pendant cette période. Comme pour se racheter, il concevra même un ordinateur du nom de sa fille…
8 — Xerox et Lisa : les interfaces graphiques
Après ce nouveau succès entrepreneurial, Steve Jobs est persuadé qu'il doit développer un produit qui portera sa griffe, son nom. En effet, dans le monde informatique et dans l'entreprise elle-même, il est clair que c'est d'abord Steve Wosniak qui est crédité pour le résultat final de l'Apple II.
De nouveaux projets voient le jour :
L'Apple III ;
Lisa, un nouvel ordinateur personnel doté d'une interface graphique (GUI pour graphic user interface) et d'une souris.
Ces deux nouveaux modèles d'ordinateurs sont des échecs commerciaux.
Pourtant, il est indéniable que les idées de Steve Jobs se révèlent porteuses. En effet, c'est grâce à lui que se forme peu à peu l'environnement bureautique et numérique que nous connaissons aujourd'hui.
Mais l'entrepreneur ambitieux et capricieux devra attendre son heure. Malgré tous ses efforts, la direction d'Apple décide de sanctionner ces échecs et le dépossède de ses fonctions exécutives ; il n'a plus la main sur la conception des ordinateurs.
Il s'en sent très frustré. C'est, de son point de vue, la première trahison professionnelle qu'il subira.
9 — Passer en Bourse : vers la gloire et la fortune…
Apple entre en bourse moins de quatre ans après sa création. Un exploit !
À la fin des années 1980, l'entreprise est évaluée à 1,79 milliard de dollars. Pour Steve Jobs, qui n'a que 25 ans, cela signifie une fortune de 256 millions de dollars…
Comment appréhender cette richesse quand vous êtes un jeune hippie intéressé aux spiritualités orientales ? Dans ce chapitre intéressant, Walter Isaacson étudie la relation de l'entrepreneur à la pomme avec la richesse.
D'un côté, Steve Jobs a une vision du monde anti-matérialiste. Mais de l'autre, il aime profondément certains objets de consommation haut de gamme, tels que les Porsche, les couteaux Henckels ou les pianos Bösendorfer. Il cherche avant tout la beauté dans des objets de luxe ; c'est un esthète.
Qui peut aussi être un requin. Lors de l'entrée en bourse d'Apple, Steve Jobs interdit à de nombreux employés de la première heure d'acheter des options. Il se les réserve.
À l'inverse, Steve Wozniak offre généreusement un nombre important de ses propres actions pour compenser le comportement égoïste de son compagnon.
10 — Le Mac est né : vous vouliez une révolution
Le Macintosh ou Mac est certainement l'ordinateur le plus connu de sa génération. Vous le connaissez sans doute mieux que les Apple I et II. Le voilà, le premier grand succès commercial véritablement signé Steve Jobs !
Pourtant, en réalité, ce projet était initialement dirigé par Jeff Raskin. Ce spécialiste talentueux des relations homme-machine, d'abord embauché pour écrire un manuel pour l'Apple II, avait fait son chemin dans la hiérarchie, au point d'être aux commandes du projet.
D'ailleurs, c'est lui qui donna son nom au Macintosh, qui est en fait sa variété de pomme préférée !
Mais Steve Jobs, grâce à ses qualités rhétoriques et à son ambition, reprend peu à peu le contrôle et met toutes les cartes de son côté pour faire du Mac une véritable "révolution technologique".
11 — Le champ de distorsion de la réalité : imposer ses propres règles du jeu
Walter Isaacson décrit en effet un phénomène intéressant concernant Steve Jobs. Celui-ci est capable, selon ses propres collègues, de créer un "champ de distorsion de la réalité" grâce auquel il parvient à convaincre les gens et à les faire travailler à son avantage.
Selon l'auteur :
« À l'origine de la distorsion de la réalité se tenait la croyance de Jobs que les règles ne s'appliquaient pas à lui. »
D'où lui vient ce pouvoir et cette croyance ? Sans doute de son enfance. À force de lui avoir répété qu'il était spécial et "élu" par ses parents, Steve Jobs avait l'impression d'avoir à accomplir un destin hors norme.
En bref, le jeune entrepreneur veut être le nouvel Einstein ou Ghandi et pense pouvoir y parvenir !
Ce caractère charismatique a ses avantages et ses inconvénients.
Côté inconvénients : ses collègues se plaignent de sa vision du monde étriquée où vous êtes soit un génie, soit un abruti. Par ailleurs, Steve Jobs n'a pas peur de s'approprier les idées des autres sans leur en reconnaître le mérite.
Côté avantages : chef né, il parvient à créer des équipes talentueuses et motivées, qui veulent absolument faire partie de l'aventure Apple — malgré les désavantages !
12 — Le design : les vrais artistes simplifient
Steve Jobs a une ambition : trouver le design parfait. C'est là sa "patte" spécifique et ce qu'il espère infuser dans tous les aspects du projet Macintosh. Le Mac doit être un objet parfait et total.
"La simplicité de la conception devrait être liée à la facilité d'utilisation des produits." (Steve Jobs, Chapitre 12)
L'entrepreneur veut que les produits Apple soient intuitifs. L'expérience utilisateur doit être aisée. C'est notamment pourquoi, selon lui, il insiste sur le caractère fermé des ordinateurs Apple (impossible à modifier et incompatibles avec d'autres marques).
Mais plus important encore, Steve Jobs veut que ses ingénieurs se perçoivent comme des artistes ou des artisans à l'ancienne. Pour lui, créer un Mac est du domaine de l'art avant d'être uniquement un produit technologique.
Pour symboliser cette vision, il demande à tous les membres de l'équipe Macintosh de graver leurs noms dans chaque Macintosh, tout comme le feraient des artistes pour leur œuvre.
13 — Fabriquer un Mac : le voyage est la récompense
Pour Walter Isaacson, une autre caractéristique importante de la personnalité de Steve Jobs est sa compétitivité. Même au sein de l'entreprise, il cherche à gagner sur tous les fronts.
C'est ce qui se passe avec les projets Macintosh et Lisa. Comme il a été évincé du projet Lisa, il reporte toute son attention sur le projet Macintosh et fait tout pour que celui-ci soit sur le marché avant l'autre.
C'est pourtant le Lisa qui sera mis sur le marché avant… et qui connaîtra un échec (voir le chapitre 8).
Tous les regards se tournent déjà vers le Macintosh qui est, de fait, bien plus avancé que le Lisa. Et Steve Job en est bien plus fier.
L'anticipation est telle que le magazine Time décide de publier un article sur les coulisses du projet. L'ambitieux entrepreneur pensait devenir « l'homme de l'année » en 1982, mais, à la place, c'est le Mac lui-même qui est élu « Machine de l'année » !
14 — Entrée en scène de Sculley : le défi Pepsi
Dans le même temps, Steve Jobs recrute John Sculley, ancien président de PepsiCo, pour assumer le rôle de PDG d'Apple. Encore une fois, l'entrepreneur doit user de ses compétences rhétoriques pour le convaincre d'accepter.
Une fois en place, John Sculley et Steve Jobs deviennent très proches. Ils s'entendent si bien dans les premiers temps que la compréhension est totale. Cela dit, des querelles vont apparaître au fil du temps.
Leur premier désaccord majeur porte sur le coût du Mac.
Steve Jobs prévoit un prix à 1 995 $.
John Sculley, quant à lui, souhaite le pousser à 2 495 $, pour prendre en compte le coût des campagnes marketing.
Finalement, c'est le PDG John Sculley qui l'emporte. Steve Jobs regrettera cette décision, car elle a permis à Microsoft, selon lui, de dominer le marché pendant plus longtemps (au niveau des logiciels installés dans les ordinateurs, voir le chapitre 16).
15 — Le lancement : changer le monde
Un autre concurrent attire l'attention de Steve Jobs et de ses collègues. En effet, IBM commence à dépasser Apple sur le marché des ordinateurs personnels.
Pour résoudre ce problème, Steve Jobs décide de faire appel à la publicité. Il souhaite créer une publicité mémorable qui retienne l'attention des consommateurs comme jamais.
Pour ce faire, il en appelle au célèbre directeur Ridley Scott (réalisateur d'Alien, entre autres). Apple dépense 750 000 $ pour créer la campagne publicitaire la plus célèbre des années 1980 et peut-être du XXe siècle.
C'est la désormais mythhique publicité télévisée "1984". Celle-ci met en scène le Mac comme étant l'ordinateur anti-establishment, le moyen de contrer un pouvoir dystopique de type orwellien. Qui est la cible ? Les jeunes rebelles créatifs qui veulent se libérer de toutes les contraintes.
La publicité est diffusée au Super Bowl de 1984. C'est un événement. Considérée par certains comme la plus grande publicité télévisée de tous les temps, elle fait son effet : c'est en partie grâce à elle que le Mac devient un succès planétaire.
16 — Gates et Jobs : quand deux orbites se croisent
Revenons à Microsoft, l'autre grand concurrent de Apple. La rivalité est personnelle : Bill Gates est presque l'antithèse — sur le papier au moins — de Steve Jobs. Excepté le fait qu'ils travaillent tous dans le secteur de la tech et qu'ils sont nés en 1955, tout les sépare !
Steve Jobs est un ancien hippie à la spiritualité orientale. Il est intuitif, avec un caractère fort et désinhibé.
Bill Gates est le fils d'un riche avocat de Seattle, chrétien. Il est rationnel, doué pour le codage informatique et timide.
Au départ, la relation d'affaires officielle est bonne. Microsoft (Gates) écrit des logiciels pour le Macintosh ; essentiellement des programmes de traitement de texte et de feuilles de calcul (Word et Excel, aujourd'hui).
Cette collaboration fructueuse se grippe lorsque Bill Gates (qui est aussi un ambitieux) annonce le lancement de Windows, qui concurrence directement le système d'exploitation Mac.
Pour Bill Gates, Steve Jobs a, comme lui, pris son inspiration chez une troisième entreprise : Xerox. Il considère donc qu'il n'a rien volé à la firme à la pomme. Mais pour Steve Jobs, c'est une nouvelle trahison.
17 — Icare : à monter trop haut…
Le lancement du Mac est un véritable événement et un succès. Pour autant, les ventes se tassent après un petit temps.
L'ordinateur a en effet ses limites. Malgré son caractère novateur et son design attractif pour l'époque, il est lent et peu puissant.
Ces mauvaises performances amènent Steve Jobs sur une mauvaise pente. Il commence à être particulièrement désagréable, voire agressif avec les propres membres de son équipe. Au point que certaines personnes décident de quitter l'entreprise par sa faute.
Ces problèmes internes vont si loin que ce sera finalement lui qui sera mis à la porte !
En effet, John Sculley, pourtant ami et PDG de Apple, décide — avec l'aval du conseil d'administration — de virer Steve Jobs. Évincé de son propre business, l'entrepreneur se sent à nouveau trahi.
18 — NeXT : Prométhée délivré
Mais celui-ci rebondit. Il crée "NeXT" en finançant lui-même l'entreprise et en embauchant d'anciens employés d'Apple. Son objectif : vendre des ordinateurs et des dispositifs numériques aux écoles et aux universités.
Steve Jobs veut absolument soigner l'apparence et l'expérience utilisateur. Pour lui, du logo jusqu'au design de l'objet, les éléments esthétiques sont primordiaux.
Mais les prouesses techniques ne sont pas au rendez-vous. L'ordinateur de NeXT est un échec car ses performances ne sont pas la hauteur de ses concurrents.
19 — Pixar : quand la technologie rencontre l'art
C'est toutefois pendant cette périodre que Steve Jobs va trouver à se diversifier. Il s'intéresse de près à la division d'animation de la société de George Lucas, Lucasfilm : Pixar. Steve jobs achète 70 % de l'entreprise pour la bagatelle de 10 millions de dollars.
Au départ, l'entrepreneur n'a pas pour souhait de promouvoir le contenu animé. Il s'intéresse avant tout à la technologie qu'il pourrait exploiter et vendre. Mais c'est un nouvel échec.
Pourtant, il décide de ne pas abandonner. Lorsqu'il voit ce que les employés de Pixar sont capables de faire au niveau de l'animation, il décide tout de même de continuer à investir pour la réalisation de films.
En 1988, après avoir investi 50 millions de dollars dans la société, Pixar sort un court-métrage, Tin Toy, qui remportera l'Oscar du meilleur court métrage d'animation.
20 — Un homme comme les autres : Love is a four letter word
La vie personnelle de Jobs est également mouvementée . Plusieurs relations amoureuses marquent sa vie à cette époque :
Avec Joan Baez (la chanteuse) ;
Et Jennifer Egan (la romancière).
Après la mort de sa mère adoptive, il cherche aussi à renouer avec sa mère biologique. Il la rencontre finalement et découvre qu'il a également une demi-sœur, Mona, qui écrit et vit à Manhattan.
Steve Jobs cherche aussi à entretenir de meilleures relations avec sa fille Lisa. Mais celles-ci sont très instables. Ils se disputent, puis renouent avant de se disputer à nouveau. Il arrive qu'ils ne se parlent plus pendant des mois.
En 1989, Jobs rencontre sa future épouse : Laurene Powell. Laurene Powell est étudiante en MBA (Master of business affairs) à la Stanford Business School, où Steve Jobs est invité à prononcer un discours. C'est la rencontre.
Laurene tombe enceinte lors de leurs premières vacances en couple à Kona Village, Hawaï. Ils se marient en 1991 et organisent une cérémonie intime dans le parc national de Yosemite. Trois enfants naitront de ce mariage : Reed, Erin et Eve.
Lisa, la fille de Steve Jobs, emménagera un temps avec la famille avant d'aller à l'université de Harvard.
21 — Toy Story : Buzz et Woody à la rescousse
Dans ce chapitre, Walter Isaacson raconte comment Pixar et Disney se sont associés pour créer Toy Story, qui a été le point de départ d'un succès massif de Pixar dans l'industrie du divertissement.
C'est le PDG de Pixar, John Lasseter, qui présente l'idée du film à Disney pour que cette entreprise le distribue. L'idée est simple : c'est un film de copains sur des jouets… vivants. La plus grande crainte de ceux-ci consistant à être rejeté par leur propriétaire au profit de nouveaux jouets.
Le succès de Toy Story a donné lieu à un accord entre Disney et Steve Jobs qui durera plusieurs années.
22 — La Seconde Venue : le loup dans la bergerie
Selon Walter Isaacson :
"Au milieu des années 1990, Jobs trouvait du plaisir dans sa nouvelle vie de famille et son triomphe étonnant dans l'industrie du cinéma, mais il désespérait de l'industrie des ordinateurs personnels." (Steve Jobs, Chapitre 22)
Or, le temps du retour en grâce ne se fait plus attendre très longtemps. Chez Apple, le cours des actions est en baisse et John Sculley quitte le navire. Un nouveau PDG, Gil Amelio, le remplace. Et il fait appel à Steve Jobs en tant que consultant. Son rôle : insuffler une nouvelle dynamique à la multinationale.
Onze ans après son départ spectaculaire en 1985, Steve Jobs est nommé conseiller du PDG. Son entreprise, NeXT, est rachetée par Apple. Désormais, l'entrepreneur a les cartes en main pour jouer un nouveau coup de poker.
23 — La restauration : car le perdant d'aujourd'hui sera le gagnant de demain
Jobs commence par placer ses collègues les plus fidèles de NeXT à des postes de de direction chez Apple.
D'un autre côté, Steve Jobs s'assure des soutiens à l'extérieur. Le célèbre fondateur d'Oracle, Larry Ellison, lui déclare qu'il est disposé à acheter Apple et à l'installer à sa tête.
Steve Jobs refuse toutefois l'offre. Comme il refuse d'ailleurs de prendre les rennes en tant que PDG lorsque le conseil d'administration d'Apple l'invite à remplacer Gil Amelio. Il attend un moment plus favorable et plus sûr.
Mais l'entrepreneur exerce bel et bien son influence. Grâce à son statut, il conclut un accord historique avec Microsoft. Pour encourager la collaboration, Microsoft continuera à développer des logiciels pour le Mac. En échange, l'entreprise de Bill Gates recevra des actions Apple.
Ce pacte a mis fin à une bataille de longue haleine entre les deux géants de l'informatique et a instantanément augmenté la valeur d'Apple en tant qu'entreprise sur les marchés boursiers.
24 — Think Different : Jobs, iPDG
Steve Jobs va plus loin. Face à la crise que connait l'entreprise, il décide qu'il est temps de galvaniser à nouveau les foules grâce à une nouvelle campagne publicitaire audacieuse.
Le résultat ? La campagne publicitaire — elle aussi désormais légendaire — de "Think Different". À nouveau, Apple se positionne comme une entreprise pour les rebelles qui souhaitent exprimer leur créativité en s'opposant aux normes en place.
Steve Jobs choisit aussi de réorienter la production. Moins de nouveaux projets et de produits, mais plus de conception de produits de grande qualité.
Pour l'auteur, Walter Isaacson :
« Cette capacité à se concentrer a sauvé Apple. ».
Finalement, les efforts de Steve Jobs se révèlent payants. Un nouvel élan commercial en faveur d'Apple voit le jour et l'entreprise commence progressivement à retrouver sa valeur sur le plan financier.
25 — Principes de design : le duo Jobs et Ive
Comme auparavant, les principes esthétiques sont fondamentaux pour Steve Jobs. Celui-ci veut des produits faciles d'usage et beaux comme des œuvres d'art.
C'est pour cette raison qu'il embauche Jony Ive, un designer talentueux qui va l'aider à définir encore davantage l'essence des produits Apple. Leur collaboration durera de nombreuses années.
Obsédés par la valeur d'un design parfait et simple, ils prennent divers brevets de conception pour les produits Apple. Tout est pensé : même des choses aussi simples que l'emballage des produits sont conçues avec soin dans le but d'augmenter l'engagement des consommateurs pour le produit..
26 — L'iMac : hello (again)
Apple renaît. Grâce à la collaboration de Steve Jobs avec Jony Ive, de nouvelles idées émergent. L'iMac fait son apparition : un boîtier bleu translucide où l'on devine la mécanique de la machine, sans pouvoir y accéder.
Chaque détail a été pensé intelligemment. Faut-il un lecteur CD avec boîtier ou non ? Encore une fois, Apple cherche la précision et la perfection.
Son prix ? Environ 1 200 $. Conçu pour les utilisateurs de tous les jours. Et c'est un phénomène commercial, tout le monde en veut un à l'époque.
Lors de sa sortie en 1998, l'iMac devient l'ordinateur le plus vendu de toute l'histoire d'Apple.
27 — JOBS P-DG : toujours aussi fou malgré les années
Après le succès de l'iMac et de la campagne publicitaire "Think Different", Steve Jobs revient définitivement aux commandes d'Apple en tant que PDG.
Il n'exige qu'un salaire symbolique de 1 $, mais ne se laisse pas aller pour autant : avec 20 millions d'options d'achat d'actions en compensation, il a de quoi voir venir.
Entre-temps, Apple est devenu une entreprise globale qui a des fans dévoués dans le monde entier. Cette Apple mania, comme on le sait, n'est pas près de s'éteindre.
Bref, Steve Jobs prouve, à l'aube des années 2000, qu'il peut être à la fois un visionnaire d'affaires et un génie créatif. Et ce n'est, d'une certaine manière, que le début !
28 — Les Apple Store : genius bar et grès de Florence
Obsédé par l'expérience client, Steve Jobs envisage un espace de vente au détail où seuls les produits Apple seraient vendus. Et il le fait !
Après la construction d'un prototype en 2001 en Virginie, des magasins Apple commencent à émerger partout dans le monde. Souvent situés dans des endroits stratégiques et prestigieux, ils accueillent, dès 2004, plus de 5 000 visiteurs par semaine en moyenne.
Conçus de façon minimaliste et luxueuse, ces espaces de vente sont les premiers magasins de détail technologiques du genre. Ils sont organisés pour mettre en évidence le caractère unique des produits Apple.
À nouveau, Steve Jobs fait mouche. Il a cette capacité fascinante d'offrir à ses clients des expériences nouvelles et de créer de nouveaux désirs.
29 — Le foyer numérique : de l'iTunes à l'iPod
Et l'entrepreneur ne s'arrête désormais plus. Alors que tout le monde se met à télécharger de la musique en ligne et à la graver sur des compact-discs, lui voit plus loin.
Convaincu que la musique sera une fonction essentielle des outils numériques, il cherche le moyen de "disrupter" le secteur. C'est comme ça qu'il développe en parallèle :
iTunes, la plateforme pour télécharger de la musique en ligne de façon légale ;
l'iPod, à savoir le baladeur audio qui permet d'écouter la musique téléchargée.
C'est là, véritablement, le début de l'hégémonie d'Apple dans le domaine technologique. L'entreprise a une longueur d'avance sur tous ses concurrents.
Et l'entrepreneur pense connexion entre les appareils. C'est-à-dire : connexion entre les outils Apple. En effet, la logique commerciale est claire : si les utilisateurs peuvent transférer leur musique de l'iPod vers leur iMac (et vice-versa), il y a de bonnes chances pour que ceux-ci achètent l'ordinateur qui leur permettra de le faire.
30 — L'iTunes Store : je suis le joueur de flûte
Alors que l'iPod est devenu un énorme succès commercial, Jobs a vu le besoin de l'iTunes Store, qui contournerait le processus d'achat de musique, ajoutant ainsi à la fois légitimité et commodité à l'expérience client.
Les dirigeants de grandes maisons de disques ont eu du mal à lutter contre le piratage et les téléchargements illégaux, ils étaient donc venus chez Apple - à Jobs - pour obtenir de l'aide.
La proposition de Jobs était une plate-forme plus transparente et intégrée pour l'achat de musique, qui comprenait des téléchargements de 99 cents pour des chansons individuelles. iTunes a changé la donne pour l'industrie de la musique et, à bien des égards, a contribué à la sauver du piratage.
Au cours de sa première année d'existence, l'iTunes Store a vendu 70 millions de chansons.
31 — Music Man : la bande-son de sa vie
Dans ce chapitre, Walter Isaacson parle de l'amour de Steve Jobs pour la musique. En particulier, l'entrepreneur, ancien hippie, est un inconditionnel de :
Bob Dylan ;
Les Beatles.
Obsédé par le catalogue musical de ces artistes, il cherche à les rendre disponibles sur sa plateforme. Et il y réussit.
Pour Bob Dylan, cela s'avère plutôt facile. L'utilisateur peut s'offrir toutes les chansons du chanteur rebelle pour 199 $ seulement. Le célèbre parolier apparaît même dans une publicité pour l'iPod à l'occasion de son dernier album, Modern Times.
Pour les Beatles, c'est plus compliqué. Il faudra attendre quelques années — jusqu'en 2010 — avant de pouvoir télécharger leur musique via iTunes.
Par ailleurs, U2, le célèbre groupe de rock irlandais, s'associe à Apple pour promouvoir :
Leur album How to Dismantle an Atomic Bomb ;
La sortie d'un iPod spécial.
Enfin, l'auteur mentionne la passion de Steve Jobs pour un autre artiste, plus classique : Jo-jo Ma. Ce violoncelliste virtuose jouera aux obsèques de l'entrepreneur quelques années plus tard.
32 — Les amis de Pixar : … et ses ennemis
Steve Jobs, qui possède Pixar, veut conclure un accord avec Disney. Dans ce nouvel accord :
Disney achète Pixar ;
Mais Pixar conserve sa propre identité indépendante.
Après la conclusion de l'accord, Jobs a déclaré :
"mon objectif a toujours été non seulement de fabriquer d'excellents produits, mais aussi de construire de grandes entreprises […] nous avons gardé Pixar comme une grande entreprise et avons aidé Disney à le rester aussi." (Steve Jobs, Chapitre 32)
33 — Le Mac du XXI siècle : Apple se démarque
Alors que de nombreuses marques se contentent de copier des designs ou de fabriquer des ordinateurs sans aucune originalité, Apple cherche constamment à se renouveler et aller au-delà de ce que l'entreprise a déjà fait. Quitte, parfois, à échouer à nouveau.
Dans les années 2000, Apple sort un ordinateur portable grand public, ainsi que le Power Mac G4 Cube. C'est un échec, mais l'ordinateur sera tout de même exposé au Musée d'art moderne de Californie.
C'est le caractère entrepreneurial profond de Steve Jobs. Oser échouer et expérimenter sa créativité.
34 — Premier round : memento mori
Mais tous les hommes sont mortels. Et même Steve Jobs.
Celui-ci apprend qu'il a un cancer du pancréas lors d'un examen urologique de routine en octobre 2003. Il refuse la chirurgie pendant neuf mois. À la place, il a recours à des médecines alternatives et suit un régime strict.
Mais cela ne fonctionne pas. Ses médecins lui intiment de se faire opérer, sans quoi — lui prédisent-ils — il mourra.
Il subit donc une opération en juillet 2004. Mais il découvre dans le même temps que le cancer s'est propagé, gagnant d'autres parties du corps. Une chimiothérapie est nécessaire.
En juin 2005, il prononce son célèbre discours d'ouverture à l'université Stanford. Aaron Sorkin, ami et célèbre scénariste, l'aide dans la rédaction.
Steve Jobs réfléchit bien sûr à sa mortalité. Il cherche à faire amende honorable pour certaines erreurs du passé. Il se demande, aussi, si son travail acharné pour Apple et Pixar ne l'ont pas conduit à développer ce mal qui le ronge.
Le coût de son génie serait-il ce mal physique ?
35 — L'iPhone : trois produits révolutionnaires en un
L'entrepreneur charismatique va pourtant aller encore plus loin. Après le succès de l'iPod, Steve Jobs entrevoit la suite : un téléphone avec écran tactile et, comme toujours, un design élégant et minimaliste.
La recherche est complexe. Il faut trouver les matériaux adéquats et réussir à tout assembler. L'équipe en charge du projet doit s'y reprendre à deux fois. Mais finalement, le premier iPhone est mis en vente en juin 2007.
En 2010, comme le note Walter Isaacson :
"Apple avait vendu quatre-vingt-dix millions d'iPhones, et elle a récolté plus de la moitié des bénéfices totaux générés sur le marché mondial des téléphones cellulaires."
C'est indéniable : le smartphone a changé nos existences, tout autant — voire peut-être plus — que les ordinateurs personnels.
36 — Deuxième round : la récidive
Désormais, les épisodes de rechutes s'accélèrent. En 2008, le cancer de Jobs refait surface. Il doit subir une opération de transplantation du foie en 2009.
Durant de longs mois, il ne divulgue pas ses problèmes de santé. Mais le secret, peu à peu, s'évente.
Affaibli par la greffe du foie, il revient néanmoins à la charge et retrouve son caractère combatif et novateur. Il a déjà eu de nombreux succès ? Qu'à cela ne tienne ! Un nouveau défi l'attend…
37 — L'iPad : l'ère post-PC
L'iPad a reçu le surnom de « tablette Jésus » lorsqu'elle a été présentée au grand public en 2010. C'est, en effet, un petit objet miraculeux qui permet de se passer de l'ordinateur pour bien des tâches. Une sorte d'hybride entre un téléphone et un ordinateur.
C'était d'ailleurs un projet que Steve Jobs avait depuis longtemps, mais qu'il avait mis en pause afin de sortir l'iPhone d'abord.
Apple vend plus d'un million d'iPads au cours du premier mois, puis quinze millions au cours des neuf premiers mois de son existence, ce qui en fait "le lancement de produits de consommation le plus réussi de l'histoire".
Isaacson note :
« avec l'iPod, Jobs avait transformé l'industrie de la musique. Avec l'iPad et son App Store, il a commencé à transformer tous les médias, de l'édition au journalisme en passant par la télévision et les films » (503).
Encore une fois, Steve Jobs réussit à surpasser tout le monde. Les autres entreprises suivront, plus tard, en créant des tablettes en tous genres.
38 — Nouvelles batailles : un écho des anciennes
Quelques jours seulement après la révélation de l'iPad au public, Steve Jobs s'en prend au système Android de Google, qui, selon lui, est une copie du système d'exploitation d'Apple.
À nouveau, l'entrepreneur vit cette concurrence comme une trahison personnelle. Pourquoi ? Car, au départ, Larry Page et Sergey Brin, les fondateurs de Google, avaient manifesté leur respect pour lui.
Steve Jobs intente une action en justice, en invoquant une violation du droit d'auteur.
Au milieu de cette bataille, Jobs est resté attaché à l'idée d'un système fermé, compatible uniquement avec d'autres appareils Apple afin de fournir aux consommateurs une expérience optimisée et simplifiée.
Pourtant, même en insistant sur des notions qui déconcertaient souvent les autres, Jobs est resté profondément passionné par les choses qui lui tenaient vraiment à cœur, y compris enfin l'introduction des Beatles sur iTunes, ce qui s'est produit à l'été 2010.
39 — Le nuage, le vaisseau spatial, et au-delà
Après avoir mis sur le marché l'iPad 2, Steve Jobs donne la priorité à deux autres projets :
l'iCloud ;
Le nouveau siège social d'Apple, avec ses douze mille employés, et son allure de "vaisseau spatial".
Épuisé mais convaincu par ces projets, l'entrepreneur se donne corps et âme pour les mener à bien. Mais la maladie le rattrape encore et, cette fois, il doit faire face à la dure réalité.
40 — Troisième round : dernier combat au crépuscule
En 2010, Steve Jobs souhaite à tout prix assister à la cérémonie de remise des diplômes d'études secondaires de son fils, Reed. Ce jour-là, il écrit à Walter Isaacson que c'est "l'un des jours les plus heureux de sa vie".
À la même période, Steve Jobs rencontre le président Barack Obama pour parler d'éducation, et en particulier sur la formation d'ingénieurs, trop peu mise en avant lors des cursus scolaires.
Selon lui, c'est la raison pour laquelle Apple, et tant d'autres entreprises mondiales, font fabriquer leurs dispositifs électroniques dans d'autres pays.
Les derniers mois de Steve Jobs sont consacrés à sa vie intime. Il ne participe plus à de grandes réunions ou à des lancements historiques. Il cherche à se ménager et à ménager ses proches, à qui il doit faire ses adieux.
Il se retire également de la direction d'Apple en août 2011. Tim Cook, l'un de ses collaborateurs passionnés, prend le relais en tant que PDG.
41 — Héritage : "Jusqu'au ciel le plus brillant de l'invention"
Quel est l'héritage de Steve Jobs ? Selon Walter Isaacson :
"Steve Jobs est devenu le plus grand dirigeant d'entreprise de notre époque, celui dont on se souviendra le plus certainement dans un siècle. (...) L'histoire le placera dans le panthéon juste à côté d'Edison et Ford » (566). (Steve Jobs, Chapitre 41)
Pour autant, l'auteur ne cache pas les difficultés. L'entrepreneur a été, bien souvent, un être à l'ambition démesurée. Pour parvenir à ses fins, il s'est montré parfois calculateur, désagréable et même manipulateur.
Il n'en reste pas moins que son impact sur le monde est durable et évident.
C'est pourquoi, à côté de ses défauts, il faut ajouter sa vision. Steve Jobs rêvait de l'impossible et il avait la force de le réaliser. Il souhaitait allier l'art à la technologie et mettait la créativité et l'innovation au cœur de toute sa démarche.
Isaacson cite ensuite les propres mots de Steve Jobs pour conclure le livre :
"Nous essayons d'utiliser les talents que nous avons pour exprimer nos sentiments profonds, pour montrer notre appréciation de toutes les contributions qui nous ont précédés et pour ajouter quelque chose à ce flux. C'est ce qui m'a motivé. » (Steve Jobs, Chapitre 41)
Conclusion sur "Steve Jobs" de Walter Isaacson :
Ce qu'il faut retenir de "Steve Jobs" de Walter Isaacson :
J'avais déjà donné mon avis sur ce livre dans une vidéo et un court article. Mais l'ouvrage valait bien un compte rendu complet, tant il est important ! Alors, voilà : je vous conseille vivement la lecture de Steve Jobs si vous ne l'avez pas encore lu.
C'est tout simplement une biographie de référence sur cet entrepreneur d'exception aux multiples visages. Et c'est, surtout, une mine d'idées inspirantes pour vous aider à vous lancer, vous aussi, dans l'aventure de l'entrepreneuriat — ou de l'infopreneuriat.
Par ailleurs, si vous voulez continuer à explorer ce thème, je vous conseille la lecture de :
Les secrets de présentation de Steve Jobs ;
Les 65 meilleures citations de Steve Jobs ;
Bill Gates et la saga Microsoft.
Points forts :
Ce livre est très bien écrit, c'est un "page turner" ;
Il vous fera entrer dans l'aventure entrepreneuriale la plus saisissante de notre temps, à la charnière entre la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle ;
Vous apprendrez à comprendre la personnalité complexe de Steve Jobs ;
Et vous pourrez utiliser sa pensée pour avancer dans vos propres projets.
Point faible :
Je n'en ai pas trouvé.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu le livre de Walter Isaacson, « Steve Jobs » ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Walter Isaacson, « Steve Jobs ».
Visitez Amazon afin d’acheter le livre de Walter Isaacson, « Steve Jobs ».
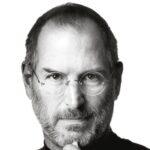 ]]>
]]>Résumé du livre de « 10 % plus heureux. Un candide au pays de la méditation » de Dan Harris : un livre en forme de biographie et de manuel de développement personnel où l’auteur partage son expérience du stress et nous montre comment en sortir grâce à la méditation.
Dan Harris, 2019 (2014), 324 pages.
Titre original : 10 % Happier.
Chronique et résumé de "10 % plus heureux" de Dan Harris
Chapitre 1 - Ça tourne !
En 2004, alors qu’il est en plein direct de la célèbre émission de télévision Good Morning America, le journaliste Dan Harris est victime d’une crise de panique. Il éprouve alors ce que les médecins appellent la « faim d’air », une sensation physiologique qui donne à une personne l’impression que ses poumons ne peuvent pas absorber suffisamment d’air.
C'est cet événement traumatisant qui a donné le point de départ au voyage entrepris par l'auteur pour découvrir l'origine de cette panique, ainsi que les moyens pour éviter que cela ne se reproduise.
Mais justement : d'où vient-il exactement ? Telle est la première question à se poser. En fait, Dan Harris raconte comment il en est arrivé à travailler pour ABC News, une grande chaîne nationale aux États-Unis.
Âgé d’une vingtaine d’années, Dan Harris était ambitieux. Lorsqu’il commence à travailler à ABC, à 29 ans, le jeune journaliste correspondant veut plaire à son chef de rédaction, Peter Jennings. Il en fait beaucoup. Trop sans doute. Le burn-out n’est pas loin.
Surviennent ensuite les attentats du 11 septembre 2001. Dan Harris et son équipe couvrent le désastre. Plus tard, alors qu’il est correspondant au Moyen-Orient, l’auteur raconte qu’il ressent très fortement ce qu’il appelle « l’héroïne journalistique ».
Qu’est-ce ? Le fait de devenir accro à la montée d’adrénaline qui accompagne le travail de journaliste. Lors des reportages dans des zones « chaudes », il peut à tout moment se faire tirer dessus. Ce danger est à la fois source de peur et d’excitation. Peu à peu, Dan Harris s’habitue aux horreurs dont il est le témoin.
À son retour aux États-Unis, il paraît plus solide qu’auparavant. Mais en réalité, il a contracté une maladie invisible : une forme d’anxiété croissante liée à ses expériences traumatisantes dans les zones de conflit.
Pour pallier ces soucis, l’auteur utilise des drogues (cocaïne, extazy). Mais celles-ci ont un effet encore plus délétère sur lui. Malgré le fait qu’il aille voir un psychiatre, l’auteur refuse de prendre sérieusement en considération son état. Jusqu’au jour où il fait cette crise de panique sur le plateau de Good Morning America.
C’est un autre psychiatre qui lui révélera qu’il est atteint de stress post-traumatique. Dan Harris est alors à la fois soulagé et inquiet pour son avenir professionnel. Il sait que c’est l’insouciance et le travail qui l’ont mené là. Mais comment modifier son comportement, maintenant que le problème est déjà bien ancré ?
Chapitre 2 - Brebis égarées
En 2004, Peter Jennings assigne au journaliste une nouvelle mission : s'occuper du traitement des affaires religieuses pour ABC News. Dan Harris et son producteur, Wonbo Woo, voyagent aux États-Unis pour couvrir des histoires sur l'essor des mouvements chrétiens et parler de thématiques diverses telles que le mariage homosexuel ou l'avortement.
Au départ, le journaliste n’est pas vraiment emballé. Pour lui, ces histoires de religion sont sans intérêt et il les dédaigne même un peu. Pourtant, son avis va changer lorsqu’il va rencontrer un évangéliste nommé Ted Haggard, qui devient l’une de ses sources privilégiées dans ses investigations.
Peu à peu, Dan Harris crée des reportages plus profonds sur les thématiques religieuses et s’intéresse davantage à ce qu’il fait. Grâce à la gentillesse et au sérieux de personnes comme Ted Haggard (qui, néanmoins, sera pris dans un scandale peu de temps après), il se prend de passion pour ces nouveaux sujets.
En 2005, son mentor Peter Jennings meurt et le journaliste doit changer de poste : il devient reporter pour le magazine Nightline. C’est aussi l’époque où il rencontre sa future femme, Bianca, qui l’incite à trouver une solution à ses problèmes d’anxiété.
Chapitre 3 - Génial ou givré ?
Dan Harris considère qu'il va mieux. Il est désormais fiancé à Biance et a un nouveau travail. Toutefois, il est encore pris de temps à autre par des attaques de panique. Il anime l'édition du dimanche de World News Tonight, mais se sent stressé, notamment vis-à-vis de ses collègues.
Lorsqu'une amie lui demande s'il a lu l'ouvrage de Eckhart Tolle, Une Nouvelle Terre, le journaliste s'en moque. Pour lui, cet auteur de développement personnel ne mérite pas vraiment qu'on s'y arrête. Pourtant, une fois qu'il le lit, quelque chose l'interpelle et il décide de lui consacrer un entretien dans son show.
Ce qu’il fait. Pourtant, le jour J, il n’est toujours pas totalement convaincu par la présentation de l’auteur. Selon lui, Eckhart Tolle ne donne pas de solution satisfaisante pour calmer la voix intérieure négative de l’égo :
"C'était comme si j'avais rencontré un homme qui me disait que mes cheveux avaient pris feu, mais refusait de me fournir un extincteur." (10 % plus heureux, Chapitre 3)
Chapitre 4 - L'industrie du bonheur
Étape suivante dans sa réflexion : une interview avec Deepak Chopra, un gourou spirituel très populaire outre-Atlantique ayant écrit plusieurs best-sellers. Dan Harris l’interroge sur l’égo et les thèses d’Eckart Tolle. Ici encore, l’auteur est déçu par la réponse et le comportement du guide spirituel indien.
Et il en va de même lorsqu'il rencontre d'autres "gourous" venus du New Age et du développement personnel.
Mais alors, que faire ? Pour lui, il est nécessaire de s’appuyer sur des preuves scientifiques solides ; il ne peut s’en remettre à des « traitements » potentiellement dangereux n’ayant pas fait leurs preuves et aux discours d’experts autoproclamés.
Chapitre 5 — Le Jew-Bu
Sa femme Bianca lui suggère de lire un autre livre : celui de Mark Epstein, un psychologue pratiquant la méditation bouddhiste. C’est grâce à cette lecture que l’auteur se rend compte de ce qui restait « caché » ou implicite chez Eckart Tolle. En fait, la théorie qu’il développait trouvait ses racines dans le bouddhisme.
Plus que ce qu’il avait lu avant, le livre de Mark Epstein lui ouvrait la voie vers une compréhension à la fois plus profonde et plus modeste que ce que prétendaient offrir ceux et celles qu’il avait rencontrés jusqu’à présent.
Par ailleurs, Dan Harris se sent proche du côté « pragmatique » et concret du bouddhisme, qui propose des solutions concrètes pour mettre un terme aux pensées négatives et au flux destructeur de l’égo. Trois expressions sont souvent utilisées par les bouddhistes pour qualifier cette intranquillité de l’esprit :
Esprit se comparant (comparing mind) : l'esprit se mesure sans cesse aux autres ;
Esprit voulant (wanting mind) : l'esprit désirant les choses ;
Et enfin l'esprit agité (monkey mind) : l'esprit insatiable et en besoin de nouveauté constante.
Reconnaître cela est essentiel à la croissance. Tout comme prendre conscience de notre tendance à "terribiliser" et, plus fondamentalement encore, l'impermanence des choses.
La seule façon d'atteindre le bonheur consiste alors à accepter complètement — et activement — ce caractère fini et provisoire des événements et des choses. Mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, bien sûr !
Emballé par ces idées, Dan Harris contacte Mark Epstein pour lui proposer une interview. Le contact passe bien et le psychologue lui propose de participer à un groupe de spiritualité nommé le "bus juif", en référence à l'origine commune des participants. Mieux encore, c'est lui qui finit par le convaincre de se mettre à la méditation.
Chapitre 6 - Le pouvoir de la pensée négative
Dan Harris se réconcilie avec la méditation après avoir lu plusieurs études scientifiques qui montrent les avantages physiologiques de cette pratique. Il ne la voit plus comme une activité de hippies en mal de découvertes orientales.
Quelques instructions simples permettent de commencer une session :
Asseyez-vous dans une position confortable ;
Suivez votre respiration ;
Lorsque l’attention s’égare, revenez à votre respiration.
L’auteur se rend compte qu’il s’agit d’un « exercice cérébral rigoureux » qui cherche à « apprivoiser le train en fugue de l’esprit ». Et cela n’a rien de facile ! Mais pour lui, cela valait vraiment la peine de persévérer.
Il a donc créé une routine quotidienne. Peu à peu, il a pris l’habitude de suivre son souffle pour soulager son anxiété et se concentrer sur les moments présents. Les résultats ne se sont pas fait attendre très longtemps.
Il a commencé à ressentir une ouverture de sa conscience. Il devenait capable de reconnaître ce qui se passe dans l'esprit moment par moment, en acceptant la nature transitoire de toute pensée.
Lors d’une retraite, Dan Harris écoute la conférencière Tara Brach, qui a créé une méthode intitulée RAIN, pour :
Reconnaître ce qui se passe (ressource) ;
Accepter l'expérience entièrement (allow) ;
Investiguer avec soin et curiosité (investigate) ;
Nourrir avec auto-compassion (nurture)
RAIN est une technique de pleine conscience en quatre étapes qui intègre :
La reconnaissance de vos pensées ;
Le fait de les laisser exister ;
L’étude de ce qu’elles provoquent dans le corps ;
Les identifier comme des états d'être transitoires, qui passent.
Pour Dan Harris, cette technique fonctionne bien. Mais son nouvel ami et mentor, Mark Epstein, lui conseille de participer à une autre retraite dirigée par Joseph Goldstein, un professeur de méditation de renom faisant partie du groupe du « bus juif ».
Chapitre 7 - Retraite
Dan Harris se rend donc au Spirit Rock Meditation Center de Californie pour assister à la retraite silencieuse de 10 jours dirigée par Joseph Goldstein. Cette fois, le niveau est plus exigeant. Le temps de méditation prévu est d’environ 10 heures par jour.
Le journaliste craint de ne pas réussir à tenir sur la longueur. Et, de fait, il pense abandonner après quelques jours, malgré les discours du soir enjoués et motivants de Joseph Goldstein.
Mais Dan Harris décide de raconter ses difficultés à quelqu’un qui lui conseille de faire baisser la pression et de ne pas essayer aussi fort. En effet, les personnes comme lui cherchent à tout prix à atteindre des objectifs et à réussir. C’est cela qui « bloque ».
L’expérience de la méditation va dans le sens inverse et beaucoup de personnes ont du mal avec cet aspect de la pratique.
Cette discussion l'aide et, peu de temps après, il fait l'expérience d'une méditation particulièrement intense qui le laisse dans un état de bien-être profond qu'il décrit comme des "vagues de bonheur".
Cet état se poursuit pendant plusieurs jours puis cesse. Lors d’une conversation avec Joseph Goldstein, celui-ci lui affirme que cette pleine conscience joyeuse augmentera avec la pratique.
Chapitre 8 - 10 % plus heureux
De retour de la retraite, Dan Harris retombe rapidement dans ses habitudes quotidiennes. Au travail, les négociations ne se passent pas comme prévu. En plus, la plupart des gens voient son nouveau goût pour la méditation avec scepticisme.
À chaque fois, les personnes qui l’interrogeaient semblaient lui dire : « Vous avez donc rejoint un culte, n’est-ce pas ? ». Afin de mieux faire comprendre cette pratique, il décide de déclarer, à chaque fois que quelqu’un le questionne, que :
« Je le fais parce que cela me rend 10 % plus heureux »…
Et c’est à partir de là qu’il a commencé à penser à écrire un livre sur le sujet ! Pour lui, cette phrase, « Cela me rend 10 % plus heureux », est à la fois accrocheuse et vraie.
En effet, Dan Harris considère qu’il est plus heureux dans son ménage et plus sympathique avec ses collègues. Finalement, il signe un contrat et commence à travailler sur Good Morning America en tant que présentateur du week-end.
C’est un changement difficile au départ, pour le journaliste, mais il s’y fait. Il doit aussi faire face à des critiques venues des réseaux sociaux à cette époque. Certes, la vie reprend son cours et le stress est toujours là. Mais la méditation fait pourtant son œuvre ! Le journaliste affirme qu’il a résolu ses problèmes plus rapidement grâce à elle.
C’est également à cette époque que Dan Harris décide également de réaliser une interview avec Joseph Goldstein. Il lui demande comment il a commencé la méditation et pourquoi organiser des retraites si intenses, comme celle de Spirit Rock.
Joseph Goldstein dit que le fait d’être dans l’environnement d’une retraite de ce type permet aux participants de se familiariser avec leurs schémas de pensée et, ainsi, de mieux comprendre ce qui est important pour eux.
Chapitre 9 - La "nouvelle caféine"
Pour lui, désormais, la méditation a tout d’un superpouvoir ! Mais, qui plus est, les scientifiques démontrent l’efficacité de la méditation grâce à de nombreuses études scientifiques, ce qui l’encourage encore davantage.
Il cite plusieurs études, notamment sur les bienfaits de la méditation sur la dépression, la toxicomanie et l’asthme (entre autres !).
Il relate également une expérience célèbre de Harvard démontrant que les personnes ayant suivi un cours de huit semaines de réduction du stress basé sur la pleine conscience voient leur matière grise :
"S'épaissir" dans les zones du cerveau associées à la conscience de soi et à la compassion ;
"Diminuer" dans les régions associées au stress".
Pour l'auteur, ces découvertes scientifiques peuvent aider à convaincre même les personnes les plus sceptiques des effets bénéfiques, tant psychologiques que physiologiques, de la méditation.
Dan Harris décide de présenter une série d’histoires sur la méditation sur la chaîne ABC. Sa première histoire porte sur la façon dont la méditation est utilisée avec succès dans les bureaux de l’entreprise du producteur alimentaire General Mills.
Sa directrice, Janice Maturano, voit la méditation comme une pratique positive et non seulement de "réduction de stress". Elle insiste tout particulièrement sur l'importance de se concentrer sur une tâche, puis de la laisser tomber et de faire une pause. Dans cet espace de repos, une solution ou une percée peut se produire plus aisément.
Lorsqu’il travaille sur les autres histoires de sa série, Dan Harris se convainc de l’utilité et de la vérité de son nouveau crédo : « 10 % plus heureux grâce à la méditation ». Il utilise toutes les sources qu’il peut pour démontrer son propos et obtient un certain succès.
Chapitre 10 - Plaidoyer intéressé pour ne pas être un con
Dan Harris finit par interviewer le Dalaï Lama. Au début, il est plutôt sceptique, mais se rassure quelque peu lorsqu'il apprend que le leader des bouddhistes s'intéresse de très près aux études scientifiques démontrant les effets bénéfiques de la méditation.
Lorsque le journaliste lui fait part de ses questionnements autour de la question de la compassion, celui-ci lui répond :
"La pratique de la compassion est finalement bénéfique à toi-même. Je la décris habituellement comme cela : nous sommes égoïstes, mais nous sommes des égoïstes sages plutôt que des égoïstes fous".
Ce propos donne à réfléchir, car il nous apprend que la pratique de la compassion est une bonne chose également pour sa propre santé. D’ailleurs, des études scientifiques citées par l’auteur dans l'ouvrage le démontrent.
Mais la compassion est plus facile à comprendre qu’à entreprendre ! L’une de ses grandes erreurs professionnelles est justement liée à un manque de compassion. Malgré ce nouveau savoir, Dan Harris reconnaît avoir été incorrect lors de l’interview qu’il réalisa avec Paris Hilton et qui poussa celle-ci à quitter le plateau de télévision.
Chapitre 11 - De la dissimulation du zen
Petit à petit, Dan Harris se désengage de la compétition sans pitié. Plutôt que de briguer inlassablement de nouvelles fonctions, il préfère se concentrer sur la méditation. Finie, la « course de rats » !
Le journaliste décide de participer à une autre retraite sur le thème de la compassion — son point le plus délicat. Sharon Salzberg, une autre professeur, y discute de la mudita, le concept bouddhiste de "joie sympathique" ou de "joie ouverte aux succès des autres". Un concept quelque peu difficile à accepter pour l'auteur !
En fait, Dan Harris ne parvient pas très bien à associer son ambition avec sa pratique de la méditation. Il se rend compte qu’il devient trop passif et qu’il met en péril sa carrière, à laquelle il a pourtant travaillé une bonne partie de sa vie. Comment rester calme sans pour autant devenir mou et sans objectifs ?
Plusieurs personnes l’ont aidé à trouver une réponse à cette question. Joseph Epstein, d’abord, qui lui explique :
«Les gens vont profiter de toi s'ils te voient comme quelqu'un de vraiment zen. Dans le comportement organisationnel, il y a un certain type d'agression qui n'y attache aucune valeur — qui verra le zen comme une marque de faiblesse. Si ça ressort trop chez toi, les gens ne te prendront pas au sérieux. Donc je pense que c'est important de garder le zen pour toi, et de les laisser voir en toi une menace potentielle. » (10 % plus heureux, Chapitre 11)
Bianca, sa femme, lui permet aussi de rééquilibrer les choses. Elle l'aide en lui faisant comprendre qu’il essaye de tout diriger, en particulier lorsqu’il se trouve sur un plateau de télévision. Or, maintenant qu’il travaille en équipe, il doit apprendre à se détendre et à suivre le courant !
Dan Harris cherche avant tout à atteindre une forme de « non-attachement aux résultats ». En fait, la vie ne va pas toujours dans le sens que nous nous attendons et nous devons l’accepter. C’est ça, selon lui, le chaînon manquant entre la pleine conscience et l’ambition.
Conclusion sur « 10 % plus heureux » de Dan Harris :
Ce qu’il faut retenir de « 10 % plus heureux » de Dan Harris :
Dan Harris termine avec 10 conseils qui récapitulent ce qu'il a appris au long de son parcours et qu'il nomme "la voie de l'inquiet" :
Ne soyez pas un sale con ;
(Et/mais…) Si nécessaire, planquez le Zen ;
Méditez ;
Le prix de la sécurité est un sentiment d'insécurité (ça vous servira un temps) ;
Le sang-froid n’est pas l’ennemi de la créativité ;
Ne forcez rien ;
L'humilité empêche l'humiliation ;
Allez-y mollo avec l'auto-flagellation ;
Ne vous attachez pas aux résultats ;
Pensez-y : qu'est-ce qui compte le plus ?
Ce livre est utile pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore la méditation et voudraient s'y initier. Mais il ne s'agit pas d'un manuel ; plutôt d'une biographie qui intègre des conseils pour apprendre à intégrer la pratique de la méditation à sa vie de tous les jours.
Le dernier chapitre est particulièrement intéressant puisqu'il montre comment associer un certain degré d'ambition avec les principes de la méditation de pleine conscience. Au final, l'objectif est d'être plus heureux dans sa vie quotidienne.
Grâce à la pratique méditative, nous devenons capables de dégonfler notre égo et d’accepter notre existence dans toutes ses imperfections. Nous sommes plus simples et justes avec nous-mêmes et avec les autres. Nous vivons davantage au présent.
]]>Résumé de « Quand la machine apprend : la révolution des neurones artificiels et de l’apprentissage profond » de Yann Le Cun : l’expert en intelligence artificielle français a séduit la Silicon Valley en contribuant de façon essentielle au développement du machine learning et du deep learning — il partage ici le récit de cette fascinante histoire !
Par Yann Le Cun, 2019, 394 pages.
Chronique et résumé de "Quand la machine apprend : la révolution des neurones artificiels et de l'apprentissage profond" de Yann Le Cun
Qui est Yann Le Cun ?
Yann Le Cun est un expert en intelligence artificielle. Récipiendaire du prestigieux prix Turing, il enseigne à l'université de New York. Il a été l'un des grands initiateurs de l'apprentissage machine et en particulier de l'apprentissage profond lié à la reconnaissance d'images.
Ses travaux ont fait de lui l'un des spécialistes les plus reconnus du domaine et l'ont amené à exercer des fonctions importantes pour la compagnie Facebook.
Dans ce livre de vulgarisation, comme vous allez le voir, Yann Le Cun revient en détail sur son parcours biographique, tout en expliquant sa démarche scientifique. Rien ne sert donc d'en dire trop ici. Lisez la suite !
NB. Si les principaux chapitres ont été conservés tels quels, l'intérieur de chaque chapitre a été résumé et certaines sections ont été fusionnées ou supprimées pour faciliter la compréhension d'ensemble ;).
Chapitre 1 — La révolution de l'IA
"Beaucoup d'observateurs ne parlent plus d'une évolution technologique, mais d'une révolution." (Quand la machine apprend, Chapitre 1)
Et si nous étions au début d'une nouvelle ère technologique ? Sans aucun doute, l'IA est d'ores et déjà omniprésente dans notre quotidien, depuis les logiciels de reconnaissance vocale jusqu'aux logiciels de création d'images, nous avons pris l'habitude de rencontrer l'intelligence artificielle dans notre vie de tous les jours.
Mais ce monde de l'IA n'en est qu'à ses débuts. En fait, "ses limites sans sans cesse repoussées", dit avec enthousiasme Yann Le Cun. De la good old fashioned IA (GOFAI), nous sommes passés à de nouvelles manières de construire et de penser l'intelligence des machines et leur apprentissage.
C'est notamment le passage de ces GOFAI au machine learning, puis au deep learning, dont l'auteur est justement l'un des chefs de file et des pionniers.
Essai de définition
"Je dirais que l'intelligence artificielle est la capacité, pour une machine, d'accomplir des tâches généralement assumées par les animaux et les humains : percevoir, raisonner et agir. Elle est inséparable de la capacité à apprendre, telle qu'on l'observe chez les êtres vivants. Les systèmes d'intelligence artificielle ne sont que des circuits électroniques et des programmes informatiques très sophistiqués. Mais les capacités de stockage et d'accès mémoire, la vitesse de calcul et les capacités d'apprentissage leur permettent d'"abstraire" les informations contenues dans des quantités énormes de données." (Quand la machine apprend, Chapitre 1)
Yann Le Cun est ambitieux et croit en l'innovation qui l'a fait connaître : le deep learning — et en particulier ces réseaux de neurones convolutifs dont nous reparlerons dans la suite de cette chronique. C'est un outil très puissant, mais qui demeure encore limité, car très spécialisé.
Un algorithme est une "séquence d'instructions", une "recette de cuisine" de mathématiciens, rien de plus. Facebook et Google, par exemple, n'en ont pas qu'un (supposé omnipotent ou presque), mais plutôt une "collection", chacun travaillant à une tâche précise.
Commençons par dire un mot du développement de l'IA depuis le milieu du XXe siècle, tout en faisant davantage connaissance avec l'auteur.
Chapitre 2 — Brève histoire de l'IA… et de ma carrière
L'éternelle quête et les premiers sursauts de l'IA
La volonté de donner la vie à des automates n'est pas neuve. Que vous pensiez aux projets du docteur Frankenstein ou à d'autres ouvrages de science-fiction (et même à des mythes anciens), cette idée est présente en l'homme. Faire émerger la vie et la pensée de ses propres mains : voilà l'idée de base.
Mais c'est autour des années 1950, et aux États-Unis, que s'initient les premières grandes manœuvres qui aboutiront à la création du champ d'études nommé "intelligence artificielle.
L'auteur reprend à son compte la notion d'"hiver" de l'IA. Tout se passe en effet en plusieurs étapes. Les premiers engouements des années 1950 et 1960 sont freinés à partir des années 1970. Les institutions états-uniennes et occidentales coupent les fonds à leurs chercheurs.
✅ À noter : pour compléter ce teaser et avoir un aperçu plus général de cette histoire, vous pouvez lire, par exemple, la chronique de L'intelligence artificielle pour les nuls.
Entrée en scène
Penchons-nous plus attentivement sur l'histoire de Yann Le Cun. Il commence à faire ses études dans une école d'ingénieur en électronique à Paris en 1978. En passionné, il lit beaucoup et croise les disciplines. Depuis la linguistique jusqu'à la cybernétique, en passant bien sûr par les mathématiques et l'informatique, tout ce qui se rapproche de l'IA l'intéresse.
Il est encore étudiant à l'IESIEE (son école d'ingénieurs) lorsqu'il a sa première intuition d'algorithme d'apprentissage qui donnera, des années plus tard, les algorithmes dits de "rétropropagation du gradient".
Entré en doctorat en 1984, il travaille beaucoup avec une maîtresse de conférence nommée Françoise Soulié-Fogelman. Grâce à cette collaboration, il va pouvoir réaliser un stage d'un mois en Californie au sein du laboratoire Xerox PARC.
Mais c’est en 1985 que sa vie professionnelle « bascule », lors d’un symposium aux Houches (Alpes françaises). Yann Le Cun y tisse des liens qui le mèneront à travailler au Bell Lab trois ans plus tard. Durant cette année, il dévoile à ses pairs ses recherches. Ceux-ci sont impressionnés.
Durant la seconde moitié des années 1980 (pourtant qualifiées d’hiver de l’IA), Yann Le Cun va patiemment contribuer à l’émergence du champ d’études dit « connexionniste » en IA.
Il termine son doctorat en 1987 et rejoint Geoff Hinton (grand spécialiste et co-inventeur de la "rétropropagation", qui recevra plus tard le prix Turing avec Yann Le Cun) à l'université de Toronto.
Les années Bell Labs
Les travaux du chercheur y sont appréciés. Pourtant, les projets en cours n'arrivent pas à se vendre. Malgré le développement d'un système de compression des données plus efficace que JPEG et PDF (nommé DjVu), c'est l'échec commercial. En cause, pour l'auteur, l'incapacité à commercialiser correctement le logiciel.
Un tabou ?
En fait, au milieu des années 1990, les recherches de Yann Le Cun et de ses quelques collègues deviennent l'objet d'une sorte de rejet ou de tabou par le reste de la communauté du machine learning. Pourtant, bon nombre de chercheurs travaillent ensemble et s'influencent l'un l'autre.
Au début des années 2000, il décide de relancer dans la recherche fondamentale (qu'il avait plus ou moins laissé tomber au Bell Labs pour le projet plus appliqué de DjVu). Il refuse, pour cela, un poste de direction dans la toute jeune entreprise… Google !
Il est embauché en tant que professeur à la New York University en 2003. Avec la "ferme intention de redémarrer un programme de recherche sur les réseaux de neurones et de démontrer qu'ils marchent".
Mais toujours pas facile de se faire accepter… Le reste de la communauté boude cette bande de scientifiques qui refusent le courant majoritaire du machine learning. Pour rendre leurs travaux plus sexys, Yann Le Cun et ses amis renomment leur projet en deep learning. Au début, rien.
Il faut attendre 2006 et surtout 2007 pour que la notion commence à circuler largement et soit peu à peu acceptée dans la communauté scientifique.
]]>Résumé de "Bill Gates et la saga Microsoft – Nouvelle édition 2020" de Daniel Ichbiah : dans cette biographie détaillée de Bill Gates, Daniel Ichbiah retrace l'épopée hors-norme du fondateur intrépide de Microsoft. Il nous plonge au cœur de ses fulgurants débuts, de ses controverses jusqu’à ses combats titanesques pour bâtir et défendre son empire technologique tentaculaire.
Par Daniel Ichbiah, 2020, 453 pages.
Édition anglaise : "The Making of Microsoft: How Bill Gates and His Team Created the World's Most Successful Software Company", 1992 (pas de réédition en 2020 dans cette édition).
Chronique et résumé de "Bill Gates et la saga Microsoft – Nouvelle édition 2020" de Daniel Ichbiah
Préambule
Ce livre, écrit par Daniel Ichbiah, retrace l'histoire de Bill Gates et celle de Microsoft, des débuts de l’entreprise en 1995 à aujourd'hui.
L’édition du livre que je résume ici a été largement mise à jour en 2020. Ainsi, cette actualisation est à l’origine d’un nouveau chapitre qui raconte les 20 dernières années de cette aventure.
Dans son préambule, l'auteur recommande de se replacer dans le contexte des années 1990, quand l'informatique et internet étaient encore naissants, pour bien comprendre le point de vue de l'époque.
Introduction - Insolite personnalité
Daniel Ichbiah, l’auteur, choisit d’introduire son ouvrage "Bill Gates et la saga Microsoft" en nous dressant le portrait atypique de Bill Gates.
Il le décrit alors comme surdoué, entrepreneur précoce, optimiste, technophile, exigeant mais fédérateur et à la fortune colossale. C’est, résume-t-il, quelqu’un qui a toujours suscité la controverse.
Bill Gates, un génie aux multiples facettes
Puis l’auteur entre dans le détail et revient sur son enfance.
Il nous présente Bill Gates comme ayant une personnalité hors du commun, dotée de qualités exceptionnelles depuis tout petit.
En effet, surdoué en mathématiques (notamment), le jeune Bill impressionne dès l’enfance. Il force l’admiration par son intelligence vive et sa capacité stupéfiante à assimiler une quantité phénoménale d'informations pour en tirer des conclusions visionnaires.
Dès lors, à l'école primaire déjà, cette vivacité de raisonnement désarçonne ses professeurs.
Daniel Ichbiah le décrit aussi comme un "Géo Trouvetout du logiciel" : Bill Gates, dit-il, est capable de "discerner des modèles au milieu du chaos" tout en trouvant, dans cet exercice intellectuel, une satisfaction intense.
Un entrepreneur précoce à la détermination sans faille
Dès l'âge de 20 ans, Bill Gates fonde Microsoft. Daniel Ichbiah montre comment le jeune entrepreneur entrevoit déjà le potentiel révolutionnaire des ordinateurs personnels. Et ce, bien avant la plupart des observateurs.
L’auteur explique aussi ici comment la détermination et l’arrogance en affaires de Bill Gates sans limite ont aidé au succès de son entreprise. "Tyrannosaurus Gates" - pour reprendre les termes de l’auteur - peut même parfois se montrer impitoyable. Il n’hésite pas, entre autres, à éliminer ses concurrents en usant de méthodes agressives. Il est capable, par exemple, d’offrir des logiciels concurrents gratuitement juste dans le but de les mettre en faillite.
En somme, l'auteur décrit un homme prêt à tout pour gagner et :
"S’il était général, il porterait "officiellement" la guerre en Pérou, ferait en sorte que ses ennemis déplacent leurs troupes sur les hauteurs de la Cordillère des Andes. Et pendant que s'agiterait ce théâtre, il investirait tranquillement le Vénézuéla."
Un patron exigeant mais rassembleur
Bill Gates, poursuit l’auteur, est aussi quelqu’un qui sait s'entourer de grands créatifs à qui il offre, dans le campus de Microsoft à Redmond, un environnement idéal pour s'épanouir et innover.
Mais le fondateur de Microsoft attend en échange qu’ils fassent preuve d’un dévouement total et d’une acuité intellectuelle à son niveau.
Patron exigeant, il peut d’ailleurs se montrer d'une dureté extrême, confie Daniel Ichbiah.
Toutefois, s’il n’hésite pas à rabrouer ses collaborateurs, son aura et son absence de prétention est fédérateur : Bill Gates a cette capacité à souder les équipes autour d'un défi commun.
Un optimiste technophile désireux d'améliorer le monde
Bill Gates est aussi décrit comme un optimiste convaincu, persuadé que les technologies numériques vont radicalement améliorer le quotidien et la société.
Bien qu'impitoyable en affaires, le chef d’entreprise reste accessible et humble dans sa vie privée, avec un désir philanthropique assumé de distribuer l'essentiel de sa fortune. D’ailleurs, l'auteur relève le contraste entre la froideur en affaires de Bill Gates et sa sentimentalité dans l'intimité.
"J'ai interviewé Bill Gates une vingtaine de fois et eu l'occasion de l'approcher à maintes reprises (...). Au fil des années, j'ai été agréablement surpris de voir qu'il avait conservé sa désarmante simplicité, une absence de préjugés et de mondanités."
Un empire technologique qui suscite la controverse
Avec la position ultra-dominante acquise par Microsoft dans les années 90, Bill Gates devient rapidement la cible de vives critiques, indique ici Daniel Ichbiah.
On l’accuse, en effet, de chercher à contrôler et régenter le monde de l'informatique.
Ses méthodes agressives et son arrogance attirent l'attention des régulateurs qui y voient de l’abus de position dominante. Par ailleurs, sa fortune et sa réussite démesurées suscitent la suspicion.
Ainsi confronté à la controverse grandissante sur son empire technologique, Bill Gates prend finalement conscience de la nécessité d'adopter une attitude plus humble et mesurée pour assurer un rééquilibrage entre les acteurs du secteur des logiciels.
Être le meilleur
Daniel Ichbiah termine l’introduction de son livre "Bill Gates et la saga Microsoft" sur ce constat :
"Au fond, si Bill a un défaut, c'est une obsession à vouloir être constamment le meilleur en tout. Il semble détester se retrouver en position d'infériorité, ne serait-ce que pendant quelques secondes. Lors d'un dîner informel à Paris, je m'étais permis de lui dire, d'un ton de plaisanterie "Quoi ! Tu ne parles pas le français ? Mais moi, à trois ans, je savais déjà parler français !" Gates m'a alors répondu de façon sèche "Oui, mais à vingt ans, tu n'avais pas créé ta propre société !". Il n'y avait aucune trace d'humour dans sa réponse. Il n'appréciait tout simplement pas d'être déstabilisé."
Chapitre 1 – Surdoué
L’auteur nous l’a dit en introduction, mais insiste : dès l'enfance, Bill Gates fait preuve de capacités intellectuelles exceptionnelles.
Il est le premier de sa classe, saisit très vite de grandes quantités d'informations et possède une mémoire remarquable. Mais l’auteur note aussi, ici, que cette intelligence supérieure à la moyenne le coupe parfois des autres. À l’adolescence notamment, Bill Gates est un garçon brillant d’une "espèce particulière" écrit l’auteur : "il apparaît comme un garçon étrange, méditatif, et fortement autodéterminé".
Bill Gates grandit dans un milieu aisé à Seattle.
Son père est avocat, sa mère enseignante puis mère au foyer.
Tous deux encouragent leur fils Bill à développer sa soif de connaissances. Ils l'inscrivent dans une école privée réputée pour sa rigueur.
Chapitre 2 - De Lakeside à Harvard
2.1 - Une révélation : la programmation
Au lycée Lakeside, Bill Gates découvre la programmation sur un ordinateur PDP-10. Immédiatement passionné par l'interaction avec la machine, il passe ses soirées avec ses amis Paul Allen et Kent Evans à expérimenter le codage en BASIC.
"Lors de la rentrée scolaire, Bill Gates et son meilleur ami Kent Evans entrent en huitième année. Au cours de la classe d'informatique qui démarre en janvier, les élèves sont invités à introduire quelques petits programmes au moyen du langage BASIC. Pour Bill, il s'agit d'une révélation. Quelle est cette machine sur laquelle il suffit de taper quelques instructions pour qu'elle vous donne quelques secondes plus tard la solution d'un problème ?"
Daniel Ichbiah poursuit :
"Bill se découvre une passion dévorante pour la programmation. Par chance, Kent Evans est pareillement fasciné par les possibilités ouvertes par le BASIC et le PDP-10. Après les cours, les deux adolescents se retrouvent spontanément dans la salle du terminal. Parfois, ils sèchent la gymnastique pour gagner la pièce dédiée à la programmation. Ils y croisent souvent un garçon blond de quinze ans qui arbore une moustache. Paul Allen, élève de dixième année dans le même établissement manifeste un enthousiasme tout aussi débordant pour l'engin.
2.2 - La passion dévorante de l'informatique réunit Bill Gates et Paul Allen
L'attrait pour la programmation et pour la science-fiction rapprochent Paul et Bill :
"Et comme leurs professeurs connaissent fort peu le sujet, les deux garçons se forment eux-mêmes sur l'ordinateur en étudiant dans le détail tous les manuels sur lesquels ils parviennent à mettre la main. Ils assimilent les concepts liés au BASIC et à la machine de DEC en un temps record, montrant une compréhension naturelle des mécanismes de l'informatique."
Un jour, Bill, Kent et Paul parviennent à obtenir du temps d'utilisation supplémentaire de l’ordinateur PDP-10 au lycée en échange de la détection de bugs dans le logiciel. Les lycéens s’auto-proclament alors "programmeurs de Lakeside". Mais les adolescents, poussé par cette passion dévorante, vont même modifier des programmes sans autorisation.
2.3 - Des talents remarqués
Forts de leur expérience en programmation, Bill Gates décide alors de fonder, avec son ami Paul Allen, une startup. Les adolescents conçoivent un ingénieux programme d'analyse statistique du trafic routier à partir de données brutes et créent ainsi Traf-O-Data.
"Lors de la rentrée 1973, Bill entame sa dernière année de lycée. La société Traf-O-Data dont il s'occupe avec Paul lors de ses temps libres, gagne plusieurs milliers de dollars en diffusant des informations sur les statistiques routières."
Les incroyables capacités de programmation des trois lycéens attirent rapidement l'attention de plusieurs sociétés. Lorsque TRW (une société qui mène un énorme projet de contrôle de distribution pour le Ministère des Armées) les contacte pour le embaucher afin de développer des logiciels complexes sur PDP-10, Bill et Paul sont aux anges :
"Paul Allen ne se fait pas prier. La vie universitaire l'ennuie, et il rêve de se frotter à la vie active. Gates bénéficie d'une permission accordée par le lycée de Lakeside, autorisant ses élèves à terminer leurs études en effectuant un stage en entreprise. Sur place, les deux programmeurs sont aux anges. Ils œuvrent au milieu d'un environnement de rêve : cinq ordinateurs DEC qui se communiquent mutuellement des informations. Ils travaillent durement pour une rétribution dérisoire - 165 dollars par semaine, l'équivalent d'une paye d'étudiant. Mais Paul considère que le simple fait d'être rémunéré pour effectuer ce qu'il adore représente le bonheur ultime."
2.4 - L'université de Harvard
En 1973, Bill Gates, diplômé du lycée, entre à la prestigieuse université de Harvard pour devenir mathématicien.
Mais, observe Daniel Ichbiah, l’étudiant se montre alors beaucoup plus intéressé par l'informatique naissante. Et pressentant le potentiel de cette industrie, il passe ses nuits à discuter avec Paul Allen de la création d'une société d'édition de logiciels.
2.5 - Un esprit pragmatique
Daniel Ichbiah termine le chapitre 2 de "Bill Gates et la saga Microsoft" en évoquant davantage d’aspects de la personnalité de Bill Gates à cette époque.
Nous apprenons ainsi que déjà, Bill Gates :
Fait preuve d’un sens des affaires précoce et d’un certain opportunisme : l’auteur nous fait remarquer, par exemple, qu’adolescent, Bill Gates revendait des badges de campagne électorale pour en tirer du profit. Ou encore, avec Traf-O-Data : le jeune homme avait compris très tôt l'intérêt des microprocesseurs Intel. Ainsi, pour Daniel Ichbiah, le fondateur de Microsoft a un vrai flair pour détecter les technologies prometteuses.
Est un excellent pirate informatique : en effet, fasciné par le défi intellectuel, Bill Gates n'hésite pas à pirater des systèmes informatiques complexes pour en percer les faiblesses. Par exemple, quand il n’a que 13 ans, le jeune programmeur parvient à provoquer un plantage généralisé sur le réseau national CDC (Control Data Corporation) en s'introduisant sur leur ordinateur central. Si cet épisode lui a valu de sévères réprimandes par la suite, le jeune Bill s’est pour autant beaucoup amusé de cette péripétie, raconte l’auteur.
Possède un caractère ambivalent : Bill Gates peut se montrer déterminé et intraitable dans la poursuite de ses projets, n'hésitant pas à évincer ses anciens partenaires comme Paul Allen et Kent Evans. Mais il sait aussi déjà fédérer des équipes de programmeurs autour d'une vision enthousiasmante de l'informatique du futur.
Chapitre 3 - L'Altair
3.1 - 1975 : la révolution de l'Altair, premier micro-ordinateur
Le chapitre 3 du livre "Bill Gates et la saga Microsoft" commence par un retour en 1975.
Cette année-là, l'ordinateur Altair fait la une du magazine "Popular Electronics".
Vendu en kit à 399$ par la société MITS, cet ordinateur minimaliste à monter soi-même déclenche un engouement fou parmi les passionnés d'informatique, avides de posséder leur propre machine, rappelle Daniel Ichbiah.
Le succès phénoménal de l'Altair surprend même son créateur : Ed Roberts, qui a du mal à honorer les 4000 premières commandes.
3.2 - Le défi du BASIC : une prouesse technique et une première réussite
Pour les deux passionnés de programmation que sont Bill Gates et Paul Allen, l'Altair est l'opportunité historique de créer le premier langage de programmation BASIC pour micro-ordinateur.
Ils contactent Ed Roberts pour lui proposer leur produit. Ed Roberts se montre d'abord sceptique, mais ensuite impressionné quand il constate que le BASIC fonctionne !
Car, sans même avoir vu l'Altair, Bill et Paul parviennent à développer en quelques semaines un BASIC parfaitement fonctionnel.
Pour y arriver, les deux programmeurs ont simulé le comportement du microprocesseur 8080 sur un ordinateur PDP-10. Et pour tenir les délais, ils ont travaillé d'arrache-pied jour et nuit. Contre toute attente, leur persévérance paie :
""Ca marche !" s'exclame Roberts lors de la démonstration à Albuquerque. Paul Allen lui-même est abasourdi que le programme fonctionne du premier coup."
3.3 - Un marché en effervescence
Avec ses 4000 premières commandes, l'Altair révèle l'existence d'un immense marché naissant des passionnés d'informatique personnelle.
La révolution micro-informatique tant attendue est enfin en marche, lance l’auteur, "et désormais, plus rien ne pourra l'arrêter."
Chapitre 4 - Naissance de Microsoft, la soif de liberté
4.1 - L’association de Paul Allen et Ed Roberts
Paul Allen, alors employé chez Honeywell, est fasciné par le projet Altair d'Ed Roberts.
Il contacte très souvent le patron du MITS – Ed Roberts - pour lui faire de ses suggestions. Séduit, Ed Roberts lui propose de rejoindre son équipe. Paul Allen accepte sans hésiter, attiré par les opportunités offertes par cette révolution de la micro-informatique.
Paul Allen, nommé directeur de la division logiciel (mais seul membre de ce service) travaille d'arrache-pied pour doter l'Altair d'une solide base logicielle. Bill Gates, toujours étudiant, le rejoint pendant les vacances universitaires afin de finaliser le BASIC de l'Altair. Les deux amis partagent une chambre miteuse dans un motel. Bill Gates, intrépide perfectionniste, travaille sans relâche à l'amélioration du langage.
Mais Bill Gates n'hésite pas à critiquer vertement la piètre qualité de l'Altair et de ses cartes mémoire défaillantes. Il s’attire alors l'animosité de Ed Roberts. Persuadé du bien-fondé de ses critiques, Bill Gates exige d'être rémunéré 10$ de l'heure pour poursuivre son travail.
4.2 - 1975 : Fondation de Microsoft
Un peu plus tard, Bill Gates découvre avec fureur que le BASIC est copié et distribué gratuitement par ceux que l’on appelle "les hobbyistes". Il publie une lettre ouverte virulente pour dénoncer ce piratage néfaste. Mais sous la pression d’Ed Roberts, il modère ses propos dans une seconde lettre, tout en maintenant sa position.
Dans ce contexte, Bill Gates et Paul Allen décident de fonder une société afin de commercialiser et développer le BASIC eux-mêmes.
Naît alors,à Albuquerque, en juillet 1975, Microsoft.
Bill Gates prend 60 % des parts et conserve les droits de propriété du logiciel révolutionnaire.
Microsoft signe un contrat d'exclusivité avec MITS pour la diffusion du BASIC. Toutefois, l'accord indique que Microsoft reste propriétaire de son langage. Les deux fondateurs touchent 3000$ à la signature mais les revenus ensuite sont faméliques : "chaque fois que MITS diffuse un exemplaire, elle doit reverser 35 $ à Microsoft".
4.3 - L'irrésistible envol de Microsoft
Au fur et à mesure de leur collaboration, les relations entre Bill Gates et Ed Roberts sont devenus de plus en plus difficiles.
Bill Gates commence alors à prendre ses distances avec MITS, stipule Daniel Ichbiah.
En effet, de nouveaux microprocesseurs apparaissent : le 6800 de Motorola, le 6502 de MOS Technology ou le Z80 de Zylog par exemple. Bill Gates entreprend alors de développer des versions du BASIC pour ces autres constructeurs intéressés. Il écrit lui-même les versions du BASIC pour ces puces puis sillonne les États-Unis pour convaincre les constructeurs de les adopter.
Ses talents de programmeur et sa conviction enthousiasmante séduisent. Les commandes affluent.
4.4 - Premiers bureaux, employés et fin des études pour Bill Gates
Devant le succès du BASIC, Microsoft ouvre ses premiers vrais locaux et commence à recruter.
L'équipe jeune, rebelle et motivée travaille durement, mais toujours dans une atmosphère décontractée et propice à la créativité, à l'image d'une start-up informatique de la côte Ouest américaine de l’époque.
En décembre 1976, fasciné par les perspectives qui s’ouvrent à lui avec la micro-informatique, Bill Gates décide d'interrompre ses études de mathématiques à Harvard. Il veut se consacrer entièrement à Microsoft. Ses parents s'inquiètent, mais leur ami Samuel Stroum, conquis par l'enthousiasme du jeune homme, l'encourage vivement à poursuivre sa voie.
Bill Gates est habité par une soif intarissable de réaliser son rêve. Et avec Microsoft, il entend participer activement à l'émergence d'une nouvelle ère informatique : celle de la micro-informatique personnelle !
Chapitre 5 - La cause du BASIC
5.1 - Le succès du BASIC
"Vers la fin 1976, une controverse s'élève au sujet de la propriété du langage. Ed Roberts rencontre de sérieuses difficultés à gérer MITS : il est obligé de rembourser à de nombreux clients les extensions défectueuses de l'Altair."
En fait, à cette époque, la micro-informatique souffre d'un manque de professionnalisme et de fiabilité, informe Daniel Ichbiah. Les premières machines sont artisanales, bricolées de façon approximative par des passionnés. L'assistance technique est quasi inexistante.
Mais dès 1977, de vrais produits grand public comme l'Apple II ou le TRS-80 apparaissent. Et en adoptant le BASIC de Microsoft, ces nouvelles machines vont finalement assurer le succès commercial de la jeune société qu’est alors Microsoft.
5.2 - L'avènement de l'Apple II et l’émergence de CP /M
Ainsi, dans le 5ème chapitre du livre "Bill Gates et la saga Microsoft", Daniel Ichbiah nous raconte comment, grâce à sa détermination et à d'habiles négociations, Microsoft parvient, en 1977, à conserver la propriété de son BASIC révolutionnaire. Et comment il devient rapidement le langage de programmation de référence des micro-ordinateurs naissants.
Avec son design réussi, sa robustesse et son BASIC intégré, l'Apple II de Steve Jobs et Steve Wozniak séduit rapidement les particuliers. Soutenu par des investisseurs, Apple s'impose alors comme le premier véritable succès commercial de l'histoire de la micro-informatique.
"L'Apple II fait l'objet d'éloges de la part des magazines spécialisés : il s'agit d'un ordinateur disponible en boutique qui fonctionne dès qu'on le branche. Il devient le premier succès de la micro-informatique."
De plus, le système d'exploitation CP/M, créé par Gary Kildall, permet de faire fonctionner les logiciels sur différents micro-ordinateurs grâce à une interface standardisée. Son adoption généralisée facilite grandement le développement d'un véritable marché du logiciel indépendant des constructeurs.
5.3 - Une secrétaire découvre le monde étrange de Microsoft et de la programmation
Daniel Ichbiah nous parle ici de Myriam Lubow, secrétaire embauchée par Microsoft en 1977.
Il raconte, non sans humour, comment cette mère de famille de 4 enfants, et âgée de 42 ans, d’abord, découvre avec perplexité l’étrange et nouveau monde du "logiciel", et celui de l’équipe de Microsoft. Puis, il explique comment la secrétaire est vite impressionnée par la personnalité hors-norme et l'énergie débordante du jeune président Bill Gates.
5.4 - L'essor des langages
Daniel Ichbiah termine ce chapitre de "Bill Gates et la saga Microsoft" en nous apprenant que, fort de son BASIC à succès, Microsoft se diversifie rapidement. L’entreprise propose, en effet, d'autres langages comme le Pascal ou le COBOL, tous compatibles avec le standard CP/M.
En quelques années, lance alors l’auteur, Microsoft s’impose comme le leader incontesté du logiciel pour micro-ordinateurs.
Chapitre 6 - Retour au pays
6.1 - Une équipe atypique
À Albuquerque puis Seattle, les jeunes programmeurs de Microsoft mènent un rythme de vie intense. Ils travaillent jour et nuit avec un dévouement total à leur mission. Mais l'ambiance est décontractée et anticonformiste au sein de cette dream team de l'informatique, confie Daniel Ichbiah.
"Bob O'Rear est embauché le 8 janvier et découvre, à sa grande stupéfaction, une compagnie différente de toutes celles qu'il a connues auparavant. Lorsqu'il arrive au huitième étage de la Two Park Central Tower, vers neuf heures, il lui arrive de trouver Bill Gates ou Paul Allen endormis à même le sol."
6.2 - Le succès au Japon
Daniel Ichbiah nous raconte ici l’amitié que Bill Gates a noué avec Kazuhiho Nishi, un passionné de technologie japonais qui devient le représentant de Microsoft au Japon.
Grâce à lui, affirme l’auteur, le BASIC séduit rapidement les grands constructeurs japonais. Et le PC NEC 8001 qui l'adopte connaît un très grand succès commercial.
6.3 - Le retour dans l'état de Washington
En 1978, Microsoft déménage du Nouveau-Mexique.
Beaucoup incitent vivement les fondateurs de Microsoft à s’installer dans la Silicon Valley où les plus grandes sociétés de l’informatique résident. Mais Paul Allen a le mal du pays et Bill se fiche de l’endroit où s’installer à condition que le lieu soit propice à son extension. Ils choisissent donc de partir pour Bellevue, dans la banlieue de Seattle, leur ville d'origine.
"La plupart des employés consentent à migrer vers l'état du Washington" souligne Daniel Ichbiah. Myriam Lubow, quant à elle, ne peut pas les suivre. Mais au final, ce rapprochement géographique et familial soude l’équipe, explique l’auteur de "Bill Gates et la saga Microsoft". Et change le quotidien de Bill Gates qui n’avait pas pris la mesure des effets de la proximité familiale : "Plusieurs fois par jour, sa mère Mary téléphone pour prendre des nouvelles et veiller à ce qu'il prenne son déjeuner et dorme suffisamment."
6.4 - Microsoft affiche une croissance explosive !
Daniel Ichbiah termine ce sixième chapitre du livre "Bill Gates et la saga Microsoft" en revenant sur la croissance sans précédent de Microsoft à ce moment-là.
Il décrit ainsi comment l’entreprise :
Réussit à dépasser les nouveaux challenges technologiques : avec le puissant microprocesseur Intel 8086, Microsoft relève le défi de développer un nouveau BASIC 16 bits en un temps record, grâce à un partenariat fructueux avec la société locale SCP.
Atteint 2,5 millions de dollars de CA, en 1979, grâce à ses langages de programmation multi-plateformes, désormais compatibles avec le système standard CP/M.
S'impose comme le leader incontesté du logiciel micro-informatique : et ce, dans un contexte où la micro-informatique connaît une croissance explosive et devient un marché extrêmement porteur. Apple, par exemple, fort du succès de l'Apple II, s'apprête à entrer en bourse.
Ces évolutions n'échappent pas à la puissante société IBM qui observe le secteur avec attention...
Chapitre 7 - Le projet le plus insolite d'IBM
7.1 - Un projet secret chez IBM
Dans le chapitre 7 de l’ouvrage "Bill Gates et la saga Microsoft", Daniel Ichbiah nous plonge dans les coulisses d’IBM.
Nous apprenons qu’en 1980, IBM forme une équipe secrète baptisée "projet Chess". Son but est de concevoir rapidement un micro-ordinateur destiné au grand public.
Ce projet insolite, dévoile l’auteur, est confié à des esprits libres et créatifs, totalement affranchis de la lourdeur administrative habituelle d'IBM.
Contrairement aux habitudes d'IBM, le comité Chess est chargé de s'appuyer sur des fournisseurs externes pour le matériel et les logiciels. Il s'inspire en fait, selon l’auteur, du succès de l'Apple II, avec sa conception hardware ouverte et sa capacité à évoluer grâce aux extensions par cartes.
7.2 - Le BASIC de Microsoft s'impose
Pour ce qui concerne le logiciel, le BASIC de Microsoft apparaît incontournable. Il semble évident que c’est celui qui devra être intégré nativement à tous les micro-ordinateurs du marché.
IBM contacte donc Bill Gates comme consultant et lui commande plusieurs langages :
L'option du microprocesseur 8086 : Bill Gates plaide avec succès pour qu’IBM choisisse le puissant microprocesseur 16 bits 8086 d'Intel. Ce choix audacieux ouvre la voie au développement d'une nouvelle génération de logiciels bien plus élaborés.
Le système d’exploitation QDOS : devant l'échec des négociations tendues avec Digital Research pour obtenir CP/M dans les délais, IBM demande à Microsoft de leur trouver une solution. Microsoft mise alors, pour cela, sur QDOS, un clone de CP/M pour le 8086 développé par Tim Paterson de SCP. C’est semble-t-il, pour Bill Gates, le système d'exploitation parfait pour le futur PC IBM.
Chapitre 8 - Le sauna MS-DOS
Le huitième chapitre de "Bill Gates et la saga Microsoft" décrit les challenges rencontrés par Microsoft pour répondre aux commandes d’IBM.
8.1 - Un développement sous haute sécurité
Pour développer en secret le MS-DOS et les logiciels du futur PC IBM, les programmeurs de Microsoft sont confinés à Bellevue dans une petite pièce sans fenêtre, sous des conditions de sécurité draconiennes imposées par IBM. La porte doit rester fermée à clef et les documents conservés dans des coffres, relate l’auteur.
"Les conditions de travail que devront supporter les programmeurs sont infernales" écrit Daniel Ichbiah : "la pièce ne mesure que 3 mètres sur 2, n'a ni fenêtres ni ventilation".
8.2 - Un travail d'adaptation colossal
Par ailleurs, Microsoft doit adapter et étendre considérablement les capacités limitées du système QDOS racheté à Tim Paterson pour créer un MS-DOS digne d'équiper le futur PC grand public d'IBM. Et les délais imposés par IBM pour livrer une première version sont extrêmement serrés.
8.3 - Des problèmes techniques majeurs
La fiabilité hasardeuse du prototype fourni par IBM et les changements continuels de spécifications matérielles causent des retards importants.
Les programmeurs de Microsoft perdent un temps précieux à diagnostiquer des bugs qui proviennent en fait du hardware de mauvaise qualité.
8.4 - Une collaboration étroite entre IBM et Microsoft
Malgré les difficultés techniques, IBM et Microsoft collaborent étroitement au quotidien pour tenter de respecter les délais convenus. Des ingénieurs d'IBM sont dépêchés à Seattle et un système de messagerie électronique relie en permanence les équipes des deux sociétés.
8.5 - Des tests de qualité draconiens
Avant validation, les logiciels sont soumis à une batterie de tests intensifs et rigoureux conduits par IBM. Cette exigence de qualité totale force l'admiration des développeurs de Microsoft et leur permet d'atteindre un nouveau niveau professionnel.
8.6 - Objectif enfin atteint !
En 1981, après des mois de labeur intense dans des conditions difficiles, la version 1.0 du MS-DOS est enfin approuvée par IBM pour équiper le futur PC grand public.
La version 1.0 de MS-DOS soumise pour approbation comporte quatre mille lignes de langage assembleur et occupe 12 Ko de mémoire. IBM valide le système créé par Microsoft.
"Un soir de juillet 1981, Bill apprend que Big Blue se prépare à annoncer la sortie de sa machine. L'événement est célébré avec délire dans un restaurant chic de Seattle. Pour les programmeurs, une grande quantité de travail reste à fournir puisqu'il faut achever les langages Pascal, Fortran, Cobol, Assembleur... Le travail reprend donc de plus belle. Le 27 du même mois, Paul Allen acquiert les droits du QDOS de Tim Paterson auprès de SCP pour la somme de 50 000 dollars. Gates reçoit un message pour le moins formel de son commanditaire : "Cher Fournisseur. Vous avez accompli un bon travail"."
Chapitre 9 - Le kid de Big Blue
9.1 - L'annonce de l'IBM PC
En août 1981, IBM créé la surprise en annonçant l'IBM PC, un micro-ordinateur 16 bits performant doté du MS-DOS de Microsoft :
"IBM annonce un ordinateur personnel commercialisé au prix de 1.565 dollars. Cette machine, destinée aux entreprises, écoles et foyers peut utiliser plusieurs centaines de logiciels. Elle comporte un microprocesseur 16 bits à haute vitesse. Le PC peut être utilisé avec un écran couleur ou noir et blanc. Il intègre le célèbre BASIC de Microsoft et peut exécuter le logiciel de prévision financière VISICALC."
La machine séduit par son design soigné et suscite un fort engouement, bien au-delà des prévisions prudentes d'IBM.
De plus, contrairement aux habitudes monolithiques d'IBM, le PC est conçu de manière ouverte, avec des composants standard et des spécifications publiées. D'autres constructeurs sont donc en mesure de produire des "clones" compatibles.
Quant à Apple, l’entreprise accueille "ce concurrent redoutable avec courtoisie et humour en s'offrant une pleine page dans le Wall Street Journal, intitulée : "Bienvenue à IBM, sérieusement"." Le texte se poursuit dans le même esprit :
"Bienvenue sur le marché le plus excitant et le plus important depuis que la révolution informatique a commencé il y a trente-cinq ans. Et félicitations pour votre premier ordinateur personnel. En mettant la puissance d'un ordinateur entre les mains des individus, il est possible d'améliorer la façon dont ils travaillent, pensent, apprennent à communiquer et occupent leur temps de loisir. L'aptitude à l'informatique devient aujourd'hui aussi presque aussi fondamentale que savoir lire ou écrire."
Apple termine en disant "qu'elle espère qu'IBM sera un concurrent responsable et contribuera à apporter cette technologie américaine au monde entier".
9.2 - Le match MS-DOS / CP/M
Daniel Ichbiah expose ici la concurrence rude entre le MS-DOS et le CP/M, alors leader du marché.
Gary Kildall, créateur du CP/M, considère qu’en s’inspirant de CP / M pour créer le MS-DOS, Microsoft les a tout simplement volé. Dès lors :
"Il [Gary Kildall] va jusqu'à envisager un procès à l'encontre d'IBM. Don Estridge [père de l’IBM PC] calme la situation en expliquant qu'il n'était pas au courant de ce plagiat et propose un arrangement à l'amiable. IBM proposera officiellement deux systèmes d'exploitation pour son PC : le MS-DOS, et la version 16 bits de CP/M, dès que celle-ci sera prête."
À ce moment-là, Bill Gates réalise que rien n’est gagné face à la popularité soutenue du CP/M parmi les passionnés. Et que le nom d'IBM n'est pas suffisant pour imposer le MS-DOS ni même le PC :
"CP/M reçoit le soutien de la presse spécialisée et fait l'objet d'une adulation persistante. […] Lorsque InfoWorld élit les dix meilleurs produits de l'année 1981, neuf titres correspondent à des logiciels CP/M. Il faudra attendre mars 1982 pour que ce magazine se résigne à publier le banc d'essai d'un produit MS-DOS."
Ainsi, face à des ordinateurs concurrents de meilleure qualité que l'IBM PC et souvent équipés de CP/M, Bill Gates et Tim Paterson (le créateur du système d’exploitation) décident d'aller activement démarcher les fabricants pour promouvoir le MS-DOS, espérant le faire adopter sur leurs machines.
Et leurs efforts auprès des constructeurs paient. En 1984, Microsoft équipe 80 % des PC et compatibles.
9.3 - L'essor du logiciel
Finalement, porté par le succès d'IBM, le MS-DOS s'impose comme standard de facto et stimule le développement massif de logiciels spécifiques par des éditeurs tiers indépendants. L'industrie du logiciel décolle.
"Des milliers de programmeurs réfléchissent activement aux logiciels du futur et entretiennent l'espoir de réaliser les premiers best-sellers de la machine d'IBM..."
Chapitre 10 - Une application irrésistible
10.1 – Créer une application marquante pour le grand public
L’auteur du livre "Bill Gates et la saga Microsoft" souligne, dans ce chapitre, que Bill Gates devient ensuite conscient d’un point important : le micro-ordinateur a besoin d'applications marquantes pour séduire le grand public, à l'image de VisiCalc pour l'Apple II dans les années 1970.
Le président de Microsoft se lance alors dans le développement de Multiplan, un tableur destiné à concurrencer VisiCalc.
10.2 - Le développement de Multiplan, le futur concurrent de VisiCalc
C’est Charles Simonyi, un ingénieur hongrois venu de Xerox, qui prend en main le développement de Multiplan en 1981.
Ce dernier structure une équipe pour programmer le logiciel selon une approche pyramidale qu'il a théorisée. Le tableur de Simonyi et son équipe est conçu pour fonctionner sur un maximum de machines différentes, dans une stratégie d'encerclement du leader VisiCalc : "Par cette stratégie d'encerclement, Gates et Allen espèrent établir Electronic Paper comme le tableur n°1 de la micro-informatique".
Microsoft informe IBM, son partenaire privilégié, du projet Multiplan et accepte de brider les capacités du logiciel pour qu'il puisse tourner sur les PC d'entrée de gamme de la firme. Après de multiples péripéties, Multiplan est finalement commercialisé en août 1982 sur Apple II, avant d'arriver en octobre sur IBM PC.
10.3 - L'arrivée fracassante de Lotus 1-2-3, le futur leader
En novembre 1982, au salon Comdex de Las Vegas, Microsoft découvre avec stupéfaction Lotus 1-2-3, un tableur développé spécifiquement par Mitch Kapor pour exploiter toute la puissance des IBM PC haut de gamme.
"À son grand dam, Simonyi sait que ce nouveau concurrent, Lotus, détient l'application irrésistible de l'IBM PC !"
Commercialisé en janvier 1983 après un lancement pharaonique, Lotus 1-2-3 s'impose en quelques mois comme le tableur de référence. Il distance rapidement Multiplan, bridé par les choix initiaux de Microsoft. Mitch Kapor refuse la proposition de rachat par Microsoft. En 1984, Lotus devient alors le premier éditeur de logiciels, dépassant Microsoft.
"L'ascension de Lotus agace fortement Bill Gates", glisse Daniel Ichbiah. Et l'arrivée tonitruante de Lotus 1-2-3 marque un tournant pour Microsoft.
Car à ce moment-là, Bill Gates prend la mesure du talent de conception de logiciels de Mitch Kapor. Et malgré ses indéniables qualités techniques, Multiplan ne peut rivaliser avec le produit phare de Lotus.
Chapitre 11 - Word, le littéraire
11.1 - Word, le traitement de texte révolutionnaire
Après Multiplan, Bill Gates et Charles Simonyi se lancent dans le développement de Word, un traitement de texte appelé à révolutionner l'écriture sur ordinateur.
Word est conçu par Charles Simonyi en s'inspirant de Bravo, un traitement de texte innovant doté d'une interface graphique qu'il avait créé chez Xerox. L’auteur le décrit comme le premier traitement de texte PC "dont les services seront accessibles en manipulant une souris" avec un écran affichant "certains aspects du texte : gras, souligné, italique, interlignes, etc."
11.2 - Aux USA, Word est un succès très mitigé
Face à WordStar, leader du marché, Word mise sur la convivialité et l'ergonomie.
Présenté en 1983, le fameux traitement de texte reçoit d’abord un accueil mitigé :
Aux États-Unis, il ne parvient d’abord pas à percer, car il est largement dominé par WordPerfect. Ce n’est qu’après 3 ans et 3 versions, que Word s’impose enfin aux USA :
"Si les premières moutures de Word n'étaient pas satisfaisantes, la version 3, publiée en avril 1986 le met au diapason de ses concurrents. Elle intègre un didacticiel qui permet aux débutants de maîtriser les subtilités du traitement de texte. Un correcteur orthographique analyse les documents et propose de rectifier les anomalies. Cette troisième tentative est la bonne : Word obtient un accueil chaleureux, et vient se classer à la cinquième position des ventes de l'année."
En France, par contre, Word rencontre rapidement un franc succès grâce à une stratégie marketing audacieuse : en effet, le PDG de Microsoft France Bernard Vergnes et son équipe mènent une offensive de charme auprès des revendeurs pour promouvoir Word. Ils sillonnent le pays de long en large pour former en masse les distributeurs qui deviennent des ambassadeurs du logiciel.Grâce à cette stratégie marketing audacieuse et à l'arrivée des imprimantes laser, Word devient le traitement de texte le plus vendu en France en 1987.
Chapitre 12 - La révolution Macintosh d’Apple
Le chapitre 12 du livre "Bill Gates et la saga Microsoft" nous plonge au cœur d’une révolution informatique : celle déclenchée par le lancement du mythique Macintosh.
Le Macintosh - ou Mac - est une machine conviviale dotée d’une interface graphique innovante. Son lancement est un séisme numérique, car c’est ce qui va enfin rendre les ordinateurs accessibles au grand public. À son origine : Steve Jobs et son équipe chez Apple.
12.1 - Les découvertes de Xerox inspirent Apple à créer le Macintosh
L’auteur de "Bill Gates et la saga Microsoft" relate d’abord une anecdote sur la genèse du Macintosh.
Un jour de septembre 1979, Steve Jobs est invité à visiter les laboratoires de recherche de Xerox (Xeros a, en effet, investi un million de dollars dans la société Apple, et a donc accepté de dévoiler certaines de ses inventions à des membres triés sur le volet).
Daniel Ichbiah relate la visite :
"Lorsque Lawrence Tessler [alors président de Xeros] a dévoilé l'ordinateur Alto, les hôtes de Cupertino [ville de la Silicon Valley qui abrite le siège d’Apple] ont poussé un cri d'admiration : ils n'ont jamais rien vu de tel ! Job a été effaré par la démonstration effectuée par Tessler : un écran qui affiche des images à la place de mots, une souris pointe sur des objets graphiques et les déplace à volonté. C'est ainsi qu'il faut concevoir les ordinateurs ! Or, Xerox néglige cette manne providentielle :
- Mais pourquoi ne commercialisez-vous pas cela ? C'est extraordinaire ! Vous pourriez pulvériser tout le monde ! s’exclame Jobs.
Jobs, Atkinson, Raskin et leurs six autres collègues sont revenus de Palo Alto avec la ferme conviction d'avoir entrevu l'ordinateur du futur."
C’est ainsi, qu’inspiré par ces innovations, Steve Jobs décide d'intégrer les interfaces graphiques développées chez Xerox au Macintosh, l’ordinateur expérimental qu’Apple mijote en secret.
12.2 - Apple et Microsoft travaillent ensemble pour développer le Macintosh
Microsoft est appelé à la rescousse pour co-développer le Mac.
Charles Simonyi, le maitre d’œuvre du logiciel Word de Microsoft, participe alors activement à la conception de ce bijou technologique. Sous la direction de Steve Jobs, le Macintosh introduit des concepts révolutionnaires comme la souris, les icônes, le glisser-déposer. Microsoft développe des applications comme Multiplan.
Mais la collaboration prometteuse entre Apple et Microsoft tourne court : les premiers mois, c'est la dolce vita entre les deux entreprises. On code nuit et jour dans une ambiance décontractée. Mais la lune de miel est de courte durée.Microsoft ne parvient pas à tenir les délais irréalistes imposés par Apple. Et à peine le Macintosh sorti, des tensions éclatent. Apple accuse Microsoft de lui avoir subtilisé des secrets technologiques pour développer Windows, l'interface graphique de Microsoft pour PC.
L’ambiance est électrique dans la Silicon Valley !
12.3 - Un lancement tonitruant pour le Macintosh
Dévoilé en 1984, le Macintosh suscite l'émerveillement par son interface graphique révolutionnaire.
"Le public découvre avec ravissement l'interface graphique du Mac. MacPaint, qui a été conçu par Bill Atkinson est simple d'emploi. Le dessin est effectué à la souris en sélectionnant des formes et en les étirant à volonté" décrit l'auteur.
Steve Jobs orchestre un lancement pharaonique pour le Macintosh, présenté comme l'antithèse de la rigueur IBM. Malgré des débuts tonitruants, les ventes du Macintosh vont rapidement décliner, la machine restant trop coûteuse.
Chapitre 13 – Excel
Le treizième chapitre du livre "Bill Gates et la saga Microsoft" revient sur la création d’Excel.
Daniel Ichbiah nous raconte comment ce tableur signé Microsoft va s'imposer, non sans rebondissements, audace et obstination, pour devenir l'application reine de sa catégorie dans les années 80.
Grâce à son interface intuitive, le logiciel séduit massivement les utilisateurs. En quelques mois à peine, le petit poucet Excel détrône le géant Lotus 1-2-3. Une incroyable démonstration de force signée Bill Gates.
13.1 - Excel, le tableur de Microsoft censé détrôner Lotus
Dans cette partie de "Bill Gates et la saga Microsoft", Daniel Ichbiah revient plus en détail sur la naissance laborieuse d’Excel.
Année 1983 : rappelez-vous, sur le marché des tableurs, Lotus 1-2-3 règne en maître absolu. Il écrase littéralement ses concurrents. Cette situation hérisse Bill Gates. Mais le fondateur de Microsoft aime les défis impossibles. Il réunit son équipe dans un chalet isolé avec une mission : créer un tableur pour détrôner Lotus.
Les brainstormings, lors de cette retraite, suscitent des débats houleux ! Mais le projet Excel finit par émerger des discussions animées. Parmi les développeurs positionnés sur le projet, Doug Klunder s’investit corps et âme. Le problème, c’est que les délais imposés par Bill Gates sont intenables.
Et surtout, coup de tonnerre en 1985 : Apple lance le Macintosh... avec Lotus Jazz, concurrent direct d’Excel ! Bouleversé, Bill Gates décide de changer Excel de plateforme pour contrer Lotus Jazz. Doug Klunder, lui, claque la porte, ulcéré de voir son boulot réduit à néant, promettant de "ne jamais remettre les pieds dans cette boite".
13.2 – Quand Excel faillit ne jamais voir le jour
C’est alors le début d’un développement cauchemardesque. Le nouveau responsable du projet, Phil Florence, est "submergé par les responsabilités du projet, en butte aux remontrances persistantes de Gates". Il finit par craquer et est victime d’une "défaillance cardiaque".
Excel frôle même l’annulation. Heureusement, Doug Klunder revient in extremis sauver son bébé :
"Au sein de l’équipe de développement, l’atmosphère est lourde et le moral entame une chute libre. Tandis que Florence part pour la clinique, l'avenir d'Excel apparaît compromis. La chance donne alors un coup de pouce. Doug Klunder se fait voler le bagage qu'il avait emmené sur les routes de Californie. Totalement démuni, il se trouve dans une situation où il doit au plus vite gagner un peu d'argent. Tout bien réfléchi, Microsoft apparaît la solution la plus adéquate. Doug Klunder revient à Seattle et s'en vient frapper à la porte de son ancien employeur. Il est accueilli les bras ouverts, à la façon d'un messie."
Le 30 septembre 1985, après moult péripéties, Excel sort enfin ! Un accouchement douloureux qui marquera à jamais ses créateurs.
13.3 - Le triomphe d'Excel sur Macintosh
Grâce à une intense campagne marketing, Excel rencontre un immense succès sur Macintosh.
Encore une fois, en quelques mois seulement, il supplante Lotus Jazz, pourtant présenté comme LE tableur du Macintosh ! Porté par des capacités techniques supérieures, Excel s’impose même comme l’application incontournable des tableurs sous Mac.
En avril 1986, le verdict tombe : Excel vend 2 fois plus que son rival ! rapporte l’auteur.
Si bien qu’avec Excel et Word, Microsoft s'arroge 50 % du marché des logiciels sur Macintosh en 1987.
Grisé par ce comeback retentissant, Bill Gates a désormais le regard rivé vers un horizon encore plus ambitieux : reproduire cette domination écrasante sur l’énorme marché des PC compatibles IBM. Avec son précieux sésame : Windows.
L’appétit de Microsoft semble décidément sans limite. Et Bill Gates est prêt à tout pour assouvir ses ambitions dévorantes !
Chapitre 14 – Windows ou la conception chaotique d'un géant
14.1 - Un projet pharaonique semé d'embûches
En 1981, en pleine effervescence graphique, Microsoft se lance dans un pari fou : développer Windows, un système d'exploitation qui se veut révolutionnairedestiné à uniformiser l'apparence des logiciels.
Mais très vite, ce projet titanesque vire au chemin de croix.
En effet, le développement d’un tel système s'avère d'une complexité technique insoupçonnée, fait observer l’auteur. Dès lors, les délais ambitieux ne sont pas tenus et Windows accumule les retards, au grand dam de Bill Gates. Ce dernier change constamment d'avis sur les spécifications du système, exaspérant les développeurs. "Entre conflits et départs, le projet Windows devient chaotique" lance l'auteur.
Bref, retards à répétition, changements de cap incessants imposés par Bill Gates, départs en cascade des développeurs à bout de nerfs... Windows devient le projet maudit de Microsoft !
14.2 - La sortie laborieuse de Windows 1.0, première version du système d’exploitation
Après 4 ans de déboires et de retard par rapport aux prévisions initiales, Windows 1.0 voit enfin le jour fin 1985. Sous le triomphalisme de façade, la réalité est cruelle : jugé lent, buggé et inutilisable, Windows 1.0 est un loupé retentissant.
En effet, le public boude massivement le système d’exploitation de Microsoft, moqué et devenu tristement célèbre sous le nom de "vaporware", soit logiciel fantôme. "Windows 1.03 apparaît comme une imitation bâtarde et médiocre de l'interface graphique du Mac" assène l'auteur.
Ce qu’on ne sait pas encore, c’est que, contre toute attente, cet accouchement douloureux marquera, en fait, la naissance d’un futur géant, souligne Daniel Ichbiah. Car en dépit des railleries, Bill Gates persiste. Le chef d’entreprise visionnaire pressent le potentiel révolutionnaire de Windows. Et bien lui en prend, car quelques années plus tard, Windows s’imposera comme LE système d’exploitation quasi universel…
Chapitre 15 - L'introduction en Bourse de Microsoft
Dans le quinzième chapitre de "Bill Gates et la saga Microsoft", Daniel Ichbiah met en lumière un évènement majeur de la saga Microsoft : il relate comment, en 1986, après des années de croissance fracassante, Microsoft devient enfin une société cotée en bourse.
En fait, l’introduction en Bourse de la société a été méticuleusement préparée par Bill Gates et ses équipes, confie l’auteur…
15.1 - La préparation minutieuse de l'opération boursière
Nous voilà donc en 1986. Malgré ses réticences initiales, Bill Gates, s’est résout, cette année-là, à introduire Microsoft en Bourse.
La société peaufine l'opération avec le plus grand soin. Elle est conseillée par les cabinets financiers Goldman Sachs et Alex Brown. "Un prospectus est rédigé avec soin, Bill Gates effectue une tournée promotionnelle auprès des investisseurs" note l'auteur.
Après âpres négociations entre Frank Gaudette, directeur financier de Microsoft, et les équipes de Goldman Sachs, le prix de l’action est fixé à 21 $. 12 % du capital de Microsoft sera proposé aux investisseurs. La machine est lancée !
15.2 - Un succès boursier retentissant propulse Bill Gates au sommet
Le 13 mars 1986 restera à jamais une date historique, témoigne l’auteur de "Bill Gates et la saga Microsoft".
Oui, ce jour-là, l’action Microsoft entre en fanfare à la Bourse de New York. Affichée à 27,75 $ avec une demande massive, elle flambe rapidement jusqu’à 35 $.
La valeur de Microsoft explose littéralement, pulvérisant tous les records du secteur. Celle-ci est estimée à 661 millions de dollars.
Grâce à ses 11 millions d'actions, la fortune personnelle de Bill Gates est évaluée, elle, à 350 millions de dollars. "L'action de Microsoft progressant de façon rapide, le montant de la richesse de Gates s'élève, moins d'un an plus tard, à plus d'un milliard de dollars " fait remarquer Daniel Ichbiah.
L’opération boursière a donc propulser Bill Gates au rang de milliardaire. À seulement 31 ans, Bill Gates figure parmi les hommes les plus riches du monde. Emperor Bill est né !
Chapitre 16 - La redistribution des cartes dans le monde du PC
Au milieu des années 1980, de nouveaux acteurs bouleversent l'équilibre établi dans le monde des PC et du logiciel. IBM décline, Microsoft poursuit son ascension. Plus que jamais.
C’est ce que nous raconte Daniel Ichbiah dans le chapitre 16 du livre "Bill Gates et la saga Microsoft".
16.1 - Le déclin progressif d'IBM, leader historique mais géant aux pieds d'argile
Vers la moitié de la décennie 1980, IBM subit de plein fouet l'offensive des constructeurs de compatibles à bas prix. Incapable d'imposer ses normes propriétaires OS/2 et PS/2, sa domination sur le standard PC s’effrite rapidement. Big Blue sombre inexorablement. Pendant ce temps, Bill Gates mise avec génie sur les clones de Compaq…
16.2 - La montée en puissance de Microsoft
Grâce au succès foudroyant d'Excel, Microsoft double Lotus : en 1987, la marque s’empare de la pole position des éditeurs de logiciels.
Mais la sortie de Windows 2.0, bien plus performant, et l'accord avec les fabricants de compatibles renforcent encore davantage la position dominante de Microsoft.
Seul bémol, Apple intente un procès retentissant contre Windows, accusé de plagier éhontément le Macintosh...
La Silicon Valley entre dans la tempête !
16.3 - Un nouvel ordre s’installe
En quelques années à peine, l’ordre établi dans la micro-informatique a volé en éclats, termine l’auteur de "Bill Gates et la saga Microsoft". IBM n’est plus qu’un acteur de second plan et Microsoft règne en maître.
Sous l’impulsion de Bill Gates, un Nouveau Monde s’est imposé. Et ce n’est pourtant que le début de l’ère Microsoft...
Chapitre 17 - Microsoft Inc.
Dans le chapitre 17 de son livre "Bill Gates et la saga Microsoft", Daniel Ichbiah montre comment Bill Gates a créé chez Microsoft un environnement de travail singulier. Un fonctionnement hors-norme qui reflète parfaitement la personnalité charismatique et travailleur acharné du fondateur de la firme imposante.
17.1 - Microsoft Inc., un empire aussi fou que son génie de fondateur
Grâce au génie de Bill Gates, Microsoft est le cocktail détonnant d’un esprit "potache" de campus et d’obsession concernant les résultats : "L'ambiance est celle d'un campus universitaire potache" écrit Daniel Ichbiah.
Étrangement, malgré la pression infernale, l’état d’esprit y reste très décontracté. Une grande liberté est accordée aux employés.
L'actionnariat et les stock-options permettent à de nombreux employés de s'enrichir considérablement. C'est un puissant facteur de motivation et de fidélisation au sein de Microsoft.
17.2 - Un dirigeant passionné, exigeant et colérique
Bill Gates se dévoue corps et âme à Microsoft, travaillant sans relâche jour et nuit, week-ends et vacances. Passionné par l'informatique, il est d'une exigence extrême envers lui-même mais aussi envers ses collaborateurs. Et il insuffle, de fait, un rythme effréné à son entreprise.
Les colères, homériques du chef d'entreprise, et son caractère entier suscitent des clashs violents et des hurlements au sein de Microsoft. "Il existe un autre Bill, que certains représentent comme tyrannique, blessant et dédaigneux" souffle Daniel Ichbiah. Puis, il rajoute : "Gates est célèbre pour une expression que de nombreux employés avouent avoir pris au visage de plein fouet : "C'est l'idée la plus stupide que j'aie jamais entendue".
Toutefois, Bill Gates sait reconnaître ses torts. Et derrière son caractère volcanique se cache aussi un fin psychologue très doué pour repérer les talents et les galvaniser, assure l’auteur.
17.3 - L’ADN Gates coule dans toutes les veines
Finalement, en un peu plus de 10 ans, Bill Gates a créé un empire à son image : démesuré, passionné, incontrôlable. Chez Microsoft, on vit, respire et transpire Microsoft 24 heures sur 24. La patte Gates est partout, son ADN coule dans toutes les veines. Et dans cet univers décalé, on travaille dur mais on s’amuse bien ! soutient l’auteur.
Chapitre 18 - La magie de Windows 3.0
Dans ce nouveau chapitre, l’auteur du livre "Bill Gates et la saga Microsoft" nous parle du lancement spectaculaire de Windows 3.0 en 1990 par Microsoft. Son succès immédiat fait entrer les interfaces graphiques dans une nouvelle dimension et marque aussi la fin de la collaboration avec IBM.
18.1 - Le lancement hollywoodien de Windows 3.0
Le 22 mai 1990, Bill Gates orchestre le lancement de Windows 3.0 comme un véritable show à grand spectacle. 5000 personnes assistent à l'événement au Manhattan Center de New York. "Jamais dans l'histoire du PC, un produit n'a été annoncé avec une telle fanfare et un sens aussi aigu du spectacle" s’enthousiasme l'auteur.
Le jour J, un film introduit la nouvelle version de Windows, présentée comme une révolution :
"14 heures 45. Un jazz synthétique aux accents californiens baigne l'atmosphère. La musique s'estompe discrètement tandis que les lumières progressivement s'éteignent. Le film qui présente Windows 3.0 aux cinq mille spectateurs présents à New York ce jeudi 22 mai 1990 semble avoir été conçu avec autant d'attention que le logiciel lui-même. Le message est clair : ce moment est historique. Nous traversons les années de genèse de la micro-informatique depuis l'apparition des premiers microprocesseurs sur fond de Watergate jusqu'aux années 90. Des éclairs laser jaillissent de toute part sous les applaudissements."
18.2 - Le public est conquis !
Lors de la démonstration, la luxuriance des couleurs et des icônes saisit le public :
"À présent, la vidéo présente un utilisateur passablement étonné devant son PC "ancienne mode" recouvert du MS-DOS. À la façon d'Alice qui pénétrait de l'autre côté du miroir, il enjambe l'écran qui s'est transformé en fenêtre et s'introduit à l'intérieur du PC. Il se retrouve dans une pièce colorée, décorée de palettes géantes, où l'on voit défiler les titres de logiciels appelés à entrer dans la légende : Excel, PageMaker... Un mot-clé emplit l'écran, symbolisant le nouvel esprit qui doit présider à la micro-informatique sur PC : COOL ! Le film d'introduction se conclut sur une déclaration éclatante : IL EST LA ! MAINTENANT ! Lui, c'est Windows 3.0, et son architecte, le Maître Gates apparaît sur la scène, accueilli comme un réalisateur qui viendrait de rafler plusieurs Oscars."
Après sa présentation, la foule fait une ovation à Bill Gates :
"Comme un adolescent qui viendrait de jouer sa première pièce devant un parterre d'adultes, il [Bill Gates] apostrophe la foule : "Alors, qu'en pensez-vous ?" Pour toute réponse, il reçoit une salve d'applaudissements ponctuée de cris joyeux. Businessmen, analystes financiers et hauts responsables, oublient leur réserve habituelle et manifestent leur allégresse."
Des événements similaires sont ensuite organisés dans le monde entier. L’auteur rapporte que 25 programmeurs ont œuvré à cette version de Windows. À chaque représentation, ces derniers sont présents et invités par Bill Gates à monter sur scène. Sur leurs tee-shirts est écrit : "Nous croyons dans la magie".
18.3 - Un triomphe commercial immédiat et la fin de l’alliance avec IBM
Windows 3.0 est accueilli avec un grand enthousiasme : dès sa première semaine de commercialisation, il devient le logiciel le plus vendu. De nombreuses entreprises annoncent leur passage à Windows.
Grâce à cette version 3.0, les interfaces graphiques entrent définitivement dans les usages, observe Daniel Ichbiah.
"Du côté d’IBM, le désarroi est grand. Microsoft n’était-elle pas censée œuvrer avant tout sur le système OS/2 ? Comment est-il possible que Gates ait ainsi retourné la situation ?" s'interroge l'auteur.
Le triomphe de Windows 3.0 marque la fin de la collaboration étroite entre Microsoft et IBM. Désormais, Microsoft mise sur la réussite des interfaces graphiques Windows pour s'imposer face aux offensives d'IBM.
Chapitre 19 - Divorce avec IBM
19.1 - La romance IBM-Microsoft tourne court
Nous le savons, les alliances stratégiques dans le monde des affaires sont "éphémères, tactiques et intéressées".
Aussi, Daniel Ichbiah commence ce chapitre de "Bill Gates et la saga Microsoft", en relatant comment l’alliance historique IBM-Microsoft, pilier du succès de DOS, finit, avec le temps, par voler en éclats :
Avec le temps, l'union IBM-Microsoft a fini par ressembler à celle d'un vieux couple curieusement assorti. Le fringant Bill Gates avait épousé la richissime Big Blue, qui en guise de dot, lui avait donné les clés d'un royaume doré. La présence du système d'exploitation MS-DOS sur les IBM PC a permis au gigolo de Seattle d'amasser les dollars par millions. Oui, mais voilà : l'union est devenue invivable, car fort de sa richesse, Madame se croyait tout permis. IBM a voulu imposer des décisions que Bill savait erronées et absurdes !
Autrement dit : quand IBM veut imposer son OS/2, Bill Gates prévient IBM : la conception d'OS/2 est une erreur. Mais IBM n'écoute pas ses arguments, et malgré ses avertissements, campe sur ses positions bureaucratiques. L’innovation made in Microsoft se heurte au mur de la lourdeur IBM.
C'est à partir de là que le divorce commence à se profiler. Daniel Ichbiah analyse les tenants et aboutissants de l'histoire :
"Dès 1989, Bill Gates a été clairement tenté par le divorce. [...]. Mais on ne se sépare pas impunément de Big Blue. Trop d'intérêts sont en jeu. Constructeurs de compatibles PC ou d'accessoires, éditeurs de logiciels, magazines spécialisés, tous tirent parti de l'image idyllique renvoyée par le couple. Bill a manqué de courage et préféré une porte de sortie, graduelle et furtive. Avait-il le choix ? Pas si sûr. Il reste que lorsque la divorcée découvrira le pot aux roses, elle aura mille raisons de se sentir bafouée. Quant aux amis de la famille, ils auront le sentiment d'avoir été trahis. Persuadés que Microsoft exécutait sans rechigner les volontés d'IBM, ils ont naturellement inscrit leur parcours sur la trace de celle-ci. Comme IBM criait "OS/2", ils ont suivi la route d'OS/2, alors que dans le plus grand secret, Bill Gates se tournait délibérément vers Windows..."
19.2 - Le développement laborieux d'OS/2
Le développement d'OS/2 sous la supervision d'IBM s'est fait de manière bureaucratique, à l'opposé de la culture d'innovation chez Microsoft. Avec des équipes gigantesques de 1700 programmeurs répartis sur 3 sites, la prise de décision était lente et compliquée :
"À Seattle, si l'un d'entre eux est traversé par une idée brillante, il lui suffit de traverser quelques couloirs pour en faire part à son directeur de projet. Si nécessaire, il peut même adresser un message à Steve Ballmer ou même à Bill Gates lui-même. En quelques heures, la décision d'aller de l'avant ou non est prise. À Boca Raton, dans les laboratoires d'IBM, le projet OS/2 était dirigé de façon bureaucratique par une hiérarchie de comités. La prise de décision pouvait s'étaler sur plusieurs jours ou semaines, le temps qu'une proposition gravisse un à un les échelons de commandement."
Lenteurs, tergiversations : Bill Gates sait qu’OS/2 court à la catastrophe.
Pendant qu’il comprend l’échec annoncé de OS/2, Windows 2.0 caracole en tête grâce à Excel. Microsoft prépare en secret la riposte avec Windows 3.0.
19.3 – Bataille à mort dans la Silicon Valley
Année 1990 : tandis qu’OS/2 s’écrase au décollage, Windows 3.0 triomphe.
Les éditeurs de logiciels sont furieux du double jeu de Bill Gates. Ils se sentent trahis par l’alliance IBM-Microsoft. La rupture est inévitable. Et la guerre est déclarée !
"Jim Manzi de Lotus a manifesté publiquement sa colère et laissé entendre qu'il soupçonnait Microsoft d'agir de façon déloyale. Tandis que Steve Ballmer a tenté de calmer le jeu, en coulisses, certains sont allés jusqu'à envisager la constitution d'un front anti-Microsoft."
Quand un jour, un document confidentiel rédigé par Bill Gates fuite dans la presse... Il s'agit d'un mémo dans lequel le chef d'entreprise indique qu'"il faut "attaquer" le système d'IBM par tous les moyens". Cette publication signe la fin des relations. Désormais, IBM misera sur son alliance avec Apple, en 1991, pour contrer l’ennemi Gates...
19.4 – Microsoft assoit sa domination, IBM amorce son déclin
Avec Windows 3.1 (qui succède à Windows 3.0), Microsoft devient n°1 mondial des éditeurs et enchaîne les milliards de revenus.
Pendant ce temps, IBM dégringole et doit se séparer de 30 000 employés. Cruel retournement de situation ! L’alliance historique n’était qu’un mariage de raison. Ce divorce était inéluctable... pour le meilleur et pour le pire !
Chapitre 20 - Enquête sur l’empire Microsoft
Dans le chapitre 20 du livre "Bill Gates et la saga Microsoft", Daniel Ichbiah nous explique comment, malgré ses dénégations, Microsoft se retrouve dans le collimateur des autorités pour ses pratiques anticoncurrentielles présumées au début des années 90.
L’auteur montre que, même si la FTC ("Federal Trade Commission" ou "Commission Fédérale du Commerce" en anglais) échoue dans son action, l'enquête du ministère de la Justice promet un long bras de fer juridique avec le tout puissant empire Microsoft.
20.1 - L'empire du logiciel sous la loupe
Avec le succès fulgurant de Windows à partir de 1990, Microsoft connaît une croissance exponentielle et devient un véritable empire du logiciel, réalisant 2,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 1992.
Mais cette expansion fascine autant qu'elle inquiète, signale l’auteur. Le géant Microsoft donnerait-il la priorité à ses profits plutôt qu'à l'innovation ? Ses pratiques commerciales sont-elles équitables ? L'administration américaine décide de se pencher sérieusement sur ces questions.
20.2 - Une annonce qui éveille les soupçons
Tout commence par une annonce lors d'une conférence à Las Vegas en 1989.
Microsoft et IBM y déclarent publiquement avoir trouvé un accord pour qu'OS/2 devienne le système d'exploitation haut de gamme, tandis que Windows restera cantonné au bas de gamme.
Cette annonce alerte aussitôt la Federal Trade Commission (FTC), qui y voit un signe de collusion illégale entre les deux mastodontes du logiciel pour éliminer la concurrence.
20.3 - Cinq chefs d'accusation contre Microsoft
Sous l'impulsion de son nouveau président Janet D. Steiger, la FTC ouvre discrètement une enquête confidentielle en 1990. Celle-ci est d'abord axée sur la relation entre Microsoft et IBM, mais ne révèle aucune preuve concrète de collusion illégale.
Par contre, énonce Daniel Ichbiah, de nombreux éditeurs de logiciels accusent Microsoft d'abus de position dominante.
L'enquête s'élargit donc et porte désormais sur une tentative présumée de monopole dans le secteur des logiciels. En 1992, la FTC rend publiques ses conclusions accablantes. Elle accuse Microsoft de 5 pratiques anticoncurrentielles graves.
Selon elle, Microsoft a :
Imposé son système d'exploitation MS-DOS aux constructeurs informatiques via des accords contraignants.
Pu mener une guerre des prix et proposer ses logiciels à très bas coût, subventionnés par les importants revenus générés par les licences MS-DOS.
Permis à ses équipes de développement pour Windows de bénéficier d'informations et d'accès privilégiés par rapport aux autres éditeurs de logiciels concurrents.
Annoncé à plusieurs reprises la sortie prochaine de nouveaux produits qui n'existaient pas encore, dans le but de gêner ses concurrents.
Volé des idées innovantes développées par des entreprises concurrentes pour ses propres logiciels, sans contrepartie.
20.4 - L'échec d'une injonction préliminaire
La FTC recommande une injonction préliminaire pour faire immédiatement cesser ces agissements, mais elle échoue à convaincre le comité décisionnel.
"Le 21 juillet, un nouveau vote est organisé à la FTC et le résultat est rigoureusement identique à celui de février : deux contre deux. Mary Azcuenaga, la seule membre qui eût permis de faire pencher la balance en faveur du "oui" déclare qu'elle n'a pas trouvé dans le dossier suffisamment de preuves justifiant d'attaquer Microsoft en justice."
Suite à ce blocage, le ministère américain de la Justice reprend l'enquête en 1993 sous la direction de la pugnace Anne Bingaman.
20.5 - L'offensive des rivaux de Microsoft
Années 90. Fort de ses succès, Microsoft se retrouve maintenant dans le collimateur de ses concurrents.
Son rival Novell, un autre éditeur de logiciel réputé, devient un opposant de poids. Son PDG Ray Noorda s’allie à Lotus et dépose plainte auprès de l’Union Européenne. Il dénonce, en effet, des accords liant le MS-DOS aux constructeurs d'ordinateurs, qui empêchent, dit-il, Novell de vendre son DR-DOS concurrent.
Bill Gates contre-attaque avec sarcasme. "La nouvelle du rapprochement de Lotus et Novell est annoncée en fanfare en avril. Gates la commente d'une boutade en demandant ce que peut bien faire l'addition de "1" plus "1-2-3"."
Mais Novell fournit des documents compromettants, relançant l’enquête aux USA...
20.6 – Une bataille d'influence sans merci
Dans le même temps, Andrew Schulman, expert réputé de Windows, affirme que Microsoft a sciemment introduit des "pièges" dans Windows pour le rendre incompatible avec DR-DOS de Novell.
La révélation fait l’effet d’une bombe et renforce considérablement l’accusation.
Bill Gates vacille.
Jusqu'au dernier vote en juillet 1993, les deux camps mènent un lobbying intensif pour influencer la FTC. Le résultat est à nouveau un blocage de la FTC.
Mais le ministère de la Justice mené par Bingaman reprend l'affaire. Furieux, Microsoft se prépare à une longue bataille judiciaire. L’Empire Gates tremble sur ses bases !
Chapitre 21 – Bill Gates et la civilisation multimédia
Dans le chapitre 21 de "Bill Gates et la saga Microsoft", Daniel Ichbiah revient sur la capacité visionnaire de Bill Gates à anticiper, dès les années 80, l'avènement d'une "civilisation multimédia", qu'il voit comme la "nouvelle Renaissance". Une époque où Microsoft, nous le verrons, compte bien, sous la férule de son dirigeant ambitieux, conserver sa position dominante de maître du monde numérique.
21.1 - L’avènement annoncé du multimédia
Dès 1986, Bill Gates entrevoit la naissance d'une "civilisation multimédia".
Pour lui, c’est clair : avec la démocratisation des PC, le numérique envahira tous les foyers, voitures, poches, etc. Et Microsoft fournira les logiciels indispensables à cet avenir tout numérique.
Bill Gates mise alors sur le CD-ROM. Il anticipe son avènement : le CD-ROM permettra d'accéder à des contenus multimédias interactifs. En 1989, il crée même Continuum, future Corbis, pour acquérir les droits d’œuvres d’art à numériser.
21.2 – Le futur multimédia : l’info "au bout des doigts"
Au Comdex 1990, Bill Gates prédit un futur où l’information sera accessible partout. Un monde où chacun recevra quotidiennement l’actualité personnalisée et bénéficiera d’enseignements à distance.
C’est que le fondateur de Microsoft appelle la "nouvelle Renaissance".
Anticipant cette révolution, Microsoft se dote rapidement d'une division dédiée au grand public pour développer des CD-ROM de divertissement. Et ce, avant même qu'Al Gore ne popularise le concept "d'autoroutes de l'information".
21.3 - Garder sa couronne
Bill Gates s'allie avec Intel et d'autres pour la télévision interactive. Il mise aussi sur un "Wallet PC", assistant électronique miniature futuriste.
En 1994, le marché du CD-ROM explose, les ventes aux particuliers dépassent celles aux entreprises.
Mais Internet pointe son nez, et cette montée inquiète Microsoft.
Bill Gates investit alors massivement - des milliards - pour rester incontournable dans la distribution de l’information : hors de question de perdre son statut de maître du monde du numérique !
Chapitre 22 - Bill Gates intime
Derrière l'image d'homme d'affaires impitoyable et malgré son immense fortune, Bill Gates mène une vie simple, note Daniel Ichbiah. C'est ce qu'il nous décrit avec détail dans ce nouveau chapitre de "Bill Gates et la saga Microsoft" consacré au milliardaire dans son intimité.
22.1 - La fortune colossale de Bill Gates
Bill Gates déteste qu'on évoque sa richesse colossale. "L'argent ne me rapporte rien", confie le titan du logiciel, "si ce n'est des questions indiscrètes" continue-t-il.
Sa fortune est pourtant devenue la plus importante des États-Unis en 1992, avec 6,3 milliards de dollars selon Forbes.
Le fondateur de Microsoft minimise cet aspect, rappelant que sa richesse n'est que virtuelle via ses actions Microsoft.
Malgré ses milliards, il mène d’ailleurs un train de vie simple et modeste, révèle l’auteur de "Bill Gates et la saga Microsoft". Il déteste gaspiller. Par exemple, pour ses déplacements en avion, il voyage quasiment toujours en classe économique, se refusant le confort de la première classe.
22.2 - La vie sentimentale discrète de Bill Gates
Bill Gates est très discret sur sa vie privée. Avant son mariage, on le connait comme étant peu enclin à la fidélité. Il a alors de nombreuses petites amies, attiré par les femmes intelligentes et indépendantes, divulgue l’auteur.
Sa relation la plus notable reste, à cette époque, dans les années 80, celle avec Ann Winblad. Selon l'auteur, celle-ci a eu une influence positive sur son hygiène de vie. Ann le décrit comme un homme qui aime les situations extrêmes.
Puis, "peu après sa rupture avec Winblad, Bill a entamé une relation sentimentale avec une employée de Microsoft, de neuf ans sa cadette, Melinda French" confie l’auteur.
En 1992, Melinda devient sa compagne officielle. Leur mariage secret a lieu début 1994 à Hawaï. Selon Daniel Ichbiah, sa relation avec Melinda French l'a assagi. Cette dernière réussit même à le convaincre de fonder une famille.
22.3 - Une résidence high-tech estimée à 50 millions
Daniel Ichbiah nous apprend ici que le couple Gates habite un manoir high-tech spectaculaire de 20 000 m2 sur les rives du lac Washington, avec piscine, bibliothèque, home cinéma...
"La propriété privée de Bill est ainsi appelée à devenir l'endroit idéal pour effectuer des démonstrations de technologies avancées à ses visiteurs et méditer sur la société numérique du futur."
La maison est entièrement contrôlée par ordinateur.
22.4 - Un philanthrope passionné par Léonard de Vinci
L’auteur du livre "Bill Gates et la saga Microsoft" termine ce portait intime de Bill Gates en évoquant son côté philanthrope et ses passions. Nous apprenons que :
Bill Gates a annoncé qu'il léguerait 95 % de sa fortune à des œuvres philanthropiques.
En 1994, il a battu des records en achetant pour 30 millions de dollars des manuscrits de Léonard de Vinci aux enchères : ""c'est la personnalité la plus stupéfiante que la Terre ait jamais porté" estime Bill" à propos de De Vinci.
Son autre passion est la biotechnologie, dans laquelle il investit massivement.
Chapitre 23 - Splendeurs et misères de Microsoft
Dans le chapitre 23 de "Bill Gates et la saga Microsoft", Daniel Ichbiah nous explique comment, avec sa puissance grandissante dans les années 90, l'image de Microsoft et de son dirigeant Bill Gates a connu un spectaculaire retournement. De génie visionnaire adulé à tyran assoiffé de pouvoir détesté, il n’a suffi que d’un pas !
23.1 - L'image de prédateur colle à la peau de Bill Gates
De leader cool et charismatique faisant figure de génie de l'informatique, Bill Gates devient, en quelques années seulement, la cible de critiques virulentes et de caricatures assassines. On l’assimile à un prédateur assoiffé de pouvoir et de domination démesurée. Et les enquêtes anti-trust menées par les autorités américaines ont largement alimenté cette image négative, souligne Daniel Ichbiah. Le golden boy se mue en ogre !
23.2 - Un accord à l'amiable avec le gouvernement controversé
En 1994, après de longues investigations, le ministère américain de la Justice finit par proposer un accord à l'amiable pour clore son enquête anti-trust contre Microsoft. Mais cet accord jugé trop clément par les nombreux concurrents du géant du logiciel est très critiqué.
Menés par l'avocat Gary Reback, plusieurs éditeurs de logiciels font alors pression sur le juge Stanley Sporkin pour annuler cet accord négocié. Et ils n’ont pas tort, sous-entend l’auteur. Car Bill Gates continue ses attaques afin d’asseoir sa domination avec le lancement en fanfare de son propre réseau en ligne - le Microsoft Network - intégré à Windows 95 et sa tentative de rachat de l'éditeur Intuit (cette fois bloqué par le ministère de la Justice devant le tollé provoqué).
Mais coup de théâtre ! La ministre Janet Reno prend la défense de Microsoft. En juin 1995, la Cour d’Appel entérine l’accord à l’amiable initial conclu entre Microsoft et le gouvernement, provoquant la colère du camp anti-Gates.
23.3 - Une réputation de mégalo assoiffé de pouvoir
Sur Internet, Bill Gates devient la cible de rumeurs délirantes et de caricatures le dépeignant en tyrannosaure obsédé par la domination du monde..
Il faut dire que son ambition démesurée d'être le maître absolu du monde numérique finit par inquiéter et agacer. Même la presse économique sérieuse s’y met ! Le magazine The Economist le parodie sous les traits d'une araignée géante.
Bref, l’image de Microsoft continue de se dégrader, et à vitesse grand V à présent. En quelques années, la société passe de start-up triomphante et sympathique à empire tout-puissant et tentaculaire prêt à écraser impitoyablement ses concurrents. Et la réputation sulfureuse d'homme d'affaires impitoyable de Bill Gates lui colle désormais à la peau…
Chapitre 24 - L'année de tous les anniversaires
Ce chapitre de "Bill Gates et la saga Microsoft" nous amène en 1995 : année historique et triomphale pour Microsoft. Elle marquée précisément par l'accession de Bill Gates au rang de premier milliardaire mondial et le succès planétaire de Windows 95.
24.1 - Trois anniversaires symboliques
L'année 1995 est une année charnière pour Bill Gates et Microsoft.
Elle est en effet, indique Daniel Ichbiah, marquée par trois anniversaires :
Les 20 ans de Microsoft,
Les 10 ans de Windows,
Les 40 ans de Bill Gates.
La compagnie est florissante, avec un chiffre d'affaires de près de 6 milliards de dollars. Le campus de Redmond s’est considérablement agrandi : il "s'étend sur cent cinquante hectares et abrite vingt-six bâtiments". C'est aussi l'année du lancement tant attendu de Windows 95, en août. Et oui, malgré les critiques, Microsoft connaît une croissance insolente.
Quant à Bill Gates, en 1995, il devient l'homme le plus riche du monde selon Forbes. Sa fortune est estimée à 12,9 milliards de dollars. Malgré cela, il conserve un train de vie simple et déteste évoquer sa richesse. "Il écarte la possibilité d'acquérir un avion personnel qui rendrait ses mouvements plus efficaces." Il aborde la quarantaine comme un cap important, conscient du poids des années.
24.2 - Le lancement titanesque de Windows 95
Le lancement mondial de Windows 95, en août 1995, est un événement planétaire, dont s’emparent tous les médias.
Microsoft dépense sans compter en publicité, avec une campagne titanesque sur fond sonore des Rolling Stones.
"En fond sonore des images du spot publicitaire Windows 95, les Rolling Stones déclament Start me up ! C'est la première fois que le groupe de rock a autorisé une utilisation commerciale d'une de ses chansons. Selon un tabloïd anglais, Bill Gates n'aurait pas hésité à débourser 12 millions de dollars pour obtenir l'aval de Mick Jagger. […] La raison pour laquelle Gates voulait à tout prix la chanson des Stones est la présence sur le bureau de Windows 95 d'un bouton crucial portant la mention Start (Démarrer)."
Microsoft participe à une émission télévisée animée par une star de la télé. De nombreuses marques prestigieuses s’associent également à cette campagne.
24.3 - Le succès phénoménale de Windows 95
Mais il reste quand même des ombres au tableau, souligne Daniel Ichbiah : le ministère américain de la Justice poursuit son enquête anti-trust, notamment sur le Microsoft Network. Par ailleurs, un groupe de consommateurs tente d'interdire la vente de Windows 95 via des plaintes pour publicité mensongère.
Mais malgré les appels au boycott et les menaces du ministère américain de la Justice, Windows 95 sort finalement en août 1995.
Et c'est un triomphe mondial ! Le nouveau Windows intègre le controversé Microsoft Network. Les ventes démarrent sur les chapeaux de roue. Les files d'attentes ne cessent de s’allonger devant les magasins la nuit du lancement.
Mais si 1995 marque l'apogée de Windows et l'entrée dans une nouvelle ère numérique, avec Internet notamment, de nouveaux nuages s'amoncèlent à l'horizon pour le tout puissant empire Microsoft.
Chapitre 25 - La conquête d’Internet
Le chapitre 25 du livre "Bill Gates et la saga Microsoft" décrit comment, menacé, Microsoft passe à la vitesse supérieure pour ne pas rater le virage d’Internet. Et comment le géant du logiciel parvient, au final, à mettre Netscape K.-O. debout.
25.1 - La naissance du Web
En 1989, Tim Berners-Lee, chercheur au CERN à Genève, imagine le World Wide Web : un réseau reliant entre eux tous les documents disponibles sur Internet.
Son idée de génie est d’utiliser des "liens hypertextes" pour connecter les pages web entre elles. Mais pour rendre la navigation sur ce réseau réellement accessible au grand public, il faut développer un logiciel intuitif…
25.2 - L’arrivée tonitruante de Netscape
En 1993, Marc Andreessen, étudiant à l’Université de l’Illinois, crée Mosaic, le premier navigateur doté d’une interface graphique.
Jim Clark, pionnier de la réalité virtuelle, décide de s’associer à lui.
Ils fondent ensemble la société Mosaic Communications en 1994, rapidement rebaptisée Netscape.
Leur navigateur Netscape Navigator rencontre un succès foudroyant à sa sortie en octobre 1994. Et grâce à sa convivialité, il s’impose comme le logiciel de référence pour surfer sur le web.
25.3 - De sceptique à pionnier : l'évolution de Bill Gates face à Internet
Bill Gates, de son côté, se montre d’abord très sceptique sur l’intérêt d’Internet.
Sa priorité est autre : il préfère focaliser sur le développement de Microsoft Network, un service en ligne payant.
Mais petit à petit, sous l’influence de conseillers comme Steve Sinofsky, il prend conscience du potentiel du web. En 1995, il décide d’intégrer le protocole TCP/IP dans Windows 95 et rachète le navigateur Spyglass pour créer Internet Explorer.
25.4 - L’alliance fatale Netscape-Java menace l’empire Microsoft
Quand, en 1996, Netscape s’allie à Sun et son langage de programmation Java, c’est un coup de tonnerre dans la Silicon Valley .
Pourquoi ? Parce que Netscape devient alors une menace stratégique pour l’empire de Microsoft, lance Daniel Ichbiah. En effet, en permettant d'écrire des applications multi-plateformes, Java remet en cause le modèle Windows.
Aussi, quand l’action Netscape s’envole en Bourse, c’est la panique à bord. La pression sur Microsoft est à son maximum, lâche l’auteur.
25.5 – L’Empire contre-attaque
La réponse de Bill Gates est immédiate : Internet Explorer est amélioré et proposé gratuitement. Autre contre-attaque : des accords sont passés avec les constructeurs de PC. Ces accords leur imposent de pré-installer Internet Explorer sur les ordinateurs.
Petit à petit, Netscape perd des parts de marché. Résultat, la firme chute lourdement. Et en 1997, le ministère de la Justice ouvre une enquête anti-trust contre Microsoft pour abus de position dominante. Bill Gates est encore dans le collimateur des autorités. Une nouvelle bataille judiciaire commence...
Chapitre 26 – Abus de position dominante
Dans cette partie du livre "Bill Gates et la saga Microsoft", expose longuement le déroulé des batailles judiciaires du titan du software.
Daniel Ichbiah note l'arrogance et le manque d'humilité qu’affiche Microsoft dans sa défense. Une posture qui va largement contribuer à fédérer ses opposants et à ternir durablement l’image de marque de l’entreprise.
Mais que cela ne tienne ! En dépit du tollé provoqué, de la vindicte de ses rivaux et des menaces judiciaires, le mastodonte Microsoft poursuit coûte que coûte son développement.
Quitte à s'attirer les foudres de la Silicon Valley toute entière !
26.1 - Le durcissement des relations avec le Ministère de la Justice
Fin des années 90 : l'incompréhension s'accroît entre Microsoft et le Ministère de la Justice, distant tant géographiquement que philosophiquement. De plus en plus, la firme perçoit les injonctions du gouvernement comme du harcèlement bureaucratique.
Mais c’est l’affaire Internet Explorer qui va vraiment faire déborder le vase.
En effet, des constructeurs (comme Compaq) témoignent avoir été forcés sous la menace de pré-installer Internet Explorer sur leurs machines. En mars 1997, une enquête anti-trust est ouverte.
Des documents internes attestent de la volonté délibérée de torpiller Netscape, de l’éliminer du marché des navigateurs. En octobre 1997, l’inévitable se produit : le procès historique "USA contre Microsoft" est officiellement lancé.
Du côté de la Silicon Valley, on se frotte les mains. Le mastodonte vacille enfin. Et la meute de ses détracteurs aiguise ses crocs, prête à le dévorer...
26.2 - L'arrogance de Microsoft dessert sa défense
Plutôt que de faire profil bas, Microsoft affiche une arrogance et un mépris vis-à-vis des poursuites. Cette attitude lui est très dommageable, souligne l’auteur de la biographie de Bill Gates.
Le chef d’entreprise de Microsoft nie avec aplomb toute intention anticoncurrentielle devant le Congrès. Mais des extraits accablants d'emails internes et le témoignage de cadres de sociétés partenaires contredisent ses dires. Son audience difficile au Congrès, en août 1998, entame sérieusement son image d'enfant prodige intouchable.
De plus, tout au long du procès à grand spectacle, d'anciens partenaires comme Intel ou IBM viennent témoigner des pressions reçues pour favoriser Microsoft au détriment de ses rivaux.
26.3 - Le procès du siècle déclenche un cataclysme
Novembre 1999 : le verdict tombe tel un couperet. Microsoft est reconnu coupable d'abus de position dominante.
3 avril 2000 : nouveau séisme. Le juge ordonne purement et simplement de scinder Microsoft en deux !
Conséquence immédiate de cette annonce : l’action Microsoft s’effondre, entraînant la débâcle boursière des valeurs technologiques de la "net économie".
"Ce plongeon est si important qu’il entraîne la plupart des valeurs Internet dans la dégringolade. Onze jours plus tard, le 14 avril, le Nasdaq enregistre la plus forte baisse de son histoire. Bill Gates voit s’envoler 11,1 milliards de ses dollars en une seule journée. La chute de l’action Microsoft, même si elle n’est que temporaire, sonne le glas de ce que l’on a appelé la "net-économie". Les start-ups apparues depuis 1995 s’écroulent une à une et des dizaines de milliers de dépôts de bilan sont à l’horizon."
Bref, le procès du siècle provoque un véritable cataclysme sur les marchés, "une crise qui va se prolonger sur 4 ans" annonce l’auteur.
26.4 - Un front anti-Microsoft se constitue
Outre le ministère de la Justice, un front d’États américains (menés par leurs procureurs) et une coalition d’entreprises high-tech mènent désormais une action concertée contre Microsoft.
En l’espace de 2 ans, l'image de Microsoft se dégrade fortement.
Bill Gates passe du statut de génie adulé à celui d’impitoyable monopoleur abusif. Mais en dépit des coups durs et des procès, la machine Microsoft poursuit inexorablement son expansion, comme imperméable aux critiques.
Chapitre 27 – Les tribulations de Bill Gates philanthrope
Le dernier chapitre du livre "Bill Gates et la saga Microsoft" aborde la carrière philanthropique de Bill Gates, marquée par ses ambitions démesurées et sa formidable énergie au service de nobles causes. Mais Daniel Ichbiah montre aussi que, dans ce domaine, sa communication maladroite et quelques controverses évitables vont, encore une fois, sérieusement nuire à son image publique.
27.1 - La naissance d'une vocation philanthropique
En 1993, lors d'un voyage en Tanzanie avec Melinda, Bill Gates découvre la misère et les maladies comme la polio qui ravagent l'Afrique.
Profondément choqué par la pauvreté des populations, il prend conscience de l'urgence d'agir et décide de consacrer l'essentiel de sa colossale fortune personnelle à des actions humanitaires.
Quatre ans plus tard, en 1997, la lecture d'un article poignant sur les conséquences mortelles de l'eau polluée dans les bidonvilles le pousse à passer à l'action.
Avec Melinda, son épouse, il créé la Fondation Bill et Melinda Gates en 2000, qu'il dote immédiatement de 31 milliards de dollars issus de ses actions Microsoft.
27.2 - Les ambitions titanesques de la Fondation Gates
Une fois lancé, Bill Gates s'attaque avec sa fougue habituelle à des défis humanitaires monumentaux, à l'échelle de ses moyens financiers considérables : éradiquer des maladies comme la polio, fournir de l'eau potable aux populations les plus démunies, lutter contre le réchauffement climatique.
Il finance des chercheurs pour mettre au point des toilettes révolutionnaires n'utilisant ni eau courante ni électricité.
Il mise aussi sur l'énergie nucléaire propre avec des investissements massifs dans la start-up TerraPower.
Son optimisme inébranlable et sa détermination à trouver des solutions forcent l'admiration.
27.3 - Une image progressivement ternie
Pourtant, en dépit de ses indéniables succès médicaux en Afrique, Bill Gates suscite rapidement la controverse par ses liens étroits avec le géant agricole Monsanto et sa promotion des OGM.
Puis, suite à la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon en 2011, son soutien ferme à l'énergie nucléaire civil est aussi largement critiqué.
Surtout, ses propos maladroits sur la nécessaire réduction de la population mondiale par la vaccination sont déformés et utilisés contre lui.
En 2020, il devient même la cible n°1 des conspirationnistes sur l'épidémie de coronavirus.
Encore une fois, en quelques années, son image d'optimiste bienveillant s'est sérieusement ternie.
27.4 - Le lent déclin de Microsoft
Pendant ce temps, souligne l’auteur, Microsoft perd inexorablement du terrain face aux géants de l'internet Apple et une jeune pousse, Google, nettement plus innovants.
Sa tentative de diversification dans les consoles de jeux avec la Xbox reste un demi-succès.
Bill Gates donne parfois l'impression d'un capitaine dépassé par l'époque qu'il a lui-même largement façonnée. Mais cela ne l'empêche absolument pas de poursuivre inlassablement ses combats humanitaires à très grande échelle, avec une générosité et une opiniâtreté qui forcent le respect, termine l'auteur.
Conclusion de "Bill Gates et la saga Microsoft – Nouvelle édition 2020" de Daniel Ichbiah
1/ Les 3 grandes thématiques développées dans cette biographie de Bill Gates
1.1 - Le destin exceptionnel d'un génie de l'informatique
Dans cet ouvrage passionnant, Daniel Ichbiah brosse le portrait d'un homme fascinant, doté d'un esprit brillant, à la fois geek surdoué, entrepreneur intrépide et dirigeant charismatique.
Ainsi, Daniel Ichbiah revient, en détail, sur le parcours hors-normes de Bill Gates qui, avec son intelligence vive et ses capacités de visionnaire, est parvenu, en quelques années, à bâtir rien de moins que l’entreprise leader mondial du logiciel informatique !
1.2 - La saga mouvementée de la création de Microsoft
L'auteur nous plonge ensuite dans les coulisses de la genèse de Microsoft. Une aventure exaltante mais semée d'obstacles, de revirements stratégiques et de coups de poker audacieux.
Daniel Ichbiah montre très bien comment, avec une énergie et une détermination à toute épreuve, Bill Gates et son équipe sont parvenus à imposer leur vision en faisant de Microsoft une machine à innover devenue incontournable.
1.3 - Une hyperpuissance controversée
Enfin, le livre retrace les années 1990 et la montée en puissance controversée de l'empire Microsoft, son dirigeant charismatique se muant progressivement en tyran pour certains.
L'ouvrage revient sur les pratiques commerciales agressives du géant du logiciel, les procès retentissants pour abus de position dominante et l'image de Bill Gates, passant du statut de héros admiré des nouvelles technologies à celui de redoutable tyran avide de pouvoir.
2/ Ce que la lecture de "Bill Gates et la saga Microsoft" va vous apporter
Avec ce récit captivant aux nombreux rebondissements, Daniel Ichbiah nous fait revivre de l'intérieur l'une des épopées les plus fascinantes de l'histoire de l'informatique.
En suivant le parcours de Bill Gates, c'est aussi toute une industrie en pleine ébullition créative que vous découvrirez, avec la formidable aventure humaine qui l'a portée. L'ouvrage est ainsi une plongée passionnante dans les coulisses de la révolution numérique qui a profondément transformé nos sociétés.
3/ Une biographie incontournable, à lire comme une épopée des temps modernes
"Bill Gates et la saga Microsoft" est une épopée passionnante ! Je vous en recommande vivement la lecture si vous vous intéressez à l'histoire de l'informatique, aux grandes sagas entrepreneuriales ou plus largement à l'aventure des nouvelles technologies qui ont radicalement changé nos modes de vie.
Porté par une galerie de personnages hauts en couleur et de nombreux rebondissements, "Bill Gates et la saga Microsoft" se dévore comme un roman d'aventure haletant. C'est assurément l'une des biographies les plus complètes jamais écrites sur Bill Gates et Microsoft.
Points forts :
La biographie passionnante de Bill Gates, génie charismatique de l'informatique et l'un des hommes les plus riches de la planète.
Le récit haletant et captivant des succès et épreuves traversés par Microsoft, la plus grande société de logiciels au monde, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui.
Des anecdotes et témoignages qui nous plongent au cœur de la révolution numérique et de tous ses protagonistes fascinants et hauts en couleurs.
Points faibles :
Certains passages très techniques sur le fonctionnement des logiciels et sur le monde de l’informatique peuvent rebuter les non-initiés.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu "Bill Gates et la saga Microsoft – Nouvelle édition 2020" de Daniel Ichbiah ? Combien le notez-vous ?
Visitez Amazon afin d'acheter le livre de Daniel Ichbiah "Bill Gates et la saga Microsoft – Nouvelle édition 2020"
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Daniel Ichbiah "Bill Gates et la saga Microsoft – Nouvelle édition 2020"
Cet article Bill Gates et la saga Microsoft est apparu en premier sur Des livres pour changer de vie.
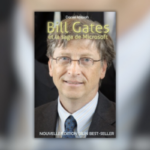 ]]>
]]>Résumé de « Autobiographie d'un yogi » de Paramahansa Yogananda : le témoignage unique et fabuleux du yogi qui a exporté le yoga de l'Inde vers les États-Unis au début du vingtième siècle.
Par Paramahansa Yogananda, 2022, 769 pages.
Titre original : Autobiography of a yogi, 2012.
Chronique et résumé de "Autobiographie d'un yogi" de Paramahansa Yogananda
1 - Mes parents et mes premières années
Né dans l'Uttar Pradesh (Inde) en 1893, Mukunda Lal Ghosh était le quatrième enfant d'une famille de huit personnes. Ses parents étaient des disciples du maître spirituel Lahiri Mahasaya, qui leur enseigna le Kriya Yoga.
À 8 ans, Mukunda est atteint du choléra asiatique. Il a alors une vision de saints dans des grottes de montagne. Il découvre également sa capacité à prédire certains événements.
Lorsqu'il est encore enfant, sa famille déménage à Lahore, au Pendjab. À cette époque, le jeune garçon vénère tout particulièrement la déesse Kali.
2 - La mort de ma mère et l'amulette mystique
À 11 ans, Ananta, le frère de Mukunda, se fiance. Malheureusement, sa mère meurt la même année, sans que celui-ci ait le temps de la revoir une dernière fois.
Ananta donne à Mukunda un message de leur mère, révélant qu'un moine lui a confié qu'il est destiné à devenir yogi. En héritage, elle lui transmet une amulette en argent, symbole de sa vocation nouvelle.
3 - Le saint aux deux corps
A 12 ans, Mukunda visite la ville de Banaras. À cette occasion, son père lui demande de donner une lettre à son ami Kedar Nath Babu. Grâce à l'intervention d'un tiers, le garçon parvient à localiser la personne et à le rencontrer pour lui remettre le document.
L'ami de son père, Kedar, arrive au rendez-vous après s'être baigné dans le Gange, puis disparait subitement dans la foule. Il semble à Mukunda que ce personnage saint parvient à se trouver simultanément à deux endroits !
4 - Ma fugue vers l'Himalaya est interrompue
Mukunda et ses amis prévoient de fuir Calcutta vers l'Himalaya. Ils se déguisent en Européens afin d'éviter que son grand frère, Ananta, ne les retrouvent.
C'est une véritable aventure mystique qui s'enclenche. L'un de ses amis disparaît à Burdwan, tandis que les autres continuent vers Hardwar. Ils sont interrogés par un responsable des chemins de fer, mais parviennent à s'échapper. À Hardwar, ils sont arrêtés par la police et c'est la fin de l'expérience.
Suite à cet épisode, Ananta emmène Mukunda à Banaras pour rencontrer un érudit hindou, dans l'espoir de le décourager de devenir sannyasi (initié, "prétendant" moine hindou). Cependant, leur mission échoue et ils retournent à Calcutta.
Le père de Mukunda fait alors en sorte que Swami Kebalananda, un moine disciple de Lahiri Mahasaya, lui enseigne le sanskrit. Cet apprentissage renforce encore davantage sa vocation.
5 - Le saint aux parfums et ses prodiges
Mukunda rencontre Gandha Baba, le « Saint des parfums », qui prétend notamment avoir le pouvoir de redonner aux fleurs fanées leur parfum. Mukunda remet en question ces prétentions en considérant qu'il est aisé de se procurer du parfum.
Pourtant, celui-ci est mis à l'épreuve et Mukunda est finalement convaincu par le pouvoir du moine (swami). Bien plus tard, il comprendra que les expériences sensorielles sont le résultat de variations vibratoires des électrons et des protons. Selon lui, Gandha Baba utilise des pratiques yogiques pour modifier la structure des représentations sensorielles et créer les effets souhaités.
6 - Le swami aux tigres
Mukunda rend visite à un autre swami, dit le Swami aux tigres. Ce saint lui raconte son histoire. Plus jeune, il était connu pour combattre les tigres à mains nues. Selon lui, ces animaux ne sont pas plus redoutables que les chats domestiques — il faut simplement de la force pour les maîtriser !
Après une blessure infligée lors d'une bataille mémorable avec un tigre, l'homme est blessé. Durant plusieurs mois, il lutte pour recouvrer la santé. Il décide alors, suivant les prédictions d'un prêtre, de se tourner vers la voie spiriturelle.
Celui-ci lui avait dit :
« Je t'apprendrai à maîtriser les bêtes de l'ignorance qui errent dans les jungles de l'esprit humain » (Autobiographie d'un yogi, Chapitre 6)
C'est comme ça que l'homme est devenu le "Swami aux tigres".
7 - Le saint aux lévitations
L'ami de Mukunda, Upendra Mohun Chowdhury, rapporte avoir vu un saint nommé Bhaduri Mahasaya léviter au-dessus du sol.
Ils finissent, là aussi, par se rencontrer. Bhaduri Mahasaya et Mukunda discutent de la pratique du yoga et le premier convainc le second qu'il devrait être pratiqué à la fois en Orient et en Occident.
Bhaduri Mahasaya devient un maître important pour Mukunda. C'est lui qui le convaincra de se rendre pour la première fois aux États-Unis pour y enseigner le yoga.
8 - Jagadis Chandra Bose, grand scientifique de l'Inde
Mukunda découvre les inventions du scientifique indien Jagadi Chandra Bose, notamment le crescographe, qui mesure la croissance des plantes. J. C. Bose admire la méthode scientifique occidentale et considère qu'il peut, grâce à elle, révéler la vie émotionnelle des plantes.
Pendant tout un temps, Mukunda fréquente l'Institut Bose de Calcutta. Il y apprend les lois physiques de la matière organique et inorganique. Les réalisations du laboratoire influencent, à cette époque, des domaines ausi variés que :
La physique ;
Mais aussi la physiologie ;
La médecine ;
Et même l'agriculture.
Mukunda observe les nombreux instruments inventés ou perfectionnés par J. C. Bose, comme le "cardiographe résonant", qui mesure les pulsations infinitésimales des structures végétales, animales et humaines.
9 - Le bienheureux fidèle et son amour cosmique
Alors jeune homme, Mukunda ressent un manque. Il pleure la perte de sa mère et se sent seul. Il demande de l'aide auprès d'un maître hindou qui le guide vers le Temple de Kali, célèbre déesse que Mukunda honorait déjà lorsqu'il était plus jeune.
C'est pour lui une nouvelle révélation. Toute cette période est marquée par une sensation de profonde plénitude et de dévotion à l'égard de Kali.
10 - Je rencontre mon maître, Sri Yukteswar
Mukunda ayant réussi ses examens de lycée, il rejoint un ermitage de Bénarès (aujourd’hui Vanarasi) avec son ami Jitentra. Au départ, il a du mal à s'adapter à la vie à l'ermitage ; d'autant plus qu'il découvre que son amulette a disparu (celle que lui avait confiée sa mère).
Il prie Kali pour l'aider et c'est à ce moment qu'il rencontre Sri Yukteswar Giri, son futur maître (guru ou gourou, en français). Il le suit jusqu'à Serampore, où ce dernier a sa résidence, et y passe plusieurs jours.
La fin du séjour se passe dans la discorde, car le gourou n'est pas content du refus de Mukunda de retourner auprès de sa famille. Il le met en garde : son enseignement futur n'est pas garanti. Mukunda devra à nouveau convaincre le maître de lui faire confiance.
11 - Deux garçons sans argent à Brindaban
Le frère de Mukunda, Ananta, envoie Mukunda et Jitendra à Brindaban pour le décourager de suivre sa vocation religieuse. Ils sont accompagnés de deux inconnus qui leur offrent de la nourriture, un abri et un repas luxueux.
Lors de leur périple, ils visitent aussi un temple et apprennent le Kriya Yoga auprès d'un jeune homme. Ananta lui-même est impressionné et demande à Mukunda de lui apprendre cette pratique.
Après le départ de son frère, Mukunda se rend à Serampore pour rencontrer son maître, qu'il avait connu quatre semaines plus tôt.
12 - Les années à l'ermitage de mon Maître
Sri Yukteswar demande à Mukunda de fréquenter l'université de Calcutta et est ensuite initié au Kriya Yoga. Il apprend de son maître ce qu'est la force vitale créatrice et comment elle peut le rendre plus sain et plus fort.
Il voit son gourou guérir des maux et apprend à discipliner son esprit. Le progrès spirituel de Mukunda dépend du traitement strict que lui réserve son maître.
Lors de la visite d'un érudit à l'ashram (ermitage), Sri Yukteswar se rebelle contre la lecture par cœur que celui-ci propose des Écritures saintes. Il lui demande comment il a véritablement appris de ces écritures à partir de sa propre expérience directe.
L'érudit, déstabilisé par ce questionnement, doit reconnaître qu'il n'a aucun sentiment profond et intérieur du divin. Plus tard, Sri Yukteswar soulignera encore que l’apprentissage des livres n’est pas nécessaire à la réalisation spirituelle. Le plus important, c'est la pratique.
13 - Le saint qui ne dort jamais
Après six mois passés à l'ashram de Sri Yukteswar, Mukunda rend visite à Ram Gopal Muzumdar, le "saint sans sommeil", dans l'Himalaya.
Après des débuts un peu houleux, Ram Gopal se montre plus amical et partage ses 25 années de pratique du yoga. Il prédit que Mukunda finira lui aussi par perdre le sommeil.
Cette visite fait beaucoup de bien à Mukunda, y compris sur un plan physique.
14 - L'expérience de la conscience cosmique
De retour à l'ashram, Sri Yukteswar lui indique que les montagnes himalayennes ne peuvent lui offrir ce qu'il cherche vraiment, à savoir la conscience cosmique.
Le secret est de vivre de manière équilibrée, en expérimentant l’infini sans affecter les tâches quotidiennes. En apprenant à calmer toujours davantage ses pensées, Mukunda pourra provoquer ce qu'il souhaite obtenir.
Celui-ci y parvient finalement. Il fait l'expérience de l'illumination divine, de la vision omnisciente et de la joie.
15 - Le vol du chou-fleur
Mukunda passe ses vacances d'été à Puri, à 310 milles au sud de Calcutta. À cette occasion, son gourou lui joue un tour pour le punir de son étourderie (il avait oublié de fermer la porte de l'ashram avant de partir). Il fait en sorte qu'un paysan vole un chou-fleur que Mukunda lui avait offert.
16 - Comment déjouer les astres
Mukunda est initié à l'influence des astres par Sri Yukteswar. Selon le gourou, il est possible de protéger de leur influence néfaste en portant certains objets sur soi. C'est ce que fait Mukunda et il en est satisfait.
Par ailleurs, Sri Yukteswar propose une interprétation intéressante de l'histoire d'Adam et Ève. Pour lui, l'arbre représente le corps humain et le serpent est son énergie sexuelle vitale.
17 - Sasi et les trois saphirs
L'un des amis d'université de Mukunda, Sasi, souffre de tuberculose. Son état s'améliore suite à sa visite à l'ashram et à l'intervention du gourou Sri Yukteswar.
Mukunda néglige ses études universitaires au profit de sa vie à l’ashram. Toutefois, il réussit ses examens et obtient un diplôme intermédiaire. Sri Yukteswar lui conseille de quitter Calcutta et de poursuivre le reste de ses études à Serampore.
18 - Le faiseur de miracles musulman
Sri Yukteswar raconte à Mukunda l'histoire étonnante d'un "faiseur de miracles" musulman qui prétendait pouvoir faire disparaître et faire apparaître n'importe quel objet.
Le gourou explique à son élève que cette magie était tournée vers l'égoïsme et qu'elle n'aide personne. Finalement, le faiseur de miracles se repentit et décida d'entrer dans une véritable réflexion sur le sens de la spiritualité.
19 - Mon Maître, en visite à Calcutta, m'apparaît à Serampore
Mukunda emmène l'un de ses amis d'université nommé Dijen à l'ashram, car celui-ci doute de l'existence de Dieu et des miracles. Toutefois, Sri Yukteswar a dû s'absenter à Calcutta.
Mukunda reçoit une carte postale de sa part indiquant qu'il arrivera en train à Serampore à 9h00 mercredi. Mais Mukunda a l'intuition que son maître n'aura pas pu prendre ce train et ne se rend donc pas à la gare.
Dijen va quant à lui à la rencontre du train, mais revient déçu. Plus ou moins au même moment, Sri Yukteswar "apparaît" à Mukunda pour lui annoncer son heure d'arrivée. Dijen n'en croit pas ses yeux lorsque la prédiction se réalise !
Il se rend alors compte que ses connaissances universitaires sont bien insuffisantes pour appréhender tout cet univers.
20 - Nous n'allons pas au Cachermire
Mukunda prévoit un voyage au Cachemire avec son maître et plusieurs amis. Cependant, Sri Yukteswar persuade Mukunda de rester avec lui un peu plus longtemps, pendant que ses amis prennent déjà le train pour Calcutta.
Après leur départ, Mukunda commence à éprouver les symptômes très douloureux du choléra asiatique. Sri Yukteswar avait pressenti le danger et cherche à protéger son élève. Finalement, celui-ci récupère plus vite que prévu et peut penser à partir.
21 - Nous allons au Cachemire
Une fois Mukunda rétabli, Sri Yukteswar accepte de se rendre au Cachemire. Le groupe de six personnes se rend d'abord à Rawalpindi puis à Srinagar, capitale du Cachemire. Ils visitent un ancien temple. Mukunda monte à cheval pour la première fois et aperçoit l'Himalaya.
Après trois semaines de voyage, Mukunda retourne au Bengale, tandis que Sri Yukteswar reste quelque temps à Srinagar. Celui-ci laisse entendre qu'il aura bientôt des problèmes de santé et qu'il pourrait même en mourir.
De fait, Sri Yukteswar tombe à son tour dangereusement malade, mais récupère cependant en quelques jours. Lorsque le maître revient à Serampore deux semaines plus tard, Mukunda constate qu'il a perdu beaucoup de poids.
22 - Le cœur d'une statue de pierre
Roma, la sœur de Mukunda, demande son aide. Son mari, Satish Chandra Bose, est trop matérialiste et elle souhaite qu'il se développe spirituellement. Mukunda fait en sorte qu'ils visitent tous les trois le temple de Kali, dans l'espoir qu'il ressentira la présence divine.
Au cours du voyage, Satish se montre cynique et sans respect vis-à-vis des saints et des prêtres. Le matin, Mukunda prie et demande à Kali de changer le cœur dur de son beau-frère.
Après la fermeture du temple, Satish se plaint de n'avoir pas déjeuné. Mukunda lui dit de ne pas s'en faire et que Dieu y pourvoira. Finalement, un déjeuner est servi par un prêtre du temple, alors que cela est normalement interdit après la fermeture. Voilà le signe attendu.
Sur le chemin du retour, Satish adoucit son attitude et décide de voir comment il pourrait poursuivre une vie plus spirituelle.
23 - J'obtiens mon diplôme universitaire
Mukunda passe beaucoup plus de temps à l'ashram qu'à l'université. Si bien que les étudiants du Serampore College l’appellent « Mad Monk » !
Il sait qu'il n'est pas prêt pour les examens finaux qui concluront ses quatre années d'études. Pourtant, son gourou insiste pour qu'il trouve une solution. Mukunda demande à son ami Romesh de l'aider.
Grâce à cela, Mukunda réussit tous ses examens et obtient son diplôme de l'Université de Calcutta en 1915.
24 - Je deviens moine de l'Ordre des Sawmis
Un mois plus tard, Sri Yukteswar initie Mukunda à l'Ordre Swami. Le maître l'invite à choisir un nouveau nom et Mukunda choisit Yogananda. Le nom signifie « félicité (ananda) par l'union divine (yoga) ».
Un swami appartient à un ancien ordre monastique qui a été réorganisé il y a plusieurs siècles par Shankaracharya. Les moines font vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance et se consacrent au service de l'humanité.
Par ailleurs, Yogananda définit le yogi comme toute personne qui pratique une technique afin de se mettre au contact du divin. Selon lui :
« [Le yoga] est une méthode pour contenir les turbulences naturelles des pensées qui, autrement, empêchent les gens d’entrevoir leur véritable nature de l’esprit » (Autobiographie d'un yogi, Chapitre 24).
25 - Mon frère Ananta et ma sœur Nalini
Ananta tombe malade et meurt alors que Yogananda est en Chine.
Événement troublant : le jeune moine achète un cadeau pour Ananta, mais le laisse tomber. Le cadeau casse et Yogananda en déduit que cela présage une mauvaise nouvelle pour son frère. À son retour en Inde, son plus jeune frère Bishnu confirme qu'Ananta est morte le jour même où Yogananda a acheté le présent.
Sa sœur Nalini, quant à elle, s'est toujours plainte d'être trop maigre. Grâce à un régime végétarien suivi selon les conseils de Yogananda, elle parvient à reprendre du poids. Atteinte, plus tard, d'une fièvre thyroïde, elle parvient à s'en tirer, là aussi, en suivant les conseils de son frère.
26 - La science du Kriya Yoga
Cette technique contemplative de yoga a été popularisée en Occident par l'auteur. Son enseignement ne peut toutefois pas être divulgué dans un livre, car il s'agit avant tout d'une pratique qui doit être enseignée sous l'égide d'un professeur reconnu.
Yogananda affirme notamment dans ce chapitre que :
Il s'agit d'une technique de maîtrise de la respiration qui permet de recharger le sang en oxygène ;
Cette méthode — ou une autre très similaire — fut utilisée par des personnalités religieuses de tous horizons, y compris Jésus !
27 - Création d'une école de yoga à Ranchi
Yogananda fonde une école de garçons en 1917. Celle-ci dispense des cours classiques, notamment liés à l'agriculture, ainsi que des cours de préparation physique et mentale appelés "yogoda". L'école peut accueillir 100 élèves en résidence, et le succès est au rendez-vous.
28 - Kashi, réincarné et retrouvé
L'un de ses élèves du nom de Kashi lui demande, lors d'une randonnée en groupe, quel sera son destin. Yogananda lui annonce qu'il risque de mourir et lui conseille de rester à l'école. Mais ses parents l'emmènent à Calcutta et il périt effectivement du choléra.
Le jeune homme lui avait demandé de le retrouver s'il se réincarnait. C'est ce que fait son professeur : il retrouve un bébé dans une maison de Calcutta et un lien s'établit entre eux. Son nom est également Kashi. Il le suivra durant plusieurs années et le jeune garçon entrera dans une école grâce à son aide.
29 - Radindranath Tagore et moi comparons nos systèmes d'éducation
Radindranath Tagore est un écrivain indien qui reçoit le prix Nobel de littérature en 1913. Peu après, il invite Yogananda à venir visiter l'école qu'il a lui-même fondée.
Les systèmes éducatifs sont assez semblables. Mais, dans l'école de R. Tagore, l'enseignement de la littérature et de la poésie est davantage poussé, ainsi qu'en musique. À l'inverse, le yoga n'est pas enseigné.
Le prix Nobel insiste sur l'importance, pour les étudiants, de trouver la sagesse par eux-mêmes.
30 - La loi des miracles
Pour les hindous, la nature profonde du monde est l'unité. Même si nous divisons les choses en corps/esprit, notamment, et même si nous voyons de la multiplicité partout, le monde est "Un".
Selon Yogananda, la physique de son époque, et en particulier les travaux d'Albert Einstein, va dans le sens de cette croyance. La théorie de la relativité unifiée permet de penser l'univers de façon cohérente avec la philosophie hindouiste.
Pour l'auteur, c'est ce qui permet aux yogis véritablement expérimentés de réaliser des "miracles". C'est parce qu'il maîtrise sa propre structure et qu'il est relié au tout de l'univers que le maître de yoga peut réaliser des choses étonnantes.
31 - Un entretien avec la vénérable mère
L'auteur rend visite à Srimati Kashi Moni, la femme de l'un des plus grands yogis de tous les temps : Lahiri Mahasaya. Elle lui raconte sa vie avec son mari et gourou, ainsi que les miracles qu'il a, selon elle, accomplis.
Yogananda relate ces exploits. Il parle aussi d'un homme qui aurait vécu 300 ans et dont l'existence était remplie de choses extraordinaires.
32 - Rama ressuscité des morts
L'histoire suivante est encore plus troublante (et même si nous n'y croyons pas, il est important de l'écouter comme un témoignage de la culture de l'époque).
L'auteur rapporte que Lahiri Mahasaya, qui était le maître de son propre maître, Sri Yukteswar, parvint à soigner et "ressusciter" l'un des compagnons de ce dernier, que tout le monde — médecins y compris — pensait mort.
33 - Babaji, un yogi-Christ de l'Inde moderne
Il est intéressant de constater comment les yogis font référence à leurs maîtres : il y a une chaîne de transmission du yoga qui est racontée tout au long du livre.
Dans ce chapitre, l'auteur parle de Babaji, le maître de Lahiri Mahasaya. Il est dit que celui-ci aurait vécu plusieurs siècles, mais il existe peu d'informations sur sa vie (date de naissance, etc.). Yogananda reçoit des témoignages de plusieurs personnes et les rapporte dans Autobiographie d’un yogi.
Ici encore, l'auteur raconte les miracles et péripéties de ce personnage, parvenu, semble-t-il, à un degré éminent de sagesse et de maîtrise de son propre corps.
34 - La matérialisation d'un palais dans l'Himalaya
Son professeur de sanskrit lui raconte une autre histoire sur Babaji, qu'il a entendue de Lahiri Mahasaya. Selon cette légende, Lahiri Mahasaya rencontra Babaji dans l'Himalaya et celui-là l'emmena dans sa grotte. Mais en lieu et place de ce logement sommaire, Babaji donne l'illusion qu'il s'agit d'un véritable palais !
Pourquoi ? Car Lahiri Mahasaya avait exprimé le désir de visiter un tel édifice somptueux. En le manifestant sous ses yeux, Babaji permet en fait à son élève de se libérer de ce désir.
35 - La vie christique de Lahiri Mahasaya
L'auteur fait souvent référence à Jésus et il pense qu'il y a de nombreux points communs entre les deux religions (christianisme et hindouisme).
En l'occurrence, il fait ici remarquer le rôle joué par Lahiri Mahasaya face aux autorités de la religion hindoue traditionnelle. Comme Jésus qui s'opposa aux structures religieuses de son temps, le célèbre yogi chercha à se défaire des codes et à enseigner la pratique du yoga à un plus vaste public.
36 - Babaji montre son intérêt pour l'Occident
Le maître Babaji considérait déjà que l'Orient et l'Ouest devaient établir un chemin intermédiaire qui combine le développement matériel et scientifique à la spiritualité et à la sagesse hindoue.
Très longtemps avant que Yogananda ne devienne moine, il dit qu'il enverra à Sri Yukteswar un disciple qu'il pourrait former en vue de répandre le yoga en Occident.
Cette prédiction s'est réalisée sous les traits de l'auteur de ce livre, qui accomplit précisément ce projet !
37 - Je vais en Amérique
Yogananda se rend en Amérique, où il a été invité à servir en tant que délégué à un Congrès international des libéraux religieux à Boston. Anxieux au sujet du voyage, Yogananda prie pour obtenir des conseils divins — et Babaji apparaît à sa porte ! Il rassure Yogananda sur sa mission et lui donne des instructions pour la mener à bien, puis s'en va.
Le 6 octobre 1920, il s'adresse au congrès des États-Unis et c'est un succès. Pendant trois ans, Yogananda vit à Boston pour y donner des conférences et des cours.
En 1924, il accomplit un voyage dans tout le pays, donnant des conférences dans de nombreuses villes.
À la fin de 1925, il établit un premier quartier général à Los Angeles. Entre 1920 à 1930, les cours de yoga se développent à grande vitesse et accueillent des dizaines de milliers d'étudiants.
38 - Luther Burbank, un saint au milieu des roses
L'auteur se lie d'amitié avec un botaniste californien du nom de Luther Burbank, qui a conçu des variétés hybrides de plantes et a aussi écrit un livre sur l'éducation (The Training of the Human Plant).
Le botaniste se met à la pratique du Kriya Yoga avec passion. Luther Burbank publie aussi un article dans le premier numéro du magazine créé par Yogananda, nommé East-West.
39 - Thérèse Neumann, la catholique stigmatisée
En méditation, Yogananda entend la voix de son maître, Sri Yukteswar, lui demandant de rentrer chez lui. Après 15 ans en Amérique, Yogananda part en juin 1935.
Après une brève visite en Angleterre et en Écosse, il se rend en Allemagne pour rencontrer une mystique catholique, Thérèse Neumann de Konnersreuth. Il est très intéressé par le récit de son expérience et partage plusieurs jours avec elle, se faisant le témoin de son ascèse et de ses expériences de transe.
Finalement, il passe par la Palestine et l'Égypte avant de retourner en Inde.
40 - Mon retour en Inde
Yogananda arrive à Bombay (aujourd'hui Mumbai) en octobre 1935. Il se rend à Calcutta avec son secrétaire Richard Wright, et de grandes foules le saluent. À Serampore, il retrouve son père et Sri Yukteswar.
Ensuite, il retourne à Calcutta et travaille dur pour venir à bout des difficultés financières que connaît l'école de Ranchi qu'il avait fondée des années plus tôt. Bientôt, la situation s'améliore.
Les élèves y pratiquent quotidiennement leurs exercices spirituels et apprennent les valeurs morales liées à la pratique du yoga.
41 - Voyage idyllique dans l'Inde du sud
En novembre 1935, Yogananda se rend dans l'État de Mysore, dans le sud de l'Inde. Il y donne des conférences qui rassemblent parfois plusieurs milliers de personnes.
Il en profite également pour visiter certains sites archéologiques et en apprendre davantage sur l'histoire des villes qu'il visite. L'auteur s'intéresse également aux écrits de la Grèce antique qui ont mis en avant et valorisé la culture indienne.
Finalement, Yogananda et son secrétaire font un pèlerinage pour rencontrer le sage Sri Ramana Maharishi, dans son ashram près de Tiruvannamalai.
42 - Les derniers jours de mon guru
Lors d'une célébration d'hiver, le maître de Yogananda confie à son élève qu'il n'en a plus pour très longtemps. Celui-ci devra prendre la charge de l'ashram dans lequel il a reçu son éducation.
Lors d'un périple en janvier, l'auteur a l'opportunité de voir le Taj Mahal. Il visite également un autre yogi qui lui remet un message de Babaji.
Peu après, alors qu'il est de retour à Calcutta, il apprend que son gourou est dans une autre ville, à plus de 3 000 miles de là. Il s'y rend, mais celui-ci meurt avant qu'il n'arrive. Yogananda présidera la cérémonie funéraire.
43 - La résurrection de Sri Yukteswar
Plusieurs mois plus tard, en juin 1936, Yogananda est dans une chambre d'hôtel à Bombay lorsqu'il a une vision de Sri Yukteswar.
Sri Yukteswar explique à son ancien élève ce qu'est le "monde astral", sorte de paradis pour les yogi ayant achevé le cycle de leurs réincarnations. L'auteur en profite pour expliquer la théorie de l'âme typique de la religion hindoue.
44 - En visite chez le Mahatma Gandhi
Yogananda rend visite au Mahatma Gandhi à son ashram en août 1935. C'est le jour de silence de Gandhi, et il les accueille avec une note écrite. À 8 heures, il sort du silence. Il interroge Yogananda sur l'Amérique et l'Europe, et ils discutent de l'Inde et des affaires mondiales.
L'après-midi suivant, Yogananda visite l'ashram de Gandhi pour les petites filles. Lorsqu'il retourne à l'ashram de Gandhi, il observe à quel point la vie de l'homme est simple, dépourvue de pièges matériels.
Yogananda demande à Gandhi sa définition de la non-violence, et le Mahatma répond :
« Éviter de nuire à toute créature vivante dans la pensée ou l'acte. » (Autobiographie d'un yogi, Chapitre 44)
Réfléchissant plus tard à l'action de Gandhi, Yogananda écrit que sa méthode de non-violence s'est avérée extrêmement efficace. Il observe que la force ne résout pas les problèmes humains et en appelle tà préférer la vie plutôt que sur la mort et la destruction.
45 - Ma Ananda Moyi, la "Mère rayonnante de joie"
Le moine rend également visite à une sainte, Ananda Moyi Ma, à Calcutta. Elle est sur le point de partir avec ses disciples, mais retarde son départ pour Yogananda.
Cette sainte hindoue voyage beaucoup en Inde et est responsable de beaucoup de réformes sociales. Yogananda l'invite à l'école Ranchi dont il est le responsable pour qu'ils échangent sur ces sujets.
Lorsqu'elle lui rend visite, elle confie à Yogananda qu'elle ne s'est jamais identifiée à son corps physique, même dans son enfance. Elle s'est toujours sentie "enveloppée dans l'éternel". Yogananda admire son dévouement.
46 - La femme-yogi qui ne mange jamais
En mai 1936, Yogananda, accompagné de son secrétaire et de quelques amis, rend visite à Giri Bala, une sainte qui pratique une technique de yoga très spéciale, qui lui permet de ne (presque) pas manger.
Giri Bala les accueille à la porte de sa maison. Yogananda est frappé par son apparence spirituelle. Elle raconte son histoire étonnante à ses invités.
47 - De retour en Occident
À la fin de 1936, Yogananda se rend à nouveau en Angleterre, puis retourne en Amérique. Il célèbre Noël au centre de la Self-Realization Fellowship, l'institution qu'il a créée pour promouvoir le yoga en Occident.
À cette occasion, Yogananda offre de nombreux cadeaux à ses amis et à ses disciples, y compris une tasse en argent à un disciple de longue date, M. Dickinson.
Celui-ci se montre étonné et avoue qu'il a attendu 43 ans pour ce cadeau. En 1893, il avait rencontré un moine qui lui avait dit que son professeur viendrait à lui en lui donnant une coupe d'argent !
48 - À Encinitas, en Californie
Pendant que Yogananda était à l'étranger, ses disciples ont construit un ashram pour lui à Encinitas, en Californie. C'est un immense domaine financé par l'un des disciples de Yogananda, James J. Lynn, homme d'affaires américain.
Quelques mois plus tard, Yogananda organise un service de Pâques au lever du soleil sur la pelouse de l'ashram. Toute cette année en Californie est décrite comme heureuse. En 1937, il fonde une succursale du Self-Realization Center à Encinitas.
49 - Les années 1940 - 1950
Plusieurs réalisations de la Self-Realization Fellowship voient le jour dans les années qui suivent :
En 1942 à Hollywood ;
À San Diego en 1943 ;
Ainsi qu'à Long Beach en 1947 :
Et à Los Angeles en 1949.
Yogananda est à l'ogirine de tous ces centres. Pour lui, c'est un devoir que Babaji et Sri Yukteswar lui avaient confié.
Au cours de ces années, l'auteur passe du temps à interpréter le Nouveau Testament et à traduire la Bhagavad Gita.
Il considère toujours que le Kriya Yoga est une pratique éminemment puissante qui permet de conduire une personne à la vérité spirituelle, "simplement" à partir d'une une compréhension juste de la respiration.
Il termine l'ouvrage en soulignant que les humains ne comprendront peut-être jamais tous les secrets de l'univers et de la vie. Mais peu importe : leur tâche est de rechercher la sagesse et d'apprendre à comprendre leur vraie nature.
Conclusion sur « Autobiographie d’un yogi » de Paramahansa Yogananda :
Ce qu'il faut retenir de "Autobiographie d'un yogi" de Paramahansa Yogananda :
Que vous croyiez ou non aux affirmations de Paramahansa Yogananda, et de façon plus générale à l'existence des miracles dans la tradition hindou, vous apprécierez ce livre pour une raison essentielle : c'est l'histoire d'un homme qui exporta le yoga des terres lointaines de l'Inde vers le monde occidental.
Ce livre est un témoignage précieux sur les modes de pensées et les pratiques du tout début du XXe siècle en Inde. Il est fascinant de voir comment le yoga s'est transformé au cours de toutes ces années. Aujourd'hui vécu surtout comme une pratique sportive et une hygiène de vie, il était alors complètement lié à la spiritualité.
Cette Autobiographie d’un yogi est sans doute un peu longue (près de 1 000 pages !) ; c'est le seul reproche qui peut lui être fait. Mais si vous voulez vous immerger complètement dans cette culture pour plusieurs jours (ou même semaines), alors c'est exactement le livre qu'il vous faut !
Vous voulez vous initier à la méditation, consultez cette chronique sur la méditation de pleine conscience.
Points forts :
Une plongée fascinante dans l'Inde du début du XXe siècle et des croyances hindoues.
De nombreuses anecdotes personnelles de l'auteur ;
Une histoire du yoga et de son arrivée en Occident ;
Un outil de réflexion pour penser le développement personnel.
Point faible :
Sa longueur, mais c'est assez subjectif.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu le livre de Paramahansa Yogananda "Autobiographie d'un yogi" ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Paramahansa Yogananda "Autobiographie d'un yogi".
Visitez Amazon afin d’acheter le livre de Paramahansa Yogananda "Autobiographie d'un yogi".
Cet article Autobiographie d’un yogi est apparu en premier sur Des livres pour changer de vie.
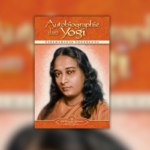 ]]>
]]>Résumé de « Un homme d'exception » de Sylvia Nasar : la biographie de John Forbes Nash, l'un des plus célèbres mathématiciens du XXe siècle, est un véritable best-seller — ayant donné lieu au film bien connu avec Russel Crowe en tête d'affiche — et un livre à lire pour toute personne qui souhaite entrer dans la peau d'un génie et en comprendre les conflits internes.
Par Sylvia Nasar, 2002.
Titre original : « A beautiful Mind », 2002.
Note : Le livre a d'abord été traduit "Un cerveau d'exception", mais après le succès du film (tiré du livre), les nouvelles éditions ont privilégié le titre Un homme d'exception.
Chronique et résumé de « Un homme d'exception » de Sylvia Nasar
Prologue
L’histoire de John Nash est celle des relations entre créativité, rationalité et schizophrénie. Cet homme a réussi à inventer de nouvelles façons de voir le monde et de l’étudier, grâce aux mathématiques principalement. Mais il a aussi dû faire face à la maladie psychique et à l’exclusion sociale.
Sylvia Nasar évoque plusieurs anecdotes significatives dans le prologue. Par exemple, lorsque l'un de ses collègues mathématiciens lui demande : « Comment avez-vous pu, vous, un mathématicien, un homme voué à la raison et aux preuves logiques… comment avez-vous pu croire que des extraterrestres vous envoyaient des messages ? Que vous avez été recruté par des êtres venus du fin fond de l'espace pour sauver le monde ? Comment…? », John Nash lui répond :
«Parce que mes idées sur ces êtres surnaturels me sont venues de la même manière que mes idées de mathématiques. Je les ai donc prises au sérieux. »
Cette courte histoire montre que, pour lui, il n'y avait pas de frontière claire entre son génie mathématique — qui consiste à créer des idées mathématiques neuves, c'est-à-dire à faire des liens originaux et pertinents qui surprennent et soient utiles à ses collègues — et sa folie.
Entrons maintenant, si vous êtes prêt, dans le détail de son existence…
Première partie — Un cerveau d'exception
Université de Princeton, États-Unis.
Bluefield (1928-1945)
En 1924, John Nash Sr. et Virginia Martin se marient dans le salon de leur maison à Bluefield, en Virginie-Occidentale.
John, conservateur, sérieux et profondément préoccupé par les apparences, souhaite que tout soit très correct. Ingénieur électricien, il aime la science et la technologie et a un esprit vif.
Virginia, une femme vitale avec un esprit moins rigide que son mari réservé, avait autrefois été une enseignante passionnée, quittant sa profession pour épouser John.
Le 13 juin 1928 naît leur premier enfant, John Nash Jr. Solitaire et introverti dès son plus jeune âge, John Nash évite la compagnie des autres enfants, préférant lire et expérimenter dans sa chambre.
Ses parents encouragent ses études mais veulent aussi qu'il soit plus sociable, le poussant autant socialement qu'académiquement.
À l'école, bien qu'intelligent, Nash refuse les méthodes préférées de l'enseignant en mathématiques, démontrant souvent des solutions élégantes en quelques étapes. Peu populaire parmi ses camarades, il est perçu comme étrange, arrogant et distant.
Obsédé par l'invention de codes secrets, il aime aussi faire des farces parfois cruelles. Après le lycée, le jeune garçon obtient une bourse pour étudier au Carnegie Institute of Technology, dans l'intention de devenir ingénieur comme son père.
Au Carnegie Institute of Technology (Juin 1945 — juin 1948)
À Carnegie, le désir de John Nash de devenir ingénieur cède rapidement la place à un intérêt croissant pour les mathématiques. Au cours de son premier semestre, il abandonne l'ingénierie pour se concentrer sur la chimie, mais il éprouve des difficultés en raison du manque de rigueur dans les cours de mathématiques.
Ses professeurs reconnaissent son immense potentiel en mathématiques et le persuadent de se spécialiser dans ce domaine.
Bien qu'excellent dans ses études, le jeune homme reste impopulaire et socialement maladroit. Après avoir révélé son attirance pour les hommes, cela s'aggrave et il devient la cible de remarques homophobes.
Bien qu'il échoue à une compétition nationale de mathématiques, Nash est accepté à Princeton, mais son inadaptation sociale devient singulièrement visible et problématique lors d'un job d'été qu'il effectue à la marine en 1948.
Le centre de l'univers (Princeton, automne 1948)
Fondée en 1746, Princeton n'était pas considérée comme une institution académique particulièrement respectable au début du XXe siècle. Sa réputation demeurait limitée et elle manquait surtout de talents scientifiques reconnus.
Cela reflétait la défaillance générale des universités américaines de l'époque, à la traîne par rapport aux universités européennes et à leurs progrès révolutionnaires en mathématiques et en physique, portés par des figures comme Albert Einstein et David Hilbert.
Cependant, d'importants dons des Rockefeller et des Bambergers allaient bientôt changer la donne. Grâce à l'argent de ces mécènes venus du monde industriel, Princeton (et d'autres) peuvent établir des chaires de recherche pour attirer des talents européens.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, des financements gouvernementaux et militaires affluent également. L'armée et le gouvernement reconnaissent le rôle décisif des mathématiques dans la planification tactique et le développement de la bombe atomique.
Le conflit mondial, en d'autres termes, a "enrichi et revitalisé les mathématiques américaines".
À l'arrivée de John Nash à Princeton en 1948, il découvre un centre des mathématiques américaines, imprégné d'optimisme et où les étudiants se considèrent comme faisant partie d'une "grande révolution intellectuelle".
L'école du génie (Princeton, automne 1948)
À Princeton, le jeune mathématicien et ses camarades rencontrent le président du département de mathématiques, Solomon Lefshetz. Il affirme qu'ils devront travailler dur pour répondre aux exigences de l'université, décrivant Princeton comme un endroit "où de vrais mathématiciens font de vraies mathématiques".
Il insiste sur l'apparence en déclarant: "Il est important de bien s'habiller" et exige qu'ils se fassent couper les cheveux chez un coiffeur de Princeton. Malgré son accent sur les apparences, le directeur valorise "la pensée indépendante et l'originalité par-dessus tout".
Au lieu des démonstrations rigoureuses et des calculs, les étincelles d'ingéniosité sont valorisées et considérées comme bien plus significatives. Cela convient parfaitement à John Nash, car cela colle exactement à son "tempérament et style en tant que mathématicien".
Autour d'un thé formel dans le Fine Hall de Princeton, étudiants et professeurs se rencontrent pour débattre, discuter d'idées, faire des potins et analyser les mathématiques. Dans une atmosphère à la fois compétitive et amicale, les idées circulent et de nouvelles théories s'épanouissent.
C'est une "serre mathématique" qui donnera bientôt à Nash le "contexte émotionnel et intellectuel dont il avait tant besoin pour s'exprimer".
Génies (Princeton, 1948-1949)
À Princeton, John Nash prospère, bénéficiant d'un environnement qui lui permet de s'engager dans les mathématiques à sa manière, avec ses propres méthodes.
Un après-midi en 1948, Kai Lai Chung, un instructeur de mathématiques, regarde par la porte habituellement verrouillée de la salle des professeurs et voit Nash étendu sur le dos sur une grande table en désordre, "parfaitement détendu, immobile, visiblement perdu dans ses pensées, les bras repliés derrière la tête".
Un tel comportement est loin d'être inhabituel pour John Nash, qui passe "la plupart de son temps, semble-t-il, simplement à réfléchir. Il se couche sur les bureaux, glisse dans les couloirs avec "l'épaule fermement pressée contre le mur", emprunte parfois des vélos et les fait tourner en "cercles concentriques de plus en plus petits". La plupart du temps, il marmonne ou siffle distraitement.
Ce n'est pas seulement l'approche immersive et absente de John Nash qui le distingue, mais toute son approche des mathématiques est originale et stimulante. Il trouve toujours des solutions par ses propres chemins, évitant les méthodes habituelles pour se fier à son intuition.
Pour maintenir son indépendance intellectuelle, John Nash :
Ne lit pas beaucoup (pour ne pas être trop influencé) ;
Ne s'attache pas à des cours ou des professeurs trop longtemps ;
Récupère des informations et les reconstruit "à sa manière".
Même ses camarades, pourtant eux-mêmes excentriques, le considèrent comme étrange et distant. Certains membres du corps enseignant acceptent sa bizarrerie, tandis que d'autres le trouvent insupportablement obtus et précoce.
Jeux (Princeton, printemps 1949)
John von Neumann, un brillant polymathe et conférencier à Princeton, entre dans la salle commune de mathématiques et voit deux étudiants jouer à un jeu avec des pions placés dans des emplacements hexagonaux sur un plateau de jeu en losange.
Lorsqu'il demande aux étudiants ce qu'ils font, ils lui disent qu'ils jouent à "Nash". Dans les années 1930, les professeurs européens introduisent la tradition de jouer à des jeux à Princeton, tels que Kriegspiel et Go, très populaires parmi les étudiants lors de la première année de John Nash.
John Nash y participe souvent avec une approche "exceptionnellement agressive", révélant sa "compétitivité naturelle et son esprit de surenchère". Il ne se contente pas de jouer, mais invente un jeu appelé 'Nash', un jeu à somme nulle pour deux personnes, sans hasard, basé uniquement sur la stratégie.
Le jeu devient très populaire et est régulièrement pratiqué dans la salle commune.
John Von Neumann (Princeton, 1948-1949)
Là où de nombreux mathématiciens remarquables de l'époque sont retirés et maladroits, John von Neumann est perçu comme plutôt séduisant. En fait, il est "universellement considéré comme le mathématicien le plus cosmopolite, polyvalent et intelligent" du XXe siècle.
La carrière de von Neumann comprend de nombreux rôles, tels que "physicien, économiste, expert en armes et visionnaire de l'informatique". Ses capacités de mémoire, de calcul mental et de connaissances générales, associées à sa manière parfois froide et directe, ont conduit les gens à plaisanter en disant qu'il est "vraiment un extraterrestre qui a appris à imiter parfaitement un humain".
Pendant la guerre, John von Neumann a co-écrit le texte très significatif "The Theory of Games and Economic Behavior" et a proposé une méthode pour déclencher la bombe atomique, créditée d'avoir raccourci le temps nécessaire au développement de la bombe d'environ un an. En 1948, il est un chercheur respecté à l'Institute for Advanced Studies de Princeton.
La théorie des jeux
En 1928, John von Neumann rédige un article sur "la théorie des jeux", suggérant que l'étude des jeux pourrait offrir des éclairages en économie. En 1938, avec le professeur Oskar Morgenstern, il développe cette théorie dans l'ouvrage novateur The Theory of Games and Economic Behavior.
Le livre attire l'attention du public et reçoit même une critique dans le New York Times. Beaucoup d'étudiants de Princeton le surnomment "la bible". Toutefois, les économistes professionnels gardent leurs distances, estimant que le livre ne tient pas ses promesses audacieuses.
Bien qu'il reconnaisse son "innovation mathématique", John Nash critique également les mérites du livre. Il remarque qu'une grande partie de la théorie "semble avoir peu d'applicabilité en sciences sociales", car elle se concentre sur des "jeux de conflit total" qui ne se produisent pas souvent dans des scénarios économiques réels.
Le jeune étudiant montre également que la discussion des jeux à plus de deux joueurs ne "prouve pas qu'une solution existe pour tous ces jeux" et que l'analyse des jeux à somme non nulle — où les gains et les pertes de chaque joueur ne sont pas équilibrés exactement par les gains et les pertes des autres joueurs —, est également incomplète. Il commence rapidement à réfléchir à des solutions à ces lacunes.
Le problème de la négociation (Princeton, printemps 1949)
Dans son deuxième trimestre à Princeton, John Nash rédige son premier article académique, intitulé "The Bargaining Problem" ("Le problème de la négociation"). Malgré une formation limitée en économie, il parvient à offrir une perspective remarquablement originale et significative dans ce domaine.
L'"idée d'échange" ou la "négociation un à un" y est centrale. Pourtant, aucune théorie n'a encore pu fournir une véritable compréhension de la façon dont les personnes engagées dans un échange se comporteront ou comment une négociation se déroulera.
Le problème central réside dans le fait que les gens ne "se comportent pas de manière purement compétitive" tout le temps. Autrement dit, ils collaborent parfois. Mais comment le prédire ? John Nash trouve une solution élégante à ce problème.
En outre, son originalité réside dans le fait qu'il a eu l'idée bien avant d'être exposé au travail de John von Neumann ou aux mathématiques avancées de Princeton. En fait, l'idée lui était d'abord venue lorsqu'il suivait son premier (et seul) cours d'économie de premier cycle à l'université Carnegie.
Non-coopération (Princeton, 1949-1950)
À l'été 1949, John Nash se plonge davantage dans la théorie des jeux. Mais avant cela, il doit consacrer l'été à préparer son examen général de fin d'études.
Une fois l'examen réussi, il retourne avec ardeur à la théorie des jeux et approche le mathématicien John von Neumann avec les prémices d'une nouvelle théorie. Lors de sa présentation, ce dernier l'interrompt. Il considère que la proposition d'un équilibre dans les jeux à plus de deux joueurs (l'apport majeur de John Nash) est "triviale".
Toutefois, tout le monde n'est pas aussi catégorique que John von Neumann. L'analyste de la théorie des jeux, David Gale, est particulièrement enthousiaste. La théorie lui semble applicable à une large classe de problèmes et les mathématiques utilisées lui semblent "très belles".
Pourtant, même le jeune mathématicien ne reconnaît pas immédiatement la véritable importance de sa théorie. C'est elle, pourtant, qui deviendra "l'un des paradigmes de base en sciences sociales et en biologie" et qui finira par lui valoir un prix Nobel en économie.
Lloyd Shapley (Princeton, 1950)
En 1950, John Nash cherche à établir des liens émotionnels. C'est à ce moment que naît son amitié avec Lloyd Shapley, un brillant mathématicien travaillant à la RAND Corporation.
John Nash exprime son admiration pour Lloyd Shapley de manière enfantine. Et parfois, cela ne passe pas. Ses blagues, notamment devant les amis de ce dernier, sont peu appréciées.
Par ailleurs, des différences de points de vue théoriques les éloignent, et leur amitié prend fin.
La guerre des têtes pensantes (RAND, été 1950)
À l'été 1950, John Nash commence à travailler à la RAND Corporation, un think tank financé par l'Air Force. L'institution a pour mission d'analyser et de résoudre le problème de l'utilisation des nouvelles armes nucléaires. L'enjeu est de prévenir la guerre avec la Russie — ou de la remporter, si la dissuasion échoue.
La théorie des jeux devient cruciale dans cette mission, propulsant cette discipline dans la pensée économique d'après-guerre grâce à la recherche de la RAND.
Bien que la paranoïa de la guerre froide soit palpable, la RAND reste étonnamment informelle, favorisant un environnement décontracté et propice à l'originalité. John Nash s'y intègre parfaitement : il déambule sans contrainte dans les couloirs, perdu dans ses pensées, souvent avec un gobelet de café vide à la main.
Toutefois, il n'est pas très populaire auprès de certains collègues qui le trouvent "absurde et enfantin", déplorant son goût pour "les blagues adolescentes" et son sifflement distrait qui agacent profondément.
La théorie des jeux à la RAND
Le travail de John Nash sur la théorie des jeux attire l'attention de la RAND. Jusqu'ici, le think thank travaillait avec l'hypothèse de John Von Neumann. Les jeux à somme nulle avec deux joueurs de ce dernier étaient réinterprétés à l'aune du "conflit total entre deux superpuissances".
Pourtant, le conflit nucléaire est loin d'être un jeu à somme nulle. La compétition doit s'allier à la coopération. John Nash introduit sa théorie de l'équilibre dans ce contexte et fournit "un cadre pour poser les bonnes questions".
L'équilibre de Nash inspire également le célèbre "dilemme du prisonnier", qui fut inventé à la RAND peu avant son arrivée. Selon cette théorie, les individus rationnels ont intérêt à collaborer plutôt qu'à rechercher leur intérêt personnel.
Ces recherches innovantes feront le succès de la théorie des jeux et la postérité de John Nash. Cependant, à la mi-1950, l'intérêt pour cette théorie diminue à la RAND.
Service militaire (Princeton, 1950-1951)
Par ailleurs, travailler dans le cadre d'un programme militaire dérange John Nash. Il se trouve engoncé, limité par les obligations liées à sa fonction. Il souhaite plutôt "avoir la liberté de se promener dans tous les domaines des mathématiques".
Pour ce faire, il décide de chercher un poste universitaire. Dans l'intervalle, il accepte un intérim à Princeton sur un projet de recherche pour la Marine.
Mais d'autres obligations l'appellent. À l'été 1950, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud et les États-Unis promettent leur soutien. John Nash craint de devoir partir à la guerre.
Ses efforts pour éviter l'enrôlement sont au moins partiellement couronnés de succès, mais il doit néanmoins réaliser son service militaire pendant plusieurs mois.
Un très beau théorème (Princeton, 1950-1951)
John Nash doit se faire une place au sein des cercles académiques. Pour se faire connaître et accroître sa réputation, il entreprend d'écrire un article visant à le faire reconnaître en tant que mathématicien pur.
Son texte est effectivement une réussite ; ses calculs sont considérés comme des mathématiques élégantes et pures. Cet article lui permet donc d'être reconnu comme un véritable mathématicien de premier plan.
Pourtant, malgré ce succès, il n'obtient pas de poste à Princeton. La raison en est sans doute que beaucoup de ses collègues le trouvent dérangeant, voire arrogant.
Finalement, John Nash accepte plutôt un poste au Massachusetts Institute of Technology, le célèbre MIT.
MIT
Le MIT est une institution historiquement dédiée à l'ingénierie. Elle a moins bonne réputation que les grandes universités où se pratiquent la physique théorique ou les mathématiques pures, par exemple. C'est pourquoi Nash se perçoit parfois comme "un cygne parmi les canards".
Néanmoins, sa présence contribue au changement de l'Institut et, grâce à lui, les mathématiques deviennent un département majeur de l'école.
Des personnalités de premier plan comme Norbert Wiener — pionnier de la cybernétique et de l'informatique, entre autres choses — et Norman Levinson, un mathématicien, l'accueillent avec bienveillance.
Garnements
Au MIT, John Nash enseigne de façon peu conventionnelle. Il adopte un style excentrique et fait beaucoup de jeux d'esprit. Ses cours, plus proches de l'association libre que de l'exposition planifiée, incluent des énigmes et des farces.
Cette originalité est valorisée dans ce milieu et permet à John Nash de se trouver des amis.John Nash ne cesse d'expérimenter et de rencontrer de nouvelles personnes. Toutefois, son caractère hautain et parfois explicitement méprisant (notamment envers les juifs) le rend détestable aux yeux de certains.
Expériences (RAND, été 1952)
À l'été 1952, John Nash fait un road trip de Bluefield à Santa Monica avec John Milnor, un étudiant diplômé en mathématiques. La bande de jeunes comprend également la sœur du mathématicien, Martha, et Ruth Hincks, une étudiante en journalisme. Le voyage prend fin quand John Nash se dispute avec cette dernière.
Les deux hommes, qui partagent un appartement temporaire près du RAND, se concentrent principalement sur leurs projets individuels. Ils expérimentent autour de la théorie des jeux et notamment des règles de coalition et de collaboration.
La relation devient toutefois tendue après que Nash a déclaré sa flamme à John Milnor.
Géométrie
Au début des années 1950, la paranoïa de la guerre froide donne lieu au maccarthysme : l'ère du soupçon à l'encontre des "espions" communistes bat son plein.
Plusieurs mathématiciens du MIT, dont Norman Levinson, sont accusés et forcés de témoigner. Ce dernier avait été membre du Parti communiste dans sa jeunesse, mais nie être resté proche de cette pensée politique.
Bien que le MIT soutienne ses employés, cet événement rappelle à tous les universitaires, y compris à John Nash, que le contrôle fait désormais partie de la vie quotidienne et que le monde qu'ils ont connu avant la guerre s'est transformé.
Deuxième partie — Vies séparées
Le poker a inspiré la théorie des jeux de Von Newman et de Nash
Singularité
Au cours de son passage au MIT, John Nash devient plus sociable et sort de sa pensée pour se frotter aux relations interpersonnelles. Comme nous allons le voir plus en détail dans les sections suivantes, il s'engage émotionnellement de façon diverse en ayant notamment :
Des relations homosexuelles ou des amitiés masculines fortes et ambigües ;
Un enfant avec une première compagne du nom d'Eleonor, qu'il abandonnera ensuite ;
Une autre compagne avec laquelle il se mariera et aura un autre enfant.
John Nash peine toutefois à répondre aux demandes d'autrui. Il comble ses propres besoins émotionnels et sexuels, mais néglige souvent ceux des autres. Orgueilleux, il estime souvent que son génie devrait suffire à les satisfaire.
Une amitié particulière (Santa Monica, été 1952)
À la fin de l'été 1952, John Nash vit l'une de ses "amitiés particulières" avec un autre homme, Ervin Thomson, âgé de trente ans et secrètement homosexuel. À l'heure du maccartisme, il est préférable de ne pas avouer trop publiquement ses orientations sexuelles.
Peu d'informations sont disponibles sur leur relation. Toutefois, elle semble significative pour John Nash, car elle marque son premier pas vers la réciprocité et l'intelligence émotionnelle. Cette relation lui permet de sortir de son isolement.
Eleanor
Lors d'une visite de routine à l'hôpital, le jeune homme rencontre une infirmière "jolie et brune" nommée Eleanor. Bien que timide et inexpérimentée sur le plan sexuel, elle est désarmée par la douceur et le charme maladroit du professeur du MIT.
Les deux amants gardent d'abord leur relation sexuelle secrète. Toutefois, lorsqu'Eleanor annonce sa grossesse, John Nash doit prendre une décision. Au départ, il semble plutôt heureux, mais cette joie est de courte durée.
La relation se détériore rapidement : Eleonor s'inquiète de l'avenir, mais le mathématicien montre peu d'intérêt pour sa situation. Malgré la naissance de leur fils, il ne la demande pas en mariage ni ne lui fournit d'aide financière.
Lorsque, finalement, John Nash suggère qu'Eleanor donne leur enfant en adoption, celle-ci se détourne de lui définitivement.
Jack
À l'automne 1952 (c'est-à-dire durant sa relation avec Eleonor), John Nash rencontre un jeune étudiant diplômé, Jack Bricker, dans la salle commune du MIT. Bien qu'habituellement dédaigneux envers les esprits moins brillants, Nash est attiré par Bricker, tandis que ce dernier est fasciné par l'intelligence et la beauté de Nash.
Leur relation, bien qu'ouverte et affectueuse, ne sera toutefois pas particulièrement heureuse. En effet, le jeune génie des maths est obsédé par son autonomie et rechigne à s'engager émotionnellement. En plus, il ridiculise son compagnon en public, puis lui avoue sa relation avec Eleanor.
La relation se détériore au point que Jack Bricker décide d'abandonner ses études supérieures.
L'arrestation (RAND, été 1954)
En 1954, John Nash passe un autre été à la RAND. Suivant ses méthodes habituelles, il passe beaucoup de temps à réfléchir à ses recherches en marchant le long de la plage ou dans le parc Palisades — souvent jusqu'à très tard dans la nuit.
Un jour, la police signale à la sécurité de RAND l'arrestation du jeune homme pour "exhibition indécente" dans ce parc — où il ne faisait pas que penser, mais pratiquait aussi le cruising (rencontre avec d'autres hommes en extérieur)…
Cela entraîne une rupture de contrat. À cette époque, l'homosexualité est vue comme obscène et dangereuse. Le climat paranoïaque de la guerre froide n'aide en rien.
Nash ne semble pas initialement perturbé par cet incident. Toutefois, celui-ci révèle la vulnérabilité de sa vie privée et l'existence de pressions extérieures.
Alicia
De retour au MIT, Nash trouve un soulagement dans ses visites à la bibliothèque musicale, où il rencontre Alicia Larde. Cette ancienne étudiante est séduite par sa combinaison de génie, de statut et de beauté naturelle. Intelligente et curieuse, elle imite ses intérêts pour attirer son attention.
Fascinée par son nouveau compagnon, Alicia décide de renoncer à ses ambitions scientifiques et vise le mariage avec lui. Mais ce dernier ne sait pas encore que faire. Il est face à de nombreux choix, tant personnels que professionnels.
Manœuvres d'approche
John Nash envisage le mariage avec une femme comme une solution possible à ses propres problèmes avec les hommes et les risques qu'il encourt. C'est avec Alicia, rencontrée au moment opportun, qu'il décide de se lancer.
Le chercheur est attiré par la jeune femme car celle-ci est intelligente, mais aussi parce qu'elle s'intéresse à lui et l'aime tel qu'il est. Mais il n'est pas très doué pour la monogamie… En effet, pendant qu'il entame cette relation, il continue à voir Eleanor et Jack Bricker (en fait, tout se passe à la même période !).
Seattle (été 1956)
Nash quitte le MIT pour assister à une école d'été à l'Université de Washington. Il espère être au centre de l'attention. Malheureusement, l'annonce de la preuve de l'existence de sphères exotiques par un autre mathématicien lui vole complètement la vedette. John Nash se sent alors petit, tout petit…
C'est néanmoins à cette occasion qu'il rencontre Amasa Forrester, un ancien camarade de Princeton, ouvertement homosexuel et très sympathique. Ils sortent un temps ensemble et John Nash garde un bon souvenir de cette relation.
Plus tard, lorsque le mathématicien est mis devant ses responsabilités de père, il accorde une pension alimentaire à Eleonor. En fait, il semble que ce soit Jack Bricker qui l'ait convaincu d'agir de la sorte pour éviter un scandale préjudiciable à sa carrière.
Décès et mariage (1956-1957)
John Nash aime la vie new-yorkaise et s'installe à New York. Il aime la vie bohème et veut vivre différemment. Toutefois, le décès de son père le confronte à nouveau à des responsabilités et à des règles qu'il méprise et rejette.
D'un autre côté, sa mère fait pression pour qu'il se marie. John Nash et Alicia se fiancent donc et organisent une petite cérémonie de mariage familiale en février 1957.
Troisième partie — Comme un feu qui couve sous la cendre
La schizophrénie de John Nash lui crée de nombreux problèmes dans la vie quotidienne.
Olden Lane et Washington Square (1956-1957)
Comme il vit à New York, John Nash visite fréquemment l'Institut Courant des sciences mathématiques de l'Université de New York. Il aime ce lieu et finit par y passer autant de temps qu'à l'Institute of Advanced Study (ISA).
Malgré l'atmosphère conviviale et les défis stimulants qu'il trouve dans ces institutions, John Nash considère avoir échoué dans ses recherches à cette époque. Il découvre qu'un mathématicien italien, Ennio de Giorgi, a prouvé un théorème sur lequel il travaillait quelques mois plus tôt.
Les méthodes non conventionnelles de Nash connaissent un certain succès. Mais il devient aussi de plus en plus obsédé par la révision de la théorie quantique ; un effort qui se révèle vain et qu'il considérera plus tard comme potentiellement lié à l'apparition de sa schizophrénie.
La fabrique de bombes
Le couple trouve, non sans difficultés, un appartement à Cambridge et commence à mener une vie conjugale classique. Malgré cette bonne nouvelle, le mathématicien reste insatisfait. Il voudrait être davantage reconnu et il s'inquiète de ne pas encore avoir une position permanente à MIT.
Il se plaint également de ne pas obtenir la prestigieuse Médaille Fields. Son travail devient pourtant de plus en plus reconnu. En réalité, il se met une pression énorme sur les épaules pour réussir ; une pression, comme nous allons le voir, sans doute excessive.
Secrets (Été 1958)
John Nash a presque 30 ans. Il est anxieux, notamment en raison de la croyance selon laquelle les meilleures découvertes mathématiques surviennent avant cet âge.
Avec cette idée en tête, il décide de se confronter à l'Hypothèse de Riemann, un problème mathématique encore irrésolu. Il passe alors fréquemment du doute et de la perte de confiance en soi à l'exaltation la plus complète.
En parallèle, John Nash développe une passion pour les marchés boursiers et l'argent. Il cherche à décoder un supposé "secret" du marché. Il demande un prêt à sa mère et commence à réaliser des investissements de plus en plus risqués.
Durant l'été, John Nash et Alicia voyagent en Europe pour leur lune de miel. Le jeune homme offre une bague trop chère à sa compagne, mais à part ça le couple est néanmoins heureux.
Des plans sur la comète (Automne 1958)
De retour à Cambridge, Alicia annonce sa grossesse. Le mathématicien se sent à la fois heureux et inquiet. Il ne sait que faire, notamment au niveau de son avenir professionnel. Il reçoit des offres de postes très intéressantes, mais préfère prendre un congé sabbatique.
À cette époque, il partage son temps entre l'IAS et l'Institut des hautes études scientifiques à Paris.
Mais il ne parvient pas à gagner en stabilité. Financièrement, il perd l'argent investi en bourse et doit rembourser sa mère. Au niveau personnel, il s'engage dans une relation ambiguë avec Paul Cohen, un homme ambitieux qui attire le mathématicien.
Certains témoins et commentateurs prétendent que c'est la relation déçue et la compétition entre Paul Cohen et John Nash qui a été la cause de son effondrement psychique.
L'empereur de l'Antarctique
Nouvel An 1958. John Nash se déguise en bébé, ce qui étonne son entourage. Mais ce n'est pas le seul événement étrange :
Il se lance dans des monologues confus ;
Fait état de croyances irrationnelles ;
Rédige des lettres insensées à des ambassadeurs ;
N'arrive plus à suivre le fil de son exposé lors de ses conférences ;
Etc.
Indubitablement, ce sont les premiers signes de la maladie mentale qui se manifestent. Comme nous allons le voir, sa santé décline rapidement et va le conduire d'hôpital en hôpital à la recherche d'un traitement.
Dans l'œil du cyclone (printemps 1959)
Alicia suspecte depuis un moment que John Nash présente des signes de détresse mentale. Il est incohérent et paranoïaque. Au début, elle attribue ces comportements au stress du travail et à la perspective d'une paternité imminente, mais les symptômes de Nash deviennent plus inquiétants.
Parmi ses comportements étranges, il menace de vider ses comptes bancaires et écrit des lettres bizarres à des institutions internationales.
Hésitant à révéler la situation par crainte des conséquences professionnelles pour son mari, elle quitte son emploi pour le surveiller. Les conseils contradictoires de psychiatres et un incident alarmant conduisent finalement Alicia à reconnaître la gravité de la situation.
Elle prend alors une décision que John Nash lui reprochera longtemps : demander son internement.
Le jour se lève à Bowditch Hall (Hôpital McLean, avril-mai 1959)
John Nash prétend être le leader d'un mouvement mondial pour la paix sous le nom de "Prince de la paix". Après une brève évaluation à l'hôpital McLean où l'emmènent des policiers, il est finalement bel et bien interné. Un diagnostic est établi : schizophrénie paranoïaque.
Sa mère, Virginia, est bouleversée. Toutefois, elle se montre incapable de soutenir Alicia. Il semble normal lorsqu'elle le visite et ne comprend pas véritablement le problème. Traité avec des médicaments et une psychothérapie intensive, il se comporte en "patient modèle".
Cependant, certains psychiatres doutent de la sincérité de son rétablissement. Finalement, l'hôpital le libère après qu'il ait fait appel à un avocat et que sa femme se soit prononcée contre un nouvel internement.
Un thé chez le chapelier fou (Mai-juin 1959)
La vie de sa compagne, Alicia, n'est pas facile.
John Nash étant à l'hôpital, elle décide de s'installer chez son amie Emma. Elle doit se défendre d'avoir fait interner son mari. Mais aussi faire face à ce dernier, qui menace de divorcer en représailles de son geste.
Bien qu'elle soit enceinte, elle met toute son énergie dans la défense de son compagnon :
"Toute son attention [est] focalisée sur une seule tâche — non pas celle d'accoucher, mais celle de sauver John Nash." (Un homme d'exception, Troisième partie)
Une fois sorti de l'hôpital, John Nash — toujours fâché contre sa femme et en proie à ses théories délirantes — décide de s'enfuir et de partir vivre en Europe.
Quatrième partie — Les années perdues
Citoyen du monde (Paris et Genève, 1959-1960)
À Paris, John Nash cherche à rompre avec son ancienne vie américaine. Il tente de renoncer à sa citoyenneté américaine, mais un fonctionnaire de l'ambassade l'en dissuade. Malgré cela, il persiste et demande le statut de réfugié en Suisse.
Après des mois de lutte et d'échecs, il est finalement expulsé d'Allemagne de l'Est et renvoyé aux États-Unis. Durant cette période, ses comportements étranges et ses idées délirantes continuent de surprendre.
Zéro absolu (Princeton, 1960)
De retour aux États-Unis, John Nash séjourne brièvement à Princeton, puis emménage avec Alicia, mais les ennuis ne tardent pas à apparaître.
Il souhaite retourner en France et prétend être lié à des affaires internationales ; il parle de paix mondiale et de gouvernement mondial. Sa femme, Alicia, réalise qu'il devra probablement être interné à nouveau.
Finalement, la police doit intervenir. Sa santé mentale exige un internement. Étrangement (ou logiquement ?), deux jours plus tôt, John Nash prédit qu'il sera emmené par les policiers.
Tour de silence (Trenton State Hospital, 1961)
Avec peu d'argent, le couple ne peut pas faire grand-chose. John Nash est placé à l'hôpital d'État de Trenton. Il dira plus tard que le traitement à l'insuline qu'il y reçoit alors a été une "torture". En outre, il vit en grande promiscuité avec d'autres patients.
Il y reste six mois. Puis il est transféré au sein de l'aile de réadaptation après que le traitement ait montré des signes de succès. Il peut enfin travailler à un article académique important et est "libéré" de l'hôpital à la fin de l'été.
Un intermède de rationalité imposée (Juillet 1961 - avril 1963)
Bien que sa récupération mentale soit considérée comme une issue positive par son entourage, John Nash ressent "un sentiment de diminution et de perte". Pourquoi ? Car il considère qu'il n'a plus accès à ce qu'il considère comme des "visions cosmiques, voire divines".
Dépendant à nouveau de la gentillesse de ses amis et collègues, John Nash obtient un modeste poste de recherche à l'IAS. Bien qu'Alicia et lui vivent à nouveau ensemble, la relation demeure tendue.
Lorsque la santé mentale du mathématicien décline à nouveau, Alicia décide d'entamer à contrecœur une procédure de divorce. Elle lui impose également de se rendre dans une clinique pour être soigné.
Le problème de l'extension (Princeton et clinique Carrier, 1963-1965)
John Nash est admis dans une clinique privée qui pratique les électrochocs et les traitements pharmaceutiques : la Carrier Clinic. Sa femme refuse qu'il reçoive davantage d'électrochocs. Il y a passé plusieurs mois.
Une fois sorti, le mathématicien vit seul et reprend son travail. Mais son comportement étrange persiste. Malgré des apparences positives, il se considère comme une "figure religieuse secrète". Après un séjour en Europe, il est réadmis à la Carrier Clinic, puis s'installe à Boston une fois le traitement terminé.
Solitude (Boston, 1965-1967)
John Nash se sent seul sans sa femme et son fils. Il voit un psychiatre et décide de prendre des médicaments, ce qui ne lui plaît guère. En effet, les médicaments nuisent à sa créativité scientifique.
Il connaît ainsi des hauts et des bas entre productivité et reprise des crises. Au printemps 1967, il devient maniaque, incohérent, paranoïaque et délirant ; il est obsédé par des nombres magiques et des conspirations internationales.
Il rencontre sa première femme avec leur fils. Mais les relations sont mauvaises, en raison de son instabilité psychologique et de son irritation face aux résultats scolaires de son fils.
Un homme seul dans un monde étrange (Roanoke, 1967-1970)
À quarante ans, John Nash paraît déjà "vieux". Il vit à Roanoke avec sa mère, erre en ville, en sifflant parfois. La plupart du temps, il reste à la maison et y tourne — littéralement — en rond. Il est complètement obnubilé par la politique et fomente des théories du complot. Il crée des codes secrets.
Terrifié à l'idée d'être hospitalisé à nouveau, John Nash est pris de colère lorsque sa sœur décide de le faire interner à nouveau après la mort de sa mère. Il rompt tout lien avec elle pendant de longues années.
Le fantôme de Fine Hall (Princeton, années soixante-dix)
John Nash est surnommé "le Fantôme" à Princeton. L'air absent, les yeux enfoncés dans des cernes creusées, il sillonne les couloirs et donne cours de façon cryptique. Lors de ceux-ci, il mélange chiffres, codes, politique, philosophie et religion. Les étudiants sont désarçonnés par un tel enseignement, qui laisse parfois à désirer, mais qui est aussi, par moment, très stimulant.
Malgré sa maladie, John Nash espère toujours rester en contact avec sa communauté. Son écriture codée pourrait être le moyen qu'il trouve, à cette époque, pour ne pas perdre pied complètement. Par ailleurs, il se sent bien dans les couloirs de l'université. Princeton est un "endroit calme et sûr" pour lui. Il peut s'y exprimer sans crainte de rejet.
En 1978, il reçoit le prestigieux prix John Von Neumann, mais n'est pas invité à la cérémonie de remise des prix.
Une vie paisible (Princeton, 1970-1990)
Dans les années 1970, Alicia et John Nash vivent ensemble tant bien que mal, malgré la maladie mentale. La santé de John Nash reste instable, mais il cherche à passer du temps avec sa femme et leur fils Johnny.
Ce dernier, doué en mathématiques, montre toutefois — lui aussi — des signes de schizophrénie. Il est hospitalisé à plusieurs reprises, mais parvient à étudier les mathématiques et obtient même un doctorat en 1985.
Cinquième partie — Le plus digne
John Nash reçoit le prix Nobel d'économie en 1994.
Rémission
John Nash retrouve un équilibre mental à partir des années 1970 et 1980. Bien qu'ils ne disparaissent jamais complètement, les symptômes de la schizophrénie diminuent progressivement durant ces années.
Cette victoire sur la maladie est liée à sa propre capacité à tenir à distance les pensées délirantes qui l'assaillent. Il parvient à se raisonner et à entretenir des relations plus saines avec cette partie de sa psyché qui lui joue des tours.
Cette amélioration lui permet de retrouver une certaine normalité dans ses interactions. Il reprend également ses recherches et se forme à l'utilisation de l'informatique.
Pendant ce temps, sa célébrité s'accroît ; il est de plus en plus cité dans des articles universitaires, principalement en économie. Mais, si son nom circule, la plupart des chercheurs pensent qu'il est mort ou en institution !
Nouveau signe important de reconnaissance : John Nash est élu membre de la Société d'économétrie.
Le prix
John Nash n'a pas fait l'unanimité ! Lorsqu'il est proposé comme candidat au prix Nobel d'économie, les membres du comité hésitent en raison de sa santé mentale. Ils enverront même un émissaire, Jörgen Weibull, pour évaluer sa personnalité.
Le comité débat par deux fois de son inclusion en tant que candidat au prix. Certains s'y opposent vigoureusement, tandis que d'autres sont ses défenseurs passionnés. D'un côté, il y a ceux qui ont connu le mathématicien dans ses pires moments ; de l'autre, il y a ceux qui considèrent avant tout ses mérites scientifiques.
Finalement, John Nash est informé qu'il reçoit le prix Nobel vers la fin de l'année 1994.
La plus grande vente aux enchères de tous les temps (Washington DC, décembre 1994)
Au même moment, Al Gore inaugure "la plus grande vente aux enchères de tous les temps" liée aux télécommunications. La particularité de cet événement est qu'il s'appuie sur la théorie des jeux et, notamment, sur l'analyse de la rivalité et de la coopération entre un petit nombre de joueurs rationnels.
C'est la preuve que les concepts développés par John Nash deviennent de plus en plus acceptés et utilisés par les mathématiciens et les économistes (qui organisent la vente aux enchères). C'est un autre type de reconnaissance : après de longues "décennies de résistance", il voit enfin sa théorie appliquée largement.
De nouveau au monde (Princeton, 1995-1997)
La vie de John Nash s'améliore financièrement après la réception du prix Nobel. Il continue à travailler à Princeton, mais ses préoccupations s'orientent toujours davantage vers sa famille ; il s'inquiète en particulier pour la santé de son fils, Johnny.
Par ailleurs, John Nash cherche également à améliorer sa relation de couple avec sa femme et l'idée d'un remariage est même évoquée.
Épilogue
Et c'est bien ce qui se produit ! Les époux Nash se remarient après 40 de mariage. John Nash se sent stable et ne craint plus les rechutes.
Le prix Nobel travaille à divers projets :
Il donne des conférences dans lesquelles il aborde, notamment, la question des troubles mentaux et de la stigmatisation des personnes qui en souffrent.
Il continue à faire des mathématiques.
Ses relations sociales s'améliorent nettement, tant avec ses collègues qu'avec ses amis et sa famille. Et finalement, l'idée que quelqu'un rédige une biographie sur lui semble lui plaire — alors qu'il la trouvait auparavant saugrenue.
Conclusion sur « Un homme d'exception » de Sylvia Nasar :
Ce qu’il faut retenir de « Un homme d'exception » de Sylvia Nasar :
Tout l'intérêt de ce livre consiste à nous faire entrer dans la peau de John Nash. Non seulement dans ses grands moments créatifs, mais aussi dans ses périodes de trouble social et psychologique. Nous apprenons beaucoup d’éléments sur sa personnalité complexe et nous nous faisons une meilleure idée de sa façon d’engendrer des idées nouvelles.
Le célèbre mathématicien qui a mis en forme une bonne partie de la théorie des jeux a bien failli ne jamais obtenir le prix Nobel en raison de ses problèmes "psy". Pourtant, comme le montre à merveille le livre, il est parvenu à se stabiliser et à devenir une personne plus vivable pour ses proches.
Sylvia Nasar parvient parfaitement à nous plonger dans cette histoire, ainsi que dans cette époque des États-Unis de l'après-guerre.
Points forts :
Une écriture brillante qui fait de cette biographie un véritable "page turner" ;
De nombreuses anecdotes qui nous permettent de comprendre les relations entre génie et folie ;
Un témoignage exceptionnel de la vie de l'un des plus grands mathématiciens contemporains ;
Si vous avez aimé le film (ou que vous ne l'avez pas encore vu), lisez le livre pour comparer !
Point faible :
C'est un livre passionnant… Donc je n'en ai pas trouvé !
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu le livre de Sylvia Nasar « Un homme d'exception » ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Sylvia Nasar « Un homme d'exception ».
Visitez Amazon afin d’acheter le livre de Sylvia Nasar « Un homme d'exception ».
Cet article Un homme d’exception est apparu en premier sur Des livres pour changer de vie.
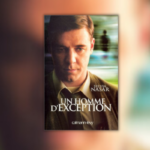 ]]>
]]>Résumé de "L'ultra marathon m'a sauvé" de Rich Roll :"L’ultra marathon m’a sauvé" de Rich Roll est un mémoire sur sa transformation personnelle de la sédentarité et des problèmes de santé à l’un des athlètes d'endurance les plus reconnus, illustrant comment il a repoussé ses limites au-delà de l'imaginable grâce à un régime végétalien et un entraînement rigoureux.
Par Rich Roll, 2013, 400 pages
Titre original : Finding ultra
Note : cet article invité a été écrit par Hugo du blog Swimxrun.
Chronique et résumé de “L’ultra marathon m’a sauvé : Devenir l'un des hommes les plus forts du monde et se découvrir pleinement” :
Préface
Lors d'une course à vélo sous une pluie battante, Rich fait une chute violente. Il se retrouve éjecté de son vélo et gravement blessé. Malgré la douleur, il réfléchit à tout le travail accompli pour en arriver là, rappelant ses heures d'entraînement et sa transformation de simple avocat sédentaire à athlète d'endurance, le tout en suivant un régime végétalien. Au milieu de la course de l'Ultraman World Championships à Hawaï, malgré les obstacles et les doutes, les équipages des autres concurrents viennent à son aide. Face à l'encouragement et à la détermination de tous autour de lui, il décide de reprendre la course, refusant d'abandonner malgré ses blessures.
Chapitre 1 : la prise de conscience
Rich évoque la nuit, la veille de ses quarante ans, qui a changé sa vie. Il se retrouve incapable de monter huit marches sans être essoufflé. U une expérience qui le confronte à son mode de vie malsain.
Rich Roll, qui était à l'époque en surpoids et ne faisait jamais de sport. Il s'est rendu compte qu'il avait besoin de changer. Il décrit comment il était, à l'époque, accro à la malbouffe et à la nicotine, et loin de l'athlète qu'il était dans sa jeunesse.
Rich Roll décide alors de changer radicalement son mode de vie. Il passe d'un régime riche en viande et produits laitiers à un régime végétalien. Et, il intègre l'exercice physique dans sa routine quotidienne. Il entame un programme de désintoxication rigoureux. Et, malgré les difficultés initiales, il commence à ressentir une amélioration significative de sa santé et de son énergie. Inspiré par ses changements positifs, il développe un intérêt renouvelé pour le sport et aspire à redevenir compétitif, même à l'approche de la quarantaine. Ce chapitre établit ainsi le prélude de son parcours de transformation et son retour au monde de la compétition sportive.
Chapitre 2 : une jeunesse solitaire et sportive
Rich évoque son amour précoce pour la natation. Une passion initiée par sa mère qui voulait lui transmettre son amour pour l'eau. Il mentionne aussi ses antécédents familiaux et la vie de ses parents avant sa naissance en 1966. Bien que fragile à la naissance, il développe un intérêt pour la natation et devient rapidement compétitif.
Par contre, sa vie à l'école est tout le contraire. Là, il est raillé et se sent exclu. Mais la natation lui donne un sens d'appartenance et il excelle.
Chapitre 3 : des études prestigieuses
Le chapitre commence par les exploits sportifs de l'auteur qui lui valent l'attention des meilleurs programmes universitaires. Après avoir été courtisé par diverses universités, il est particulièrement touché par l'histoire de son grand-père, Richard Spindle, qui était un nageur renommé à l'Université du Michigan. Même si son grand-père est décédé avant sa naissance, il sent une profonde connexion spirituelle avec lui.
Rich est finalement accepté dans toutes les universités où il postule, dont Harvard. Cependant, une visite à l'université de Stanford change sa décision. Fasciné par l'ambiance du campus et les opportunités sportives, il choisit Stanford.
Malgré ses succès initiaux en natation à Stanford, l'alcool commence à jouer un rôle négatif dans sa vie. Une nuit, après avoir bu pendant un match de football, il se blesse gravement en tombant dans les gradins. Malgré sa blessure, il participe à une importante compétition de natation et surprend tout le monde par ses performances.
Malheureusement, c'est le pic de sa carrière de nageur car sa dépendance à l'alcool commence à prendre le dessus.
Chapitre 4 : Rich sombre dans l’alcoolisme
La relation de Rich avec l’alcool empire. Dès sa première expérience avec l'alcool lors d'une soirée au Michigan, il pressent qu'il pourrait avoir un problème avec cette substance. Malgré ses réussites académiques et sportives, son penchant pour l'alcool augmente avec le temps. À l'université, il délaisse la natation pour se concentrer sur la fête. Son addiction à l'alcool s'intensifie et impacte ses performances sportives. Il finit par quitter la natation.
Après l'université, il travaille dans un cabinet d'avocats à New York où il mène une vie de débauche. Malgré son comportement autodestructeur, il parvient à obtenir son diplôme de droit, mais échoue à l'examen du barreau. En travaillant comme avocat à San Francisco, Rich Roll continue à sombrer dans l'alcoolisme, bien que conscient des conséquences. Rich est en lutte constante entre la reconnaissance du problème et la capitulation face à l'addiction.
Chapitre 5 : un premier mariage qui dure quelques jours
En 1995, l'auteur tombe amoureux de Michele, une femme dévouée à l'éducation des jeunes défavorisés. Toutefois, il est aux prises avec ses propres problèmes d'alcoolisme, se sentant insatisfait dans son travail et cherchant constamment à se repositionner dans sa carrière. Malgré des périodes de sobriété, il replonge régulièrement dans la boisson. Après deux arrestations pour conduite en état d'ivresse, il est forcé de se confronter à ses problèmes d'alcool. C'est alors qu'il découvre les réunions des Alcooliques Anonymes.
Au fur et à mesure que le chapitre avance, l'auteur se rapproche de son mariage avec Michele. Cependant, leur relation commence à se dégrader, et Michele devient de plus en plus distante. Malgré le mariage, les problèmes ne font que s'aggraver lors de leur lune de miel en Jamaïque. Finalement, l'auteur découvre que Michele a eu une liaison pendant leur engagement. Dévasté, il se tourne à nouveau vers l'alcool pour noyer sa douleur.
Chapitre 6 : la cure de désintoxication
Rich Roll décrit sa lutte acharnée pour surmonter l'alcoolisme. Après avoir vécu plusieurs rechutes et avoir perdu le soutien de sa famille, il trouve de l'aide grâce à ses parents qui lui recommandent un psychiatre. Il finit par suivre un programme de désintoxication à Springbrook Northwest. Il passe cent jours à se confronter à ses problèmes et à chercher une guérison spirituelle. Là-bas, il apprend à lâcher prise et à chercher de l'aide extérieure.
Après sa sortie, il réoriente sa carrière et commence à construire une vie nouvelle.
Il rencontre Julie lors d'une séance de yoga, avec qui il tombe amoureux et fonde une famille. Ensemble, ils achètent un terrain à Malibu Canyon et y construisent leur maison de rêve. La sobriété lui permet de retrouver l'amour et le sens de la vie.
Chapitre 7 : le régime alimentaire qui a changé Rich
Les habitudes alimentaires de Rich sont peu saines. Il explique comment il a évolué vers un régime basé sur les plantes. Rich était initialement sceptique quant au régime végétalien, le voyant comme une mode ou un choix de vie alternatif.
Cependant, après avoir expérimenté les avantages pour la santé d'un régime à base de plantes, il est devenu un fervent défenseur de cette façon de manger, qu'il a baptisée “PlantPower Diet”. L'auteur souligne que bien que le régime alimentaire puisse sembler restrictif au début, il offre en réalité une multitude de bienfaits pour la santé, notamment une augmentation de l'énergie, une amélioration de l'humeur, une meilleure récupération après l'exercice et la prévention de nombreuses maladies chroniques.
Malgré les critiques et les sceptiques, Rich défend fermement son choix de régime. L’axe de défense de ce régime est principalement axé sur sa propre expérience. Il conclut en mettant les lecteurs au défi d'essayer le régime PlantPower pendant trente jours et de constater par eux-mêmes les améliorations qu'il peut apporter à leur santé.
Ce régime a permis à Rich de perdre 20 kg en 6 mois pour atteindre 74 kg.
Description du régime Plan Power Diet :
C’est plutôt simple. C’est un régime végétalien avec aucun aliment provenant des animaux (0 œuf, 0 lait, 0 viande, 0 poisson), un maximum de nourriture bio, et un minimum de nourriture transformée industrielle.
En annexe du livre, l’auteur analyse les protéines, sels minéraux, nutriments contenus dans les végétaux et démonte les préjugés disant que l’Homme a absolument besoin de nourriture animale. (Food and Nutrition Board (FNB), Institute of Medicine (IOM), “Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients) (2002)” Lien vers l'étude)
Chapitre 8 : l’établissement d’objectif sportif ambitieux
Rich explique sa transition vers une vie plus saine et active à partir de 2007, adoptant une alimentation à base de plantes et commençant un régime d'exercices doux qui s'est intensifié avec le temps. Il a connu des échecs initiaux, y compris un essai infructueux dans un triathlon de half Ironman (1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21km de course à pied). Malgré cela, il a continué à s'entraîner et à améliorer sa condition physique, se fixant finalement l'objectif de participer à l'Ironman.
Par hasard, il apprend l'existence de l'Ultraman, une compétition intense et exclusive. Cela consiste à parcourir 515 km en trois jours en alternant nage, VTT et course. Inspiré, il se fixe l’objectif de participer à cette compétition, malgré son manque d'expérience et de qualifications. Après avoir convaincu les organisateurs et son entraîneur, Chris, de sa détermination et de son sérieux, il est accepté pour participer à l'Ultraman.
Tout au long de cette période, il apprend l'importance de la formation et de la discipline, et comment une approche équilibrée de l'entraînement d'endurance est cruciale pour éviter les blessures et optimiser la performance. Il met en lumière la relation entre la persévérance, la foi en soi et l'atteinte des objectifs, même ceux qui semblent impossibles au début.
Chemin vers Ultraman :
Le narrateur commence son entraînement pour l'Ultraman avec moins de six mois devant lui. Avec l'aide de son entraîneur Chris, il augmente progressivement son volume d'entraînement pour éviter les blessures. Avec le temps, ses progrès sont notables, notamment grâce à une approche intelligente de l’entraînement à l'approche de l'entraînement en zone 2 et à la polarisation, un concept qui lui était auparavant étranger. J’évoque cette partie dans mon plan d’entraînement swimrun.
En résumé, le narrateur parcourt un chemin transformationnel d'entraînement physique, de compréhension des blessures et d'évolution nutritionnelle pour préparer son corps à l'épreuve d'Ultraman.
Au fur et à mesure que le volume d'entraînement augmentait, il commençait à empiéter sur tous les autres aspects de la vie de l'auteur. Pour concilier travail, famille et entraînement, il a dû réévaluer et ajuster sa gestion du temps, souvent au détriment de son sommeil ou en raccourcissant ses séances d'entraînement. Malgré ses progrès sportifs, ses finances en ont souffert. Un week-end, après avoir mal calculé ses besoins en calories lors d'une longue sortie à vélo, il s'est retrouvé sans argent et a dû fouiller les poubelles pour de la nourriture. En proie à la honte et à la désolation, il a envisagé d'abandonner son rêve d'Ultraman.
Cependant, une expérience méditative profonde pendant ce trajet l'a convaincu de persévérer. Julie, sa femme, lui a réaffirmé qu'il était sur la bonne voie et que les défis financiers seraient surmontés avec la foi. Inspiré, il a continué son entraînement et, peu de temps après, les finances de la famille se sont améliorées, lui permettant de participer à l'Ultraman à Hawaï.
Chapitre 9 : le succès de l’Ultraman
En 2008, c’est le moment de l’Ultraman. Malgré les doutes et rappelant ses anciennes difficultés physiques, il se présente au départ avec un soutien solide de son équipe. Le premier jour voit un enchaînement de natation et de vélo où Rich surprend et finit deuxième.
Le deuxième jour, il fait face à la plus longue sortie à vélo de sa vie et, malgré les défis, termine à la neuvième place.
Le troisième jour est consacré à la course à pied. Adoptant une stratégie prudente, il réussit à finir fort, en se plaçant onzième au général. Rich réfléchit ensuite à sa transformation, à sa quête d'authenticité et à la signification de sa réussite, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille et pour tous ceux qui ont suivi son parcours.
Il s’est fixé des objectifs ambitieux, et les a atteints.
Chapitre 10 : Rich réussit un défi unique au monde
En 2009, Rich découvre le projet fou de son ami Jason Lester: l'EPIC5 Challenge alors qu’il s'apprête à réaliser un nouvel Ultraman. Il s'agit de réaliser cinq triathlons de distance Ironman (3.8 km de nage, 180 km de vélo et 42km de course à pied) sur cinq îles différentes en cinq jours. Cette prouesse sportive serait une première mondiale. Face à cette idée inédite et incroyable, l'auteur est à la fois sceptique et admiratif, connaissant le passé difficile de Jason et sa détermination sans faille. Et oui, son ami Jason est handicapé d’un bras.
Pendant cet Ultraman, Rich chute lourdement en vélo le deuxième jour. Mais, il parvient à continuer grâce à l'aide de sa famille et de son équipe. Il rappelle une citation de David Goggins qui dit que lorsque l'on pense avoir “atteint ses limites, on n'a en réalité utilisé que 40% de son potentiel réel”. Vous trouverez ici la chronique de ce livre de David Goggins. Malgré la douleur et la fatigue, Rich Roll finit la course puis décide de prendre part au défi l’EPIC5. Les préparatifs pour ce défi hors-norme commencent, avec une logistique complexe et un plan d'entraînement adapté à cette épreuve sans précédent.
Le défi EPIC5 : 5 Ironman’s sur 5 îles d’Hawaii en 5 jours
Jour 1 : île de Kaui
Jason et Rich commencent leur défi EPIC5 avec un triathlon à Oahu. Malgré les défis, notamment une panne de vélo, ils parviennent à compléter chaque segment à temps pour attraper leur vol commercial et rejoindre l’île suivante.
Jour 2 : île d’Oahu
Arrivant à Honolulu, ils font face à d'autres obstacles, dont la perte d'une pièce cruciale de leur vélo. Après avoir trouvé une solution, ils commencent un autre triathlon mais décident finalement de prendre un jour de repos.
Jour 3 : île de Molokai
Ils se rendent à Molokai, commencent un triathlon, et sont rejoints par des locaux pendant la course. Ils ressentent une profonde connexion avec l'île. La presse locale relaie leur exploit, et la population se masse au bord des routes pour les encourager.
Jour 4 : île de Maui
À Maui, ils sont confrontés à des défis physiques et mentaux. Mais, ils trouvent la motivation pour continuer grâce à la pensée d'inspirer d'autres personnes. Malgré les défis, ils terminent leur marathon à l'aube.
Jour 5 : Big Island
Après une pause à Big Island, l'auteur est revigoré pour le dernier triathlon. Il est accompagné par des dauphins pendant la nage et rejoint par un champion pendant la partie vélo. L'équipe termine le défi avec succès, célébrant leurs réalisations.
Le défi EPIC5 illustre la force, la détermination, et l'esprit d'équipe de Jason et Rich face à des obstacles constants, tout en mettant en avant la beauté et l'essence d'Hawaï. Les difficultés rencontrées par nos héros semblaient infranchissables. Mais ils n’ont jamais perdu de vue l’objectif et ont continué à avancer.
Conclusion sur "L'Ultra marathon m'a sauvé: Devenir l un des hommes les plus forts du monde et se découvrir pleinement" :
La vie est un long chemin parsemé de multiples sentiers. L'auteur raconte comment il s'est retrouvé pendant de nombreuses années sur une voie familière avant de réaliser qu'il désirait un changement. En écoutant son cœur et en ayant la détermination de suivre sa direction, il a vu sa vie se transformer de manière spectaculaire. Malgré les obstacles et les douleurs, il a appris que chaque défi offrait une chance de croissance.
Sa philosophie est simple : faites ce que vous aimez, chérissez ceux que vous aimez, servez les autres et soyez assuré que vous êtes sur la bonne voie. Pour tous, il y a un nouveau chemin à découvrir. Il suffit de chercher et de faire le premier pas. En étant présent et engagé, ce pas peut devenir un bond monumental, révélant notre véritable essence.
Mon avis sur ce livre
J’ai lu ce livre à la suite de la lecture du livre “Plus rien ne pourra me blesser” de David Goggins. Les sujets de ces 2 livres se rejoignent fortement. Il s’agit de deux êtres humains qui franchissent des difficultés semblant au début infranchissables et qui y parviennent. "L’ultra marathon m’a sauvé" apporte en plus une analyse de l’entraînement d’endurance ainsi que de la nutrition. Rich Roll montre au lecteur que non seulement le régime végétalien permet de rester en bonne santé, mais il peut être un réel atout pour les sportifs et non sportifs.
"L’ultra marathon m’a sauvé" est un livre qui met un mood de guerrier. Un livre qu’on lit ou écoute pour se motiver lorsqu’on doit sortir tôt dans le froid pour aller au travail, qu’on doit travailler tard le soir et que l’on n’a pas envie. Ce livre montre que dans la vie, il faut se fixer des objectifs ambitieux, sortir de sa zone de confort, et ne pas se contenter du statu quo.
Nul besoin d’être sportif pour lire ce livre. Chacun peut se fixer des défis à son échelle. Lorsque j’ai fini de lire ce livre, j’ai moi-même décidé de me fixer un défi ambitieux à mon échelle.
À la fin du livre "L'ultra marathon m'a sauvé", une question m’est venue en tête. Pourquoi l’auteur fait tout cela ? Pourquoi ne pas perdre simplement du poids, faire un peu de sport et arrêter de fumer ? À mon sens, l’auteur semble avoir remplacé ses addictions nocives par une addiction à l’adrénaline et au sport. Mais ce n’est que mon humble avis… Qu'en pensez-vous ?
Points forts :
Ce livre "L'ultra marathon m'a sauvé" montre que :
Avec de la volonté, tout peut être accompli
Chacun à notre échelle nous devons nous fixer des objectifs ambitieux qui rythme notre vie et nous emmène dans le bon sens
Ce sont les petites habitudes du quotidien qui amènent de grands résultats probants. Cela rejoint le livre Le Pouvoir des Habitudes de Charles Duhigg.
Points faibles :
Certains passages pourraient être réduits.
La diète proposée par l’auteur me semble drastique et est inapplicable pour beaucoup. Pas d’alcool, pas de viande, pas d'œuf, pas de gâteau …
Est-ce que l’auteur n’a pas remplacé ses vieilles addictions par une addiction à l’adrénaline des défis extrêmes ?
Ma note : 4
Avez-vous lu le livre "L'ultra marathon m'a sauvé" de Rich Roll ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Rich Roll "L'ultra marathon m'a sauvé"
Visitez Amazon afin d'acheter le livre de Rich Roll "L'ultra marathon m'a sauvé"
Cet article L’Ultra marathon m’a sauvé est apparu en premier sur Des livres pour changer de vie.
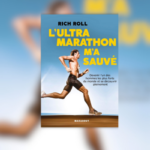 ]]>
]]>Résumé de « Devenir biographe » de Michèle Cléach et Delphine Tranier-Brard : un manuel qui vous dit tout sur le métier de biographe privé ou familial, une activité qui allie écriture et relation pour celles et ceux qui veulent prendre une nouvelle voie dans leur existence.
Par Michèle Cléach et Delphine Tranier-Brard, 2020, 238 pages.
Chronique et résumé de "Devenir biographe" de Michèle Cléach et Delphine Tranier-Brard
Avant-propos
Delphine Tranier-Bard et Michèle Cléach se sont rencontrées par l’écriture, après bien des péripéties — et quelques égarements — professionnels. C’est par la création de formations qu’elles se sont trouvées et qu’elles ne se sont plus quittées.
« Notre désir de monter cette formation a rencontré celui des responsables d’Aleph-Écriture, un centre de formation pionnier des ateliers d’écriture en France dans les années 1980 et aujourd’hui une référence dans le domaine de l’accompagnement à l’écriture […] Nous avons ainsi pu monter ce dispositif de formation après avoir identifié un référentiel de compétences prenant en compte la double entrée du métier de biographe : l’écriture et la relation.” (Devenir biographe, p. 8)
Pour aller plus loin et découvrir leurs formations en ligne, vous pouvez consulter les sites suivants :
Le dire et l’écrire ;
Aleph-Écriture.
Introduction
Aujourd’hui, l’intérêt pour la biographie est bel et bien présent dans l’espace public et s’est même fait une « place de marché » auprès d’un certain public, notamment plus âgé.
À bien y regarder, le récit de type biographique inonde déjà nos pratiques :
Lorsque des fonctionnaires ou travailleurs sociaux font le récit de notre vie afin de juger de tel ou tel aspect de notre existence (droit à des allocations, etc.) ;
Lorsque nous faisons notre CV ;
Quand nous utilisons le storytelling en marketing.
Toutefois, les auteures préfèrent s’en tenir à « la question du récit de vie » qui ne se réduit pas à l’une de ces facettes. Il s’agit au contraire de laisser la personne prendre la parole complètement, sans l’enfermer dans des relations de pouvoir (chercher à vendre, à obtenir un statut, un travail, etc.).
De plus en plus de personnes ressentent le besoin de prendre la plume ou de demander à quelqu’un de le faire pour elles. C’est à ces prête-plume que l’ouvrage s’adresse.
Ce métier est encore peu reconnu. Par ailleurs, il importe de considérer plus largement les compétences qu’il nécessite :
En écriture et édition, bien sûr ;
Mais aussi des compétences commerciales et de gestion (pour le côté indépendant) ;
Et enfin tout l’aspect « relation » que les auteures veulent particulièrement mettre en avant.
Première partie : S’orienter dans le champ biographique
Chapitre 1 : Comment se situe la biographie dans le champ biographique ?
Il y a une foule de textes qui peuvent entrer dans le « genre biographique » :
Autobiographie ;
Autofiction ;
Journal intime ;
Mémoires ;
Histoire de vie ;
Récit de vie ;
Témoignage ;
Autoportrait ;
Roman autobiographique ;
Biographie.
Selon le spécialiste de l’autobiographie Philippe Lejeune, l’autobiographie a 4 caractéristiques ;
La forme (récit en prose) ;
Le sujet traité (vie individuelle, histoire d’une personnalité) ;
Situation de l’auteur (identité du narrateur et de l’auteur) ;
Position du narrateur (identité du narrateur et du personnage principal).
Il insiste également sur l’importance d’un « contrat » passé avec le lecteur. Même si cela concerne l’autobiographie, nous pouvons garder ces premières idées en tête avant de continuer notre exploration de ce genre.
Du côté des sciences humaines et sociales
→ Le récit de vie
Les sciences humaines et sociales (SHS) utilisent les « récits de vie » dans leurs études qualitatives. C’est en particulier la sociologie de l’École de Chicago qui a introduit cette pratique. En France, Daniel Bertaux a beaucoup travaillé sur ce qu’il a nommé la « recherche biographique ».
→ L’histoire de vie
Dans son acceptation précise, l’histoire de vie va un cran « plus loin » que le récit de vie, puisqu’elle propose de compléter la narration par la réflexion et un travail d’organisation plus poussé. Ce type d’exercice est en grande partie réalisé dans les formations d’adultes.
→ L’histoire de vie collective
Nous sommes ici à la frontière entre la démarche scientifique et la démarche littéraire. L’objectif est de publier un ouvrage qui recueille des informations (familiale par exemple), mais qui fasse aussi un travail sur la langue.
Du côté de la littérature
→ Le récit de vie
Ce terme s’emploie aussi dans la littérature, où il a un autre sens, qui est difficile à circonscrire. Vous trouverez sous ce vocable les différentes thématiques :
Du récit de voyage ;
Au récit d’enfance ;
Ou encore au récit de maladie, par exemple.
→ Le journal
Le journal peut être intime, mais aussi voué à être publié (comme ce que propose le prix Nobel de littérature française 2023, Annie Ernaux). Certains journaux intimes de grands écrivains ou artistes, malgré leur caractère « secret », sont publiés après la mort de ceux-ci.
→ Les mémoires
Les mémoires portent la trace de l’événement historique : ce sont des hommes d’État ou de quelque importance qui montrent par là comment ils ont participé aux changements du monde.
→ Le portrait
C’est souvent une partie d’un roman, lorsque l’auteur a besoin de caractériser un personnage. Mais c’est aussi un type d’article journalistique que vous pouvez retrouver dans les quotidiens et autres périodiques.
→ L’autoportrait
Il est soit très bref, soit plus long. Lorsque c’est le cas, l’auteur s’attarde en détail sur :
Qui il est ;
Et comment il est.
Toutefois, il reste muet (ou presque) sur ce qu’il fait ou a fait dans le passé.
→ La vie brève
Ce sont de courts récits de personnes rencontrées furtivement ou bien connues. Les exemples contemporains classiques, en France, sont Vies minuscules (de Pierre Michon) et Vidas (de Christian Garcin).
→ Le roman autobiographique
Ici, nous sommes dans le genre « long ». Une personnalité raconte toute sa vie ou seulement une partie. Les grands classiques français contemporains sont notamment :
Barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras ;
Le premier homme d’Albert Camus ;
La promesse de l’aube de Romain Gary.
→ L’autofiction
Ici, l’auteur prend plus de libertés encore avec le « matériau » de sa propre vie. Il peut le modifier ou le raconter de façon non linéaire pour faire apparaître des éléments intéressants. Le créateur de ce néologisme est Serge Doubrovsky.
→ La biographie
Ici, l’auteur trouve un personnage plus ou moins célèbre et fait une sorte d’enquête, en se posant des questions du type : « Qui était vraiment Camille Claudel ? » Ou « Comment les Rolling Stones sont-ils devenus une légende ? ». Certaines sont plus romancées, d’autres plus informatives.
→ La biographie familiale
« Quand une personne fait le récit de sa vie à un biographe, récit destiné à sa proche famille qui en est seule destinataire, le biographe va traduire le récit oral en récit écrit. On dira alors qu’il a écrit une biographie familiale. » (Devenir biographe, p. 27)
C’est ce genre d’écrit qui fera l’objet plus particulier de ce manuel. En quelque sorte, il s’agit de faire une autobiographie par personne interposée, et c’est pour cela que les 4 caractéristiques de l’autobiographie données plus haut étaient intéressantes.
Le biographe « prête-plume » pourra écrire, selon la volonté de son « client », soit une biographie exhaustive, racontant l’entièreté de sa vie, soit une biographie partielle, se focalisant sur une ou plusieurs parties seulement de l’existence de celui ou celle pour qui il écrit.
Chapitre 2 : D’où vient le désir de devenir biographe ?
Le plus souvent, ce désir naît après 40 ans. D’où ? De l’histoire personnelle de chaque individu :
Un travail de deuil ;
Un parent âgé ;
La volonté de maintenir ou renforcer les liens entre générations ;
L’envie de se reconnecter à son histoire familiale ;
Le souhait d’un travail plus « enraciné » (après un burn-out, par exemple) ;
Le souvenir de pratiques d’écritures oubliées, enfouies depuis l’enfance…
Parmi les métiers qui y amènent, le journalisme et les métiers de l’édition arrivent en tête, mais pas seulement : des professionnels de l’accompagnement ou même des ingénieurs peuvent se reconvertir en biographe !
Et puis il y a les personnes qui ne travaillent plus et qui souhaitent passer leur temps à une activité profitable, agréable et utile pour eux et pour celles et ceux qui les entourent.
Le goût de la transmission joue aussi pour beaucoup. Et aussi avoir envie de poser la question du sens, le sens de son existence — la sienne, ainsi que celle des autres.
→ Et le désir de devenir biographe hospitalier ?
C’est Valeria Milewski qui en a fait un métier « à la mode » parmi les biographes. Mais il est important de prendre conscience que c’est une activité difficile, car elle nous confronte à des situations qui peuvent être traumatisantes.
L’association Passeurs de mots vous en apprendra plus, si ce type d’activité vous intéresse.
Au final, nous rencontrons 5 motivations principales pour devenir biographe :
Écrire ;
Accompagner ;
Transmettre ;
Acquérir une légitimité professionnelle ;
Rencontrer l’autre.
Chapitre 3 : Qui fait appel à un biographe ?
Les personnes qui souhaiteront faire appel à vous (si vous devenez biographe à votre tour !) le feront pour :
Transmettre (leur histoire et surtout leurs histoires plus ou moins rocambolesques) ;
Témoigner (d’une expérience étonnante, particulière, touchante, spirituelle, etc.) ;
Rétablir une vérité (sentir le besoin de donner sa propre version des faits) ;
Publier (le désir d’être reconnu pour le fait d’avoir vécu des choses passionnantes) ;
Aller mieux (volonté de faire le point sur son existence afin de se soigner) ;
Vivre encore (pour des personnes qui ont du mal à se sortir d’un handicap, par exemple).
Demandez-vous, en tant que biographe, quelles sont les motivations de vos « prospects » qui vous « conviennent » le mieux. Avec qui préféreriez-vous travailler ?
→ La question de la transmission
Cette question impose de poser celle du destinataire : à qui est destinée la biographie ? En fonction des motivations, vous pouvez le deviner, au moins à moitié. Mais n’oubliez pas de vous poser les questions suivantes :
Quelle pourrait être la demande implicite de votre client ?
Que cherche-t-il, au fond ?
À quelle place risquez-vous de vous retrouver ?
À noter : si une personne n’a pas de destinataire précis, elle peut déposer son récit à l’APA, l’Association pour l’autobiographie et le patrimoine autobiographique.
Chapitre 4 : Quel biographe voulez-vous être ?
Il y a beaucoup de possibilités… De la version coach de vie à l’ethnologue, en passant par le biographe aux talents (ou velléités) littéraires, le biographe hospitalier, etc. Vous avez le choix ! Mais à chaque fois, vous devrez vous poser les questions suivantes.
→ Cadre de travail
Vous devrez définir un cadre de travail :
Combien de temps ?
Quelle rémunération ?
Quels objectifs ?
Quelles règles de validation et de relecture ?
Quelles limites à l’écriture ou à la divulgation des secrets ?
Etc.
→ Posture
C’est la façon concrète dont vous allez maintenir le contact :
Les gestes ;
Les mots employés ;
Mouvements ;
Etc.
Si le cadre est bien construit, la posture s’adapte facilement. Mais si l’un et l’autre sont flottants, alors il est probable que le récit le sera aussi.
→ Éthique
C’est un point important, qui rapproche la pratique du biographe des professions de l’accompagnement. Vous vous trouvez dans une relation et vous devez donc être capable de répondre à des situations parfois tendues, où différentes possibilités s’offrent à vous.
Par exemple, vous pouvez être amené à écrire des choses désagréables pour certaines personnes de la famille qui recevra l’ouvrage : qu’allez-vous faire ? Allez-vous privilégier la vérité ou la concorde ?
Ce n’est qu’un des exemples traités dans l’ouvrage, qui vous propose de tenir un carnet de bord et de vous prêter à plusieurs simulations de situations problématiques. Comment réagirez-vous ?
Finalement :
« Même si la souplesse, la capacité d’adaptation et d’improvisation (au bon sens du terme) sont des aptitudes nécessaires au biographe, il est indispensable que chacun sache où il met les pieds, que le biographe comme le client (et/ou sa famille) sachent ce qu’ils font ensemble, quel est le cadre de travail commun et que votre posture soit en cohérence avec vos compétences et avec l’offre que vous proposez. » (Devenir biographe, p. 59)
Deuxième partie : Entrer en relation et recueillir le récit
Chapitre 5 : Comment entrer en relation ?
Il est essentiel de bien préparer cette étape. Le premier rendez-vous sera en effet déterminant pour la suite. Soyez à l’écoute de l’autre et de vous-même. Posez-vous les bonnes questions.
→ Quand le client est lui-même le biographé
Le premier entretien permettra de cerner les spécificités de la demande, de voir si vous pouvez y répondre et, éventuellement, d’aborder la question du cadre de mise en œuvre de la biographie.
→ Quand entre le client et vous il y a un commanditaire
Cet intermédiaire se maintient la plupart du temps dans un rôle restreint lié aux modalités pratiques du travail et à la rétribution. Parfois, les demandes des uns (le ou les commanditaires) et des autres (le ou les biographés) ne sont pas identiques ; le premier rendez-vous vous permettra d’y voir plus clair.
→ Et si un ami vous demande d’écrire l’histoire de sa mère ?
Si vous connaissez les personnes (commanditaire et peut-être même la personne biographée), il ne faudrait pas pour autant penser que les choses seront plus aisées. Agissez plutôt comme dans toute autre circonstance, pour éviter toute mécompréhension.
→ Et si huit frères et sœurs vous demandent d’écrire l’histoire de leur père ?
La définition du cadre de travail sera ici encore essentiel, pour éviter toute mésentente entre les parties prenantes. Vous devrez aussi vous organiser efficacement pour recueillir l’ensemble des témoignages et les transformer en récit.
Chapitre 6 : Comment conduire les entretiens ?
Il existe plusieurs types d’entretiens en SHS, en littérature et en journalisme. Les auteures passent en revue quelques différences et citent l’exemple d’un « mauvais entretien » réalisé par André Sève avec le chanteur et poète George Brassens. Voici ce que ce dernier lui reproche :
« Tu arrives ici avec un Brassens entièrement préfabriqué dans ta petite tête et tu veux me faire entrer là-dedans. La seule chose qui t’intéresse, c’est de me faire dire ce que, d’après toi, Brassens doit dire, ce que Brassens doit être. Tu pourrais avoir le vrai Brassens, et en tout cas un Brassens inattendu. Mais tu t’es préparé au Brassens que tu veux. On attend toujours les êtres comme on les veut, on n’est pas prêt à la surprise. » (Devenir biographe, p. 67)
L’ouverture à la surprise, c’est-à-dire aussi la capacité d’écoute active, en laissant l’interviewé suivre son propre chemin de parole, être intéressé par tout ce qui est dit (et non seulement par ses propres préjugés), voilà des clés d’un entretien réussi.
Alors, concrètement, comment allez-vous procéder ?
→ Quand le biographé est un « taiseux »
Suggérez-lui par exemple de vous montrez des photographies ou d’autres types de documents, puis de vous les raconter, etc.
→ Quand vous écrivez la biographie d’un couple
Vous êtes face à deux voix complémentaires, mais parfois discordantes. Si l’un parle plus que l’autre, cherchez à rééquilibrer l’échange. Pensez à effectuer des entretiens individuels en plus des entretiens de couple, etc.
→ Quand le biographé est gravement malade
Ici, vous devrez sans doute négocier avec le sentiment d’urgence de la personne. Préparez-vous aux aléas et au fait que vous devrez sans doute vous adapter à des circonstances de travail particulières (hospitalisations, etc.).
→ Quand le biographé est en perte cognitive
Ici, s’ajoute l’oubli, la difficulté à décoder les propos parfois. Vous devrez vous préparer à récolter des bribes de récits, des fragments d’idées, et à construire le récit « pas à pas ».
→ Et si vous envisagez de faire la biographie d’un proche ?
À nouveau, ce n’est pas parce que vous connaissez quelqu’un que le trajet sera plus facile. Si vous n’êtes pas très bien préparé, cela peut même être le contraire. En fait, la proximité peut vous jouer des tours et créer des conflits. Soyez-en donc conscient afin d’améliorer vos chances de succès.
→ Et si vous envisagez de faire la biographie d’un proche décédé ?
Ici, vous devrez vous contenter d’archives, de photographies, d’entretiens avec les proches, etc. Les auteures proposent de consulter l’ouvrage de Delphine de Vigan, Rien ne s’oppose à la nuit.
Chapitre 7 : Quels effets de l’entretien biographique sur le biographé et sur le biographe ?
Il arrive souvent que les personnes biographiées sentent un réel bienfait pendant ou après le processus de construction du récit biographique. Elles le disent très régulièrement. Par ailleurs, la littérature sur le sujet évoque souvent ce phénomène.
Pourtant, il faut être au clair sur ce point : ce travail n’est pas un travail thérapeutique à proprement parler.
Il importe aussi de rappeler que le travail biographique peut par contraste créer des tensions (souvenirs difficiles) et générer chez les personnes quelques problèmes, souvent passagers, comme la fatigue, la tristesse, des insomnies, etc.
Il se peut aussi que la réaction des proches soit différente que celle souhaitée par le biographé. Ou que des frustrations émergent chez les uns ou les autres. Parfois, la personne qui s’est livrée ne se sent pas entendue par son entourage, et cela entraîne des effets négatifs.
→ Et que disent les biographes des effets produits sur eux par le recueil du récit de leurs clients ?
En tant que biographe, vous ne resterez sûrement pas de marbre face aux récits collectés. Voici quelques effets possibles ;
Avoir du plaisir à écrire ;
Nouer de relations fortes ;
Ressentir de l’empathie ;
Se reconnaître dans les propos d’autrui (effet miroir) ;
Des regrets, de la nostalgie.
Même si les biographes préfèrent en général laisser la parole à autrui, il est possible et bénéfique d’échanger sur ces sujets, notamment dans le cadre d’associations, telles que l’Association pour les Histoires de Vie en Formation et pour la Recherche Biographique en Éducation.
Chapitre 8 : Quels outils de recueil du récit oral ?
Vous avez les choix entre plusieurs options.
→ Prendre des notes…
C’est la méthode que recommandent les auteures. À condition, toutefois, de ne pas chercher à tout écrire. Pour rappel, le débit de parole fluctue entre 200 et 300 mots par minute, alors qu’une main n’est capable d’en récupérer que 70 en moyenne.
Il y a donc beaucoup de perte. Mais ce n’est pas nécessairement un mal, car cela fait partie du travail de tri et d’assimilation.
→ … Enregistrer ?
L’utilisation d’un magnétophone peut être une bonne solution. Mais il y a des dangers, tels que le temps passé à retranscrire, puis à organiser le matériau écrit.
→ … Vous en remettre à un logiciel qui transforme automatiquement la parole énoncée en texte saisi ?
Cette solution encore plus avancée est rendue possible par l’amélioration des outils de reconnaissance vocale comme Dragon ou Siri. Mais ce n’est pas parfait et vous aurez, comme tout outil, à le prendre en main et à l’utiliser de façon adéquate.
→ … Écrire directement le texte pendant l’entretien, donc
Il peut être une bonne idée de créer un premier jet directement, ou au moins quelques phrases intéressantes qui nous passent par la tête, durant l’entretien ou quelques instants après. Cela vous permet de capter des moments d’inspiration qui, sinon, seraient perdus.
→ … Et garder l’enregistrement en back up ?
Cet usage est intéressant : vous utilisez les enregistrements en cas de doute ou pour rechercher un détail que vous n’avez pas eu le temps de noter. Par ailleurs, l’enregistrement peut servir à installer le cadre de l’entretien, lorsque vous posez visiblement le magnétophone sur la table.
→ Écrire à l’ordinateur… Ou à la main ?
Il n’y a pas de technique miracle : chaque biographe choisira sa propre méthode, celle qui lui semble la plus efficace ou bénéfique.
→ Témoigner de son écoute avec les doigts et les yeux
Le plus important est de montrer que vous êtes à l’écoute. Vous devrez donc équilibrer le temps de prise de notes avec les gestes et les paroles qui montrent à votre interlocuteur que vous êtes intéressé par ce qu’il raconte.
Chapitre 9 : Quel impact du mode de facturation sur la méthode de travail ?
Les clients ont des attentes et chercheront sans doute à obtenir le maximum pour le prix demandé. Il faut donc savoir, ici aussi, trouver le bon équilibre entre :
Votre public (ses attentes, ses revenus) ;
Le tarif que vous espérez demander ;
Votre méthode de travail.
Chapitre 10 : Quelle place pour la mémoire et la vérité ?
Les auteures utilisent ici les travaux de Boris Cyrulnik pour préciser leur pensée. Selon le psychologue :
« La vérité narrative n’est pas la vérité historique, elle est le remaniement qui rend l’existence supportable […] Dans toute autobiographie, il y a un remaniement imaginaire. » (Boris Cyrulnik, Sauve-toi la vie t’appelle, cité dans Devenir biographe, p. 91)
Autrement dit, il y a une part de fiction dans tout récit de soi. D’abord, parce que celui qui raconte sa vie reformule, transforme les événements de son existence passée, mais aussi parce que le biographe crée un récit à partir de matériaux incomplets, qu’il doit interpréter.
Cette problématique devient encore plus aigüe lorsque vous rédigez une biographie de couple ou de famille. Là, les questions de la vérité et de la mémoire peuvent devenir périlleuses ou, à tout le moins, complexes.
Intermède : Le rapport à la langue — la langue orale, la langue écrire — la langue de l’autre
Il n’est pas seulement intéressant de retranscrire le contenu, le dit. Il est aussi important de donner à lire le style, la gestuelle, la langue parlée et vivante de celles et ceux dont vous faites la biographie.
Cela est possible grâce au travail :
Du style ;
De l’organisation du texte ;
Du dispositif narratif (présence de descriptions, par exemple).
Questionnez-vous aussi sur votre propre rapport à la langue (orale et écrite) et à vos attentes en matière de littérature.
Troisième partie : Écrire la biographie
Chapitre 11 : Quel matériau de base et quel genre pour le texte ?
« Écrire une biographie revient à transformer le matériau du récit oral (ou de la retranscription) en un texte clair, compréhensible, lisible par son destinataire. » (Devenir biographe, p. 103)
Le matériau de départ, c’est donc la parole du biographé. À partir de là, c’est à vous de composer. Premier élément à choisir, le genre :
Récit chronologique ;
Portrait ;
Récit de voyage ;
Recueil de fragments ;
Témoignages ;
Entretiens ;
Nouvelles ;
Etc.
« Théoriquement, on peut tout faire en littérature », rappellent Michèle Cléach et Delphine Tranier-Brard. Veillez toutefois à ce que ce genre demeure pertinent et compréhensible pour celles et ceux qui le liront.
Chapitre 12 : Sur quels outils techniques s’appuyer pour mettre en place le récit biographique ?
Dans ce chapitre technique, les auteurs s’interrogent sur les questions suivantes : Comment mettre en forme le texte, les paragraphes, les phrases ? Dans quel ordre écrire les choses pour être sûr de se faire comprendre ?
Elles proposent de se souvenir des questions suivantes, qui-quand-quoi-où-comment (qu’elles relient par des traits d’union) ou, en étant plus précis : qui-raconte-quoi-à qui-comment-depuis où ?
→ Quoi
Vous devrez choisir :
Le personnage (le biographé, les membres de la famille, etc.) ;
Le cadrage du récit (raconterez-vous l’entièreté de la vie, une époque particulière ?) ;
→ Qui
Ici, vous devrez vous rappeler certains éléments théoriques du récit, tels que les notions de :
Narrateur ;
Point de vue (externe, omniscient, interne) ;
L’usage du pronom (il, elle, je, etc.).
→ Comment
Préférerez-vous une construction ;
Tragique ?
Ou épique ?
Vous veillerez à ménager la tension narrative pour maintenir le lecteur en alerte. Pour ce faire, vous pourrez utiliser les types de tensions suivants :
La catastrophe annoncée ;
Le mystère ;
Le conflit.
Vous chercherez également à établir un fil conducteur (un angle) et à donner au texte un caractère vivant.
→ À qui
Vous pouvez adresser votre texte plus ou moins explicitement à votre destinataire. Ce choix s’exprime par le pronom employé.
Vous pouvez éventuellement faire des choix audacieux et aborder votre récit par les pronoms « vous » ou « tu », en vous adressant directement à quelqu’un. Mais c’est un exercice délicat.
Il est également possible de rédiger une préface afin de vous adresser directement au destinataire avant qu’il entre dans le récit proprement dit.
→ Depuis où ?
Michèle Cléach et Delphine Tranier-Brard exposent ici les rapports du narrateur à la temporalité du récit. Parle-t-il comme s’il était un enfant ? Ou au contraire, en regardant sa vie depuis son grand âge ?
Il existe deux options principales :
Narration ultérieure (la « chaise » du narrateur est placée en aval de l’histoire) ;
Narration simultanée au présent (le narrateur se déplace en même temps).
Chapitre 13 : Comment écrire un récit vivant ?
Pour donner une forme palpitante à l’histoire de votre client, vous n’inventerez rien, mais vous jouerez avec les événements réels et avec le style. Voici quelques conseils :
S’appuyer sur la microdramaturgie ;
Rythmer le texte ;
Singulariser une expérience particulière parmi les habitudes répétitives ;
Monter d’un cran dans les insistances répétition-variation ;
Couper.
Bref, comme un directeur de cinéma, vous créerez du suspense ou des moments de calme et d’analyse grâce à un astucieux montage des scènes.
Chapitre 14 : Comment passer de l’oral à l’écrit ?
Votre première tâche : filtrer. Cela vaut pour certaines expressions typiques du langage oral (comme les « bon », « bah », « d’accord », etc.) comme pour certains propos « off » que le biographé vous demandera de ne pas répéter.
Ensuite, vous allez construire et transposer le matériau oral. Vous pourriez être tenté d’innover à la matière de Proust ou de Céline.
Mais attention : votre travail consiste avant tout à rendre le texte simple et accessible pour votre client et son entourage, qui seront les premiers (et peut-être les seuls) lecteurs du texte.
Comme nous l’avons déjà signalé plus haut, vous chercherez aussi à récupérer et à restituer la voix du biographé, c’est-à-dire son timbre notamment, mais pas seulement !
Dans la voix, il y a ici surtout l’idée de faire passer ce qui importe à l’autre. Il faut que le lecteur reconnaisse qui parle et que « ça sonne juste ».
Le vocabulaire sera simple, mais précis. À l’oral, nous utilisons moins de mots, mais nous pouvons introduire une plus grande diversité à l’écrit.
Chapitre 15 : Et si l’on arrangeait un peu cette histoire ?
Il existe plusieurs possibilités pour donner plus de corps à votre texte. En plus des entretiens (reformulés, adaptés), vous pourriez être tenté d’introduire :
De la documentation historique ;
Des photographies ;
Des détails imaginés (ou poétiques) ;
Ou carrément des faits inventés ?
Si c’est le biographé qui vous demande l’un ou l’autre, pourquoi pas. Mais plus vous allez vers l’invention et plus le terrain sera glissant. Les deux premières options sont-elles plus sages ? Peut-être, mais vous devrez faire avec vos compétences et avec votre temps.
Êtes-vous historien ? Ou spécialiste en montage photo ? Si ce n’est pas le cas, réussir un ouvrage de ce type vous prendra plus de temps. Sachez donc dès le départ dans quoi vous vous embarquez !
Chapitre 16 : Comment ne pas passer un temps fou à écrire une biographie privée ?
Le temps — justement, venons-y. Vous l’aurez deviné, écrire une biographie est une activité chronophage. Surtout lorsque vous commencez. Pour gagner en efficacité, veillez d’abord à faire des choix favorables, c’est-à-dire à vous simplifier la vie au niveau de la structure du récit.
Ensuite, une fois les choix techniques effectués, vous veillerez à :
Équilibrer le texte (chapitre/paragraphe/phrase) de façon « économique » et claire ;
Avancer dans le texte, c’est-à-dire dans l’histoire ;
Ouvrir et fermer les portes (si vous parlez de quelque chose, cela doit avoir un sens, un but) ;
Faire entrer et sortir les personnages (situer les personnages secondaires et faire connaître au lecteur ce qu’il advient d’eux) ;
Toujours faire simple et lisible ;
Faire la chasse au superflu.
Chapitre 17 : Comment s’y retrouver dans le texte : sommaire, chapitres, titres et arbre généalogique ?
Il est parfois utile d’introduire des sommaires, des titres et des intertitres dans vos biographies, surtout si celles-ci s’allongent. Elles vous permettront d’y voir plus clair lorsque vous rédigerez.
Vous n’êtes pas obligé de les conserver lors de la version finale du texte, mais vous le pouvez, afin de faciliter la navigation des lecteurs dans le texte. Dans ce cas, vous les travaillerez pour leur donner une forme plus littéraire et cohérente.
Comment faire état d’une famille nombreuse et citer tous les noms qui s’y rapportent ? C’est souvent un travail d’équilibriste. Mais il y a des solutions.
Par exemple, les auteures proposent de distiller les anecdotes et les références aux aïeux tout au long du texte, plutôt que de les présenter de façon froide au début du texte.
Chapitre 18 : Comment finir l’écriture du texte ?
Il peut y avoir mille raisons de ne pas (vouloir) finir :
Perfectionnisme ;
Empêchements ;
Demandes de correction ;
Peur du jugement ;
Etc.
→ S’en remettre à la satisfaction du biographé
Il est toutefois sain de mettre un terme à son récit. Surtout qu’il s’agit ici d’écriture professionnelle, avec un commanditaire qui attend un résultat concret. Vous vous appuierez donc sur la satisfaction du biographé pour mettre un terme à votre travail.
Il y a peut-être des éléments de cadrage (objectifs définis en début de collaboration, nombre d’allers-retours, etc.) qui peuvent vous aider à décider.
→ Boucler la boucle
Il y a aussi un autre enjeu : la fin doit se rédiger avec une intention particulière et doit donner le sentiment au lecteur qu’il est parvenu au terme du travail. Cela se fabrique à l’aide de la structure du texte, de son rythme, ainsi que du fil conducteur.
Les auteures évoquent en particulier deux situations :
Lorsque le biographié est en vie ;
Quand il décède pendant le travail d’écriture.
→ Soigner le rendu final
Vous serez tout particulièrement attentif à :
La structure — simplicité — lisibilité ;
L’emploi cohérent des temps (y compris des participes passés) ;
La typographie (y compris la ponctuation, les majuscules, les chiffres, etc.).
Quatrième partie : Clore la traversée biographique
Chapitre 19 : Quelles suites pour le récit ?
Après la rédaction proprement dite, il reste encore 4 étapes supplémentaires :
Composition ;
Correction ;
Impression ;
Publication.
Vous pouvez vous arrêter à la rédaction, ou bien considérer que vous voulez tout faire. Mais dans ce cas, sachez que vous devrez vous former afin d’acquérir les compétences nécessaires (si vous ne les avez pas déjà).
→ Composition
C’est l’étape de mise en page du texte pour qu’il réponde aux standards du livre. C’est en général un travail laissé aux graphistes.
Si vous ne souhaitez pas vous investir dans cette étape, vous remettrez le texte en Word à votre imprimeur (qui, souvent, propose ce service) avec les photos si besoin.
→ Correction
L’avantage du correcteur, c’est de fournir un œil neuf, là où vous ne voyez littéralement plus vos fautes.
Un correcteur automatique ne peut suffire à repérer les erreurs de grammaire ou de syntaxe complexes, même s’il peut s’avérer très utile pour la typographie et l’orthographe.
→ Impression
Pour les petits tirages, vous opterez probablement pour l’impression numérique, moins chère que l’impression offset. Bien sûr, tous les éléments introduits en plus (photos, etc.) impactent le coût du livre.
Cherchez dans votre région les petits imprimeurs et demandez-leur leurs prix. Préférez des acteurs de proximité sur qui vous pourrez compter en cas de besoin urgent.
Vous aurez à choisir :
Format du livre ;
Couleur ou noir et blanc ;
Couverture ;
Type de papier.
→ Édition — Publication
Avec l’évolution du numérique et des plateformes de vente (type Amazon) et des réseaux sociaux, il devient de plus en plus facile de publier.
Mais vous devrez être sur vos gardes. « Édition » n’est pas « publication ». Ce sont des types de contrats différents, comme l’expliquent les auteures p. 185.
Soyez aussi réaliste sur les gains que vous pourrez tirer d’une éventuelle publication par un véritable éditeur. En réalité, il est assez rare que les ventes dépassent 1000 exemplaires (et exceptionnel qu’elles dépassent les 2000).
Si le livre est publié et connaît un public plus large que le cadre familial strict, vous devrez aussi établir des règles pour la répartition équitable des revenus entre le biographé et vous. Habituellement, le partage se fait à égalité (50/50).
Chapitre 20 : Et après la publication ?
« Dans la plupart des cas, les destinataires sont heureux du “cadeau” qui leur est fait. […] Cependant, certains récits peuvent avoir des conséquences désagréables, voire désastreuses. » (Devenir biographe, p. 187)
Étudions donc quelques cas d’effets potentiellement problématiques sur les destinataires :
Tout d'abord, quand un enfant est absent du récit (que faire ? Prévenir le biographé pour qu’il introduise quelques propos supplémentaires ? Cela devrait être fait avant la publication) ;
Quand un parent divorcé n’évoque pas du tout son ex-conjoint et ses années de mariage (ici encore, faut-il avertir la personne ?) ;
Quand un biographé déterre une histoire de famille (s’il en parle avec colère, allez-vous l’alerter sur le caractère explosif de l’affaire ?) ;
Ou encore, quand une mère invoque la maladie psychique de son fils, ses tentatives de suicide, etc. (Comment celui-ci va-t-il réagir ?) ;
Risque juridique (vous devrez être attentif à l’exactitude des faits et au respect de la vie privée, voir p. 189-190 pour plus de détails) ;
Avec les personnes âgées en état de faiblesse (cherchez à entrer en contact avec la famille ou l’instance de tutelle pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur vos ambitions et votre travail).
Chapitre 21 : Est-ce fini quand le livre est édité-publié ?
Le travail du biographe est un travail de la relation. Il est donc possible qu’une fois le travail terminé, le souhait de continuer la relation demeure.
Cela est possible, mais plus sous la même forme : la remise du manuscrit signera la fin de la collaboration professionnelle. Vous pouvez le feuilleter ensemble, par exemple. C’est un rituel de fin efficace, qui permettra de clore sereinement la relation.
Intermède : Écrire pour soi, écrire pour l’autre, où en êtes-vous ?
Il peut être compliqué, au bout de plusieurs biographies rédigées, de continuer à écrire « pour » autrui. Ne voudriez-vous pas écrire pour vous ? Rédiger vos propres aventures ? Ou même écrire des fictions ?
Ce sont des tensions internes qu’il vous faudra peut-être vivre, comme en témoigne l’une des auteures, Delphine Tranier-Brard, qui raconte comment elle a commencé à écrire pour autrui et comment, peu à peu, elle a laissé une place à l’écriture créative en mode « je ».
Cinquième partie : Exercer le métier
Chapitre 22 : Combien coûte, combien rapporte une biographie ?
→ Que coûte une biographie pour le client ?
Il y a de nombreuses différences, qui viennent de nombre de prestations et du mode de facturations. Voyons cela d’un peu plus près.
→ Tarification au forfait
Cela varie énormément : de 400 à 20 000 € ! Cela dépend — entre autres — des services (de la rédaction à la publication).
Gardez aussi à l’esprit que travailler au forfait peut avoir des inconvénients, surtout si aucun devis précis n’est réalisé en amont. Il est souvent difficile d’établir en amont le temps que prendra le processus.
→ Tarification à l’heure d’entretien
C’est une pratique courante des biographes pour les particuliers. Les tarifs sont de 100 à 300 €/heure. Mais il s’agit en réalité d’un mini-forfait comprenant l’heure d’entretien plus les heures d’écriture à partir de celui-ci (entre 3 et 6 heures supplémentaires).
En règle générale, entre 10 à 30 heures d’entretien seront nécessaires. Il faudra y ajouter le prix de la fabrication du livre.
Dans tous les cas, vous devrez sans doute adapter votre offre en fonction du public auquel vous vous adressez.
→ Combien rapporte-t-elle au biographe ?
Une biographie coûte donc environ 3 000€ bruts. Sur cette somme, vous devrez retirer les charges, qui peuvent varier entre 20 et 60 % en fonction du statut.
Si nous le référons en taux horaire, cela signifie que le biographe travaillera pour 30 €/h net en moyenne (entre 16 et 48 € disent les auteures).
À noter que de nombreuses heures ne sont pas payées, notamment les heures de prospection ou de comptabilité, par exemple — ce qui est le cas pour tout travailleur indépendant.
→ Quand on vous apporte une pile de deux cents pages déjà écrites, comment travailler avec ce matériau ? Comment facturer ?
Les auteures sont assez dubitatives concernant cette pratique et conseillent plutôt — d’un point de vue financier, mais qui est aussi lié à la difficulté de la tâche — de suggérer au biographé de reprendre le travail depuis le début, en réalisant de nouveaux entretiens.
Chapitre 23 : Quel modèle économique privilégier ?
Au démarrage surtout, il faut y aller prudemment. Le passage par une structure d’accompagnement peut être une solution rassurante (type Avarap, BGE, etc.).
De toute façon, votre modèle économique dépendra de votre situation. Si vous êtes en reconversion professionnelle à 40 ans, vous n’aurez pas les mêmes besoins que si vous êtes retraité. À vous de définir vos objectifs tout en restant en phase avec le marché.
Voici quelques statuts possibles :
Autoentrepreneur ;
Entrepreneur en SARL ;
Éditeur ;
Indépendant en portage salarial ;
Auteur de biographies payées en droit d’auteur ;
Membre d’une association ;
Bénévole ;
Échangeur de services dans un Système d’échange social (Sel) ;
Etc.
Chapitre 24 : Comment trouver des clients ?
La prospection fait partie du métier. Mieux vaut avoir sa cible en tête avant de commencer. Puis, vous pourrez vous lancer !
Vous pouvez opter pour une approche directe :
Prendre un stand dans un salon ;
Démarcher directement des biographés potentiels ou des prescripteurs, notamment via la réalisation de miniconférences sur votre travail dans des endroits où votre cible se trouve ;
Activer les réseaux sociaux en postant, en proposant des offres promotionnelles et en organisant vos échanges autour de votre activité ;
Faire de la publicité de façon plus classique, en louant des espaces publicitaires.
Les principaux supports de communication pour prospecter sont :
Physiques (cartes, flyers, etc.) ;
Numériques (réseaux sociaux, newsletters, site internet, etc.).
Il est aussi possible de combiner l'approche directe avec une approche indirecte, plus proche de l'inbound marketing.
Mais attention : pour que votre site vitrine soit utile, vous devrez penser à le référencer correctement. C’est notamment le travail des rédacteurs web et des webmasters. Cela a un coût.
Chapitre 25 : Organiser son temps de travail et son activité
Vous pouvez par exemple choisir de :
Rédiger et faire lire vos textes au fur et à mesure de leur rédaction ;
Ou effectuer tous les entretiens et rédiger ensuite ;
Mais aussi écrire une biographie à la fois ;
Ou plusieurs au même moment.
Cela dépend de vos préférences, de vos objectifs professionnels et du temps que vous avez devant vous. Ensuite, vous devrez « caser » les moments administratifs, le temps de prospection, etc.
Chapitre 26 : Quel investissement pour créer l’activité ?
« Le métier de biographe a l’avantage de pouvoir être pratiqué avec un investissement initial minimum. » (Devenir biographe, p. 217)
En l’occurrence, vous aurez besoin impérativement d’un ordinateur (avec un bon traitement de texte) et d’une imprimante performants pour rédiger et relire vos textes.
En outre, vous aurez peut-être besoin d’investir dans des logiciels, tels qu’Antidote, Indesign ou Photoshop. Mais cela dépendra des services que vous souhaitez offrir à vos clients. Attendez un peu (peut-être après avoir rédigé une ou deux biographies) avant d’investir.
Un smartphone ou un magnétophone (pour enregistrer), ainsi qu’une tablette pour convertir vos notes en fichiers texte, pourraient également être utiles.
Mais le plus important est sans aucun doute l’espace de travail. Assurez-vous de pouvoir travailler dans un environnement qui vous convient. Un conseil : apprenez également à taper rapidement !
Vous pouvez vous former gratuitement à la dactylographie (via les tutos gratuits de TypingClub, par exemple). Il n’est par ailleurs pas inutile de penser à d’autres formations, mais — encore une fois — tout cela doit être bien pensé en fonction de vos objectifs de travail.
Chapitre 27 : Faut-il entrer dans un réseau ?
En tant qu’indépendant, il est encore plus important de faire partie d’un réseau ou d’une communauté. Pourquoi ? Car nous sommes plus seuls que dans les métiers salariés.
Les liens peuvent se créer à l’occasion d’une formation ou de la participation à une association. C’est aussi une bonne idée de vous présenter à ses confrères de la région lorsque vous commencez.
Il existe également des réseaux payants, mais renseignez-vous bien avant afin de savoir ce que chacun d’eux propose et quelles promesses ils peuvent tenir.
Chapitre 28 : Peut-on vivre du métier de biographe ? Qui en vit ?
Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, où les ateliers d’écriture créative sont monnaie courante, la France a construit un mythe du génie et du talent autour de la littérature.
Pourtant, écrire est bien une pratique, un artisanat, une activité qui demande un développement constant des compétences par le travail.
Certains biographes peuvent très bien gagner leur vie, surtout s’ils travaillent pour des maisons d’édition et travaillent pour des gens connus.
Soyons honnêtes : ceux qui travaillent pour les inconnus éprouvent souvent plus de difficultés. Rares sont ceux qui parviennent à combiner toutes les facettes du métier de façon optimale et à gagner confortablement leur vie rien qu’avec les biographies. Mais ça existe !
La plupart du temps, les biographes cumulent des activités comme, par exemple, la biographie et la rédaction web.
Voici la liste dressée par les auteures de ce qu’il vous faut si vous voulez vivre confortablement de la biographie :
Organisation ;
Respect des dates limites ;
Rapidité et qualité d’écriture ;
Empathie, écoute, tact ;
Disponibilité mentale et physique ;
Capacités relationnelles ;
Sens du commerce, gestion et marketing ;
Posture claire (éthique) ;
Connaissance des règles juridiques de publication ;
Autonomie.
Chapitre 29 : Garder sa pratique vivante
« On donne beaucoup dans ce métier. On donne de son temps, on écrit dans le “je” de l’autre, pour l’autre, on est au service de l’autre. Il est donc important, pour garder une pratique vivante, investie, humaine, de se nourrir, de se régénérer. » (Devenir biographe, p. 225)
Comment ?
En lisant ;
En rédigeant d’autres types de textes ;
Mais aussi en échangeant avec les autres ;
Et en s’interrogeant sur sa propre pratique.
Conclusion sur « Devenir biographe » de Michèle Léach et Delphine Tranier-Brard :
Ce qu’il faut retenir de « Devenir biographe » de Michèle Léach et Delphine Tranier-Brard :
Vous pouvez retenir avant tout qu’il s’agit d’un livre sincère et complet sur le beau métier de biographe d’inconnus ou “biographe privé”.
Les auteures ne cachent rien des difficultés, mais aussi de grandes joies de ce travail exigeant, qui combine goût pour l’écriture et pour la relation.
À condition d’être très bien organisé, il est tout à fait possible d’exercer cette activité en complément de votre activité d’indépendant ou de salarié.
Pour réussir, vous aurez impérativement besoin non seulement d’aimer l’écriture et la relation, mais aussi être capable de supporter la solitude et les à-côtés liés au marketing et à l’administration.
Si vous souhaitez vous orienter vers l'écriture créative, allez donc jeter un œil à ce livre de Faly Stachak, Écrire.
Points forts :
Un livre bien construit qui aborde toutes les questions importantes ;
Des témoignages qui donnent une idée précise du travail ;
Une section “Carnet de bord” à la fin de chaque chapitre, pour vous permettre de réaliser des exercices et voir si ce métier peut vous convenir.
Point faible :
La mise en page et la typographie ne sont pas toujours optimales (beaucoup d’italique qui gêne un peu la lecture).
Ma note :
★★★★
Avez-vous lu le livre de Michèle Léach et Delphine Tranier-Brard « Devenir biographe » ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Michèle Léach et Delphine Tranier-Brard « Devenir biographe ».
Visitez Amazon afin d’acheter le livre de Michèle Léach et Delphine Tranier-Brard « Devenir biographe »
Cet article Devenir biographe est apparu en premier sur Des livres pour changer de vie.
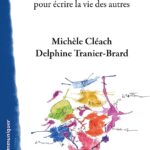 ]]>
]]>Résumé de "Ce dont je suis certaine" d'Oprah Winfrey : un livre d'introspection et de développement personnel par l'une des personnalités les plus aimées des états-uniens, "La" productrice et présentatrice de télévision qui a interviewé les plus grands de ce monde avec bienveillance et empathie.
Par Oprah Winfrey, 2022, 224 pages.
Titre original : "What I know for sure", 2014.
Chronique et résumé de "Ce dont je suis certaine" d'Oprah Winfrey
Qui est Oprah Winfrey (en quelques mots) ?
Oprah Winfrey est née le 29 janvier 1954 à Kosciusko (Mississippi). Elle est animatrice et productrice de télévision, mais pas seulement ! Elle a aussi produit des films et joué dans plusieurs films.
Par ailleurs, elle s'occupe de presse écrite : elle travaille également comme critique littéraire et éditrice de magazines.
Elle a connu la célébrité avec son talk-show The Oprah Winfrey Show, un programme produit par sa propre société : Harpo Productions.
Dans les années 1990, elle décide de focaliser son émission autour de la littérature, du développement personnel, de la spiritualité et de la méditation. C'est un succès.
En 2011, The Oprah Winfrey Show est considéré comme le programme le plus regardé dans l'histoire de la télévision.
Elle gagne de nombreux prix (pour son show, ainsi qu'une nomination aux Oscar pour sa prestation d'actrice) et est classée comme la femme afro-américaine la plus riche du XXe siècle.
En 2006, elle soutient activement la candidature de Barack Obama à la présidence des États-Unis.
Introduction
Un jour, le critique de cinéma Gene Siskel demande à Oprah Winfrey : "Dites-moi, de quoi êtes-vous certaine ?". Cette question la perturbe et elle ne sait quoi répondre sur le moment.
Malgré son expérience des interactions à la télévision, elle n'a pas tellement l'habitude d'être dans le rôle de l'interviewée !
Toutefois, elle y pense. Et elle y pense tellement qu'elle décide d'en faire une interrogation centrale de son existence et d'en faire l'objet d'une chronique dans la revue O.
Chaque semaine, elle écrit sur ce qu'elle estime savoir de source sûre. Puis, après 14 ans, elle décide de reprendre tout ce matériau et d'en faire le livre que vous tenez entre les mains (ou plutôt, pas encore !, car c'est le résumé que vous lisez ici).
Lorsqu'elle a révisé les textes, elle a été satisfaite de constater qu'elle n'a pas dû modifier énormément d'éléments. C'est ce qu'elle exprime par ces mots :
"J'ai le bonheur de vous dire que ce que j'ai découvert en révisant l'équivalent de quatorze années de chroniques, c'est que lorsqu'on sait une chose, qu'on la sait vraiment, elle a tendance à réussir l'épreuve du temps." (Ce dont je suis certaine, Introduction)
Voyons donc, point par point, ce savoir révélé par la célèbre présentatrice télé.
La joie
Oprah Winfrey commence par raconter une anecdote à propos de Tina Turner. Elle aurait voulu suivre la rockeuse dans ses tournées et vivre sa vie. Elle ne l'a pas fait, mais elle a eu la chance de la rencontrer et de chanter avec elle, à une occasion.
Cela lui a procuré beaucoup de joie. Et elle se sent fière d'avoir réussi à laisser tomber sa timidité pour profiter de l'instant présent avec la star.
L'animatrice "prend ses plaisirs au sérieux". Mais elle se sent vite contentée, car elle a besoin de peu :
"Un rien fait mon bonheur, car je tire satisfaction de tant de choses que je fais. J'accorde plus de prix à certaines choses, bien entendu. Et comme je m'efforce de mettre en pratique ce que je prêche — vivre l'instant présent —, je suis consciente la plupart du temps de tout le plaisir que je reçois." (Ce dont je suis certaine, Chapitre 1)
Le fait de connaître et surtout de se créer des expériences quatre et cinq étoiles vous donne le sentiment d'être béni. Voici quelques exemples donnés dans l'ouvrage :
Une bonne tasse de café avec une crème de noisettes parfaite = quatre étoiles.
Se promener dans les bois avec les chiens (sans les lâcher) = cinq étoiles.
Se réveiller "avec toute sa tête" et être capable de mener sa journée = cinq étoiles.
Lire le journal sous un chêne = quatre étoiles.
Lire un excellent livre = cinq étoiles.
À vous d'inventer vos expériences 4 et 5 étoiles !
Votre niveau de plaisir est déterminé par la façon dont vous considérez votre existence. Et c'est un cercle vertueux : "ce que nous donnons nous revient", dit-elle encore.
Oprah Winfrey adore le mot "délicieux" et l'applique aux expériences qui la renforcent ou la marquent. C'est le cas d'un cadeau que lui a fait une amie, le jour de son 59e anniversaire.
Autre exemple : la nourriture. Qui n'aime pas manger ! L'autrice adore ça, et surtout la cuisine authentique de Rome. Bien accompagnée, d'amis et de bon vin, un bon repas est une expérience incroyable, proprement "délicieuse".
Toutefois, son rapport à la bonne chère n'a pas toujours été facile. Oprah Winfrey a pesé plus de cent kilos et a dû changer son mode de vie pour se sentir mieux dans son corps. L'entraînement et le jardinage (ainsi que les légumes frais qui en résultaient) l'ont beaucoup aidée.
D'autres expériences sont racontées :
L'adoption de chiots ;
Le simple fait d'allumer un feu ;
Son amitié avec Gayle King ;
Ses exercices spirituels.
Elle insiste finalement sur le point central : vivre l'instant présent. Voilà ce qui permet de ressentir la joie au quotidien et d'amplifier ses expériences à tous les niveaux.
La résilience
Oprah Winfrey est née en 1953 dans le Mississippi, de parents non mariés. Sa mère n'a rien dit de sa grossesse à son entourage jusqu'au jour de l'accouchement. "Ma naissance a été marquée par le regret, la dissimulation et la honte", dit-elle.
Elle a vécu son enfance avec ses grands-parents, en se sentant énormément seule. Non pas qu'elle n'ait eu personne autour d'elle, mais elle sentait qu'elle devait se construire seule.
Guérir ce type de blessure fait partie des défis de la vie les plus importants. Il est nécessaire de comprendre ce qui s'est produit en vous, comment d'autres vous ont "programmé", afin d'apprendre à modifier cette "programmation" (via la programmation neurolinguistique, notamment).
Les problèmes que nous rencontrons sur notre chemin sont des occasions pour apprendre et nous construire une vie meilleure. Rester dans l'instant présent vous aide à ne pas surinterpréter les événements et à surmonter les obstacles lorsqu'ils se présentent.
Oprah Winfrey raconte une autre expérience traumatisante : les viols d'abord, auxquels ont succédé une grossesse non désirée et la mort de l'enfant, peu après sa naissance. Elle n'avait que 14 ans à ce moment-là (et les attouchements ont commencé lorsqu'elle avait 10 ans seulement).
L'animatrice cachait cet aspect de sa vie. Pourtant, un jour, une personne de sa famille a "vendu" l'histoire à des tabloïds. Elle en a été détruite. Mais elle a tenu bon et a été étonnée de l'empathie que son entourage personnel et professionnel a témoignée à son égard.
Elle revient ensuite sur ses débuts à la télévision. Elle dit avoir fait beaucoup d'erreurs. Notamment, elle a parfois confondu fierté personnelle et égo. Mais elle a compris petit à petit comment agir, vis-à-vis d'elle-même et des autres.
Voici quelques pratiques qu'Oprah Winfrey a mises en place pour se tranquilliser et qu'elle conseille à chacun :
Une bonne dose de calme au moins une ou deux fois par jour, 20 minutes le matin et 20 minutes le soir. Cela aide à mieux dormir et à se concentrer plus profondément, cela stimule la productivité et alimente la créativité.
La respiration est essentielle : elle est un point d'ancrage qui permet de nous centrer en cet instant précis. Chaque fois que vous faites une rencontre qui implique la moindre tension, arrêtez-vous, inspirez profondément puis relâchez l'air et la pression.
Relativiser : votre meilleur varie d'un jour à l'autre en fonction de votre état d'esprit. Peu importe, donnez le meilleur de vous-même en toute circonstance. De cette façon, vous ne créerez ni culpabilité ni honte.
Vivez de telle sorte qu'à la fin de chaque journée, vous puissiez dire : "J'ai fait de mon mieux". Voilà la grande œuvre d'une vie.
"Réfléchissez un instant à votre propre histoire — pas uniquement à l'endroit où vous êtes né ou vous avez grandi, mais aux circonstances qui vous ont amené à vous trouver ici même aujourd'hui. Quels sont, chemin faisant, les instants qui vous ont blessé ou affolé ? Selon toutes probabilités, vous en avez connu quelques-uns. Voici néanmoins ce qu'il y a de remarquable dans tout cela : vous êtes encore là, et debout." (Ce dont je suis certaine, Chapitre 2)
Les relations
Nous avons tous le besoin d'être estimés, compris, aimés. Nous recherchons souvent cela dans les relations. Et, pour une part, nous avons raison. Mais cela ne peut fonctionner réellement que si nous nous aimons déjà au préalable.
Cela peut paraître étrange, mais ce besoin d'être aimé doit commencer par un amour à se donner à soi-même. Sinon, vous ne serez pas en mesure de recevoir l'estime, la reconnaissance ou l'amour d'autrui.
Pourtant, nous faisons tous des caprices pour être reconnus de nos semblables. C'est l'une des motivations principales de nos actions. Mais — l'autrice y insiste — vous devez commencer par regarder en vous-même et affirmer votre propre existence.
Oprah Winfrey aborde ensuite la question de la communication dans les relations. Elle considère que communiquer est comme une danse. Elle prône une forme de communication non violente où les mots suivants sont importants :
"Que veux-tu au juste ?"
"Je te comprends."
Elle avoue également qu'elle "n'a jamais été une personne sociable", ce qui peut étonner lorsque nous connaissons son parcours ! Et pourtant, elle affirme qu'il a été difficile pour elle de créer ou de maintenir des liens d'amitié ou d'amour pendant de longues années.
C'est grâce à un déménagement et à l'influence de son voisinage bienveillant qu'elle a recommencé à se reconnecter aux autres, à rire, à sortir.
Oprah Winfrey aborde ensuite la question de l'amour. Elle commence par affirmer que l'amour est partout. "L'amour romantique n'est pas la seule forme qui en vaut la peine", même s'il est important. L'amour existe sous bien d'autres formes dans l'univers et vous pouvez aimer et être aimé de bien des manières.
Parfois, l'auteure marche dans son jardin et sent que tous les arbres vibrent d'amour. Il est toujours disponible pour ceux qui le demandent. Ce type de manifestation est la confirmation que quelque chose de plus grand que nous est à l'œuvre.
Ce sont des miracles de la vie qui se produisent tous les jours et que nous pouvons apprendre à capter en vivant l'instant présent.
"Lorsque vous vous faites un devoir toute votre vie d'aimer les autres, il n'y a jamais de dernier chapitre, car l'histoire se poursuit. Vous prêtez votre lumière à quelqu'un d'autre, qui éclaire une autre personne et une autre, et encore une autre. Et j'ai la certitude qu'en dernière analyse — lorsque les listes de choses à faire ne tiendront plus, que la frénésie sera terminée, que notre boite de courriels sera vide —, la seule chose qui aura encore de la valeur dans notre vie sera de savoir si nous avons aimé d'autres personnes et si d'autres personnes nous ont aimés." (Ce dont je suis certaine, Chapitre 3)
La gratitude
Pour la présentatrice, la gratitude constitue une priorité quotidienne. Elle cherche tous les jours des raisons d'être reconnaissante. Et elle n'est jamais déçue !
Oprah Winfrey a tenu un journal de la gratitude pendant une décennie entière, en notant chaque jour cinq choses pour lesquelles elle se sentait reconnaissante.
Voici l'exemple qu'elle donne dans son livre (à la date du 12 octobre 1996) :
"Une course autour de Fisher Island, en Floride, en profitant d'une douce brise rafraichissante.
J'ai mangé du melon bien froid, assise sur un banc au soleil.
Une longue conversation hilarante avec Gayle au sujet de son rendez-vous arrangé avec M. Patate.
Un sorbet en cornet, si savoureux que je m'en suis léché les doigts.
Maya Angelou m'a téléphoné pour me lire un nouveau poème." (Chapitre 4)
Le fait d'apprécier tout ce qui se présente à vous dans la vie change votre existence. Vous rayonnez et générez plus bien-être lorsque vous êtes conscient de tout ce que vous avez, au lieu de vous concentrez sur ce que vous n'avez pas.
Mais sa vie n'a pas toujours été ainsi. Elle se souvient aussi du temps où elle ne ressentait pas ce sentiment de gratitude. Mais peu à peu, notamment en raison de coups durs, elle s'est rendu compte de sa chance : "Mince, je suis encore là, j'ai une autre chance aujourd'hui de bien faire les choses."
Ce dont Oprah Winfrey est certaine, c'est qu'elle a besoin de s'accorder du temps et du repos — de dire merci à son corps et à son esprit, en quelque sorte.
C'et ce qu'elle fait en s'accordant un jour de congé chaque semaine, le dimanche. Elle ne fait rien, laisse son être décompresser tranquillement.
Elle note d'ailleurs que, chaque fois qu'elle a manqué un dimanche, elle a remarqué un net changement dans son humeur pour le reste de la semaine.
L'auteure insiste également sur l'importance de remercier l'univers d'avoir la possibilité de vieillir. Prendre de l'âge n'a rien d'un enlaidissement. C'est une chance.
"Vieillir est la meilleure chose qui me soit arrivée. Dès mon réveil, je vois la prière matinale de remerciement, affichée au mur de ma salle de bains, tirée du livre de Marianne Williamson intitulé Illuminata. Peu importe mon âge, je pense à toutes les personnes qui ne se sont pas rendues aussi loin. Je pense aux gens qui ont été rappelés avant de saisir toute la beauté et toute la majesté de la vie sur la terre." (Ce dont je suis certaine, Chapitre 4)
Oprah Winfrey dévoile aussi dans ce chapitre plusieurs lettres qu'elle a reçues lorsqu'elle était animatrice de son Oprah Winfrey Show.
Les possibilités
"Comment puis-je exploiter mon potentiel plus à fond ? Voilà une question que je me pose encore, surtout lorsque je contemple ce que l'avenir me réserve", se demande Oprah Winfrey en ouverture de ce chapitre.
Elle se souvient qu'à chaque étape de sa carrière, elle a eu peur, mais qu'elle y est allée malgré tout, dans l'objectif de se développer et d'être fière d'elle-même.
La crainte est notre pire ennemie, c'est elle "qui détient le pouvoir" sur nous, lorsque nous n'osons pas agir. Le plus important consiste à se décider fermement à poursuivre sa route, quelles que soient les embuches. C'est là le véritable courage.
Chaque défi que nous relevons a le pouvoir de nous mettre à genoux. Mais la seule façon d'endurer un tremblement de terre personnel est d'apprendre et de modifier sa position.
L'expérience de l'échec est un cadeau, il nous donne la force de faire un pas à droite ou à gauche à la recherche d'un nouveau centre de gravité. Ne le combattez donc pas. Laissez-le plutôt vous aider à ajuster votre position.
L'animatrice traite encore de plusieurs autres questions dans ce chapitre. Notamment, de son rapport à l'argent, qu'elle considère plutôt sain, car elle sait que ce n'est pas son salaire qui fera son bonheur.
Elle traite aussi de ce qu'elle aime et de ce qu'elle n'aime pas. Par exemple, elle n'est pas du genre à se lancer dans des sports extrêmes. Elle le sait et s'adapte donc : pour elle, l'aventure est une autre chose.
En fait, "le plus grand frisson que nous puissions nous procurer consiste à mener la vie de nos rêves", dit-elle. Or, il existe des opportunités qui, de temps à autre, vous ouvrent la voie. Ayez le courage de les attraper au vol !
Ne laissez pas d'autres personnes vous voler votre pouvoir : aimez-vous d'abord vous-même et n'attendez pas que d'autres vous le manifestent. Montrez au monde ce que vous pouvez faire par vous-même. Faites vos propres choix.
Car ne l'oubliez pas : le temps file à toute allure. Mais cela ne devrait pas vous angoisser. À partir du moment où vous avez pour objectif de grandir intérieurement et de vous accomplir courageusement, tout ira bien.
"Progressez en direction de votre but avec toute la force et toute l'inspiration que vous pouvez déployer. Puis lâchez prise, cédez votre plan d'action à la Puissance qui vous surpasse et laissez votre rêve se concrétiser en tant que chef-d'œuvre indépendant." (Ce dont je suis certaine, Chapitre 5)
L'émerveillement
Oprah Winfrey raconte comment elle a vécu un moment de calme et d'émerveillement alors qu'elle randonnait avec un ami. Le plus beau, c'est qu'elle avait, le matin même, médité à cette idée : l'essence même de la vie. Pour elle, ce moment de silence complet, en pleine nature, lui offrait une réponse idéale à ce questionnement.
La star du show-business ne le cache pas : elle est croyante. Et pour elle, les miracles importent. Mais ce ne sont pas des miracles comme vous pourrez en lire dans les Écritures, non. Ce sont de simples phénomènes qui nous rappellent la beauté du monde ou l'humanité et la gentillesse de nos semblables.
Pour elle, "la vie ne saurait avoir de véritable signification sans composante spirituelle". C'est quelque chose de sain et de nécessaire à l'être humain. Vous en retrouvez les traces dans les pratiques de méditation et de développement personnel.
Oprah Winfrey évoque également dans ce chapitre l'importance des livres dans son existence. Des livres de tout type, et notamment de poésie. Un poème est une "déclaration inattendue de l'âme".
Autre point important : l'importance de la quête. L'animatrice dit se voir comme une chercheuse. Elle est curieuse, ouverte au mystère de la vie et heureuse de fêter ses 60 ans (lorsqu'elle écrit l'ouvrage, en 2014).
"La plus belle réalisation à mon actif est de ne jamais avoir fermé mon cœur. Même durant les instants les plus sombres de ma vie [...], je suis restée fidèle, remplie d'espoir et disposée à voir le meilleur chez les gens, même lorsqu'ils me montraient leurs pires côtés. J'ai continué de croire que, peu importe le degré de difficulté de l'ascension, il y a toujours moyen de laisser entrer un éclat de lumière pour qu'il illumine le sentier devant soi." (Ce dont je suis certaine, Chapitre 6)
La clarté
Épictète aurait dit : "Dis-toi d'abord ce que tu veux être, puis fais ce qu'il faut pour le devenir".
Voilà une façon claire de voir les choses. Mais qu'est-ce qu'elle implique ? Qu'il faut savoir dire non. Pourtant, "j'ai mis quarante ans à apprendre à dire non", se souvient Oprah Winfrey.
Pas facile de poser nos limites lorsque nous avons eu une enfance perturbée. Pourtant, il le faut. C'est en examinant nos propres intentions que nous pouvons apprendre à suivre le fil de ce qui nous importe, tout en refusant de céder à celles et ceux qui veulent nous voir suivre leur chemin, ou nous faire agir à leur guise.
Voici une autre leçon à retenir de cela : quelle que soit votre situation actuelle, vous avez joué un rôle majeur dans sa création. Avec chaque expérience, vous construisez votre vie, pensée après pensée, choix après choix, et sous chacune de ces pensées et de ces choix se cache votre intention la plus profonde.
C'est pourquoi, avant de prendre une décision, Oprah Winfrey se pose cette question essentielle — et vous invite à faire de même : "Quelle est ma véritable intention ?"
Lorsque vous ne savez pas quoi faire, ne faites rien jusqu'à ce que la clarté entre en vous. S'immobiliser, méditer, se mettre à l'écoute de sa propre voix permet d'entrer plus rapidement en contact avec cette intention qui vous anime.
Une fois que vous avez décidé ce que vous voulez, engagez-vous et donnez tout ce que vous pouvez.
Par contre, si quelqu'un vous demande de faire quelque chose qui vous rebute, c'est le signe que vous devriez vous arrêter et vous tenir tranquille jusqu'à ce que votre instinct vous donne le feu vert (pour reprendre ou arrêter complètement).
Voici quelques autres pensées et anecdotes contées par l'animatrice :
Les femmes ont été éduquées pour répondre aux besoins et elles doivent réapprendre à se saisir de leurs intentions propres ;
Elle n'est pas si stressée que les gens le pensent habituellement ;
Elle cherche à ne pas perdre son temps ;
Oui, c'est vrai, elle a beaucoup trop de chaussures !
Et voici ce qu'elle dit cependant :
"L'excès de biens matériels va beaucoup plus loin que des objets eux-mêmes. Bien que nous sachions devoir renoncer à ces choses, cela nous angoisse. Je sais toutefois que le fait de renoncer à certaines d'entre elles laisse le champ libre à d'autres choses. Et cela vaut non seulement pour notre relation avec les chaussures, mais aussi pour celle que nous entretenons avec toutes choses. Faire le ménage à la maison — tant au sens littéral que figuré — constitue un excellent moyen de repartir à neuf." (Ce dont je suis certaine, Chapitre 7)
À la fin du chapitre, elle se promet de mettre un peu de minimalisme dans sa vie et de dire adieu à l'excès de chaussures !
Le pouvoir
"J'ai toujours estimé que le libre arbitre était un droit de naissance", affirme clairement et fièrement Oprah Winfrey. Pour elle, la liberté, c'est avant tout "avoir le choix".
Bien sûr, il y a des éléments que vous ne contrôlez pas, comme votre lieu de naissance. Si vous êtes né aux États-Unis ou dans un pays occidental, vous avez de la chance.
Il y a également de nombreux événements qui peuvent vous blesser, comme les mensonges racontés par les tabloïdes ou les potins qui circulent sur vous, par exemple. Mais toutes ces pensées négatives, vous pouvez les renvoyer d'où elles viennent.
Oprah Winfrey fait également une confidence : elle ne regarde pas beaucoup la télévision. Par ailleurs, elle avoue avoir fait preuve d'irresponsabilité dans les premières années de sa carrière.
Elle se souvient notamment avoir regretté d'avoir mis une femme dans le désarroi, lorsqu'elle a exhibé, sur le plateau de télévision, la tromperie de son mari.
Depuis lors, elle s'est juré de ne plus commettre de tel impair et de ne plus jamais rabaisser, embarrasser ou diminuer un autre être humain.
Quand vous choisissez de voir le monde comme une grande salle de classe ouverte sur l'extérieur, vous comprenez que toutes les expériences sont là pour vous apprendre quelque chose sur vous-même et que le voyage de votre vie consiste à devenir davantage qui vous êtes.
Les expériences les plus difficiles sont souvent celles qui nous apprennent le plus. Chaque fois que des problèmes se présentent à Oprah Winfrey, elle se demande : "De quoi s'agit-il vraiment et qu'est-ce que je suis censé apprendre de tout cela ?"
D'autres thèmes sont abordés dans ce chapitre :
L'endettement et les moyens de l'éviter ;
Le vote des femmes aux États-Unis ;
La santé et le problème de l'obésité aux USA ;
La pertinence de la richesse ou de la célébrité pour définir une personne ;
Le drame de l'ouragan Katrina en Louisiane et les leçons à en tirer ;
Le manque de confiance en soi d'Oprah Winfrey et sa relation avec l'embonpoint ;
Son besoin de "performer" et d'être la meilleure.
Ces thèmes sont liés entre eux. Ils ont le pouvoir pour point commun. Ce que nous pouvons faire pour améliorer notre situation et ne pas nous laisser dominer par la peur.
Voici ce que dit l'auteure :
"Laissez votre vie s'éveiller en vous. Quel que soit votre défi — la tendance à trop manger, à trop consommer une certaine substance ou à trop faire une même activité, ou encore le deuil d'une relation, d'une somme d'argent ou d'un poste —, permettez-lui de vous ouvrir la porte sur les révélations les plus nobles à votre sujet, de vous inviter à entrer dans ce qu'est la vie excellente pour vous." (Ce dont je suis certaine, Chapitre 8)
Enfin, Oprah Winfrey rappelle l'importance d'agir de façon amicale avec les autres. Toutes nos actions tournent autour de nous "aussi surement que la Terre tourne autour du Soleil", dit-elle. L'amour que vous transmettez vous sera renvoyé d'une manière ou d'une autre. Ayez confiance en cela.
"Aujourd'hui, j'essaie de bien agir envers toutes les personnes que je rencontre et d'être bien en leur compagnie. Je veille à employer ma vie à faire le bien ; car ce dont je suis certaine, c'est que tout — ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais — me sera rendu. Et il en va de même pour vous." (Ce dont je suis certaine, Chapitre 8)
Conclusion sur "Ce dont je suis certaine" d'Oprah Winfrey :
Ce qu'il faut retenir de "Ce dont je suis certaine" d'Oprah Winfrey :
Ce livre est composé d'une collection de chroniques qu'Oprah Winfrey a tirées de sa chronique populaire dans le magazine O. Elle y confie ses expériences et ses leçons de vie pendant 14 ans.
Dans l'ensemble, tous les thèmes se connectent et résonnent les uns avec les autres et forment, pourrions-nous dire, l'échelle des valeurs d'Oprah Winfrey :
La joie ;
La résilience ;
Les relations ;
La gratitude ;
Les possibilités ;
L'émerveillement ;
La clarté ;
Le pouvoir.
L'expérience de l'auteure, à près de 60 ans, lui permet d'avoir le recul suffisant pour analyser sa vie riche en rebondissements, en drames et en moments joyeux.
Plutôt que de se cacher derrière de grandes théories, Oprah Winfrey s'exprime honnêtement sur les tragédies de son enfance, ses échecs, ses erreurs et ses plus grandes réussites et bonheurs.
Son expérience d'intervieweuse joue un grand rôle aussi dans sa connaissance de l'âme humaine.
Enfin, Oprah Winfrey montre dans ces lignes que la méditation et le développement personnel l'aident au quotidien, ainsi que la spiritualité.
Points forts :
C'est agréable de se plonger dans la vie et l'esprit de cette célébrité ;
Il y a de nombreuses réflexions intéressantes à méditer ;
Le livre est très bien organisé, les chapitres clairs et se lit facilement.
Point faible :
Ne vous attendez pas à une grande théorie ici ni à un manuel de savoir-vivre ou de développement personnel classique ; il s'agit simplement — mais c'est déjà beaucoup — de réflexions sur la vie.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu le livre de Michèle Léach et Delphine Tranier-Brard « Devenir biographe » ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Michèle Léach et Delphine Tranier-Brard « Devenir biographe »
Visitez Amazon afin d’acheter le livre de Michèle Léach et Delphine Tranier-Brard « Devenir biographe »
Cet article Ce dont je suis certaine est apparu en premier sur Des livres pour changer de vie.
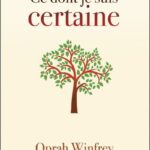 ]]>
]]>Résumé de "Plus rien ne pourra me blesser" de David Goggins : Un récit puissant et inspirant de David Goggins, qui, malgré une enfance marquée par la violence et la négligence, a transformé sa vie en repoussant ses limites physiques et mentales. Il nous y enseigne de précieuses leçons sur la discipline, la motivation et la persévérance.
Par David Goggins, 2018, 363 pages
Titre original : Can't Hurt Me: Master Your Mind and Defy the Odds
Note : cet article invité a été écrit par Amaury du blog La Prise De Masse.
Chronique et résumé de “Plus rien ne pourra me blesser” de David Goggins
I. Introduction
"Je n’utilise que 10 % de mon véritable potentiel."
Ces mots résonnent encore en moi depuis que j'ai plongé dans les pages captivantes de "Plus rien ne pourra me blesser".
Dans ce livre, David Goggins vous invite à un voyage extraordinaire au cœur de sa vie, où il a transcendé les limites humaines pour réaliser l'inimaginable.
Au fil de ce récit saisissant, Goggins explique comment il a réussi à briser les chaînes des croyances limitantes qui l'entravaient. Avec une honnêteté brute, il nous plonge dans les moments les plus sombres de sa vie, mais aussi dans les triomphes indéniables qui ont suivi. À travers chaque épreuve, il a fortement forgé son esprit, se transformant physiquement, mentalement et émotionnellement.
En plongeant dans les pages de "Plus rien ne pourra me blesser", vous découvrirez les secrets de la résilience, de la persévérance et de la discipline. Vous serez ébloui par les exploits incroyables de Goggins, des records d'endurance inégalés aux limites qu'il a repoussées sans relâche.
Mais ne vous méprenez pas, ce livre n'est pas seulement un récit captivant. C'est un guide pratique qui vous conduira pas à pas sur votre propre chemin, vous aidant à surmonter vos propres limites et à accomplir ce que vous pensiez impossible.
Préparez-vous à être emporté dans un tourbillon d'émotions, à être profondément touché et à être transformé.
"Plus rien ne pourra me blesser" va bien au-delà d'une simple lecture. C'est une expérience de vie qui vous invitera à devenir le héros de votre propre histoire.
Laissez les mots puissants de David Goggins être votre guide vers la découverte de votre véritable potentiel.
II. Enfance difficile de David Goggins : Les racines de la résilience
Description de l'enfance de David Goggins marquée par la violence et la négligence
Dans son enfance, David Goggins a été confronté à l'horreur absolue.
Son père, un mac impitoyable, régnait sur un monde de prostitution, frappant à la fois sa mère et lui sans relâche. Ces violences familiales étaient un tourbillon de terreur qui les engloutissait, les laissant dans une angoisse permanente.
Dans son livre, David raconte de nombreuses scènes choquantes qu’il a vécues, comme la fois où son père trainait sa mère dans les escaliers en la tirant par les cheveux après l’avoir mise KO.
Mais, ce n’est pas tout !
À l'école, Goggins était la cible de cruels actes racistes.
Il était laissé seul face à ces agressions, personne ne venant à son secours. Les insultes et les menaces de mort l'assaillaient, déchirant son cœur et ébranlant sa confiance en lui.
Cette enfance marquée par la violence et le racisme était un cauchemar éveillé, une épreuve indescriptible qui aurait brisé la plupart des personnes.
Les croyances limitantes et l'estime de soi affectée
Les cicatrices physiques étaient visibles, mais les blessures invisibles causées par les années de maltraitance étaient tout aussi profondes.
Les violences domestiques répétées et les agressions racistes ont laissé une empreinte indélébile sur l'esprit de Goggins.
Les mots blessants et les actes de cruauté ont sapé sa confiance en lui et ont semé des graines de doute quant à sa valeur en tant qu'individu. Il croyait profondément qu'il n'était pas assez bon, pas assez fort, pas assez intelligent pour réussir.
Ces croyances limitantes ont étouffé ses aspirations et ont façonné un cercle vicieux de peur et d'auto sabotage. Les voix qui résonnaient dans sa tête lui disaient qu'il était condamné à vivre dans les ténèbres de son passé, qu'il ne méritait pas d'être heureux ou de réussir. Ces pensées négatives ont étouffé son potentiel, limitant ses ambitions et l'empêchant d'atteindre ses objectifs les plus profonds.
L'estime de soi de Goggins était brisée, fragmentée par les années de maltraitance et de mépris. Il se voyait à travers les yeux des autres, à travers le prisme des humiliations passées.
Il avait du mal à croire en lui-même, à reconnaître sa valeur intrinsèque en tant qu'être humain.
Les conséquences désastreuses sur sa vie
Les séquelles émotionnelles et psychologiques ont laissé une empreinte profonde, se manifestant dans différents aspects de son existence.
Au niveau scolaire, David était en échec.
Les traumatismes subis avaient érodé sa confiance en lui et sa capacité à se concentrer sur les études. Les défis éducatifs semblaient insurmontables, et il se sentait souvent découragé, incapable de saisir les opportunités qui s'offraient à lui.
Son corps portait également les stigmates de cette enfance difficile.
Il était en surpoids, piégé dans un cercle vicieux de mauvaises habitudes alimentaires et d'un mode de vie sédentaire. La confiance en soi était ébranlée et il ne voyait aucune issue à cette spirale descendante.
Mais le plus alarmant était le manque de rêves et d'ambition qui l'habitait.
Les traumatismes l'avaient plongé dans une profonde apathie, lui faisant croire qu'il n'était pas digne de rêver en grand, qu'il était condamné à une existence médiocre et sans perspective.
Les conséquences désastreuses de son passé étaient palpables, menaçant de l'enfermer dans un cycle d'autodestruction et de stagnation. Il était au bord du gouffre, prêt à se laisser emporter par le poids de ses expériences passées.
Jusqu’à ce que…
III. Lutte contre l'obésité et la transformation personnelle
Le déclic qui pousse Goggins à entreprendre une transformation physique et mentale
Un soir, alors qu'il était affalé devant la télévision, Goggins tomba par hasard sur le discours d'un Navy Seal.
Les paroles puissantes et inspirantes de cet homme résonnèrent en lui, faisant vibrer quelque chose de profond à l'intérieur de lui.
Il se sentait électrisé, comme si une étincelle s'était allumée dans son esprit. Les mots du Navy Seal faisaient écho à ses propres aspirations enfouies. Il était captivé par la notion de repousser les limites, de se surpasser et de devenir la meilleure version de soi-même.
Ce discours fut le catalyseur qui déclencha un feu ardent en Goggins. Il ressentait un mélange d'excitation, de détermination et de frustration face à tout ce qu'il n'avait pas encore réalisé dans sa vie. Il savait au plus profond de lui-même qu'il était temps de prendre les rênes de son existence et de se lancer dans une transformation physique et mentale.
Ce déclic créa en lui une motivation inébranlable. Il était prêt à affronter ses démons intérieurs, à briser les schémas autodestructeurs et à se construire un avenir à la hauteur de son potentiel réel.
Cette rencontre fortuite avec le discours du Navy Seal fut le point de départ d'un voyage extraordinaire vers l'autodiscipline, la résilience et l'épanouissement.
Dès le lendemain, David appela le centre de recrutement des Navy Seals.
Après avoir expliqué brièvement sa situation, les recruteurs se moquèrent ouvertement de lui avant de raccrocher. Mais Goggins ne baissa pas les bras. Durant les trois jours qui suivirent, il appela encore et encore…
Jusqu’à obtenir une réponse : Les prochains tests de sélections auront lieu dans 3 mois et le poids maximum pour participer est 85 kg.
Il devait perdre plus de 50 kg en 3 mois !
Challenge 1 : Détecter nos facteurs limitants
Pourquoi pas vous ?
Pourquoi ne pas vous créer vous-même ce déclic aujourd’hui et vous donner les moyens d’atteindre vos rêves les plus fous ?
C’est tout à fait possible. Et, pour y parvenir, voici par quoi vous devriez commencer : identifier vos facteurs limitants.
Demandez-vous “Qu’est-ce qui, aujourd’hui, m’empêche d’atteindre mes rêves ?”
Au début, vous répondrez sûrement “Je n’ai pas assez de temps”, “pas assez d’argent” ou “pas de chance”. Mais forcez-vous à chercher un peu plus loin. Soyez 100 % honnêtes avec vous-même.
Dans la plupart des cas, vous vous rendrez compte que :
Vous avez des pensées limitantes
Vous n’êtes pas prêt à faire les efforts nécessaires
Ou encore vous avez pris de mauvaises habitudes…
Je vous recommande vraiment de faire cet exercice. Si vous ne prenez pas conscience de ce qui vous limite, vous ne pourrez jamais vous en libérer.
Sa transformation physique et mentale extrême
David n’avait qu’un objectif en tête : réussir le test des sélections des Navy Seals.
Et pour y parvenir, une seule solution : changer radicalement son quotidien.
La première étape a été d’adopter une diète stricte. Fini les donuts et les smoothies au chocolat. Désormais, son alimentation se composait uniquement de menus protéinés et seins pour la prise de muscle. Il s'était engagé à prendre soin de son corps, en lui fournissant les nutriments dont il avait besoin pour se muscler et éliminer du gras.
Mais la transformation de Goggins ne s'arrêtait pas là.
Il réalisait quotidiennement des entraînements hyper intenses, repoussant constamment ses limites physiques. Que ce soit la course, la musculation, le vélo ou la natation, il s'est donné à fond. Il s’entraînait parfois plus de 6 heures par jour. Chaque séance d'entraînement était une opportunité de repousser ses propres barrières et de devenir plus fort, plus rapide, plus résistant.
Mais la partie la plus importante de sa transformation a été de supprimer ses mauvaises habitudes et de se créer un mental d’acier. Pour y parvenir, il sortait constamment de sa zone de confort. Il se fixait des objectifs ambitieux et se donnait les moyens de les atteindre, en s'engageant pleinement et en refusant de se dérober devant les défis.
Une autre facette clé de sa transformation mentale a été de se responsabiliser. Il s’est convaincu que sa vie était entre ses mains et qu'il était le seul responsable de son propre succès. Il a refusé de jouer le rôle de la victime et s’est approprié pleinement son parcours.
Voici, une technique qui lui a permis d’y parvenir.
Challenge 2 : Le miroir des responsabilités
Le plus gros frein à la progression est le déni.
Comment faire évoluer le statu quo si on est convaincu que tout va bien ? C’est impossible.
Le deuxième challenge que nous lance David est simple : mettez-vous face à votre miroir et dites-vous des vérités qui sont difficiles à entendre.
Par exemple, “Je suis en surpoids”
“Je n’ai pas de véritables amitiés”
“Je suis incapable de me concentrer sur une tâche durant plus d’une heure”
ou encore “Je ne profite pas assez avec ma famille”
Ensuite, notez chacune de ces phrases sur un post-it et collez-les à votre miroir de sorte que, chaque matin en vous réveillant, vous les voyez.
Vous serez autorisé à les enlever le jour où ces affirmations deviendront fausses.
IV. Les forces spéciales de l'armée : Dépassement des limites
Les défis rigoureux de la formation des forces spéciales
Les tests d’admission aux Navy Seals comprennent des épreuves écrites, des tests physiques et surtout la “Hell Week”. Littéralement : La semaine de l’enfer.
Le concept est simple : Tous les participants sont regroupés sur une île et devront y rester durant une semaine. La difficulté étant que les instructeurs les pousseront à bout.
Ils devront enchaîner des courses à pied interminables en soulevant des charges lourdes, des baignades glaciales en pleine nuit et une torture mentale constante. Le tout avec presque pas de sommeil.
Les instructeurs sont sans pitié. Que vous ayez les côtes cassées, une pneumonie ou un terrible mal de crâne, ils ne feront aucune concession. Il y a parfois même des personnes qui perdent la vie lors de ces tests.
Seulement 20 à 30 % des participants (déjà surentraînés) arrivent au bout de cette semaine.
Challenge 3 : S’habituer à l’inconfort
S’il est obligatoire de passer de telles épreuves, ce n’est pas pour rien.
L’armée d’élite américaine veut recruter les personnes les plus fortes mentalement.
Mais, contrairement à ce que certains pensent, la force mentale n’est pas un don. On ne naît pas avec un mental d’acier et une discipline à toute épreuve. C’est quelque chose qui se travaille.
Et il y a un seul moyen de le travailler : s’exposer à l’inconfort.
En sortant constamment de votre zone de confort, vous l’étendez petit à petit. Par exemple, s’il est difficile pour vous de parler à des inconnus, mais que vous vous forcez à le faire tous les jours, cela finira par devenir naturel.
C’est le cas dans tous les domaines : sport, travail, exposition au froid…
Voici votre mission :
Trouvez 1 à 3 domaines dans lesquels vous souhaitez progresser et essayez chaque jour de faire une action qui vous met dans une situation inconfortable.
Les épreuves physiques et mentales vécues lors de l'entraînement
Mais, tout ne s’est pas passé comme prévu…
Malgré une préparation de Spartiate et une motivation infaillible, Goggins n’est pas allé au bout de la semaine de l’enfer.
Il n’a pas abandonné à cause de la fatigue, des blessures ou de son état mental. Il a abandonné car il était atteint d’une pneumonie. S’il n’arrêtait pas, il risquait sa vie.
L’histoire aurait pu se terminer là…
Mais quelques mois plus tard, David était de retour aux tests d’admission, prêt à retenter sa chance.
Cette fois-ci fut la bonne. Malgré une fracture du tibia, Goggins est allé jusqu’au bout de la Hell Week. Mais les complications ne s’arrêtent pas là…
Sa blessure ne guérissant pas, David est donc contraint de quitter les Navy Seals pour récupérer juste après les avoir rejoints. Et qui dit démission dit semaine de l’enfer à repasser…
Comme vous pouvez vous en douter, Goggins ne baisse pas les bras. Quelques mois plus tard, il est de retour sur l’île, prêt à en découdre. Et cette fois, il triomphe pour de bons.
L'importance de la persévérance et de la résilience face aux épreuves
Tandis que la plupart d’entre nous auraient abandonné après quelques heures, David a persévéré pendant sept jours. Trois fois de suite !
La différence entre lui et nous est que David a appris que la persévérance est la clé pour surmonter les obstacles. Il a compris que chaque échec est une opportunité d'apprendre et de grandir.
Plutôt que de se laisser abattre par les revers, il les a utilisés comme des tremplins pour se propulser vers de plus grands succès.
La résilience de Goggins a été mise à l'épreuve à maintes reprises. Malgré les douleurs physiques, les échecs et les moments de doute, il a refusé d'abandonner. Il a puisé dans sa détermination pour se relever à chaque fois qu'il tombait, et il est devenu plus fort à chaque épreuve.
L'histoire de Goggins est un exemple inspirant de la capacité de l'esprit humain à se surpasser. Il nous rappelle que nous sommes tous capables de surmonter les épreuves, quelle que soit leur ampleur. En nous concentrant sur notre mental, en cultivant la persévérance et en développant notre résilience, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires.
Voici une des techniques qu’il partage dans son livre qui lui a permis de survivre à ces trois semaines de l’enfer.
Challenge 4 : Capturer leurs âmes
Cette technique consiste à utiliser la négativité transmise par vos adversaires, vos ennemis et vos haters comme une force.
Selon Goggins, la meilleure des motivations est de montrer à ces personnes qu’elles ont tort.
Cela s’applique dans de nombreux domaines. Votre patron vous reproche de ne pas être assez efficace, utilisez-le comme une force pour lui montrer le contraire. Votre coach ne vous donne pas suffisamment de temps de jeux, devenez excellent et montrez-lui qu’il fait une erreur.
En effet, votre objectif doit être d’atteindre un niveau que ces personnes sont incapables d’atteindre.
Dans un interview, Goggins a même confié qu’il enregistrait tous les commentaires négatifs qu’il recevait et qu’il les écoutait en boucle durant ses entraînements (à ne pas reproduire à la maison en cas de déprime).
V. Les exploits d'endurance : Repousser les limites humaines
La participation à des courses d'endurance extrêmes et à des défis inimaginables
Après plusieurs années au sein des Navy Seals, Goggins avait besoin de changements, de nouveaux défis.
C’est dans les efforts d’endurance qu’il trouva son bonheur.
Son objectif : participer à Badwater, une des courses les plus difficiles du monde. Cette course de 217 km se situe dans la vallée de la mort en Californie (ça donne tout de suite le ton). C’est un lieu dans lequel la température dépasse fréquemment les 50 °C à l’ombre.
Et, vous commencez à connaître le personnage…
Quand David Goggins a un objectif, il se donne les moyens de l’atteindre.
Cette fois-ci, il ne s’est pas contenté d’atteindre son objectif initial. Goggins est aujourd’hui l’un des meilleurs coureurs d’endurance de toute la planète.
Il a surmonté des montagnes, des marathons en Arctique et les ultra marathons les plus durs de la planète. Chaque épreuve était une occasion de se prouver qu'il pouvait accomplir l'impossible.
Mais les défis de Goggins ne se limitaient pas à la course. Il s'est également lancé dans des exploits de force mentale, battant le record mondial de tractions en 24 heures. Il a poussé son corps et son esprit au-delà de leurs limites.
La participation de Goggins à ces courses d'endurance extrêmes et à ces défis inimaginables démontre sa détermination inébranlable à se dépasser constamment.
Si, comme lui, vous souhaitez devenir un athlète hybride en alliant course à pied et musculation, je vous conseille de lire cet article.
Challenge 5 : Visualiser le succès
Vous avez forcément déjà connu cette situation :
Vous vous êtes lancés dans un projet plein de motivation et de bonne volonté. Mais, après quelques semaines (peut-être même avant), vous avez perdu toute motivation. Vous ne voyez aucun résultat et vous ne prenez plus de plaisir à travailler sur ce projet.
C’est quelque chose qui arrive à tout le monde (même à Goggins).
Mais c’est justement là qu’il faut persévérer. Voici la méthode de David pour y parvenir :
Visualisez votre succès. Imaginez votre vie une fois que votre objectif aura été atteint. Rappelez-vous pourquoi vous faites tous ces sacrifices aussi souvent que possible.
C’est exactement ce que fait Goggins tout au long de ses courses.
Les obstacles physiques et mentaux rencontrés lors de ces épreuves
Les défis physiques étaient ardus, mettant à l'épreuve sa force, son endurance et sa résistance.
Il affrontait des terrains difficiles, des conditions météorologiques impitoyables et des distances dévastatrices. Malgré la fatigue et la douleur, il continuait d'avancer, repoussant les limites de son corps.
Mais ce n'était pas seulement un défi physique. Les épreuves mentales étaient tout aussi difficiles, sinon plus. Des doutes et des pensées négatives l'assaillaient, tentant de le décourager. Mais Goggins puisait dans sa détermination intérieure, refusant de céder à la faiblesse mentale.
Il faisait face à des moments de désespoir, à des moments où il voulait abandonner. Mais il trouvait la force en lui pour continuer, pour se relever après chaque chute.
Une des techniques qu’il utilisait pour y parvenir était celle de la boite à biscuit.
Challenge 6 : La boite à biscuit
Prenez une feuille de papier et inscrivez dessus toutes les choses que vous avez accomplies et dont vous êtes fier.
N’écrivez pas simplement vos réussites, mais aussi tous les obstacles que vous avez réussi à surmonter (arrêter de fumer, surmonter une dépression…). Découpez ensuite chacune de ces réussites et placez-les dans une boite.
Lorsque vous vous sentez démoralisés ou que vous manquez de motivation, prenez cette boite et tirez quelques papiers.
Les leçons apprises et la détermination à aller au-delà de ses propres limites
Au fil de ses épreuves et de ses victoires, Goggins a tiré des leçons précieuses.
Il a découvert que la seule limite qui existe est celle que nous nous fixons. Il a compris que la vraie croissance se produit en sortant de sa zone de confort et en embrassant l'inconfort.
David Goggins a appris que la discipline et la persévérance sont les clés du succès. En s'engageant à rester fidèle à ses objectifs et à ses principes, il a pu réaliser des exploits extraordinaires. Il a compris que chaque épreuve était une occasion de se renforcer, de devenir meilleur.
La détermination de Goggins à aller au-delà de ses propres limites est une inspiration pour tous. Il nous rappelle que nous sommes capables de bien plus que nous ne l'imaginons.
Il nous encourage à repousser nos propres barrières, à défier nos croyances limitantes et à viser l'excellence.
Challenge 7 : la règle des 40 %
La règle est simple : lorsque tu penses avoir atteint tes limites, tu n’es sûrement qu’à 40 % de tes capacités réelles.
Il y a une semaine, j’ai couru un marathon pour la première fois de ma vie. Durant toute la course, j’ai gardé cette règle à l’esprit.
À plusieurs reprises, j'ai eu envie d’abandonner, mais je me disais “je ne suis qu’à 40 %. Mon esprit veut abandonner, mais mon corps est encore capable”.
Si je n’avais pas lu ce livre, je ne suis pas sûr que j’aurais fini cette course.
VI. La recherche constante de l'excellence : La philosophie de Goggins
Dans ce livre, David Goggins partage des perspectives profondes et des leçons précieuses sur trois aspects essentiels de la réussite.
Tout d'abord, Goggins met en évidence l'importance de la discipline.
Il explique que la discipline est un choix quotidien de faire les actions nécessaires pour atteindre vos objectifs, même lorsque cela demande des sacrifices et de l'effort. Il vous incite à cultiver une discipline rigoureuse dans tous les aspects de votre vie, car c'est ce qui vous permettra de rester sur la voie du succès.
En ce qui concerne la motivation, Goggins vous apprend que la motivation véritable ne vient pas seulement de sources externes temporaires, mais plutôt de votre propre feu intérieur.
Il vous encourage à découvrir votre pourquoi profond, votre raison d'être, qui alimentera une motivation intrinsèque durable et vous permettra de surmonter les obstacles avec détermination.
Enfin, Goggins insiste sur l'importance de la persévérance.
Il reconnaît que le chemin du succès est souvent semé d'embûches et de défis, mais il vous pousse à persévérer et à ne jamais abandonner. Il vous encourage à voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage, à relever chaque défi avec résilience et à garder les yeux fixés sur vos objectifs, peu importe les difficultés rencontrées en cours de route.
En lisant "Plus rien ne pourra me blesser", vous serez amené à réfléchir profondément sur votre propre discipline, motivation et persévérance.
Vous serez inspiré par les récits et les enseignements de Goggins, et vous serez guidé vers une nouvelle mentalité, une mentalité qui repousse les limites, embrasse l'inconfort et ne cesse de s'améliorer.
Challenge 8 : la quête de l’échec
Pour cette dernière leçon, Goggins nous donne un conseil : s’exposer le plus possible aux obstacles et aux échecs.
Si vous n’avez jamais connu l’échec, vous n’avez jamais réellement progressé.
Vous devez absolument mettre des obstacles sur votre chemin. Faites en sorte d’être exposé à l’échec.
Une fois que cela sera le cas, vous n’aurez plus qu’à appliquer toutes les méthodes que vous venez de voir pour transformer cet échec en réussite.
C’est le meilleur moyen pour atteindre tous vos objectifs et réaliser vos rêves.
Conclusion sur “Plus rien ne pourra me blesser” de David Goggins
Avant de lire ce livre, je pensais vivre ma vie à mon plein potentiel.
Je faisais du sport et travaillais tous les jours. Je mangeais sainement. Mais aussi, je prenais le temps de m’intéresser et de me former sur énormément de sujets. Je faisais en sorte de sortir régulièrement de ma zone de confort. Et, en plus, j’avais le temps de profiter avec ma famille, mes amis et ma copine.
Mais il y avait malgré tout un problème qui persistait : je ne progressais pas assez vite.
Le fait de m’intéresser à plein de domaines m’empêchait de devenir vraiment bon dans un domaine (en tout cas, je le pensais).
J’étais convaincu que je n’étais pas capable d’en faire plus. Je pensais que si je :
m’entraînais plus dur et plus longtemps, je serais trop fatigué
travaillais davantage, j’allais finir déprimé
sortais plus souvent de ma zone de confort, je dépasserais mes limites
J’avais tout faux.
Ce livre m’a fait un réel déclic. Je me suis rendu compte que je sous-estimais grandement les capacités de mon corps et de mon mental. En réalité, je suis capable de pousser tous mes efforts bien plus loin que je ne le faisais.
Depuis, je me suis lancé de nombreux challenges qui me paraissaient auparavant insurmontables :
Courir un marathon sans entraînement
Me lever tous les matins à 6 h 30
M’entraîner 7 jours sur 7
En résumé, ce livre m’a permis de découvrir mon réel potentiel et de commencer à m’en rapprocher. Je suis convaincu que cela sera le cas pour vous aussi !
Points forts :
L’histoire est touchante et captivante. C’est un livre très facile à lire.
Contrairement à d’autres biographies, Goggins ne se contente pas de raconter sa vie. Il nous donne des conseils concrets que l’on peut appliquer.
Sans aucun doute, le livre le plus motivant que j’ai lu
Point faible :
La vie de David Goggins est tellement loin de notre réalité qu’il est parfois difficile de s’identifier à lui
Ma note
★★★★★
Avez-vous lu le livre de David Goggins "Plus rien ne pourra me blesser" ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de David Goggins "Plus rien ne pourra me blesser"
Visitez Amazon afin d'acheter le livre de David Goggins "Plus rien ne pourra me blesser"
Cet article Plus rien ne pourra me blesser est apparu en premier sur Des livres pour changer de vie.
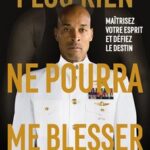 ]]>
]]>Résumé de « Une Terre promise » de Barack Obama : Les mémoires du premier président noir des États-Unis dans une période difficile qui conjugue crise économique, terrorisme et montée en puissance de la droite conservatrice de Donald Trump.
Par Barack Obama, 2020, 890 pages.
Titre original : « A Promised Land » (2020)
Chronique et résumé de « Une Terre promise » de Barack Obama
Préface
Barack Obama commence à rédiger ses mémoires peu après la fin de sa présidence, alors qu’il est en vacances à Hawaï avec sa famille.
Ses objectifs sont de :
Rendre un compte rendu honnête de son mandat ;
Offrir aux lecteurs une idée de ce que c’est que d’être président des États-Unis ;
Faire la lumière sur le fonctionnement du gouvernement fédéral ;
Inspirer les jeunes qui envisagent une carrière dans la fonction publique.
Bien sûr, il n’ignore pas que la situation des États-Unis en 2020 est problématique :
Pandémie de COVID-19 ;
Crise économique ;
Attaques contre la démocratie américaine ;
Guerre entre républicains et démocrates.
Toutefois, malgré le climat actuel, Barack Obama garde l’espoir. Il croit aux possibilités offertes par un monde interconnecté, où les gens vivent ensemble, coopèrent les uns avec les autres et reconnaissent la dignité de l’autre.
Les yeux du monde entier sont rivés sur l’expérience démocratique américaine. Barack Obama reste confiant que les générations futures peuvent parvenir à une union plus parfaite.
Partie 1 — Une Terre Promise : Le pari
Chapitre 1
Barack Obama commence l'écriture de Une Terre promise, par retracer son enfance et ses années de formation. Il se souvient combien sa grand-mère et sa mère, Ann Duham, ont été importantes pour lui.
Celle-ci l’a initié au mouvement pour les droits civiques, au mouvement de résistance face à la guerre du Vietnam et au mouvement pour les droits des femmes, notamment.
Par contre, le jeune homme n’a presque pas connu son père, Barack Obama Sr., un économiste kényan.
Au départ plutôt fainéant et nonchalant, Barack Obama est peu à peu devenu un étudiant brillant et engagé. Il a véritablement pris conscience de son identité mixte et des différences de classes sociales à son entrée en secondaire.
Mais c’est à l’université que son goût pour la politique s’est révélé. C’est aussi à ce moment qu’il étudie de façon plus sérieuse. Barack Obama étudie d’abord les sciences économiques et les relations internationales à l’université de Columbia, avant de rejoindre Harvard pour des études de droit.
Il commence à prendre la parole et s’investir dans sa communauté à Chicago. Il y observe les actions du premier maire noir de la ville, Harold Washington. Comme ce dernier, il veut donner de l’espoir aux gens. Cependant, il se rend compte que le charisme ne suffit pas à créer le changement social.
Le jeune homme se sent attiré par la carrière politique. Et celle-ci lui tend potentiellement les bras, puisqu’il réussit avec brio ses études à Harvard (avec la plus grande distinction) et devient le premier Noir à diriger la célèbre Harvard Law Review.
Chapitre 2
Le chapitre 2 de Une Terre promise est divisé en 2 parties :
La relation de Barack Obama avec sa (future) femme, Michelle Obama.
Le début de sa carrière politique.
Dans la première partie du chapitre, il raconte comment il a rencontré Michelle. Celle-ci travaillait dans un cabinet d’avocats où il était entré pour réaliser un stage. Elle était chargée de superviser son séjour.
Très vite, ils se sont rendu compte qu’ils partageaient les mêmes valeurs et qu’ils avaient tous les deux de fortes convictions. Ils se sont mariés en 1992. C’était une période de travail intense, puisqu’à cette époque il enseignait également à l’université de Chicago et terminait son premier livre.
Dès le départ, Michelle Obama l’a prévenu de la difficulté de son choix de carrière. Quant à elle, elle a préféré quitter son travail d’avocate d’affaires pour se mettre au service de ses concitoyens en dirigeant un programme associatif.
La seconde partie du chapitre concerne les débuts de Barack Obama en politique. En 1995, il décide de participer à la course au Congrès d’Alice Palmer, tout en pensant récupérer son siège démocrate au Sénat de Chicago. C’est un premier travail de terrain très formateur. Et il gagne sa place de jeune sénateur !
Par contre, il échoue en 2000 alors qu’il souhaite obtenir un siège au Congrès de l’État.
Cette époque est aussi marquée par des événements personnels heureux et malheureux :
Le décès de sa mère ;
La naissance de sa première fille, Malia.
Conjuguer vie de famille et vie professionnelle n’est pas de tout repos à cette période. Et ce ne le sera pas non plus par la suite !
Chapitre 3
Dans ce chapitre de Une Terre promise, la deuxième fille du couple Obama, Natasha (ou Sasha) naît également dans la foulée. Politiquement, à cette époque, Barack Obama commence à voir grand : il veut atteindre le Sénat des États-Unis.
Il recrute à cette fin Dabid Axelrod et lance une campagne audacieuse avec sa petite équipe. Et c’est une large victoire — avec plus de 40 points d’avance sur son concurrent républicain, du jamais vu dans l’histoire de l’Illinois !
Selon lui, plusieurs facteurs contribuent à cette réussite :
Son échec au Congrès lui a permis de comprendre comment communiquer plus efficacement ;
Il s’est associé aux syndicats et à des personnalités populaires du Congrès ;
Il a aussi peaufiné son CV en dirigeant des projets de loi importants ;
Par ailleurs, il s’est fait reconnaître en critiquant l’invasion étasunienne de l’Irak ;
Barack Obama a pu compter sur une équipe jeune qui a su faire bon usage d’internet ;
Il a patiemment visité les quartiers les plus pauvres et les communautés religieuses ;
Enfin, quelques articles et publicités bien placées dans des journaux de référence, publiés au bon moment, ont aussi joué un rôle.
Une fois installé à Washington, Barack Obama cherche à se faire des contacts. Il est dans l’opposition et sait que ses moyens d’action sont limités. Mais il cherche néanmoins à faire de la politique étrangère sa priorité.
Il voyage notamment en Ukraine pour promouvoir la non-prolifération nucléaire. Ensuite, il revient au pays pour s’adresser aux victimes de l’ouragan Katrina, en Louisiane. Leurs témoignages le touchent et il bataille désormais sur ces deux fronts :
Les inégalités sociales et le racisme ;
La politique étrangère (il visite notamment les troupes américaines engagées dans les conflits au Moyen-Orient).
Chapitre 4
Peu à peu, Barack Obama sent qu’il peut aller loin, très loin. Il considère la possibilité de se présenter à la présidentielle en 2006. C’est son chef de cabinet, Pete Rose, qui l’y encourage. Cependant, il demeure hésitant.
D’autres personnalités proches de lui, au sein du camp démocrate, l’encouragent également. Par ailleurs, il sent que le peuple américain est prêt pour un changement important et pour un autre type de président.
Au départ, Michelle Obama ne le soutient pas dans cette idée. Selon elle, c’est trop tôt. Cette année-là, la famille voyage en Afrique et rend visite à des personnalités telles que Nelson Mandela et Desmond Tutu.
Barack Obama entreprend aussi un voyage au Kenya vers la frontière somalienne, puis en Éthiopie, au Chad et au Darfur, notamment pour rencontrer les militaires basés dans ces régions.
Après son voyage, les choses s’accélèrent. Un discours, puis un entretien télévisé dans l’émission Meet the Press rendent les médias électriques et curieux.
Quand il se rend compte qu’il pourrait bien gagner la primaire démocrate et devenir véritablement président des États-Unis, il commence à stresser pour de bon. Le peuple américain, lassé du président républicain G. W. Bush, vote en masse pour le camp opposé.
Mais Barack Obama n’est pas le seul en lice. Hillary Clinton est sa principale rivale pour la primaire.
Finalement, Michelle Obama se joint à lui dans les dernières semaines de la course et lui offre tout son soutien. Mais elle ne le donne pas sans lui demander, auparavant, ce qu’il peut offrir d’unique au peuple américain.
Celui-ci lui répond : donner un sentiment d’appartenance nationale aux personnes noires et aux minorités, leur donner espoir et servir de modèle pour les enfants autour du monde.
Partie 2 — Une Terre Promise : « Yes, We Can »
Chapitre 5
Les débuts de la campagne de Barack Obama ne sont pas très réussis. Lui qui aime parler et donner de longues explications doit apprendre d’autres manières de communiquer, plus directes, dans les débats.
Il embauche quelqu’un qui va beaucoup l’aider : David Plouffe. Celui-ci va mettre en place une communication sur internet qui va rapporter de nombreux soutiens au candidat à la Maison-Blanche.
Un autre de ses collaborateurs, Paul Tewes, le conseille aussi sur la façon de gagner l’État d’Iowa. Selon lui, il est préférable de se concentrer sur les grands électeurs lors des caucus.
Les jeunes se mobilisent peu à peu également. Ils font du porte à porte pour convaincre les gens de voter démocrate. Barack Obama se sent reconnaissant vis-à-vis de toutes ces personnes qui l’ont aidé.
Il prend progressivement confiance et réalise quelques performances oratoires qui mettent en danger Hilary Clinton. Il réussit, notamment, à se faire remarquer lors d’un événement important précédent le caucus.
Et c’est la victoire dans l’Iowa — le premier caucus de la campagne et symboliquement l’un des plus importants !
Chapitre 6
Mais rien n’est gagné. Bien sûr, Barack Obama fait maintenant figure de concurrent principal à Hillary Clinton. Mais celle-ci a encore des ressources et gagne le second caucus du New Hampshire.
Cela est partiellement dû à une erreur de Barack Obama durant un débat au cours duquel il défend — maladroitement — son opposante qui doit répondre à une question qu’il juge triviale et sexiste. Finalement, c’est lui qui se retrouve désavantagé par son propre geste.
Par ailleurs, Hilary Clinton parvient à convaincre les électeurs de son engagement lors d’une rencontre avec des sympathisants indécis. Cela aussi lui fait marquer des points.
L’auteur aborde aussi la question de la race, si présente aux États-Unis. Bien qu’il souhaite que le pays passe à autre chose et soit capable de prendre un chemin où les différences raciales ne soient plus déterminantes, il doit reconnaître que celles-ci ont parfois joué un rôle dans la campagne.
Il a parfois été l’objet de racisme dans certains quartiers blancs. Par ailleurs, il a reçu un large soutien (mais pas forcément unanime) de la communauté noire.
Des secousses ont lieu lorsque le magazine Rolling Stone publie un article contenant des propos controversés du pasteur de Barack Obama. Celui-ci doit se distancier de son ancien guide spirituel et se tourne vers l’ancien collègue de Martin L. King, Joseph Lowery.
La bataille pour la Caroline du Sud fut difficile et brutale. Bill Clinton aida son épouse, mais Barack Obama finit malgré tout par gagner cet État.
Chapitre 7
Le Super Tuesday est un jour très particulier dans la campagne des élections primaires, parce que c’est le jour où plus de la moitié des États votent pour élire les candidats de chaque parti.
Barack Obama, avec son équipe, choisit de se concentrer sur les États plus petits, ruraux et majoritairement blancs. C’est un pari risqué, mais qui fonctionne : cette stratégie lui permet de remporter un certain nombre d’États, dont l’Idaho.
C’est une victoire importante, car elle lui permet, avec cet État, de remporter plus de délégués que Clinton avec la victoire du New Jersey (pourtant 5 fois plus peuplé).
Il remporte finalement 13 des 22 élections du Super Tuesday, ce qui lui « rapporte » 13 délégués de plus qu’Hillary Clinton.
Toutefois, celle-ci se défend âprement et connaît même un moment de grâce peu après, tandis que Barack Obama doit répondre à certaines tentatives de déstabilisation de la part des républicains.
La présence de plus en plus marquée de Michelle Obama dans la campagne aide le candidat démocrate à se sentir en confiance. Celle-ci a du succès, elle touche le cœur d’une partie de l’électorat.
Les services secrets qui les protègent le surnomment le « renégat » en raison des menaces dont il fait l’objet constamment.
Finalement, la bataille démocrate se termine et il devient le candidat officiel du parti progressiste. Il prononce un discours en faveur d’un changement de politique et il se jure à lui-même, secrètement, qu’il ne laissera pas tomber ceux qui l’ont soutenu.
Chapitre 8
Désormais, Barack Obama doit affronter le candidat du parti républicain : John McCain. Contrairement à la tradition, il décide de mener sa campagne frontalement, en cherchant à convaincre directement les électeurs des États plus conservateurs.
Pour renforcer sa stature internationale et se doter des connaissances nécessaires, Barack Obama visite plusieurs pays, dont l’Irak, l’Afghanistan, Israël, Le Royaume-Uni et la France, entre autres.
Le futur président des États-Unis souhaite se retirer du Moyen-Orient, mais il doit prendre en considération des avis divergents. Un plan de route est mis en place dès cette époque, mais Barack Obama sait toutes les difficultés qui l’attendent s’il est élu.
Joe Biden, qui est un proche de la famille Obama, devient son colistier. Le fait que le candidat républicain choisisse Sarah Palin facilite les choses du camp démocrate. Bien que celle-ci fasse grand bruit auprès des républicains, elle n’est pas suffisamment préparée pour le poste.
Chapitre 9
La crise de 2008 — apparue d’abord dans le secteur immobilier dès 2007 — vient frapper de plein fouet la campagne présidentielle. Les banques et les entreprises de crédit sont au bord de la faillite et l’État doit intervenir. Il s’agit notamment de sauver les institutions « trop grosses pour couler » (too big to fail).
Barack Obama décide de soutenir le plan de G. W. Bush nommé Troubled Asset Relief Program (TARP) pour venir en aide à l’économie. Étonnamment, le candidat républicain reste sur la touche sur ce sujet, n’apportant aucune contribution significative au débat. Une version révisée du programme sera finalement adoptée.
La campagne se durcit et les propos des supporters républicains sont parfois violents. Mais la victoire de Barack Obama est proche et arrive finalement, peu après le décès de sa grand-mère bien-aimée, malheureusement.
Le premier président noir des États-Unis vient d’être élu. Le jour de l’élection, il est avec sa famille et son équipe pour célébrer l’événement. Mais ce sont des millions de personnes qui sont aussi virtuellement avec lui à ce moment-là.
Partie 3 — Une Terre Promise - Le renégat
Chapitre 10
Entrer dans le Bureau Ovale est une expérience spéciale pour Barack Obama. Il décrit la pièce en détail dans le début de ce chapitre du livre Une Terre promise.
Le nouveau président doit choisir ses collaborateurs, notamment au niveau économique et pour les services de la défense, qui sont les deux thèmes qui le préoccupent le plus (la crise économique et les guerres du Moyen-Orient).
Par ailleurs, il doit choisir un secrétaire d’État : il opte pour son ancienne rivale, Hillary Clinton.
Avant l’inauguration, Barack Obama effectue un séjour à Hawaï afin de se reposer et de livrer les cendres de sa grand-mère à l’océan.
Michelle Obama se prépare elle aussi. Elle cherche à créer un environnement stable et « normal » pour leurs filles, Malia et Sasha. Pour ce faire, elle parle notamment avec l’ex-Première dame, Laura Bush. Sa mère déménage également à la Maison-Blanche.
Barack Obama est à la fois :
Enthousiaste et heureux de commencer son nouveau travail ;
Nerveux et préoccupé par les défis qui l’attendent.
Dans ses discours, il cherche à prévenir ses concitoyens des difficultés économiques, mais il sait aussi que son élection a suscité beaucoup d’espoir et d’optimisme.
L’inauguration se passe sous tension, en raison d’un risque d’attaque terroriste. Ensuite, le couple se rend dans 10 bals organisés en l’honneur du nouveau président. C’est seulement alors que les Obama peuvent profiter d’une fête en famille.
Chapitre 11
Dans les premières semaines de son mandat, le président signe une série d’ordonnances pour interdire la torture et assurer une meilleure protection sanitaire pour les enfants, notamment.
L’économie est toutefois sa priorité numéro 1. Avec ses équipes, il monte un plan d’aide nommé American Recovery and Reinvestment Act. Celui-ci a pour but de rebooster l’économie en injectant de l’argent dans les services publics et en aidant les entreprises.
Il a besoin d’une large majorité de 60 votes au Sénat pour faire passer sa proposition. Il doit donc chercher à convaincre des républicains. Barack Obama raconte que 4 politiciens républicains en particulier ont joué un rôle important dans ses échecs et ses réussites. Il les nomme « The four Tops » (les 4 plus hauts).
Le Recovery Act fut très critiqué par le parti républicain, qui chercha à le rejeter et à obstruer toute avancée en ce sens. Pourtant, il finit par passer et ce fut une première victoire pour Barack Obama.
Chapitre 12
La crise financière n’en est pas pour autant finie. Obama lance deux programmes supplémentaires pour faire face à l’effondrement du marché du logement et du chômage :
Le Home Affordable Modification Program (HAMP), qui a réduit les paiements hypothécaires mensuels ;
Le Home Affordable Refinance Program (HARP), qui permet aux emprunteurs de refinancer leurs prêts hypothécaires à des taux plus bas.
Il reçoit des critiques venues de la droite, qui considèrent qu’il ne faut pas aider les gens qui se sont endettés. Mais Barack Obama trouve cela profondément hypocrite : ces experts conservateurs ou néolibéraux n’ont rien dit lorsqu’il a été question de sauver les banques, mais ils refusent d’aider les plus petits à survivre !
Ces premières semaines sous haute tension sont épuisantes.
Michelle Obama cherche aussi à trouver sa place. Elle choisit de se consacrer à 2 missions :
La lutte contre l’épidémie d’obésité ;
L’aide aux familles des militaires.
Le couple trouve des moyens pour gérer au mieux le stress en se créant des routines quotidiennes. Barack Obama trouve même la volonté pour arrêter de fumer ; une mauvaise habitude qui contrariait beaucoup sa femme !
D’un point de vue politique et économique, Barack Obama parvient à gérer la crise financière durant les 100 premiers jours qui suivent l’investiture. Toutefois, cela se paie de nombreuses critiques, tant sur le côté « gauche » que sur le côté « droit ».
Chapitre 13
Le chapitre 13de Une Terre promise est consacré à l’effort de guerre et à la volonté de Barack Obama de concilier 2 rôles essentiels :
La protection des Américains contre les menaces (notamment terroriste) ;
L’engagement des États-Unis vis-à-vis de la liberté.
Protéger ses concitoyens est, selon l’auteur, la tâche la plus importante. Mais cela ne doit pas se faire au prix d’une privation des libertés ou de l’imposition d’un ordre injuste à d’autres nations.
Pour résoudre ce difficile conflit, Barack Obama choisit de se doter d’une équipe d’internationalistes, c’est-à-dire de personnes qui croient dans le leadership américain en vue d’améliorer la situation mondiale.
En Irak, Barack Obama reste sur sa promesse de campagne et s’engage en faveur d’un retrait des troupes pour 2011.
Les choses sont différentes en Afghanistan. Poussé par les généraux du Pentagone à accroître le nombre de troupes, Barack Obama déploie 17 000 soldats supplémentaires en Afghanistan. En parallèle, il cherche aussi à renforcer le rôle et le pouvoir du gouvernement afghan, ainsi que de la police et de l’armée.
Partie 4 — La bonne lutte
Chapitre 14
Dans ce chapitre de son livre Une Terre promise, Barack Obama parle de son expérience sur la scène internationale et tout particulièrement du sommet du G20. Il parvient à trouver un accord avec l’Europe concernant la crise économique, mais doit convaincre l’Allemagne et la France plus longtemps que l’Angleterre.
Finalement, un accord équilibré est trouvé, qui inclut aussi les pays des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).
À cette occasion, il rencontre également le président russe Dmitry Medvedev afin de limiter la prolifération des armes nucléaires.
Dans la foulée de son tour européen, le président se rend également en Irak pour soutenir les troupes américaines encore sur place.
Dans l’ensemble, le voyage est considéré comme un succès par les médias.
Chapitre 15
La lutte contre le terrorisme est l’un des enjeux clés de la présidence de Barack Obama.
C’est elle qui a fourni la justification des guerres en Afghanistan et en Irak à l’époque de G. W. Bush. Mais la bataille contre Al-Qaïda est devenue de plus en plus complexe au fil du temps.
Terroristes et services de sécurité jouent au chat et à la souris, cherchant à déjouer les astuces ou les nouveautés technologiques des uns ou des autres. Barack Obama insiste sur les efforts des différentes institutions :
L’Agence de sécurité nationale (NSA) utilise des superordinateurs et une technologie de déchiffrement pour détecter les communications terroristes.
Les équipes Navy SEAL et les forces spéciales de l’armée effectuent des raids de précision à l’intérieur et à l’extérieur des zones de guerre
La CIA développe de nouvelles façons de recueillir et d’analyser les renseignements.
La Maison-Blanche elle-même s’adapte à l’ennemi, qui est en constante évolution.
Chaque mois, Barack Obama organise une réunion dans une salle spéciale où il réunit toutes les agences de renseignement pour examiner le développement des opérations et assurer la coordination. De cette façon, le président cherche à améliorer la coordination entre les différentes agences.
Il veut également fermer le camp de prisonniers de Guantanamo.
Barack Obama cherche également à communiquer autour de ces thématiques, à l’intérieur du pays comme à l’international. Il prononce notamment 2 discours sur l’Islam.
Le premier, pour le peuple américain, vise à reconnaître les contributions des civilisations islamiques à la science, aux mathématiques et à l’art. Il cherche aussi à rendre compte du rôle du colonialisme et de l’Occident dans les luttes et les problèmes actuels.
Le second, prononcé au Caire, met l’accent sur la démocratie, les droits de l’homme, les droits des femmes, la tolérance religieuse, la nécessité de paix en Israël et la création d’un État palestinien autonome.
Chapitre 16
Barack Obama aborde ensuite la question des soins de santé. Ce que nous connaissons en Europe sous le nom d’Obama Care (un nom qui lui a en fait été donné par ses opposants du Tea Party !) est l’une des grandes réformes de son premier mandat. Comment cette politique a-t-elle pris naissance ?
Le président organise une conférence préliminaire sur le sujet auquel assiste le sénateur Ted Kennedy. Pour celui-ci, l’heure de l’assurance santé universelle est venue. Il insiste pour que Barack Obama saisisse l’occasion de faire l’histoire en cette matière.
En 2008, plus de 43 millions d’Américains n’avaient pas d’assurance maladie. Comme il bénéficie d’une large majorité démocrate, le gouvernement Obama peut agir : il conçoit l’Affordable Care Act (ACA).
Le président doit lutter contre les compagnies d’assurance et l’industrie pharmaceutique, qui font de la résistance, mais il ne lâche pas. Pour reconstruire le système de soins de santé, il s’inspire de celui conçu par Mitt Romney pour le Massachusetts et lui apporte les évolutions ou corrections nécessaires à son implémentation nationale.
Ceux qui n’ont pas d’assurance fournie par le travail ou qui ne peuvent pas se permettre de souscrire eux-mêmes à une assurance reçoivent, grâce au système mis en place, un financement pour acheter une couverture santé.
Les marchés en ligne permettent aux consommateurs de comparer les assurances et de contracter celle qui est la plus intéressante pour eux. D’un autre côté, les compagnies d’assurance se voient interdites de refuser un contrat aux personnes en situation difficile.
Alors qu’il donnait une conférence de presse sur le sujet, un journaliste du Chicago Sun-Times a posé une question hors sujet sur Henry Louis Gates Jr., un professeur noir de Harvard arrêté devant sa maison de Cambridge.
Barack Obama répond que les policiers qui ont arrêté le professeur ont eu un comportement « stupide ». Cette réponse crée une réaction en chaîne : non seulement son propos sur les soins de santé passe inaperçu, mais il met aussi en colère les syndicats de police qui l’accusent d’élitisme.
Ce bref commentaire a eu un impact sérieux sur la sympathie d’une partie de l’électorat blanc à l’égard de Barack Obama.
Chapitre 17
L’ACA est soumis au Comité « Santé et éducation » du Sénat et à la Chambre des représentants. Dernière étape : passer devant le Comité sénatorial des finances, dirigé par le démocrate Max Baucus. Obama est optimiste et envisage de signer le projet avant la fin de l’année 2009, mais son collègue cherche à obtenir un plus large accord, notamment dans les rangs républicains.
Toutefois, la montée en puissance du Tea Party change la donne. Ce parti antifiscal, anti-régulation et antigouvernemental a non seulement surnommé l’ACA « Obamacare », mais le présente dans les médias comme un projet de loi socialiste qui changera l’essence même du pays.
Par ailleurs, les membres de ce parti politique n’hésitent pas à se salir les mains : ils répandent des théories du complot sur l’euthanasie ou encore sur les origines et la confession religieuse de Barack Obama.
Face à ces menaces, M. Baucus décide de faire avancer le projet de loi au sein du Comité sénatorial des finances. Trois semaines plus tard, le projet sera voté sur le fil.
Pour convaincre les citoyens, Barack Obama prononce un discours aux heures de grande écoute, juste avant une session du Congrès, pour vanter les avantages de l’ACA. Cela fonctionne assez bien, puisque le soutien de la population américaine au projet augmente, selon les sondages.
Finalement, c’est un projet plus souple et moins ambitieux que prévu qui passe le 21 mars 2010. Barack Obama voulait faire plus, mais il a dû faire avec la diminution de l’influence démocrate au Sénat (en raison, notamment, de la mort de Ted Kennedy et de la prise de son siège par un républicain).
Partie 5 — Une Terre Promise - Le monde tel qu’il est
Chapitre 18
Dans ce chapitre de Une Terre promise, Barack Obama revient sur la guerre en Irak et en Afghanistan. Il doit travailler avec des collaborateurs républicains pour gérer au mieux la crise. Parmi les objectifs à atteindre en Irak, il y avait :
Le renforcement des institutions irakiennes ;
L’entraînement des forces de sécurité du pays ;
La reconstruction des infrastructures.
Le départ d’Irak pouvait être envisagé avec plus de sérénité, mais la situation afghane était bien plus compliquée. Attentats suicides et corruption, notamment, gangrènent le pays. Le Pakistan n’aide pas en fournissant aux Talibans et à Al-Qaïda des bases de repli.
Le général Stanley McChrystal, fraichement nommé, recommande une contre-offensive, qu’il relaye même dans les médias afin de pousser le président à sortir de sa réserve. Plus généralement, c’est l’armée elle-même qui fait pression pour qu’une décision musclée soit prise.
Barack Obama doit sévir auprès de certains responsables militaires pour ce type de comportement. Le fossé se creuse entre la Maison-Blanche et le Pentagone. Toutefois, après de nombreux débats, Barack Obama autorise un plan visant à envoyer 30 000 soldats supplémentaires en Afghanistan, tout en imposant un calendrier de retrait des troupes.
Le mois suivant, il reçoit le prix Nobel de la paix.
Chapitre 19
La diplomatie est un point important de la présidence Obama. Le président cherche, tout au long de ces deux mandats, à renouer les liens parfois distendus avec les autres nations du globe. Il a agi pour la coopération internationale en promouvant auprès de ces équipes les valeurs d’intérêt mutuel et de respect.
Lui-même, lors de ces déplacements, veut montrer l’exemple. Il visite d’ailleurs des pays négligés par l’ancien président et souhaite rencontrer non seulement les hauts fonctionnaires, mais aussi les jeunes des contrées dans lesquelles il se rend. C’est un succès, puisque l’image des États-Unis dans le monde s’améliore nettement.
Cependant, la diplomatie a ses limites. Pour les problèmes plus sérieux, Barack Obama utilise un système ancien de récompenses et de punitions pour influencer l’action des leaders d’autres pays. C’est ce qu’il met en place avec l’Iran.
Sa stratégie pour pousser le président Mahmoud Ahmadinejad à restreindre son programme de développement nucléaire est décomposée en 2 temps.
Premièrement, il envoie une lettre secrète à l’ayatollah Khamenei pour ouvrir le dialogue sur les questions qui intéressent les deux pays ; celui-ci la rejette (comme s’y attendait Barack Obama).
Deuxièmement, le président utilise les instances internationales pour mettre en place des sanctions économiques qui pousseront l’Iran à se mettre à la table des négociations.
Barack Obama a toutefois besoin d’un allié de taille : la Russie. Il rencontre d’abord Dmitry Medvedev, puis Vladimir Poutine. Lorsque le président américain demande à son homologue son avis sur les relations entre les États-Unis et la Russie, celui-ci commence à faire la liste de toutes les injustices et trahisons qui ont été commises, en particulier au temps de son prédécesseur, George W. Bush.
Selon Vladimir Poutine, G. W. Bush n’a pas accepté la main tendue qui lui était proposée après le 11 septembre. En plus, il a tendu les relations de façon encore plus extrême lorsqu’il a décidé de se retirer du traité sur les missiles antibalistiques et de faire héberger des systèmes de défense antimissile aux frontières de la Russie.
Barack Obama s’efforce de répondre point par point, mais la discussion devient de plus en plus difficile. Il quitte la Russie inquiet. Que deviendra le pays sous l’influence grandissante de son président ?
Chapitre 20
Le chapitre 20 de Une Terre promise poursuit la discussion sur les manœuvres diplomatiques d’Obama pour freiner le programme nucléaire iranien. L’Iran insiste sur le fait que ses équipements et ses stocks d’uranium enrichi sont utilisés à des fins civiles.
Or, c’est faux. Mais ce prétexte fournit des raisons suffisantes à la Russie et à la Chine pour bloquer les sanctions auprès du Conseil de sécurité de l’ONU.
Barack Obama et ses équipes doivent donc continuer à travailler sur ces 2 fronts : russe et chinois.
Sur le front russe, le président révèle des informations secrètes à la Russie qui déstabilisent la relation entre ce pays et l’Iran. Au niveau de la Chine, Barack Obama doit négocier avec le président Hu Jintao. Outre la question iranienne, ils doivent notamment parler des conflits commerciaux et de la Corée du Nord.
Il en appelle par ailleurs à l’intérêt propre des Chinois, en avertissant Hu Jintao que les États-Unis ou les Israéliens pourraient être contraints de frapper les installations nucléaires iraniennes. Or, cela aurait un impact négatif sur les approvisionnements pétroliers chinois.
Les résultats de ces ouvertures diplomatiques avec la Chine apparaissent au printemps 2010. Mais c’est à l’été que les résultats concernant la question iranienne se font jour : la Russie et la Chine acceptent de voter de nouvelles sanctions contre l’Iran au Conseil de sécurité de l’ONU.
Chapitre 21
Dans le chapitre 21 du livre Une Terre promise, Barack Obama fait le bilan sur ses politiques en matière d’environnement :
Nomination de Carol Browner, ancienne chef de l’Agence de protection de l’environnement, à ses côtés pour gérer ses questions ;
Proposition d’un programme complet de réduction de 80 % des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis d’ici 2050 ;
Transformation du secteur de l’énergie en créant un fonds pour développer la recherche et le développement d’énergies propres. Cela conduit à une forte baisse du coût des sources d’énergies renouvelables.
Il souhaite aussi influencer les pays les plus polluants à signer un accord international sur le climat.
Création de réglementations fédérales, notamment concernant les normes de kilométrage et les normes d’efficacité énergétique.
Les républicains ne lui facilitent pas la tâche, mais après un long lobbying et la réalisation de compromis, il parvient à faire passer son projet de loi sur le climat à la Chambre. Huit républicains modérés votent en faveur du projet de loi. Après d’intenses discussions, le Sénat adoptera lui aussi un projet de loi modifié.
Au niveau international, Barack Obama se bat pour que les pays les plus riches fournissent une aide financière aux pays les plus pauvres, tant que ceux-ci respectent leurs engagements en matière de changement climatique.
Le sommet mondial des Nations Unies sur le changement climatique de 2009, la 15 COP, se tient à Copenhague. Les dirigeants européens, dont Angela Merkel, expriment leur frustration vis-à-vis de l’attitude du président des États-Unis, car ils cherchent à définir des objectifs plus ambitieux.
Même si la conférence est considérée comme un échec, Barack Obama se félicite d’avoir finalement pu signer un accord (très peu contraignant) avec les pays européens et les autres nations du monde, notamment les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud).
Partie 6 — Une Terre Promise - Dans le tonneau
Chapitre 22
La politique du président Obama doit faire face à des critiques de plus
en plus vives, principalement du côté du parti républicain et de son aile droite du Tea Party. Il perd en popularité dans les sondages. La presse aussi devient plus critique.
Le plus gros problème d’Obama, cependant, demeure l’économie. Il sait que de nombreux foyers risquent de perdre leurs économies et leur maison. Il doit faire face aux tentatives de réduire les aides financières qui sont octroyées, car les républicains les considèrent comme dangereuses pour la santé budgétaire du pays.
En 2010, l’économie des États-Unis se porte mieux. Mais ce n’est pas gagné. La récession européenne crée un effet d’aspiration qui nuit au décollage américain. La dette grecque est particulièrement problématique. Contre ses homologues français et allemand, qui préfèrent jouer l’austérité, Barack Obama plaide pour un plan d’aide à la Grèce visant à stabiliser l’économie.
Dans le même temps, le président américain cherche aussi à faire passer son plan de réforme de Wall Street. L’objectif ? Réduire la possibilité des crises financières de cette nature à l’avenir et responsabiliser les institutions marchandes.
Le processus législatif est complexe et oblige à des compromis. Au final, la loi passe durant le mois de juillet. Elle diffère assez substantiellement de la proposition originale, mais contient, selon le président, de bonnes et importantes mesures. Malheureusement, ce travail reste invisible aux yeux du public et Barack Obama ne peut donc en profiter pour remonter dans les sondages.
Chapitre 23
En avril 2010, la catastrophe environnementale de Deepwater Horizon, la plateforme de forage pétrolier, frappe les côtes américaines. C’est le plus grand déversement de pétrole dans la mer de l’histoire des États-Unis. 11 travailleurs de BP sont morts et au moins 4 millions de barils de pétrole se sont déversés dans le golfe du Mexique.
Barack Obama envoie des experts pour coordonner l’effort de nettoyage, qui s’avère particulièrement complexe puisque les fuites se situent au fond de l’océan.
Peu à peu, la presse et le public commencent à rejeter la faute sur le président lui-même. Celui-ci aurait fait preuve de laxisme en autorisant ces forages et en minimisant les questions de sécurité. La publication de vidéos en temps réel des fuites n’arrange pas les choses. La colère gronde.
Ne pouvant stopper totalement les fuites dans un premier temps, l’administration Obama se concentre sur la prévention de futurs incidents. Le président annonce la formation d’une commission chargée d’établir des lignes directrices en matière de sécurité.
Il veille également à ce que BP (l’entreprise responsable de la fuite) tienne sa promesse d’indemnisation vis-à-vis des personnes touchées par le sinistre.
Finalement, l’équipe d’experts parvient à boucher la fuite et les travaux de nettoyage sont entrepris.
Barack Obama aborde ensuite les élections de mi-mandat. Cette catastrophe, cumulée avec une économie encore fragile et des troupes militaires toujours engagées à l’étranger, crée un risque pour les démocrates.
Par ailleurs, les républicains attaquent la décision du président de libérer et rapatrier chez eux des détenus du camp de Guantanamo. Ils jouent toujours sur la même carte : Barack Obama serait trop laxiste vis-à-vis du terrorisme.
Les élections de mi-mandat rendent leur verdict : en perdant 63 sièges à la Chambre, les démocrates perdent leur contrôle du Congrès.
Chapitre 24
Bien sûr, Barack Obama est déçu de perdre le Congrès. Mais il n’en demeure pas moins déterminé à agir en fonction de son programme et des convictions politiques. Il se promet de trouver le moyen de renouer le dialogue avec les Américains. Par ailleurs, il va devoir réapprendre à négocier avec les républicains.
Lors de la seconde partie de son mandat, il cherche à faire avancer 4 initiatives qui lui tiennent à cœur :
La ratification de New START, un accord de non-prolifération nucléaire qu’il a négocié avec la Russie.
L’abrogation de Don't Ask, Don't Tell, une loi interdisant aux personnes LGBTQ de servir ouvertement dans l’armée.
Un projet de loi de réforme de l’immigration appelé la loi DREAM, qui établit une voie vers la citoyenneté pour les enfants d’immigrants sans papiers.
Un projet de loi sur la nutrition des enfants dirigé par Michelle.
À l’exception notable de la loi DREAM, toutes les initiatives furent adoptées par le Congrès après d’intenses débats.
Autre point du programme : la réduction des impôts pour la classe moyenne et leur augmentation pour les riches. Toutefois, la crise de 2008 modifie la donne. Augmenter les impôts, pense-t-il, serait trop risqué.
Joe Biden négocie avec les républicains pour permettre aux plus pauvres de bénéficier des prestations de chômage d’urgence et du crédit d’impôt.
Barack Obama fait également appel à l’ancien président Bill Clinton pour un point de presse impromptu. Celui-ci l’aide à faire passer l’accord fiscal proposé par son administration et à calmer les critiques venues des médias.
Partie 7 — Une Terre Promise - Sur la corde raide
Chapitre 25
Les événements au Moyen-Orient font la une de l’actualité en 2010 : le conflit israélo-arabe qui s’enlise à nouveau et le printemps arabe.
Sur le premier volet, Barack Obama réaffirme son engagement pour faciliter la paix entre Israël et la Palestine. C’est, selon lui, à la fois comme un impératif moral et une obligation pour la sécurité nationale.
Un travail diplomatique est entrepris par Bill Clinton pour mettre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas à la table des négociations.
En parallèle, le président lui-même négocie un arrêt temporaire de la construction de nouvelles colonies en Cisjordanie et organise la première réunion entre Netanyahou et Abbas à l’Assemblée générale des Nations Unies.
Toutefois, des tensions resurgissent lorsque les parties apprennent que Netanyahou a autorisé de nouvelles colonies à Jérusalem-Est. Le processus de paix est de nouveau au point mort. Abbas accepte par la suite de revenir à la discussion grâce à l’intervention du président égyptien Hosni Moubarak et du roi Abdallah de Jordanie.
Barack Obama accueille les trois chefs d’État aux côtés de Netanyahou, lors d’un dîner privé à la Maison-Blanche pour lancer les pourparlers. Deux rencontres entre Israéliens et Palestiniens ont lieu dans les jours qui suivent. Malheureusement, Israël refuse de prolonger le gel de la colonisation des terres palestiniennes, brisant les espoirs de l’administration Obama de parvenir à un accord de paix.
Qu’en est-il du Printemps arabe ? Cette série de soulèvements antigouvernementaux a commencé en décembre 2010, en Tunisie d’abord, puis en Égypte, en Syrie, en Lybie et au Bahrain. Les répressions sont violentes.
Dans son discours sur l’état de l’Union de la fin de l’année, Barack Obama affirme son soutien au peuple tunisien et à tous ceux qui promeuvent la démocratie. Il s’indigne également publiquement de la violence du gouvernement Mubarak en Égypte et ailleurs. Il appelle à la démission de Muammar Gaddafi en Lybie, mais résiste à l’idée d’envoyer de nouvelles troupes américaines sur place.
Chapitre 26
Le chapitre 26 de Une Terre promise aborde 2 questions principales :
Le problème de Kadhafi ;
L’obstructionnisme républicain.
Les objectifs d’Obama en Libye sont d’empêcher le massacre de civils et de donner aux Libyens une chance de créer un nouveau gouvernement. À cette fin, son équipe élabore un plan permettant aux États-Unis et à leurs alliés d’attaquer les forces de Kadhafi.
L’ambassadeur des États-Unis auprès de l’ONU distribue un projet de résolution parmi les membres du Conseil de sécurité. Le président russe émet des réserves, mais il n’y oppose pas son veto. Tous les éléments de l’opération sont mis en place très rapidement.
Les troupes libyennes entrent à Benghazi, ce qui incite Obama à répondre. Des navires de guerre américains et britanniques tirent des missiles Tomahawk et détruisent les défenses aériennes libyennes. Les avions à réaction européens ciblent les forces qui avançaient sur Benghazi. L’armée de Kadhafi se retire en quelques jours.
Malgré le succès de la mission, l’opération libyenne se transforme en un problème de relations publiques pour le président américain.
À l’étranger, Vladimir Poutine critique la résolution, malgré le soutien implicite de Dmitri Medvedev.
À l’intérieur, les républicains se montrent critiques et mettent en doute la légalité de l’opération.
Les problèmes créés par les républicains ne s’arrêtent pas là. Comme ils contrôlent le Congrès, ils cherchent à freiner les dépenses gouvernementales, ce qui met en danger les plans de Barack Obama en matière de reprise économique. Ils menacent aussi d’empêcher l’administration Obama de payer la dette du pays.
Mais ce n’est pas tout : Donald Trump commence à avoir du succès et à diffuser des idées fausses sur les origines de Barack Obama. La Maison-Blanche décide de rester silencieuse pour ne pas mettre de l’huile sur le feu, mais les sondages montrent que 40 % des républicains croyaient à ces mensonges.
Chapitre 27
Le dernier chapitre de Une Terre promise, porte sur l’opération visant à éliminer Oussama ben Laden, le cerveau des attentats du 11 septembre. C’était une promesse de longue date de Barack Obama et un point clé de son mandat.
Pour lui, c’est une priorité absolue pour 3 raisons :
Ben Laden était une source de douleur pour ceux qui ont perdu des êtres chers le 11 septembre.
Il était le recruteur le plus efficace d’Al-Qaïda.
L’élimination de Ben Laden réoriente la stratégie antiterroriste du pays.
En effet, Barack Obama préfère se concentrer sur les terroristes responsables du 11 septembre, plutôt que sur la poursuite d’une guerre ouverte contre le terrorisme en général.
La première avancée significative de cette opération intervient peu après le neuvième anniversaire du 11 septembre. La CIA identifie un grand complexe dans un quartier aisé d’Abbottabad, au Pakistan. Elle pense qu’il s’agit de la cachette de Ben Laden.
L’un des résidents, un grand homme surnommé le Pacer, ne quitte jamais le bâtiment. Barack Obama a alors 2 options :
Lancer un raid aérien ;
Préparer une mission d’opérations spéciales terrestre.
Il choisit la seconde.
Pendant le temps de la préparation et de l’entraînement des équipes, Barack Obama veille à répondre aux allégations de Donald Trump en publiant son certificat de naissance dans la presse.
Le lendemain, il doit choisir. L’identité du Pacer demeure incertaine. Faut-il attaquer ou non ? Dans son équipe rapprochée, Bill Clinton y est favorable, mais Joe Biden cherche à l’en dissuader. Il décide d’y aller.
Pendant que l’opération est en cours, il effectue plusieurs voyages intérieurs :
Il se rend en Alabama pour se rendre compte des dommages causés par une tornade ;
À Cap Canaveral pour le lancement final de la navette spatiale Endeavor ;
Enfin, il prononce un discours au Miami Dade College.
Le lendemain, il participe au dîner des correspondants de la Maison-Blanche, où il fait un petit discours au cours duquel il se moque ouvertement de Donald Trump, présent dans la salle.
Le lendemain matin — le 2 mai 2011 —, une équipe SEAL lance la phase finale de l’opération Neptune. Barack Obama et ses conseillers observent le cours des événements dans la salle de crise.
Après une longue période de silence, ils entendent les mots « Geronimo ID'd » et « Geronimo EKIA » (ennemi tué en action). Près de dix ans après avoir orchestré les attentats du 11 septembre, Ben Laden est exécuté par les services américains.
Conclusion sur « Une Terre promise » de Barack Obama :
Ce qu’il faut retenir de « Une Terre promise » de Barack Obama :
Une Terre Promise est faite pour celles et ceux qui aiment la politique et veulent entrer dans les coulisses de la Maison-Blanche durant la présidence de Barack Obama. L’auteur y traite une grande variété de thèmes politiques et sociaux sur plus de 900 pages !
Il fait part de ses raisons pour agir, de ses doutes, de ses émotions aussi. Vous y découvrirez mieux le personnage et ses traits de caractère.
La structure de Une Terre promise est très bien pensée, ce qui permet de suivre les débuts de Barack Obama, puis d’entrer dans tout l’univers des élections : d’abord étatiques, ensuite fédérales. Le récit de la course à la Maison-Blanche est particulièrement passionnant.
À partir de là, le récit s’attache aux principaux aspects du premier mandat de Barack Obama. Les chapitres oscillent entre questions d’ordre intérieur — crise économique, catastrophes, conflits avec les républicains — et les problématiques de politique étrangère ou internationale — guerres, enjeux environnementaux, etc.
La plume de l’ancien président est toujours simple et alerte. Il cherche à nous faire comprendre ses dilemmes et à nous faire voir ce que c’est que d’être président des États-Unis, sans nous bombarder de termes experts ou de trop d’informations.
Les points forts et les points faibles du livre
Points forts de Une Terre promise :
Une porte d’entrée dans le Bureau Ovale ;
Une façon efficace de créer plus d’intimité avec l’ancien président des États-Unis ;
De nombreux rappels historiques qui permettent de mieux comprendre l’Histoire.
Points faibles de Une Terre promise :
Un pavé — attention à la tendinite !
Ma note après la lecture de Une Terre promise :
★★★★★
Le petit guide pratique du livre Une Terre promise de Barack Obama
Les grands axes du livre Une Terre promise de Barack Obama
Crise économique
Terrorisme
Montée en puissance de la droite conservatrice de Donald Trump
Foire Aux Questions (FAQ) du livre Une Terre promise de Barack Obama
- Comment le public a accueilli le livre Une Terre promise de Barack Obama ?
Une terre promise a bien été accueilli par le public. Le livre s’est rapidement imposé et est très vite devenu un best-seller après sa parution. Le livre a été très bien accueilli par le public.
- Quel fut l’impact du livre Une Terre promise de Barack Obama ?
Le livre a eu une influence considérable sur le public. Il a stimulé des débats sur la politique américaine, et a fourni un contexte historique précieux. Il a également incité les lecteurs à s'impliquer davantage dans la vie publique.
- À qui s’adresse le livre Une Terre promise de Barack Obama ?
Le livre de Barack Obama « Une Terre Promise » s'adresse à un large public, en particulier à ceux qui s'intéressent à la politique et à l'histoire récente des États-Unis. Il s'adresse également à ceux qui ont suivi la présidence de Barack Obama ou qui souhaitent en savoir plus sur son parcours en tant que 44e président des États-Unis.
- Qu’est-ce que le super Tuesday ?
Le Super Tuesday est un jour très particulier dans la campagne des élections primaires. C’est le jour où plus de la moitié des États votent pour élire les candidats de chaque parti.
- Quels sont les objectifs du président Obama en Irak
Le renforcement des institutions irakiennes
L’entraînement des forces de sécurité du pays
La reconstruction des infrastructures
Les 2 programmes supplémentaires de Barack Obama vs Les 2 missions de Michelle Obama
Deux programmes de Barack Obama Deux missions de Michelle Obama
Le Home Affordable Modification Program (HAMP) La lutte contre l’épidémie d’obésité
Le Home Affordable Refinance Program (HARP) L’aide aux familles des militaire
Qui est Barack Obama ?
Barack Obama est un homme politique américain né à Honolulu (Hawaï) en 1961. Il a été le 44ᵉ président des États-Unis, pendant deux mandats, de 2009 à 2017. Barack Obama a acquis une certaine notoriété en tant que premier président afro-américain. Au cours de sa présidence, il a dû relever des défis tels que la crise financière mondiale, la réforme du système de santé et la lutte contre le terrorisme. Ses réalisations comprennent l'adoption de la loi sur les soins abordables (Obamacare), la reprise économique et la normalisation des liens avec Cuba. M. Obama est également connu pour son attitude calme et réfléchie, ses talents d'orateur et son plaidoyer en faveur de l'inclusion et de la diversité. Il est resté actif dans la vie publique depuis la fin de son mandat et a écrit un certain nombre de livres à succès dont « Une Terre promise ».
Avez-vous lu le livre de Barack Obama « Une Terre promise » ? Combien le notez-vous ?
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Barack Obama « Une Terre promise »
Visitez Amazon afin d’acheter le livre de Barack Obama « Une Terre promise »
Cet article Une Terre promise est apparu en premier sur Des livres pour changer de vie.
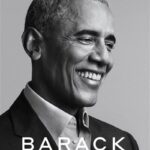 ]]>
]]>Chronique et résumé de « Devenir » de Michelle Obama : l'autobiographie de la Première dame des États-Unis vous fait entrer dans l'intimité du couple le plus glamour de la Maison-Blanche et dans les coulisses des décisions politiques les plus importantes de la fin du XXe siècle.
Michelle Obama, 2018, 520 pages.
Titre original : Becoming (2018).
Chronique et résumé de « Devenir » de Michelle Obama
Première partie — Devenir moi
Chapitre 1
Michelle Robinson naît le 17 janvier 1964 à Chicago. Ses parents, Fraser et Marian Robinson, louent un appartement au-dessus de celui de ses oncle et tante, Terry et Robbie. Or, il se trouve que cette dernière est professeure de piano.
Bientôt, Craig, le frère aîné de Michelle, commence à prendre des cours. Bien sûr, celle-ci veut l’imiter ! De façon générale, toute la famille adore la musique et l’ancienne Première Dame se souvient en particulier du premier album que l’un de ses oncles lui a offert : Talking Book de Stevie Wonder.
Michelle Obama raconte également plusieurs anecdotes intéressantes à propos des cours de piano. Elle se souvient qu’elle se repérait sur le clavier parce que l’une des notes — un do au milieu du clavier — était légèrement cassée.
Elle se rappelle aussi qu’elle fait rapidement des progrès et qu’elle veut aller plus loin. Pourtant, Robbie l’empêche parfois de jouer les morceaux dont elle a envie, parce qu’elle pense qu’elle n’est pas encore prête. Son père et sa mère regardent ces conflits avec une curiosité amusée.
Lors d’un récital annuel organisé par sa tante, toute la famille est réunie dans le grand hall où l’événement a lieu. Son père, atteint d’une sclérose en plaques, ne peut guère marcher longtemps et il faut donc garer sa Buick le plus près possible de l’entrée.
Au début de la représentation, Michelle Obama est perturbée : elle ne retrouve plus le do ébréché qui lui servait de point de référence ! Heureusement, Robbie lui montre la bonne position et la petite fille se met à jouer pour son public.
Chapitre 2
À l’école, Michelle Obama est rapidement une bonne élève : faisant preuve d’une grande soif d’apprendre, elle saute une classe et se retrouve avec des gens plus calmes, ce qu’elle préfère.
Son grand frère est un modèle à bien des égards pour elle. Il joue très bien au basket et se fait des amis très facilement. La petite fille, quant à elle, est un peu plus réservée. Pourtant, vers 9 ans, elle parvient à se faire respecter par une dure à cuire et se lie d’amitié avec elle.
Son père travaille dans une usine de filtration d’eau et gagne correctement sa vie. Sans être riches, les Robinson s’en sortent correctement. Chaque année, toute la famille se retrouve une semaine dans un centre de vacances où tous peuvent s’amuser dans la piscine et oublier la maladie et les soucis du quotidien.
Même si elle a une enfance paisible, le racisme est présent dans l’enfance de Michelle Obama. Un jour, alors qu’ils visitent des amis dans une banlieue riche plutôt peuplée de blancs aisés, la voiture de son père se fait vandaliser.
Chapitre 3
Malgré sa maladie, le père de Michelle Obama cherche à se rendre utile et à participer à la vie de sa communauté. Il se porte notamment volontaire pour aider le parti démocrate dans sa circonscription.
Lors de ses tournées de quartier, sa fille l’accompagne. Sur le moment, elle est réticente ; mais à postériori, elle reconnaît que cela l’a aidé à devenir plus sociable.
Michelle Obama parle également de ses grands-parents :
Southside, le grand-père maternel, est un grand fan de musique et de fêtes familiales. Il lui offre également un chien qui reste chez lui… mais qui est le sien !
Dandy, le grand-père paternel, est un homme en colère contre ses proches et contre le monde en général.
Michelle Obama ose parfois lui répliquer. Elle trouve en effet révoltant qu’il s’en prenne à sa femme, LaVaughn, qui gère avec succès une librairie. Selon elle, l’amertume de Dandy vient des échecs universitaires et professionnels auxquels il a dû faire face.
Un jour, l’un de ses cousins lui demande pourquoi elle parle « comme une Blanche ». Cela l’étonne sur le moment. En fait, elle se rappelle que sa famille l’a toujours incité à parler un anglais correct, bien articulé.
Il est étrange que cela éveille encore le soupçon ! Barack Obama lui-même, lorsqu’il deviendra président, devra répondre à des questions de ce genre.
Chapitre 4
Les Blancs et Noirs les plus riches quittent le quartier dans le 4e chapitre du livre Devenir. Cet exode se ressent au niveau scolaire. Sa mère, Marian, cherche à maintenir le niveau d’enseignement en :
Récupérant des fonds pour acheter des équipements ;
Organisant des repas pour les professeurs ;
Soutenant un programme pour les élèves doués.
Michelle Obama participe à ce programme et s’en sort très bien. Marian est une épouse et un parent attentif et qui prend soin de toute la famille du mieux qu’elle peut, même si elle voudrait bien parfois s’enfuir.
Adolescente, Michelle Obama fréquente beaucoup deux sœurs, qui sont devenues ses meilleures amies. Elles font du shopping, s’intéressent aux garçons. Elle se souvient de son premier baiser. Ainsi que des commentaires et des regards qui peuvent, parfois, s’avérer indésirables.
Désormais, Craig et Michelle ne partagent plus leur chambre. Cela permet encore davantage à la jeune fille de prendre son autonomie.
Chapitre 5
Pour subvenir aux besoins de la famille et à l’éducation des enfants, Marian travaille comme assistante de direction.
Ses parents envoient Craig dans un lycée catholique à majorité blanche où il peut étudier de façon sérieuse tout en jouant au basket.
Michelle Obama entre quant à elle au lycée Whitney Young. Assez éloignée de chez elle, cette école accueille principalement des élèves noirs et hispaniques.
Par ailleurs, elle se souvient que l’intelligence y est perçue positivement. La jeune fille cherche à faire aussi bien que les meilleurs.
Au cours de sa scolarité, Michelle Obama se lie d’amitié avec Santita Jackson. Santita est la fille du révérend Jesse Jackson, le leader des droits civiques. Elle se souvient de certaines réunions publiques où elle et son amie se retrouvaient prises dans la foule.
C’est là, dit-elle, qu’elle s’est aperçue que la vie politique n’est pas ordonnée et prévisible comme elle le souhaiterait.
Craig a obtenu une place de joueur titulaire dans l’équipe de basket-ball de Princeton. Son père en est très fier. Comme pour le piano (et pour d’autres choses), Michelle Obama veut suivre les pas de son grand frère !
Malgré l’avis plutôt négatif d’un conseiller d’orientation, elle se lance et elle est admise au sein de la prestigieuse université.
Chapitre 6
C’est en 1981 que Michelle Obama fait son entrée à Princeton. C'est à ce moment qu'elle en profite pour rompre — maladroitement — avec son petit ami de l’époque, David.
Elle parvient peu à peu à se faire à sa nouvelle vie d’étudiante, même si certaines expressions et habitudes la surprennent parfois. Parfois, elle bénéficie aussi d’être la petite sœur de Craig.
Si le racisme n’est pas très explicite ou problématique, il est néanmoins présent. Elle se souvient par exemple d’une expérience assez déplaisante.
En l’occurrence, la mère de sa colocataire blanche a fait changer celle-ci d’habitation pour qu’elle ne soit plus avec Michelle Obama. Celle-ci ne l’apprendra que plus tard.
Qu’à cela ne tienne, Michelle se lie d’amitié avec Suzanne dans ce chapitre du livre Devenir. Une jeune femme brillante et gaie originaire de Jamaïque — et devient sa colocataire.
Bien sûr, la vie n’est pas toujours rose : Michelle Obama doit accepter un peu de désordre, elle qui l’aime pourtant par-dessus tout… Et elle se souviendra de ces compromis lorsqu’elle emménagera avec Barack Obama !
La jeune femme travaille désormais. À l’initiative de sa cheffe, elle lance même un petit programme d’aide scolaire pour les enfants du personnel noir de Princeton.
Elle sent bien que ses parents vieillissent, mais ne se rend pas compte de la gravité de la situation de son père par téléphone. Ce n’est que lorsqu’elle revoit son père à l’occasion d’un match de basket de Craig qu’elle en prend conscience. Il se déplace désormais en fauteuil roulant.
Chapitre 7
Michelle Obama se sent bien à l’université de Princeton. Elle y prend vraiment ses marques et aime sa vie là-bas.
En plus, cela lui donne l’occasion de mieux connaître sa famille et ses racines. La sœur de son grand-père Dandy, Tante Sis, y vit à Princeton. Et celle-ci aime raconter l’histoire familiale lors de dîners occasionnels qu’elle organise.
Michelle Obama se rend compte que certains de ses aïeux vivaient à Georgetown, en Caroline du Sud, et étaient esclaves dans des plantations.
À cette époque, plusieurs personnes de sa famille décèdent, dont son grand-père Southside, avec qui elle était proche, enfant.
Michelle Obama a un nouveau petit ami, mais s’en détache après ce qu’elle considère être une preuve d’égocentrisme (devenir la mascotte d’une équipe sportive). Elle sait ce qu’elle veut : obtenir son diplôme de droit. Ce qu’elle fait.
Elle obtient un diplôme de sociologie, puis de droit à Harvard. Ensuite, sans grandes difficultés, elle décroche un emploi dans un cabinet haut de gamme de Chicago.
Pourtant, elle se rend maintenant compte que ce n’est pas la vie qui lui plaît. Que faire ? Le hasard va décider pour elle : il se trouve justement que l’entreprise vient de lui demander d’être l’encadrante de stage d’un étudiant en droit de Harvard au nom étrange.
Chapitre 8
Dans ce chapitre de Devenir, la jeune femme s’est spécialisée en marketing et en propriété intellectuelle. Elle gagne désormais bien sa vie. Pourtant, elle vit avec ses parents dans la vieille maison héritée de son oncle Robbie.
Elle remarque à cette occasion que le quartier est en déclin. Toutefois, il est relativement épargné par l’épidémie de crack ayant ravagé d’autres communautés afro-américaines du pays.
Premier jour de travail de Barack Obama au cabinet : celui-ci arrive en retard ! Il est mince, mais beau, avec une belle voix et un beau charisme. Et un esprit brillant qui fait vite sa renommée au sein de l’entreprise ! Par contre : il fume et Michelle — bientôt Obama — déteste ça.
Le jeune homme a trois ans de plus que Michelle, mais il est toujours à l’université. Cela s’explique par son parcours particulier. Dans son enfance et sa jeune vie d’adulte, il a beaucoup voyagé.
Il s’intéresse beaucoup à la vie de la communauté et affirme qu’il veut étudier le droit car il voit que les changements sociaux passent par des évolutions politiques et légales.
L’alchimie opère. Surtout lorsqu’elle le voit jouer au basket-ball lors d’un barbecue d’entreprise. Il ne lui en faut guère plus pour qu’elle accepte une glace… et un premier baiser.
Deuxième partie — Devenir nous
Chapitre 9
Leur relation devient vite sérieuse. Un soir, elle est particulièrement ébahie par les talents d’orateur de son nouveau petit ami, qui cherche à convaincre quelques paroissiens de la communauté de travailler pour « le monde tel qu’il devrait être », au lieu de se contenter du « monde tel qu’il est ».
Elle présente Barack Obama à ses parents. Son père pense que la relation ne durera pas, car Michelle est trop ambitieuse. Ce sera sans compter sur les propres ambitions du futur président des États-Unis !
Celui-ci lui avoue sa flamme et, alors qu’il retourne à Harvard, ils commencent une relation à distance, par téléphone.
Elle rend visite à sa famille à Honolulu pendant Noël. Elle apprécie la chaleur humaine de ces rencontres et observe son futur mari plus détendu que d’habitude.
Michelle Obama fait partie de la team recrutement de son entreprise. Elle insiste pour modifier les critères de sélection et accepter davantage de personnes que les seuls diplômés de Harvard et consorts.
Cela dit, ses visites à Harvard dans le cadre de son travail lui permettent de voir Barack Obama. Elle est également restée en contact avec son amie Suzanne. Malheureusement, atteinte d’un cancer en phase avancée, celle-ci décèdera quelques années plus tard.
Chapitre 10
Barack Obama et Michelle emménagent à Chicago, dans l’appartement situé à l’étage supérieur de celui de ses parents.
Le frère de Michelle, Craig, lui fait passer un « test ». Comment ? En observant sa manière de jouer au basket. Il le réussit, car il allie correctement la volonté de faire des passes (le jeu collectif) et celle de tirer (l’ambition de gagner).
Une fois son diplôme en poche, Barack Obama se destine à une carrière d’avocat spécialisé dans les droits civiques.
Quant à Michelle Obama, elle se rend de plus en plus compte qu’elle n’aime pas son métier. En outre, elle souffre d’anxiété, car elle a parfois des difficultés à trouver sa place face à l’ambition de son conjoint.
La question du mariage les divise :
Michelle Obama estime que l’union complète de deux personnes qui s’aiment est naturelle (elle a pour modèle ses parents, restés ensemble toute leur vie) ;
Barack Obama considère le mariage comme le moyen pour deux personnes d’avancer ensemble et de se soutenir dans l’accomplissement des rêves de chacun (son modèle est plutôt sa mère, libre et autonome).
C’est au tour du père de Michelle Obama de décéder, après une lente détérioration de santé. Les derniers moments entre la fille et son père sont doux et émouvants.
Chapitre 11
La vie est courte : voici la leçon que tire Michelle Obama des décès de son père et de son amie. Elle sent qu’elle doit prendre un virage professionnel maintenant.
Après plusieurs mises en relation, Michelle Obama décide de travailler pour le parti démocrate et l’équipe du maire de Chicago de l’époque.
Barack Obama lui fait sa demande en mariage lors d’un dîner au cours duquel ils célèbrent la réussite de celui-ci au barreau. Il commence pourtant par lui faire croire qu’il reste sur ses positions… Mais lorsque Michelle soulève le couvercle du plateau de desserts, une bague l’attend !
Barack Obama se met à genoux pour lui demander sa main et elle accepte. Peu de temps après, ils s’envolent pour le Kenya où la future Première dame rencontre la grand-mère de son fiancé, Sarah.
Bien qu’elle ressente une sensation étrange, en tant qu’Afro-Américaine en Afrique, elle se sent bienvenue et accueillie chaleureusement.
Chapitre 12
Michelle Obama travaille comme représentante du bureau du maire sous la direction de Valerie Jarrett et Barack Obama s’occupe quant à lui du Projet VOTE ! et se concentre sur l’inscription des électeurs dans la région de Chicago.
En octobre 1992, le couple se marie. Suit une lune de miel en Californie.
Au retour, le couple doit affronter une mauvaise nouvelle : un éditeur mécontent veut récupérer l’avance donnée à Barack Obama pour un livre que celui-ci n’a jamais écrit. Le contrat est annulé et il doit donc, de fait, la rembourser.
Mais il y a aussi du positif ! Le travail de Barack Obama à Chicago a aidé :
Bill Clinton a remporté la présidence ;
Carol Moseley Braun a été élue au Sénat américain.
Barack Obama veut tout de même travailler sur le livre qu’il a en tête et le vendre à un nouvel éditeur. Pour ce faire, il s’isole dans une cabane… à Bali.
Michelle Obama, quant à elle, s’interroge sur ses capacités à associer carrière et vie de famille épanouie. Lorsque Barack rentre avec son livre presque terminé en main, sa femme, toujours en proie au doute, pense à se diriger vers le milieu associatif.
Peu après, les Obama achètent un appartement à Hyde Park.
Chapitre 13
Michelle co-fonde une nouvelle organisation, dont elle devient la directrice : Public Allies. Son but : aider les jeunes gens à travailler dans le secteur associatif. C’est un succès, en partie grâce à l’aide financière de leurs connaissances.
La jeune femme obtient également un emploi à l’université de Chicago. En tant que doyenne associée, elle se charge notamment de faire le lien entre les étudiants et les offres de bénévolat, un travail qu’elle connaît bien et apprécie.
Barack Obama travaille quant à lui pour un cabinet d’avocats d’intérêt public. Il traite surtout des affaires de droit de vote et de discrimination à l’embauche.
En outre, il enseigne à la faculté de droit de l’université de Chicago et continue ses activités d’animateur communautaire.
Il trouve également le temps d’achever son premier livre en travaillant d’arrache-pied le soir : Dreams of My Father (Rêves de mon père).
Mais ce n’est pas tout : son mari choisit également de se présenter au Sénat de l’État de l’Illinois. Si elle est réticente au début, elle ne l’empêche toutefois pas d’agir.
Et il remporte la victoire ! Ce premier pas en politique « officielle » est l’occasion pour lui, et pour elle, d’expérimenter avec satisfaction ce nouveau type de fonctions.
Mais deux chagrins familiaux viennent frapper à la porte :
La mère de Barack Obama meurt avant que celui-ci n’ait pu lui faire ses adieux.
Michelle Obama fait une fausse couche.
Finalement, le couple se tourne vers la fécondation in vitro après plusieurs années d’essais infructueux. Malia, leur première fille, naît le 4 juillet.
Chapitre 14
Dans ce chapitre de Devenir, Michelle Obama reprend ses activités de doyenne à mi-temps tout en s’occupant de sa fille. Et elle se sent plutôt débordée, même avec une nounou à la maison.
À cette époque, Barack Obama perd une élection primaire contre un député démocrate. Il est critiqué pour n’être pas rentré en Illinois lors d’une affaire importante. En fait, il était à Honolulu et il lui était très difficile de quitter ses proches à ce moment-là.
La famille accueille Sasha, et Michelle Obama décide de revoir ses priorités suite au départ de la baby-sitter. Elle parvient néanmoins à se faire embaucher au centre médical de l’université de Chicago en tant que directrice de l’action sociale. C’est un travail qui lui donne plus de flexibilité et qui lui permet d’obtenir de l’aide supplémentaire à la maison.
11 septembre 2001. Les attentats. George W. Bush est président. Barack Obama, quant à lui, pense au Sénat américain.
Mais c’est la goutte d’eau pour Michelle Obama : elle n’en peut plus des retours tardifs de son mari. Une thérapie de couple les aide à remonter la pente.
Chapitre 15
Michelle Obama allie sa vie de famille et son travail à l’hôpital, où elle a reçu une promotion. Grâce à ses efforts :
Plus de bénévoles aident les soignants ;
Le personnel se sent plus impliqué dans la vie communautaire ;
Les personnes sans assurance et les malades chroniques sont mieux pris en charge.
Elle doit aussi composer avec les ambitions de son mari, qui s’amplifient au fur et à mesure des mois et des années.
En 2004, il prépare sa campagne pour le Sénat américain. Sa victoire est éclatante et son discours à la Convention démocrate en fait une star nationale. George W. Bush est quant à lui réélu.
Barack Obama déménage à Washington, mais sa femme préfère rester à Chicago avec les enfants, malgré une certaine pression du milieu politique. Elle souhaite continuer à y mener sa vie personnelle et professionnelle.
Déjà, Barack Obama voit plus loin : c’est l’élection présidentielle de 2008 qu’il a en vue. Cela semble un peu tôt pour toute la famille, mais qu’à cela ne tienne, il se lancera bientôt dans la course !
L’ouragan Katrina marque les esprits. Michelle Obama pense que son mari pourrait aider toutes ces personnes s’il était élu. Mais, secrètement, elle ressent un doute et un malaise profonds : elle pense qu’un homme noir ne peut pas gagner.
Chapitre 16
Barack Obama s’entoure de David Plouffe (directeur de campagne) et David Axelrod (médias), entre autres, pour gérer sa campagne. Premier grand enjeu : le caucus de l’Iowa.
Michelle Obama se souvient d’avoir à subir des attaques parfois personnelles dans les médias :
À propos d’un prétendu radicalisme de Barack Obama ;
Sur les relations politiques qui auraient permis à Michelle Obama d’obtenir son poste à l’hôpital.
Assistée par une petite équipe, la future Première dame va à la rencontre des habitants de l’Iowa. Sans script prédéfini, elle se mêle à leurs conversations, partage leurs peines, et se fait rapidement apprécier pour son empathie. Cela lui vaut le surnom de « Closer » (plus proche).
Elle se fait peu à peu à sa nouvelle condition de personnalité publique. Elle se lie aussi d’amitié à Sam Kass, jeune chef, qui devient le cuisinier personnel des Obama.
Huit semaines avant le caucus, Barack Obama est encore loin derrière Hillary Clinton. Pourtant, son discours lors du traditionnel dîner Jefferson-Jackson du parti démocrate de l’Iowa va faire la différence.
Quelques jours plus tard, il se retrouve en deuxième place, en compétition directe avec la politicienne démocrate. C’est à ce moment que Michelle Obama pense que, finalement, tout est sans doute possible !
Chapitre 17
Être frappé au visage par surprise ou être victime de harcèlement médiatique fait à peu près le même effet. C’est en tout cas ce que raconte Michelle Obama dans le livre Devenir.
Durant plusieurs mois, certains médias l’accusent de haine envers son propre pays, en utilisant quelques mots d’un discours, coupés de leur contexte, ainsi que d’autres matériaux douteux.
Cela la met en colère et elle considère que cela est justifié, même si elle sait que cela renforce un stéréotype ancré dans la mémoire collective américaine. Ses conseillers l’invitent à jouer la prudence et à redoubler d’efforts pour se maîtriser, même si l’attaque est effectivement injuste.
Deux interventions vont l’aider à changer son image auprès du plus grand nombre :
Une intervention dans l’émission The View.
Un discours où elle parle à cœur ouvert de son père et de Barack Obama.
À la fin de ce chapitre, Michelle Obama raconte une anecdote au sujet de l’anniversaire de Malia, leur fille aînée.
Chapitre 18
Étonnamment, la campagne contre John McCain pour la présidence est moins intense que les primaires démocrates. Cela est notamment dû au manque de préparation de Sarah Palin, la colistière du candidat républicain.
Cette période est toutefois marquée par le décès de la grand-mère de Barack Obama, Toot, qui meurt peu après une dernière visite de son petit-fils et deux jours seulement avant l’élection.
La famille va voter ensemble. Barack Obama est d’humeur joyeuse, mais le stress est néanmoins présent. Son beau-frère l’emmène jouer au basket pour le détendre.
Malgré des prévisions rassurantes, Michelle est inquiète. Elle craint « l’effet Bradley », qui veut que certains électeurs mentent pendant les sondages au sujet de leurs préjugés, mais les expriment au moment de l’élection.
Pourtant, ce n’est pas le cas. Les résultats tombent : Barack Obama et son colistier, Joe Biden, l’ont remporté !
Barack Obama prononce un discours dans le Grant Park, situé au bord du port de Chicago. L’ambiance est à la prise de recul qui prépare l’action. L’heure est au changement.
Troisième partie — Devenir plus
Chapitre 19
Les Obama sont très attentifs à ne pas faire de faux pas durant la passation de pouvoir. Ils payent par exemple eux-mêmes leur déménagement, même si des fonds sont alloués à ces dépenses. Heureusement, George et Laura Bush organisent les choses avec soin et respect.
Il y a, évidemment, 1 000 choses à faire, 1 000 décisions à prendre ! Michelle Obama se fait aider grâce à une nouvelle équipe. Elle peut aussi compter sur la famille du vice-président. Ses enfants se sont liés d’amitié aux petits-enfants de Joe Biden et elle-même se sent proche de l’épouse de Joe Biden, Jill.
Elles s’occuperont toutes les deux d’un programme d’aide aux familles des militaires en difficulté. D’ailleurs, Beau, le fils des Biden, sert pendant la guerre en Irak.
Toute la famille est plus ou moins obligée de se plier aux règles de sécurité et à la présence des gardes des services secrets. Seule la mère de Michelle Obama, qui s’installe à la Maison-Blanche, échappe relativement à cette contrainte.
Le jour de l’investiture, après une tournée de dix bals d’inauguration, par un froid de canard, la Première dame n’en peut tout simplement plus. Elle file se reposer dans sa nouvelle chambre, si étrange pour elle !
Chapitre 20
Les Obama peuvent compter sur le personnel de la Maison-Blanche pour leur faciliter la vie. En plus, comme le bureau du président est désormais à quelques pas seulement, il lui arrive d’être à l’heure pour dîner !
Tous les membres de la famille trouvent progressivement leur marque. Pour Malia et Sarah, ce n’est pas facile tous les jours, notamment pour rencontrer des amis et camarades de classe.
Lors d’une visite officielle en Grande-Bretagne, Michelle Obama crée la controverse en faisant un hug (câlin) à la reine ! Celle-ci, toutefois, ne s’en offusque nullement.
Le lendemain, la Première dame des États-Unis visite une école populaire de Londres où de nombreux élèves ont la peau foncée. Elle est particulièrement émue et ravie de cette rencontre.
Autre initiative : Michelle Obama et Sam Kass, le cuisinier, décident d’utiliser l’une des pelouses de la Maison-Blanche pour créer un potager ! Elle aime creuser la terre avec des écoliers locaux et observer les résultats de ses efforts.
Chapitre 21
Un dîner du couple provoque un scandale. Michelle Obama voit bien qu’aucune spontanéité, aucun faux pas ne leur est plus permis. Par ailleurs, les mesures de sécurité sont parfois étouffantes, mais des compromis sont trouvés pour le bien-être des enfants.
Côté « mode », Michelle est entourée d’ :
Une assistante qui l’aide à varier ses tenues, en promouvant les créateurs américains ;
Un coiffeur ;
Un maquilleur.
Au-delà de cet aspect people, elle doit calculer chacune de ses décisions, en particulier en période de crise économique.
Michelle Obama choisit d’approfondir ses engagements précédents en s’attaquant à l’obésité infantile, un fléau de santé publique. Comment promouvoir l’exercice physique et l’alimentation saine ? Après beaucoup d’efforts, son équipe lance l’initiative Let’s Move !, qui connaîtra un beau succès (si cela vous intéresse, le chapitre 22 en dit plus à ce sujet).
Chapitre 22
Les Obama doivent intervenir et montrer leur empathie dans les moments de douleur que connaît le pays.
Par exemple :
Lors de la marée noire causée par BP dans le golfe du Mexique ;
Lorsqu’un tremblement de terre dévaste Haïti.
À côté de l’initiative Let’s Move !, Michelle Obama continue de s’investir auprès des familles de militaires. Toujours en compagnie de la femme du vice-président, elle crée le programme Joining Forces.
Donald J. Trump fait de plus en plus parler de lui dans la vie politique des États-Unis. Il accuse notamment Barack Obama de ne pas être un citoyen américain, ce qui provoque plus d’une tension.
Malgré cela, la vie suit son cours et toute la famille cherche à vivre sainement et aussi normalement que possible. Michelle Obama, toujours active, lance de nouvelles initiatives, dont un programme de mentorat pour jeunes filles.
Barack Obama dort mal. De nombreux enjeux le tracassent et l’empêchent de dormir. L’une de ces inquiétudes se dissipe toutefois, lorsqu’il apprend qu’Oussama ben Laden a été éliminé sans faire de victimes civiles.
Chapitre 23
Michelle Obama sait qu’elle est appréciée de la population américaine. Malgré tout, elle ressent une forte pression : comment tenir son rôle de première Première dame de l’histoire états-unienne ? Et comment aider son mari dans sa course à la réélection ?
Elle se rend notamment en Afrique pour une tournée internationale. Elle y rencontrera entre autres l’archevêque Desmond Tutu et Nelson Mandela. Par ailleurs, elle cherche à suivre de près ses autres initiatives pour la santé des jeunes et les vétérans.
Malgré des débuts quelque peu laborieux, Barack Obama remporte les élections face à Mitt Rodney. Michelle Obama refuse de regarder les résultats à la télévision et l’apprend seulement plus tard.
De macabres tragédies se succèdent peu de temps après :
Un tireur tue vingt-six enfants et membres du personnel à l’école Sandy Hook de Newtown ;
Une jeune fille des quartiers sud de Chicago est tuée dans une fusillade.
Si elle ne parvient pas à réunir ses forces pour accompagner son mari lors du premier drame, elle décide qu’elle agira lorsque la jeune élève meurt. Michelle Obama ne peut rester indifférente, d’autant plus que cette personne lui rappelle sa propre enfance.
Michelle mise tout sur l’éducation et lance un nouveau programme, « Reach Higher », qui vise à encourager les jeunes à s’inscrire à l’université. L’enseignement est, selon elle, la meilleure manière de mettre un terme aux guerres des gangs.
Chapitre 24
La famille a désormais deux chiens, Bo, l’ancien, et Sunny, le petit nouveau. Ce sont les nouvelles stars des séances photo à la Maison-Blanche.
Au plan social et politique, il y a des événements brutaux et d’autres qui donnent de l’espoir :
La mort de jeunes hommes noirs par la police et le massacre de fidèles noirs dans une église de Charleston, en Caroline du Sud, créent l’émotion nationale. Barack Obama chante « Amazing Grace » lors de l’inhumation de ces derniers.
Un beau moment a lieu, en revanche, lorsque la Cour suprême confirme le droit au mariage entre personnes du même sexe.
En 2016, l’heure des adieux a bientôt sonné. Michelle Obama fait tout ce qu’elle peut pour promouvoir son dernier programme, Let Girls Learn, qui a pour but d’améliorer l’accès à l’éducation des adolescentes dans le monde entier.
Lors de la campagne présidentielle, Michelle Obama est outragée par l’attitude du candidat républicain Donald Trump. Elle se positionne en faveur d’Hillary Clinton et prononce un discours où elle utilise le slogan « When they go low, we go high » (« Quand ils s’abaissent, nous nous élevons »).
Alors qu’elle pense que la candidate démocrate va gagner, ses espoirs sont déçus : consternée, elle doit reconnaître la victoire de Donald Trump. Elle se réconforte en pensant à tout ce qui a été fait pendant les 8 dernières années.
Épilogue
L’au revoir est difficile, bien sûr. Toutes les personnes qui ont accompagné la vie de la famille Obama durant 8 ans sont devenues précieuses ; certaines sont même devenues des proches.
Par ailleurs, la déception est claire : le jour de l’investiture de Donald Trump, lorsque Michelle Obama voit l’assemblée d’invités du nouveau président — très majoritairement blanche et masculine —, elle ne cherche même plus à sourire.
Va-t-elle se présenter à l’élection présidentielle un jour ? Elle n’en a pas l’intention. Michelle Obama est en train de devenir ce qu’elle sera ensuite. Et elle vit dans l’espoir d’un monde meilleur, en se souvenant de ce qui a été réalisé de bien jusqu’ici.
Conclusion sur « Devenir » de Michelle Obama :
Ce qu’il faut retenir de « Devenir » de Michelle Obama :
Avant Devenir, Michelle Obama avait déjà écrit American Grown. Son dernier livre en date, The Light We Carry, est déjà un succès de librairie international.
La particularité de Devenir est de raconter en détail le parcours de la Première dame, depuis ses origines jusqu’à la Maison-Blanche. Devenir est un livre intime, qui vous transportera dans les coulisses du pouvoir, auprès d’une famille extraordinaire et pourtant simple.
Michelle Obama se montre au naturel et crée un lien fort avec son lecteur en l’incitant à vivre pleinement sa vie. Elle cherche particulièrement à donner plus de force aux jeunes et aux minorités.
Publié en 24 langues, l’ouvrage est un succès mondial. Record de ventes aux États-Unis, il a atteint les deux millions d’exemplaires vendus deux semaines seulement après sa mise en vente. En novembre 2020, les chiffres sont de 14 millions d’exemplaires à travers le monde.
Vous pouvez retrouver le livre Devenir en version audio (couronné par un Grammy Award du meilleur album de littérature orale). Il en existe aussi une version pour la jeune génération.
Enfin, un documentaire basé sur la sortie du livre Devenir est sorti sur Netflix en 2020.
Points forts :
Une présentation claire et ordonnée en trois parties ;
Une immersion dans l'intimité du couple politique le plus en vogue de ces dernières années ;
Des conseils et un ton qui donnent envie de se donner à fond pour devenir meilleur.
Points faibles :
Je n'en ai pas trouvés.
Ma note :
★★★★★
Le petit guide pratique du livre Devenir de Michelle Obama
Autour de quoi s’accentue le livre Devenir de Michelle Obama ?
Michelle Obama, ex première dame des Etats-Unis partage avec dans son autobiographie, l’intimité de son couple et les coulisses des décisions politiques les plus importantes de la fin du XXe siècle.
Foire Aux Questions (FAQ) du livre Devenir de Michelle Obama
- Comment le public a accueilli le livre Devenir de Michelle Obama ?
Le public a répondu au livre « Devenir » de Michelle Obama avec un enthousiasme considérable. Depuis sa sortie en novembre 2018, il a connu un succès fulgurant, se vendant à des millions de clients dans le monde entier.
- Quel fut l’impact du livre Devenir de Michelle Obama ?
Le livre a été un succès financier qui a retenu l'attention des lecteurs et a inspiré un large public. Il a joué un rôle crucial dans les débats sur les questions sociales et a renforcé l'impact de Michelle Obama en tant qu'icône politique et culturelle.
- À qui s’adresse le livre Devenir de Michelle Obama ?
Devenir est un livre qui peut plaire à un large éventail de lecteurs, qu'ils s'intéressent à l'histoire politique, à l'autonomie personnelle, à l'inspiration ou aux questions sociales contemporaines.
- Quel est le point commun de la famille Robinson ?
Toute la famille Robinson adore la musique
- Qu’a fait la mère de l’auteur pour maintenir le niveau d’enseignement ?
Pour maintenir le niveau d’enseignement, Marian a :
Récupéré des fonds pour acheter des équipements
Organisé des repas pour les professeurs
Soutenu un programme pour les élèves doués
Point de vue de Barack et de Michelle sur le mariage
Point de vue de Barack Point de vue de Michelle
Le moyen pour deux personnes d’avancer ensemble et de se soutenir dans l’accomplissement des rêves de chacun Union complète de deux personnes qui s’aiment est naturelle
Qui est Michelle Obama ?
Michelle Obama est une avocate et une auteure américaine. Elle est devenue la 44ᵉ Première dame des États-Unis après l'élection de Barack Obama en 2008, un rôle qu'elle a assumé en participant à de nombreux projets axés sur la santé et l'éducation des jeunes Américains. Depuis qu'elle a quitté la Maison-Blanche, Michelle Obama s'est consacrée à l'écriture de son autobiographie, Devenir, qui s'est vendue à plus de 14 millions d'exemplaires dans le monde.
Avez-vous lu le livre de Michelle Obama « Devenir » ? Combien le notez-vous ?
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Michelle Obama « Devenir »
Visitez Amazon afin d’acheter le livre de Michelle Obama « Devenir »
Format Poche :
Cet article Devenir est apparu en premier sur Des livres pour changer de vie.
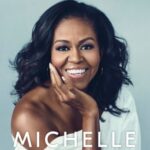 ]]>
]]>Dans cet article, je partage cinq biographies d’entrepreneurs absolument hors-normes.
Ces hommes, partis de rien, ont réussi, par leur audace, à bouleverser le monde. Portés par leur vision, ils sont parvenus, à force de détermination, à bâtir de véritables empires.
Les livres biographiques sont souvent une grande source d’inspiration. Ils contiennent cette dimension humaine réelle que les autres genres littéraires ne proposent pas. Les histoires de vie y sont souvent ordinaires et extraordinaires à la fois. Ainsi, il nous arrive de nous identifier. Alors, elles nous inspirent. Elles nous encouragent à suivre, nous aussi, notre destinée. Et en chemin, elles nous apprennent des leçons de vie en revivant des situations.
Les cinq hommes que vous allez découvrir dans ces grandes biographies vous ressemblent. Mais s'ils ont su, toutefois, se hisser parmi les hommes les plus riches et les plus influents de la planète, c'est parce qu'ils ont eu cette capacité d'oser, au bon moment, au bon endroit. Ils ont eu le cran d'innover, le courage de persévérer.
Ces cinq biographies vous embarquent dans leur vie étonnante. Ces cinq success stories vous plongent dans les coulisses de leurs succès et de leurs échecs. Je vous invite à les découvrir et vous propose, en fin d'article, un bonus : je partage les quatre caractéristiques clés que j'ai identifiées dans les biographies de chacun de ces grands leaders mondiaux.
- "Mark Zuckerberg : La Biographie"
Biographie de Mark Zuckerberg, fondateur et président-directeur général de la société Meta, maison-mère des réseaux sociaux Facebook, Instagram et WhatsApp.
Titre original : "Mark Zuckerberg : La Biographie"
Par Daniel Ichbiah, 2018, 336 pages. Réédité en 2021, 356 pages.
Résumé de la biographie de Mark Zuckerberg, fondateur de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp)
Le bestseller mondial "Mark Zuckerberg : La Biographie" retrace la vie et les réalisations d’un des hommes les plus influents de la planète : Mark Zuckerberg, fondateur et président directeur général du réseau social Facebook et de sa maison-mère appelée aujourd’hui Meta.
La naissance de Facebook
Mark Zuckerberg naît en 1984 aux États-Unis dans l’État de New York. Il commence à développer des compétences en informatique dès son plus jeune âge, initié notamment par son père, un psychiatre passionné par les nouvelles technologies émergentes.
Doté d’une intelligence que beaucoup qualifie de "surhumaine", Mark crée déjà, à l'âge de 12 ans, son premier programme informatique, un réseau social appelé Zucknet qui permet à sa famille de s'envoyer des messages d'une pièce à l'autre.
Adolescent, Mark ne ressemble pas aux autres jeunes de son âge. Il se démarque par sa soif d'apprendre. À 16 ans seulement, il intègre un programme scolaire très avancé dans une prestigieuse école avant-gardiste en matière de technologie. À cette époque, il conçoit plusieurs logiciels qui rencontrent déjà beaucoup de succès.
Puis, il poursuit ses études secondaires en informatique au sein de la très réputée université de Harvard.
En automne 2003, Zuckerberg hacke le système informatique de l'établissement universitaire et s'amuse à lancer un genre de réseau social, appelé Facemash. Celui-ci vise à se moquer des photos des étudiants sous leur plus mauvais jour. Il frôle l'exclusion mais cette affaire lui vaut finalement de devenir la star du campus.
Par ailleurs, cet épisode fait mûrir une idée dans la tête de l'étudiant. Cette idée, il la concrétise quelques mois plus tard : Mark Zuckerberg lance, un soir de février 2004, un site de réseautage social pour les étudiants de Harvard qu’il nomme "thefacebook.com".
Facebook est né !
Rapidement, le réseau gagne en popularité.
Accusé d’avoir "volé" cette idée de réseau à d’autres étudiants, Mark Zuckerberg est, à ce moment-là, poursuivi en justice (mais l'affaire trainera et sera finalement réglée bien des années plus tard à l'amiable). Cette accusation n’empêche pas le réseau social de poursuivre sa croissance fulgurante.
Quelques mois plus tard seulement, Facebook touche des millions d’étudiants à travers le pays.
L'aventure Facebook
Plusieurs chapitres portent alors sur les débuts de ce succès explosif. Daniel Ichbiah agrémente le récit de multiples anecdotes croustillantes.
On découvre également les balbutiements de Zuckerberg en tant que manager et entrepreneur, et le parcours, à ses côtés, de ses jeunes collaborateurs, encore étudiants. On apprend notamment que Mark Zuckerberg, alors âgé de vingt-trois ans, refuse de vendre Facebook, à Yahoo! puis à Microsoft pour des milliards de dollars.
Au fil des pages, Daniel Ichbiah continue en décortiquant comment Facebook réussit à se développer de façon aussi exponentielle, à garder le cap et finit par s’imposer dans la Silicon Valley.
En 2006, Facebook devient une entreprise en propre. La société est introduite en bourse en 2012. Et en 2018, Mark Zuckerberg devient la troisième fortune mondiale.
Aujourd'hui, Facebook est l'une des entreprises les plus importantes et les plus influentes de la technologie, utilisé par des milliards d'utilisateurs. La société, appelée aujourd'hui Meta, englobe également les fameux réseaux sociaux que sont Instagram et WhatsApp et s'est largement engagée dans le secteur de l'intelligence artificielle.
Le chemin parcouru en tant qu’homme
Au-delà de l’aventure entrepreneurial de Facebook, Daniel Ichbiah nous dépeint, dans cette biographie, le visage personnel de Mark Zuckerberg : son ambition, sa vision à long terme, sa détermination, sa gestion du travail mais aussi sa part de complexité, son côté déroutant, ses erreurs de parcours, ses ambiguïtés, ses scandales.
L’ouvrage évoque sa vie privée, en tant que conjoint et papa de deux filles. Il raconte sa façon de vivre, son indifférence extrême à l'argent et les challenges personnels que l’homme s’impose chaque année (comme celui d’apprendre le chinois par exemple).
Impliqué dans plusieurs causes philanthropiques, le chef d’entreprise compte parmi les donateurs les plus généreux de la planète. Avec son épouse, il crée la Fondation Chan Zuckerberg Initiative, qui a pour but d’améliorer la santé des enfants en particulier, et l'éducation à travers le monde.
Les sujets brûlants liés aux nouvelles technologies
Enfin, tout au long des chapitres, la biographie de Mark Zuckerberg aborde des questions de fond : quel est réellement l’impact social et politique de Facebook en termes de fake news et de données récoltées. Daniel Ichbiah s'interroge aussi sur une volonté politique ou non de Mark Zuckerberg derrière sa revendication de vouloir participer à un monde ouvert et connecté.
Mon avis sur le livre biographique de Mark Zuckerberg
Une biographie complète et palpitante du début à la fin
L’histoire de Mark Zuckerberg est fascinante. Non seulement parce qu’elle est possède tous les ingrédients d’une success story : comment ne pas être captiver par le récit de ce jeune étudiant passionné d’informatique devenu chef d’entreprise milliardaire à 24 ans parmi les plus influents de la planète.
Mais aussi parce que cette biographie est remarquablement documentée et écrite. Avec ses suspens et rebondissements, l’ouvrage se lit comme un roman à "dévorer" d’un trait (si la longueur ne vous fait pas peur).
De témoignages de proches en messages privés, de réunions à huit clos retranscrites en anecdotes personnelles, Daniel Ichbiah nous livre une biographie complète et palpitante.
Un ouvrage qui permet de saisir les enjeux d’internet dans les changements sociétaux actuels
Tout au long du récit, Daniel Ichbiah parvient à nous restituer le personnage complexe qu’est Mark Zuckerberg, tout comme la dynamique des autres acteurs dans sa destinée.
Les évolutions et le futur de notre société y sont également traités dans un style à la fois narratif et journalistique.
En fait, cette biographie nous montre comment, sans vraiment s’en rendre compte, Mark Zuckerberg et ses acolytes ont créé un phénomène planétaire. Comment ils ont ainsi participé à l’élaboration d’un nouveau monde. Et comment, dans son sillon, Mark Zuckerberg a balayé, en une quinzaine d’années, un grand nombre de valeurs sociétales acquises au fil des siècles.
Et finalement, son rôle a largement dépassé celui que n'importe qui imaginait au départ, allant désormais jusqu’à influencer le déroulement des affaires du monde.
Les points forts et points faibles du livre "Mark Zuckerberg – La biographie" de Daniel Ichbiah
Points forts :
Le parcours passionnant et étonnant d’un des hommes les plus influents de la planète.
Le style de l’auteur qui sait créer le juste suspens pour nous plonger dans une atmosphère captivante.
La façon dont l'auteur traite les événements majeurs qui ont bouleversé nos sociétés dans le contexte de vie de Mark Zuckerberg et du phénomène Facebook.
Une histoire extrêmement bien documentée et racontée sans parti pris.
Point faible :
Je n’en vois pas.
Ma note :
★★★★★
Pour aller plus loin :
Lire la chronique sur ce blog
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre “Mark Zuckerberg : La Biographie”
Visitez Amazon et achetez le livre “Mark Zuckerberg : La Biographie”
- "Amazon – Les secrets de la réussite de Jeff Bezos"
Biographie de Jeff Bezos, fondateur d’Amazon.com et de Blue Origin.
Titre original : "One Click: Jeff Bezos and the Rise of Amazon.com"
Par Richard Brandt, 2012, 240 pages.
Note : Une biographie plus récente de Jeff Bezos a été publiée en 2021. Elle a été écrite par Brad Stone et s’intitule "Jeff Bezos : la folle ascension du fondateur de l'empire Amazon" (édition française). Le titre original est "Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire" (édition en anglais).
Résumé de la biographie de Jeff Bezos, fondateur d'Amazon
Dans cette biographie, Richard Brandt raconte la vie de Jeff Bezos, depuis son enfance jusqu'à son succès en tant que fondateur d’Amazon. Le livre retrace également la croissance sans précédent du site de e-commerce Amazon.com.
Jeff Bezos naît à Albuquerque, au Nouveau-Mexique (USA) en 1964. Il grandit à Houston, au Texas et obtient un diplôme en génie électrique et informatique à l'Université de Princeton.
Le jeune Jeffrey (son vrai prénom) débute sa carrière en travaillant au sein de diverses entreprises, chez Bankers Trust à Wall Street notamment. Mais en 1994 Jeff Bezos choisit de quitter son emploi. Il a pour projet de créer une entreprise de vente de livres en ligne.
Le jeune homme appelle son entreprise Amazon.com. Il l'installe à Seattle. Il pense en effet que la ville possède un potentiel technologique. De plus, elle est située à proximité d'un centre de distribution de livres.
La première année, Amazon réalise un bon chiffre d'affaires (511 000 dollars). Mais Jeff Bezos a plus d’ambition que cela. Et surtout, il a la conviction que son entreprise peut devenir bien plus importante.
La suite donne raison à Jeff Bezos. Une fois entrée en bourse (en 1997), Amazon devient très vite l'un des sites de commerce en ligne les plus utilisés au monde.
La biographie raconte alors la croissance rapide d'Amazon.
Grâce aux profits générés, Jeff Bezos fait l’acquisition de plusieurs entreprises en parallèle (IMDb, une base de données de films, et Alexa Internet, un service de statistiques de trafic sur le web notamment). Le livre revient sur les investissements de Bezos dans d'autres entreprises, notamment la célèbre entreprise spatiale appelée Blue Origin.
Enfin, le livre biographique évoque la Bezos Family Foundation créé par le PDG d’Amazon (ex-PDG à l'heure où j'écris ces lignes) aujourd’hui milliardaire, ainsi que sa participation à The Giving Pledge, un engagement pris par les personnes les plus riches du monde à donner la majorité de leur fortune à des œuvres de charité.
Mon avis sur le livre biographique de Jeff Bezos
L’histoire de la réussite commerciale la plus explosive de notre époque
La biographie de Jeff Bezos est inspirante car elle raconte brillamment tout le chemin parcouru par le numéro 1 mondial de la distribution en ligne. Et ce, depuis ses débuts.
Quand on connaît ce qu'est devenu le site e-commerce aujourd’hui, il est alors assez incroyable de découvrir ce qu'était l’entreprise lorsqu’elle ne vendait que des livres : ses premiers investisseurs et salariés, les premières commandes avec l’envoi des livres à même le sol, etc.
L’ouvrage revient sur toutes les épreuves qu’Amazon a traversé au fil des années - l’éclatement de la bulle Internet et la dégringolade du cours de son action de 90 % par exemple, ou encore, ses milliards de pertes avant ses gains - jusqu’à sa croissance fulgurante à partir de 1998, et l’apparition de ses produits phares comme la Kindle et de ses nombreuses filiales.
De belles leçons à prendre en tant qu’entrepreneur
Parce qu'elle retrace l’ascension d’un geek informatique devenu l’un des entrepreneurs les plus riches au monde, et parce que ce dernier a réussi à propulser la croissance de sa société jusqu’à lui donner un statut de quasi-monopole, la biographie de Jeff Bezos est aussi formatrice qu'inspirante.
La réussite extraordinaire d'Amazon s'explique par les qualités de leadership de Jeff Bezos et sa capacité à changer de vision quand il le faut. Mais elle est provient surtout d’une stratégie commerciale extrêmement réussie. Le business model de Jeff Bezos est basé sur l’expérience client, le but étant de toujours satisfaire le client et de rendre les achats en ligne le plus facile et pratique possible pour le client (en un seul clic).
Les points forts et points faibles du livre "Amazon – Les secrets de la réussite de Jeff Bezos" de Richard Brandt
Points forts :
La vision entrepreneuriale d’un visionnaire en matière de business en ligne, la psychologie d’un entrepreneur qui a bouleversé le monde.
L’apprentissage que l'on retire du livre en stratégie entrepreneuriale : un business model centré sur l'expérience client.
La motivation d’entreprendre que procure l’ouvrage.
Point faible :
Quelques passages pas très bien traduits.
Ma note :
★★★★★
Pour aller plus loin :
Lire la chronique sur ce blog
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre "Amazon : Les secrets de la réussite de Jeff Bezos"
Visitez Amazon et achetez le livre "Amazon : Les secrets de la réussite de Jeff Bezos"
- "Steve Jobs"
Biographie de Steve Jobs : pionnier de l’ordinateur personnel, du smartphone, de la tablette tactile/ Cofondateur et ancien président-directeur général d’Apple Inc./ Ancien directeur des studios Pixar.
Titre original : "Steve Jobs : The Exclusive Biography"
Par Walter Isaacson, 2012, 668 pages.
Résumé de la biographie de Steve Jobs, cofondateur d'Apple et Pixar
L'écriture de la biographie de Steve Jobs
Après avoir appris être atteint d’un cancer, Steve Jobs, cofondateur et PDG d'Apple Inc., contacte Walter Isaacson pour suggérer l’écriture de sa biographie.
Plus de quarante rencontres entre Steve Jobs et l’auteur sont alors réalisées pendant deux ans. Des centaines d’entretiens sont organisées entre Walter Isaacson et l’entourage familial, amical et professionnel de Jobs, y compris avec ses rivaux et concurrents.
Grâce à tous les témoignages recueillis, Walter Isaacson publie une biographie complète de Steve Jobs en 2012, soit un an après sa mort. Dans ce livre biographique, il retrace son incroyable vie personnelle et professionnelle, de son enfance à sa mort.
Avant sa parution, Steve Jobs n’a imposé aucune limite à l’écriture de sa biographie. Il n’a eu aucun droit de regard sur son contenu ni même la possibilité d’en prendre connaissance avant sa publication.
La vie de Steve Jobs
Né en 1955 à San Francisco, puis adopté, Steve Jobs grandit en Californie.
Dans sa jeunesse, Steve embrasse un mode de vie hippie. Dans la lignée de cette philosophie de vie et en quête d'un gourou, il entreprend un voyage de sept mois en Inde à 19 ans. Cette expérience le marquera à vie. Il en fera souvent allusion dans ses allocutions et elle influera même sa vie professionnelle.
De retour en Californie, Steve Jobs cofonde, à l’âge de 21 ans, la société Apple Inc., avec Steve Wozniak et Ronald Wayne.
La biographie se poursuit en décrivant la carrière de Steve Jobs. On le sait déjà, Jobs va bouleverser cinq industries différentes en inventant plusieurs produits révolutionnaires :
L’informatique : en commercialisant le premier ordinateur grand public, le Macintosh, en 1984.
Les films d’animation : en créant les studios Pixar.
La musique : avec iTunes et l’iPod.
La téléphonie : avec l’iPhone, en 2007.
Les tablettes numériques : avec l’iPad en 2010.
Steve Jobs, une icône de l'innovation
Steve Jobs est décrit comme un homme à la personnalité de génie. Complexe, perfectionniste, hyperactif, intransigeant, les traits qui caractérisent le manager charismatique sont tout à la fois un atout et un défi pour lui et ses collaborateurs.
La nouvelle de la mort Steve Jobs, des suites d’une forme rare d’un cancer pancréatique à l’âge de 56 ans, laisse le monde sous le choc.
Aujourd'hui, Steve Jobs incarne l’icône de l’innovation.
On le considère comme un visionnaire qui fut capable d’anticiper, de façon extraordinaire, les tendances technologiques. Il est aux yeux du monde un génie d’invention qui réussit à créer des produits révolutionnaires en combinant la créativité à la technologie. Il est aussi celui qui a introduit une dimension émotionnelle dans la technologie "grand public".
Mon avis sur le livre biographique de Steve Jobs
La trajectoire de vie d’un homme visionnaire qui a révolutionné le monde
La biographie de Steve Jobs fait partie des biographies les plus lus au monde.
Que l’on aime ou pas Steve Jobs avec son caractère bien trempé, sa vie et sa personne restent absolument fascinantes.
Sa vision a bouleversé des univers majeurs, comme celui des nouvelles technologies. L'ouvrage nous embarque dans les montagnes russes de l’histoire d’Apple et de son fondateur. Walter Isaacson expose avec beaucoup de détails les réalisations de Steve Jobs. Il révèle l'homme au-delà de ce qu'il a accompli avec beaucoup de sincérité. Il nous fait vivre l'aventure de sa vie. D'une vie extraordinaire.
Et cette raison est suffisante pour en faire une lecture incontournable.
Un destin qui suscite plein de leçons de vie
Certes, l’ouvrage est une biographie. Mais c’est aussi un livre qu’on pourrait aisément classer dans la catégorie "développement personnel". tellement la la vie de Steve Jobs, tout au long des chapitres, motive, inspire et transmet de grandes leçons de vie.
La qualité de l’écriture remarquable de l'auteur, très vivante et authentique, y fait beaucoup. Walter Isaacson nous plonge avec beaucoup d’honnêteté dans l’univers de Steve Jobs.
Bref, cette biographie est une vraie pépite. Il est dommage d'y passer à côté.
Les points forts et points faibles du livre "Steve Jobs" de Walter Isaacson
Points forts :
Le récit passionnant d'un homme qui a révolutionné le monde et qui fait que, bien que volumineux, l'ouvrage se dévore du début à la fin.
L’écriture de Walter Isaacson d’une qualité remarquable.
Une biographie authentique, non censurée et parfaitement documentée.
Point faible :
Pour ceux qui ne sont pas dans le domaine high-tech, certaines parties peuvent s’avérer un peu techniques.
Ma note :
★★★★★
Pour aller plus loin :
Lire la chronique sur ce blog
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre "Steve Jobs"
Visitez Amazon et achetez le livre "Steve Jobs"
- "Elon Musk - Tesla, Paypal, SpaceX : l'entrepreneur qui va changer le monde"
Biographie d’Elon Musk, cofondateur et président-directeur général de la société astronautique SpaceX, directeur général de la société automobile Tesla.
Titre original : "Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future"
Par Ashlee Vance, 2017, 372 pages.
Résumé de la biographie d’Elon Musk (SpaceX, Tesla)
Ce best-seller biographique raconte le parcours de vie et les réalisations de l’un des industriels les plus puissants au monde : Elon Musk. Innovateur par excellence, entrepreneur ingénieur sud-africain, il est notamment le fondateur des célèbres entreprises de pointe que sont PayPal, Tesla, SpaceX et SolarCity.
Le portrait d'un entrepreneur dans la démesure
Ashlee Vance commence cette biographie en nous racontant comment il a réussi, à force d'acharnement, à convaincre Elon Musk de le rencontrer pour écrire sa biographie.
Puis, l'auteur nous embarque immédiatement dans l'univers d'Elon Musk en réalisant un tour d'horizon des trois gigantesques entreprises que dirige cet homme au moment de l'écriture de son livre, à savoir :
SpaceX, dans le secteur de l'aérospatial,
Tesla, dans le secteur de l'automobile,
SolarCity, dans le secteur de l'énergie.
L'auteur partage ensuite la quête particulière qui anime Elon Musk dans tout ce qu'il entreprend, qui est de sauver l'humanité. Il revient sur sa première rencontre "déconcertante" avec Elon Musk et décrit l'organisation personnelle et professionelle quelque peu "délirante" du chef d'entreprise.
Une enfance et adolescence atypique et agitée
La biographie se poursuit sur plusieurs chapitres par l'enfance et l'adolescence d'Elon Musk.
On apprend alors que le petit Elon naît en Afrique du Sud en 1971. Il grandit dans une famille recomposée.
Très jeune, Elon se passionne pour la lecture. Son entourage l'appelle le "petit génie" tant il se montre intelligent. Pourtant, sa scolarité est chaotique. Il n'aime pas les devoirs et se fait renvoyer de plusieurs établissements scolaires. Pendant longtemps, il est victime de harcèlement à l'école et se dit tout aussi mal à la maison.
Vers l'âge de 10 ans, le pré-adolescent découvre les ordinateurs. Il développe très vite des compétences en informatique : à 12 ans déjà, Elon vend son premier logiciel. Dans le même temps, il développe un très fort engouement pour les technologies, la science-fiction et le fantastique.
À 17 ans, le jeune homme décide de quitter l'Afrique du Sud pour partir faire ses études aux USA. Il rêve déjà de la Silicon Valley qu'il considère à juste titre comme un haut-lieu de technologies et de réussites.
Après un passage obligé par le Canada (pour des questions de visa), il intègre un cursus en physique à l’Université de Pennsylvanie. Au campus, Elon se sent bien et respecté dans ses capacités intellectuels notamment. Fâché avec son père, il finance lui-même ses études grâce à une bourse et des petits jobs dans l’informatique. Son frère Kimball le rejoint. Les deux hommes partent en road trip à travers les États-Unis.
En 1995, soit après trois ans de vie étudiante et juste avant d’obtenir son doctorat en physique énergétique, Elon Musk interrompt son cursus. Conscient du développement majeur de l’informatique et des idées de titans déjà plein la tête, l’étudiant veut lancer sa société.
La conquête de l'espace par Elon Musk
La biographie d'Elon Musk raconte ensuite ses débuts dans l'entrepreneuriat.
L'auteur explique avec détails comment, en quelques années seulement, Elon Musk est passé du statut d'étudiant fauché et vagabond à celui de multi-millionnaire.
En effet, entre 1995 et 2002, Elon Musk fonde deux entreprises majeures : Zip2 puis X.com qui deviendra PayPal. La vente de ces entreprises l'enrichit considérablement et servira de tremplin à sa carrière.
Fort de ses réussites, l’ingénieur s'accorde une période de répit. Il s'investit alors davantage dans sa vie personnelle. Avec son épouse, il décide de fonder une famille. Le couple achète une maison à Los Angeles et part voyager en Afrique (où il attrape une malaria sévère qui nécessitera six mois de guérison).
Mais rapidement, ses rêves intergalactiques et de conquête de l'espace ressurgissent. Dont un en particulier : celui de coloniser Mars.
Elon Musk décide alors de réunir d'impressionnants experts de l'industrie spatiale en créant sa "Life to Mars Foundation".
Puis, un jour,au retour d'un voyage en Russie, il a un déclic et se lance dans le projet fou de construire ses propres fusées !
C'est ainsi que va naître SpaceX, en 2002 : une entreprise ayant l'objectif de rendre l’accès à l’espace plus abordable.
Au fil des années, SpaceX grandit pour devenir un acteur majeur du monde.
Mais depuis leurs débuts considérés comme saugrenus à leurs réussites absolument étonnantes et improbables, les équipes de SpaceX ont connu les montagnes russes.
Tout au long de cette biographie, Ashlee Vance raconte avec brio l'aventure entrepreneuriale passionnante et pleine de rebondissements de SpaceX. Les épisodes relatifs aux lancements de fusées sont particulièrement captivants. Ils nous permettent d'ailleurs de prendre la mesure de l'incroyable leadership d'Elon Musk, sa détermination, sa passion et toute l'ampleur de sa vision.
Les autres innovations techniques et entrepreneuriales d’Elon Musk dans une nouvelle économie
La biographie retrace deux autres grandes aventures entrepreneuriales d'Elon Musk. Avec ses défis et ses réussites, l'auteur nous en fait aussi un récit captivant :
Tesla Motors : fondée en 2003, cette société vise la transition vers un système de transport totalement automatisé en développant des véhicules électriques de haute performance. L'auteur nous fait revivre les énormes challenges de Tesla dans ses débuts. Bien que révolutionnaire dans l'industrie automobile mondiale, l'entreprise d'Elon Musk frôlera la faillite à plusieurs reprises
SolarCity, une entreprise de panneaux solaires. L'idée de cette entreprise a germé dans la tête d'Elon Musk alors qu'il participait au célèbre Burning Man en 2004. Elle se concrétise en 2014 . SolarCity fusionnera avec Tesla quelques années plus tard.
Dans cette biographie, Ashlee Vance brosse donc la vie incroyable de l’un des titans de la Silicon Valley. Mais, en dépeignant aussi ses innovations techniques et entrepreneuriales, le livre traite inéluctablement des mutations de nos modèles industriels tout particulièrement en ce qui concerne les voitures, les trains et les fusées.
Elon Musk : qui est-il vraiment en privé ?
Tout au long de sa biographie, Ashlee Vance entrouvre une porte sur l'intimité d'un homme à la personnalité complexe et souvent controversée.
L'auteur raconte comment, avec sa notoriété publique, la vie du chef d'entreprise est devenue plus tumultueuse et comment sa réputation a commencé à se détériorer. Dans la sphère familiale, sa situation subit les pressions de son statut, de ses responsabilités et de son obsession au travail. Ses relations familiales en souffrent, avec ses compagnes notamment.
Ashlee Vance revient sur la relation d'Elon avec Justine Wilson, sa première épouse, rencontrée à l'université au Canada, avec qui il a eu un premier enfant mort en bas âge, puis deux jumeaux (Griffin et Vivian) et des triplés (Kai, Saxon et Damian). Le couple divorce après 8 années de mariage, en 2008.
L'auteur évoque aussi le mariage d'Elon Musk avec Talulah Riley, alors que l'homme est au bord du gouffre mentalement et financièrement.
Enfin, la biographie de Ashlee Vance aborde avec détails :
La personnalité exigeante d'Elon Musk en qualité de manager : sa façon autoritaire de gérer ses équipes et ses collaborateurs, sa faculté à fédérer et motiver les troupes autour d'un projet, sa capacité à rebondir après les échecs, son style de gestion intense, son obsession à aller au bout de ses objectifs et ses heures de travail élevées.
Les projets ambitieux et démesurés à venir de l'homme qu'on a qualifié plusieurs fois de "fou", ainsi que la mission de vie qui l'anime profondément depuis son enfance.
Mon avis sur le livre biographique d’Elon Musk
Le récit chaotique d’un génie visionnaire et presqu'indestructible
Dans ce livre biographique d’Elon Musk, Ashlee Vance nous plonge dans les coulisses de l’univers fascinant d’Elon Musk.
Cette biographie nous permet d’abord de découvrir l’enfance agitée et le parcours chaotique de ce géant de la technologie visionnaire.
Ensuite, le récit nous dresse le portrait d’un homme extrêmement exigeant avec lui-même ainsi qu’avec ses collaborateurs. Loin d‘être un PDG ordinaire, on prend la mesure du génie tumultueux, mu par une vocation personnelle et extrêmement profonde. Son leitmotiv est la survie de l’humanité. Cette idée qui remonte à son enfance lui a apporté une force et une ambition sans limite tout au long de sa vie.
L’homme est impressionnant de détermination. Ashlee Vance y décrit sa capacité à ne jamais lâcher, à endurer un stress de forte intensité. En cela, on le perçoit comme presqu’indestructible.
La biographie d’un homme controversé, parmi les plus puissants au monde
La biographie d’Elon Musk est particulièrement inspirante.
D’abord parce qu’Elon Musk est aujourd’hui considéré comme un homme capable, à lui-seul, de changer les règles du jeu de la planète.
Ensuite, parce que ses incroyables innovations technologiques font vibrer le monde.
En s’attelant à des secteurs comme l’énergie et l’aérospatial, sans expérience concrète dans ces domaines, Elon Musk prouve à quel point il n’a peur de rien, et que, pour lui, tout est possible. Il montre ainsi que tout le monde peut penser et rêver plus grand.
Alors certes, l'homme est controversé, en raison notamment de son style de management et sa communication impulsive. La presse et ceux qui le connaissent le qualifie parfois de mégalomane, de despotique. Toujours est-il que les réussites entrepreneuriales d'Elon Musk sont en train de disrupter les plus grands modèles du monde économique et entrepreneurial.
En ce sens, nous avons affaire à la biographie d'un homme sans commune mesure.
Les points forts et points faibles du livre "Elon Musk - Tesla, Paypal, SpaceX : l'entrepreneur qui va changer le monde" de Ashlee Vance
Points forts :
La personnalité étonnante d’un homme au génie visionnaire et controversé.
Le récit sans parti pris qui montre le long parcours entrepreneurial, lève le voile sur l’envers du décor et la sphère plus privée de ce que nous connaissons de l'homme public.
Le ton très accessible de l’auteur qui alterne à merveille entre le style narratif et captivant d’un récit de vie, des réflexions sur l’enjeu de l’humanité et des données scientifiques et technologiques.
Point faible :
Malgré l’édition enrichie, la biographie d’Elon Musk reste très peu développée après 2015.
Ma note :
★★★★★
Pour aller plus loin :
Lire la chronique sur ce blog
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre “Elon Musk”
Visitez Amazon et achetez le livre “Elon Musk”
- "Alibaba : L'incroyable histoire de Jack Ma, le milliardaire chinois"
Biographie de Jack Ma, fondateur et ex-président de la société d’e-commerce Alibaba.
Titre original : "Alibaba, The House That Jack Ma Built"
Par Duncan Clark, 2017, 208 pages.
Résumé de la biographie de Jack Ma (Alibaba)
"Alibaba : L'incroyable histoire de Jack Ma, le milliardaire chinois" est un livre biographique qui raconte la vie de Jack Ma, connu pour avoir fondé le site e-commerce Alibaba. Ce récit nous permet aussi de comprendre le grand tournant de la Chine vers la société de consommation.
L'anglais, la première passion de Jack Ma
L’ouvrage retrace d’abord l’enfance et l’adolescence de Jack Ma, né en 1964, dans une famille modeste à Hangzhou, en Chine. À ce moment-là, le pays sort tout juste de la Révolution Culturelle.
Très tôt, le petit Jack se passionne pour l’anglais. Aussi, à 14 ans, pour améliorer son anglais, Jack endosse le rôle de guide touristique auprès des voyageurs anglophones de sa ville. Grâce à cette activité, il fera, un jour, une rencontre déterminante dans sa trajectoire de vie : celle à l'origine de son amitié indéfectible avec la famille australienne Morley.
Plus tard, Jack Ma devient enseignant d’anglais. Puis, il crée son cabinet de traduction.
Le succès d'Alibaba
C'est après deux échecs entrepreneuriaux que la vie de Jack Ma prend un tournant décisif. Lors d’un étrange voyage aux États-Unis, Jack Ma découvre internet. Pour lui, c’est une révélation !
Convaincu du potentiel d’internet en matière de commerce en ligne, il décide de lancer, en 1999, une plateforme de e-commerce en ligne. Il s'agit du premier site d'achat en ligne d'Alibaba : Taobao.
Le concept de Taobao est le suivant : créer à la fois un réseau de boutiques numériques, une plate-forme de distribution aux fabricants (pas de stock en propre) et un site d'achats en ligne de produits divers et rapidement livrables.
L'idée est innovante. Le site plaît aussi bien aux vendeurs qu'aux acheteurs. Tous y trouvent des avantages logistiques, financiers et très compétitifs.
Taobao rencontre rapidement un succès phénoménal. Et Alibaba devient, au fil du temps, l'une des plus grandes entreprises de commerce en ligne au monde.
En parallèle, et entre plusieurs évènements marqués de hauts et de bas, Jack Ma lance d'autres entreprises. L'une d'entre elles est Alipay, un service de paiement en ligne.
Le chef d'enreprise investit, par ailleurs, dans de multiples autres projets dans les médias, l'entertainment, la santé et la finance. Il soutient de nombreux jeunes entrepreneurs porteurs de nouvelles idées.
Malgré des concurrents redoutables et des autorités gouvernementales peu à l’aise avec Internet, Jack Ma a réussit à faire d'Alibaba un véritable empire commercial en ligne qui prospère en Chine et à l'étranger. En 2014, Alibaba entre à la bourse de New-York.
Aujourd’hui, Jack Ma est milliardaire. Alibaba attire des centaines de millions de clients par an, et le chef d’entreprise fait partie des acteurs les plus influents de l’économie d’Internet.
Mon avis sur le livre biographique de Jack Ma
Le parcours de vie exceptionnel d’un entrepreneur atypique
Le parcours de vie exceptionnelle de Jack Ma est particulièrement inspirant et captivant.
D’abord, parce que c'est l'histoire d'un homme qui, parti de rien, s’est construit à force de passion et avec une féroce détermination d’entreprendre.
Mais au-delà de Jack Ma le businessman, sa biographie nous fait découvrir un showman aux capacités de communication exceptionnelle. Les nombreuses anecdotes relatées dans une sphère plus intime nous éclairent aussi sur la singularité du fondateur d'Alibaba et sa personnalité hors-norme.
La découverte d’un modèle de culture d’entreprise spécifique à la Chine
L’histoire de Jack Ma racontée dans cette biographie s’inscrit dans celle d’un pays en plein bouleversement politique et économique.
Ainsi, on y découvre le néo-capitalisme chinois : comment la Chine s’est ouverte aux grands défis technologiques et médiatiques mondiaux et comment Internet a bouleversé l’entrepreneuriat chinois.
Le livre nous ouvre également les portes de la culture d’entreprise en Chine, à des années-lumière des modèles occidentaux.
Et si aujourd’hui Jack Ma est devenu un très grand entrepreneur, il est aussi un personnage symbolique de la nouvelle économie chinoise. Il incarne la révolution de la consommation et de l’entreprise en Chine. Il a eu le courage de s’attaquer à des secteurs comme la finance ou les médias longtemps dominés par l’État chinois.
Les points forts et points faibles du livre "Alibaba : L'incroyable histoire de Jack Ma, le milliardaire chinois" de Duncan Clark
Points forts :
Le parcours inspirant d’un homme atypique et parti de rien.
Le récit documenté de la vie de Jack Ma mais aussi de l’économie chinoise.
La découverte d’une culture d’entreprise très spécifique à l’Asie et très éloignée de l’Occident.
La découverte des coulisses d’un géant du web.
Point faible :
Une chronologie pas toujours facile à suivre.
Ma note :
★★★★★
Pour aller plus loin :
Lire la chronique sur ce blog
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre “Alibaba : L'incroyable histoire de Jack Ma, le milliardaire chinois”
Visitez Amazon et achetez le livre “ Alibaba : L'incroyable histoire de Jack Ma, le milliardaire chinois”
Conclusion - Quatre leçons clés à retirer de ces entrepreneurs à succès
L'innovation et l’audace
Un des premiers dénominateurs que l’on retrouve dans chacune de ces biographies est l’innovation.
Les entrepreneurs de ces cinq biographies ont tous su identifier un besoin non satisfait, l’associer à une tendance technologique pour finalement créer des produits capables de révolutionner des industries et des modes de vie.
En édifiant leurs entreprises disruptives, ces visionnaires ont tous fait preuve de beaucoup d’audace. Ils ont osé, ont su s’adapter et saisir les opportunités là où d’autres ne les voyaient pas. Ils ont tous, à un moment ou à un autre, pris des risques calculés pour atteindre le succès rencontré par la suite.
La persévérance, motivée par la passion et la vision à long terme
Un autre élément présent dans chacun de ces livres biographiques est le suivant : tous ont su persévérer.
En effet :
Avant d'arriver à propulser une fusée dans l'espace, Elon Musk et ses équipes ont essuyé plusieurs échecs de lancement de prototypes à grande échelle.
Steve Jobs a été licencié d’Apple en 1985, mais est revenu onze ans plus tard pour sauver l’entreprise de la faillite.
La société de Jack Ma a dû faire face à de féroces concurrents mais aussi à l'hostilité des autorités gouvernementales chinoises pour survivre.
Mark Zuckerberg a affronté de nombreux défis avec Facebook : la gestion de contenus et la protection de la vie privée des utilisateurs sur ses réseaux sociaux ont fait l'objet de beaucoup de polémiques et même de poursuites judiciaires.
Enfin, Jeff Bezos a aussi traversé de nombreuses crises et dû gérer une croissance fulgurante.
Malgré les obstacles, ces entrepreneurs hors-normes ont toujours continué à croire en leur vision. Tous ont travaillé dur pour les réaliser ou pour se renouveler. Et plutôt que de se concentrer sur des gains immédiats, tous ont fait des choix pour construire une entreprise durable et prospère.
La culture d'entreprise
Nombreux sont les entrepreneurs qui attribuent leur réussite à la culture d'entreprise qu'ils ont créée :
La biographie de Mark Zuckerberg évoque, par exemple, ses fameux "hackathons" : des événements où les employés de Facebook se rassemblaient pendant une période de temps déterminée, souvent un week-end, pour collaborer et créer des prototypes de nouvelles fonctionnalités pour le réseau social. Les hackathons sont un élément clé de la culture d'innovation et de la croissance rapide de Facebook au cours de ses premières années.
Comment ne pas évoquer, par ailleurs, la culture mise en place par Steve Jobs au sein d'Apple. Innovante, celle-ci combinait qualité (supérieure, visant l’excellence et la perfection), design (minimaliste, élégant et centré sur l’expérience utilisateur) et innovation (les employés étaient encouragés à pousser les limites de ce qu’ils pensaient "possible" et à toujours aller vers la simplicité).
De même, la biographie d’Elon Musk montre comment son ambition démesurée et son envie de changer le monde est ancrée dans les fondements de ses entreprises : on les retrouve dans les process de recrutement, dans ses exigences en terme de performances, la présence de services dédiés à l’expérimentation, etc.
Et quand Jack Ma prône l’intégrité et la collaboration, Jeff Bezos, lui,ne jure que par l'optimisation des process, la compréhension et la satisfaction du client.
La philanthropie
Il est difficile de savoir si la philanthropie est une cause ou une conséquence de la réussite de ces cinq entrepreneurs. Toujours est-il qu’elle est une caractéristique commune très forte dans leur parcours de vie.
Plus ou moins discrets sur leurs actions, tous sont de fervents partisans de causes philanthropiques. Tous donnent aujourd’hui des millions de dollars à des associations ou injectent des sommes incommensurables dans leurs propres fondations.
Qu'avez-vous pensé des biographies de ces entrepreneurs qui ont changé le monde ? N'hésitez pas à faire part de vos avis en commentaires, ou à suggérer d’autres biographies qui vous ont particulièrement inspiré !
Cet article Les 5 biographies des entrepreneurs les plus fascinants au monde est apparu en premier sur Des livres pour changer de vie.
 ]]>
]]>