Résumé de "S'épanouir : pour un nouvel art du bien-être" de Martin Seligman : en découvrant S’épanouir de Martin Seligman, le lecteur explore une psychologie scientifique du bien-être, loin des recettes simplistes, où optimisme, engagement, relations, sens et accomplissement deviennent des leviers concrets pour transformer en profondeur sa santé, son travail et ses liens.
Par Martin Seligman, 2016, 512 pages.
Titre original : Flourish. A New Understanding of Happiness and Well-Being - and how to Achieve Them.
Chronique et résumé de "S'épanouir : pour un nouvel art du bien-être" de Martin Seligman
Préface de Christophe André
Christophe André décrit son beau-père comme un véritable maître du bonheur, capable de transformer chaque épreuve en émerveillement. L’accident, l’hémorragie, le transport en hélicoptère et les soins deviennent pour lui un souvenir heureux. Le psychologue souligne que ce beau-père incarne la positive attitude sans effort conscient, plutôt qu’il ne la prêche.
À l’inverse, Christophe André se sent longtemps peu doué pour la joie, marqué par une éducation centrée sur la sécurité. Ses parents, éprouvés par la vie, privilégient le sérieux et le devoir, pas l’allégresse. Il se reconnaît dans le pessimisme de Freud, de certains écrivains et des intellectuels sombres des années 70-80.
Le psychologue raconte ensuite comment la parentalité bouleverse ce schéma intérieur, lorsqu’il devient père à trois reprises. Il se sent responsable de ne pas contaminer ses enfants avec ses inquiétudes injustifiées. Il comprend que beaucoup de ses ruminations ne relèvent pas de tragédies réelles, mais d’une adversité ordinaire.
Le second tournant majeur est la découverte de la psychologie positive, au tournant des années 2000. Martin Seligman élargit la mission de la psychologie, qui ne doit plus seulement réparer les troubles. Il s’agit aussi d’augmenter le bien-être psychologique, de savourer la vie et de prévenir les rechutes.
Selon le psychologue, cette quête du bonheur existait déjà chez les philosophes, de Voltaire à d’autres penseurs. La nouveauté réside dans l’ampleur des preuves scientifiques, qui accélèrent la compréhension du bien-être. Le nombre de recherches sur le bien-être subjectif explose et ouvre une nouvelle ère pour la clinique.
Christophe André présente ensuite le livre de Martin Seligman comme un guide privilégié au cœur de cette révolution. L’auteur y dévoile les coulisses de la psychologie positive, ses applications dans l’armée, l’école et l’entreprise. Il rappelle que cette approche ne consiste pas à nier le négatif ni à sourire bêtement en permanence.
Enfin, le psychologue insiste sur la sincérité et les failles de Seligman, loin de l’image d’un gourou radieux. L’auteur avoue ses côtés grognon, son ego, ses inquiétudes financières et son manque de talent thérapeutique. Pour Christophe André, M. Seligman n’est pas un maître du bonheur, mais un expert de la quête du bonheur, ce qui le rend d’autant plus crédible et proche de ses lecteurs.
]]>Résumé du "Manifeste du capitalisme" de Robert Kiyosaki : un livre engagé de l'auteur de "Père riche, Père pauvre", dans lequel Kiyosaki cherche à démontrer tout l'intérêt individuel et collectif à suivre la voie capitaliste — intéressant, dérangeant parfois, mais indispensable !
Par Robert Kiyosaki, 2024, 504 pages.
Titre original : Capitalist Manifesto (2022).
Chronique et résumé du livre "Manifeste du capitalisme" de Robert Kiyosaki
Introduction
La définition du Parabellum ("Si tu veux la paix, prépare la guerre")
Robert Kiyosaki explique qu’à ce stade de sa vie, il a peu à gagner. En revanche, il risque beaucoup s’il publie un livre sur le capitalisme aujourd’hui.
Il s’interroge parce que le climat culturel lui paraît hostile. Il évoque notamment la Cancel Culture, les accusations de racisme et la censure des voix dissidentes.
L’auteur décrit des dirigeants passifs face aux émeutes, aux pillages et au slogan « defund the police ». Il critique aussi la réécriture de l’histoire, la destruction de statues et la diabolisation de symboles nationaux. Pour lui, cette dynamique menace la mémoire collective et la nation.
Robert Kiyosaki s’insurge contre les géants des médias capables de « déplateformer » même un président. Il voit dans ces pratiques une remise en cause profonde de la liberté d’expression. Il reproche aussi aux éducateurs de privilégier pronoms de genre et mots déclencheurs plutôt que l’éducation financière.
L’entrepreneur rappelle le succès mondial de Rich Dad Poor Dad (Père riche, Père pauvre) depuis 1997. Ce succès rend sa prise de position encore plus risquée, car il a beaucoup de réputation à perdre.
Il précise que ce livre ne porte pas sur la politique ni sur Donald Trump, même s’ils ont coécrit deux ouvrages. Il reconnaît toutefois que le pouvoir actuel pousse, selon lui, un agenda socialiste qui menace les libertés.
Robert Kiyosaki dit écrire pour défendre les marchés libres, le capitalisme et la Constitution américaine. Il voit les entrepreneurs comme une force capable de sauver le rêve américain et l’économie mondiale. Il veut combattre les idées communistes enseignées à l’école en diffusant le capitalisme dans les familles.
Il conclut en se posant une dernière question : qu’y a-t-il de plus important que l’argent ?Pour lui, la réponse est claire : la liberté.
Écoutez votre père
L'auteur rappelle que George Washington est souvent considéré comme le « père de son pays ». Washington avertit que sans liberté d'expression, les citoyens risquent d'être menés comme des moutons à l'abattoir. Robert Kiyosaki estime qu'en 2021, cette liberté disparaît derrière le politiquement correct et la censure culturelle.
Il dénonce la réécriture de l'histoire, les statues abattues et la surveillance accrue des réseaux sociaux. Il associe ces phénomènes à des idéologues qu'il juge racistes et à l'enseignement de la Critical Race Theory. Pour lui, ces dynamiques affaiblissent l'unité nationale et menacent la mémoire historique du pays.
George Washington met aussi en garde contre l'accumulation de dettes et l'usage excessif de la monnaie papier. Robert Kiyosaki voit dans la Réserve fédérale moderne un système corrompu, créant de l'argent et ruinant les épargnants. Il compare les plans de relance récents à l'hyperinflation de Weimar et au contexte ayant permis la montée d'Hitler.
Selon lui, avec une dette publique gigantesque, l'Amérique imprime désormais de l'argent fictif et se rapproche de la faillite. Chaque nouveau dollar augmente la dette plus vite que la richesse produite dans l'économie. Il compare cette situation à un drogué à l'héroïne, pour qui l'argent reçu accélère la destruction au lieu de sauver.
L'auteur rappelle que l'école ne nous apprend presque rien sur l'argent, alors qu'il structure chaque jour nos vies. Il se demande si cet oubli est accidentel ou s'il révèle une omission intentionnelle liée à un agenda politique. Sa conviction est claire : l'absence d'éducation financière sert ceux qui profitent du système.
En 1997, Robert Kiyosaki auto-édite Rich Dad Poor Dad après le refus des éditeurs new-yorkais. Ces éditeurs rejettent trois idées centrales de son père riche, qui contredisent la sagesse financière conventionnelle :
Les riches ne travaillent pas pour l'argent.
Ta maison n'est pas un actif.
Les épargnants sont perdants.
Pour lui, ces croyances expliquent pourquoi la majorité reste coincée dans la rat race salariale. Robert Kiyosaki estime que la plupart des éditeurs suivaient la philosophie de son pauvre père plutôt que celle du riche. Le pauvre père prône études longues, emploi stable, épargne et investissement boursier à long terme.
L'entrepreneur choisit l'autre voie et, avec Kim, atteint la liberté financière sans emploi, héritage ni loterie. En 1996, il crée le jeu de société CASHFLOW pour enseigner concrètement le capitalisme et les notions financières. Les écoles et certaines élites universitaires refusent le jeu, voire affirment que les femmes ne jouent pas.
Pour expliquer sa philosophie, Robert Kiyosaki rédige une simple brochure, qui deviendra finalement Père riche, Père pauvre.
Son pauvre père est un universitaire brillant, diplômé de grandes universités et devenu surintendant de l'Éducation à Hawaï. Il se présente en politique, perd, est blacklisté par le gouverneur et se retrouve sans emploi durable. Il finit par mourir pauvre, malgré un hommage tardif avec un doctorat honorifique qui reconnaît sa dévotion à l'éducation.
Robert Kiyosaki sert comme pilote de Marine au Vietnam avant de revenir voir son père en 1973. Son père lui conseille de reprendre des études, obtenir un master, puis un emploi sûr de pilote de ligne. L'auteur comprend alors que ce parcours respectable l'a conduit à la quasi-pauvreté et décide de changer de modèle.
Il se tourne vers son riche père spirituel, installé à Waikiki, pour obtenir un autre type de conseil. Rich dad lui recommande d'apprendre la vente, d'investir dans l'immobilier et d'utiliser la dette comme outil. Il l'encourage aussi à devenir entrepreneur, créer des emplois et payer légalement très peu d'impôts.
En 1974, Robert Kiyosaki quitte le Corps des Marines et s'engage pleinement sur la voie entrepreneuriale. Après le succès mondial du livre, il reçoit des lettres de haine pour avoir qualifié son père de « pauvre ». Avec Capitalist Manifesto, il sait qu'il sera attaqué et traité de réactionnaire pour qualifier son père de marxiste.
Il cite George Washington, qui met en garde contre l'adhésion précoce à des systèmes politiques étrangers mal compris. Selon l'auteur, les écoles américaines enseignent aujourd'hui la Critical Race Theory et des idées issues du marxisme. L'élection de 2021 en Virginie montre, selon lui, des parents réveillés qui rejettent ces programmes scolaires.
Robert Kiyosaki rappelle que le Manifeste communiste appelle à la révolution lorsque l'écart riches-pauvres devient trop grand. Il considère qu'au lieu d'enseigner aux gens à « pêcher », l'État américain se contente de distribuer toujours plus d'aides. Ce livre veut apprendre le capitalisme dans les familles, pendant que les écoles diffusent, selon lui, le communisme.
En 1965, à l'académie de la Marine marchande, il étudie Marx, Hitler, Mao et d'autres penseurs autoritaires. Il réalise alors que son pauvre père incarne une vision communiste, tandis que son riche père incarne le capitalisme. En voyant plus tard le Vietnam dévasté puis des magasins américains barricadés, il pense que ces avertissements se réalisent.
Attaché aux Marines, il choisit de lancer ce manifeste le jour anniversaire du Corps, le 10 novembre 2021. Il demande le soutien de son ancien camarade Jack Bergman, devenu général puis membre du Congrès. En entendant son « Semper fi », Robert Kiyosaki voit une confirmation qu'il est temps de défendre la liberté.
L'auteur affirme que trois institutions clés incarnent aujourd'hui le marxisme caché : la NEA, l'IRS et la Fed. Il veut les sortir de l'ombre, tout en rappelant que l'Amérique doit rester un pays de choix et de débats. En citant George Washington sur la parole libre et le courage, il demande s'il n'est pas temps d'écouter notre père.
Qui êtes-vous ?
L’auteur commence par demander au lecteur s’il est socialiste, marxiste, fasciste, communiste ou capitaliste. Il insiste sur la nécessité de définir clairement ces termes. Ces définitions serviront de base à tout le livre.
Le socialisme désigne, pour lui, un système où la communauté possède ou contrôle production, distribution et échanges. Dans la théorie marxiste, il représente une phase transitoire entre le capitalisme renversé et communisme. Il associe aussi le socialisme à des politiques publiques inspirées de cette logique.
Le marxisme regroupe les théories politiques et économiques de Marx et Engels, prolongées par leurs disciples. Il explique le changement social par les facteurs économiques et les moyens de production. Marx et Engels annoncent une révolution prolétarienne et une société communiste sans classes.
Le communisme défend la propriété collective et la fin de la propriété privée individuelle. L’auteur rappelle les régimes issus de cette idée : URSS, Europe de l’Est, Chine, Cuba, Vietnam, Corée du Nord. Il souligne l’écart entre la théorie d’un État appelé à « dépérir » et la réalité d’États omniprésents.
Le fascisme est présenté comme un système autoritaire, nationaliste et intolérant. Il met en avant la suprématie d’un groupe national ou racial et le culte d’un chef puissant. L’auteur cite Mussolini, Hitler et Franco comme exemples historiques.
La démocratie repose, pour lui, sur le gouvernement du peuple par des représentants élus.
Le capitalisme se définit par la propriété privée des entreprises et la recherche du profit. Le commerce et l’industrie y sont contrôlés par des acteurs privés plutôt que par l’État.
Robert Kiyosaki oppose ensuite Capitalist Manifesto au Manifeste communiste. La propriété privée est au cœur du capitalisme, alors que Marx et Engels veulent l’abolir. Il rappelle leurs avertissements sur la démocratie menant au socialisme et sur le rôle des révolutions.
L’auteur cite une prédiction attribuée à Marx sur l’endettement massif des travailleurs. Selon cette vision, la dette excessive conduit à la faillite des banques, puis à leur nationalisation. Ce processus ouvrirait la voie à un système communiste piloté par l’État.
Rich dad pose une question centrale : pourquoi il n’y a pas d’éducation financière à l’école. L’auteur rapproche cette absence des citations de Lénine, Staline, Hitler et Mao sur l’endoctrinement par l’éducation. Il laisse entendre qu’un contrôle idéologique commence dès l’enfance.
Robert Kiyosaki rapporte un sondage de 2020 de la Victims of Communism Memorial Foundation. 40 % des Américains, et près de la moitié des Millennials et Gen Z, ont une vision favorable du socialisme. Dans le même temps, le soutien au capitalisme baisse légèrement et une majorité privilégie la liberté à la sécurité.
Première partie : Vue d’ensemble du capitalisme et du communisme
Chapitre 1 : On nous avait prévenus
Nikita Khrouchtchev avertit en 1959 que les Américains finiront sous le communisme par petites doses de socialisme. Robert Kiyosaki relie cet avertissement à son retour du Vietnam, en 1973. À son arrivée, il découvre un pays hostile aux soldats, entouré de manifestants qui les insultent.
De retour sur la base, il voit des familles heureuses, mais aussi des Marines accueillis par des avocats avec des papiers de divorce. Il raconte la détresse d’un ami pilote, quitté par sa femme pendant la guerre. Pour lui, la guerre la plus dure commence dans l’Amérique déchirée et politisée qu’il retrouve.
À Honolulu, son pauvre père vient le chercher en silence. La famille, autrefois engagée dans le Peace Corps, désapprouve son engagement dans les Marines. L’atmosphère reste tendue, sur fond de guerre impopulaire et de désaccords politiques.
L’auteur rappelle que son père est surintendant de l’Éducation et dirige le syndicat des enseignants. Il associe les syndicats à la tradition marxiste, en citant le slogan « Workers of the world, unite ». Pour lui, la NEA illustre ce marxisme, en privilégiant pouvoir et argent plutôt que l’éducation.
Il cite des articles de Forbes et d’autres médias conservateurs qui accusent la NEA de corrompre l’école publique. Selon ces critiques, le syndicat protège les enseignants, bloque les réformes et fait grimper les coûts sans améliorer la qualité. L’auteur voit dans cette institution une force qui sabote l’apprentissage réel.
Adolescent, il assiste aux réunions syndicales chez ses parents et conclut que la priorité n’est pas l’élève. À l’inverse, son riche père fait face à une grève de ses employés, soutenue par le syndicat. Quand Robert traverse les piquets de grève pour l’aider, son pauvre père le traite de « scab », de traître.
En 1969, il refuse d’adhérer au syndicat des officiers de la marine marchande, par rejet du marxisme. Il choisit plutôt le Corps des Marines pour combattre les marxistes au Vietnam. Il se retrouve ainsi en opposition frontale avec la vision syndicale et politique de sa famille.
Plus tard, les divisions resurgissent autour de Donald Trump : lui et son frère le soutiennent, ses sœurs votent Biden. L’auteur évoque les polémiques sur Dominion Voting Systems et les accusations de fraude électorale. Il cite Staline et Hitler pour dénoncer, selon lui, la manipulation des votes et de la vérité.
Il raconte une interview où il déclare qu’il aurait pu « tuer des communistes » en tirant sur l’hôtel de ville, parole qu’il regrette. Pour lui, cela illustre à quel point la colère contre le communisme s’est invitée à l’intérieur même du pays. Il suggère que beaucoup « ne supportent pas la vérité ».
L’auteur se demande si le Manifeste communiste infiltre l’Amérique via l’école et les enseignants. Il note que de nombreux parents contestent aujourd’hui les programmes, notamment la Critical Race Theory. Il rappelle la mise en garde d’Einstein sur ceux qui négligent la vérité dans les « petites choses ».
Robert Kiyosaki répète alors l’avertissement de Khrouchtchev sur le socialisme administré par petites doses. Il relie cet avertissement au COVID-19, qu’il voit comme une « pause » pour réfléchir. Il pose une série de questions : les Américains sont-ils crédules, déjà socialisés, et leur économie affaiblie ?
Il accuse la NEA de « perfuser » le marxisme dans l’école, comme un opioïde idéologique. Il rappelle que des parents contestataires sont parfois assimilés à des « terroristes domestiques ». Il cite des articles relatant un mémo de Merrick Garland demandant au FBI de surveiller les menaces contre les conseils scolaires.
Pour l’auteur, ses outils capitalistes sont le jeu CASHFLOW et le livre Rich Dad Poor Dad. Ils servent à enseigner le capitalisme à la maison pour contrebalancer un enseignement scolaire qu’il juge marxiste. Il voit ces outils comme des armes éducatives dans une bataille idéologique.
Enfin, il aligne des citations de Marx, Lénine, Staline, Mao et Hitler sur le contrôle de l’éducation. Selon lui, ces dictateurs ont compris que l’école façonne les esprits et donc le système politique. Capitalist Manifesto veut, à l’inverse, aider les citoyens à reprendre le contrôle de l’éducation, de l’économie et de leurs libertés.
Chapitre 2 : Une autre éducation
L’auteur se souvient de l’essai nucléaire de 1962 à Hawaï, ciel rouge sang et peur d’une guerre atomique. Il relie cette angoisse aux menaces du communisme et aux propos de Khrouchtchev sur les « petites doses de socialisme ». Les exercices absurdes “sous le pupitre” lui montrent déjà le décalage entre réalité et discours officiel.
Plus tard, il compare cette situation aux débats sur le COVID-19, les masques et la fermeture des écoles. Il cite des responsables politiques qui veulent rouvrir les classes et accusent les syndicats d’enseignants de bloquer. Pour lui, la crise sanitaire révèle une école coûteuse, inefficace et idéologisée.
L’auteur évoque ensuite l’augmentation du décrochage scolaire pendant la pandémie, aux États-Unis et dans le monde. Ne pas finir le lycée réduit fortement le revenu futur des jeunes. Il y voit une bombe sociale silencieuse.
Il décrit la crise des prêts étudiants : dette colossale, difficilement effaçable par la faillite. Les familles aisées peuvent aider leurs enfants, les familles pauvres restent piégées. Candace Owens illustre cette impasse en parlant d’un diplôme cher, sans compétences pratiques.
En parallèle, il dénonce les bailouts de 2008, qui sauvent les banques mais pas les citoyens endettés. Il s’appuie sur G. Edward Griffin et la notion de « moral hazard » : les dirigeants prennent des risques, sachant qu’ils seront sauvés. Les étudiants, eux, portent à vie une dette que l’État a contribué à créer.
L’auteur critique la politique d’Obama sur les prêts fédéraux, qu’il juge inflationniste et irresponsable. Il cite des éditoriaux qui accusent la Maison-Blanche d’encourager l’irresponsabilité et d’alourdir la facture pour les contribuables. Pour lui, cette mécanique affaiblit l’économie, comme Khrouchtchev l’avait annoncé.
Robert Kiyosaki attaque aussi Black Lives Matter, dont certaines fondatrices se disent marxistes. Selon lui, limiter le discours à « Black Lives » est en soi raciste, car toutes les vies comptent. Il relie ce mouvement, ainsi que le 1619 Project, à une réécriture marxiste de l’histoire américaine.
Il rappelle l’histoire de sa propre famille japonaise-américaine : internement, biens confisqués, oncles prisonniers ou héros du 442e bataillon. Personne ne réclame de réparations, contrairement aux débats actuels sur l’esclavage. Il s’interroge : pourquoi certaines victimes seraient indemnisées et d’autres non ?
L’auteur liste ensuite des intellectuels noirs conservateurs, en particulier Thomas Sowell. Il résume sa trajectoire : Marine en Corée, Harvard, économiste prolifique au Hoover Institution. Il reprend ses critiques de l’idéologie progressiste, de la rhétorique sans faits et de l’endoctrinement scolaire.
Pour contrer ce qu’il appelle l’endoctrination marxiste. Il oppose les valeurs militaires – mission, honneur, discipline – à la culture des « snowflakes », des triggers et de la victimisation. Les mots deviennent des armes : soit pour renforcer la responsabilité, soit pour nourrir le ressentiment.
Enfin, l’auteur raconte son propre parcours scolaire chaotique, ses échecs et son rejet de l’université classique. Son père défend sa liberté de penser autrement, mais refuse de financer des études sans projet. Grâce aux écoles militaires et à la Marine, il choisit la « route moins fréquentée », la discipline et, plus tard, l’entrepreneuriat plutôt que la voie universitaire standard.
]]>Résumé du livre "L'art d'être seul : L'isolement était ma prison, la solitude est ma maison" de Renuka Gavrani : Et si ta plus grande peur, être seul, devenait ta super-puissance ? Dans L'art d'être seul (The Art of Being Alone), Renuka Gavrani t’apprend à transformer la solitude en refuge, en moteur de succès et en histoire d’amour avec la seule personne qui ne partira jamais : toi.
Par Renuka Gavrani, 2023, 149 pages.
Titre original : The Art of Being Alone. Solitude is my Home, Loneliness was my Cage.
Chronique et résumé de "L'art d'être seul : L'isolement était ma prison, la solitude est ma maison" de Renuka Gavrani
Introduction
Renuka Gavrani rappelle d’abord que la solitude affecte la santé autant que fumer plusieurs cigarettes par jour. Pourtant, elle refuse d’écrire un livre rempli de chiffres. Elle veut parler d’un cœur à un autre. Le lecteur cherche surtout comment apaiser sa propre solitude.
L’autrice montre que la solitude devient un tabou dès que le temps avec soi-même est perçu comme une anomalie. Elle raconte ses anciennes pensées autodépréciatives, persuadée qu’un défaut la rendait rejetable. Après une longue introspection, elle découvre qu’elle aime sa propre compagnie. Introvertie, elle préfère peu de relations, mais sincères.
Renuka Gavrani décrit ensuite une camarade de lycée toujours seule, vite cataloguée comme « bizarre ». À l’école, l’élève isolé suscite moqueries ou pitié. Les livres et les films reprennent ce schéma. Le personnage solitaire apparaît comme une victime à sauver.
Peu à peu, la créatrice de contenus relie cette peur à notre quête d’acceptation sociale. Nous craignons d’être jugés, ridiculisés, exclus. Cette peur freine nos projets bien avant les réactions réelles des autres. À l’université, Renuka Gavrani se sent terriblement seule alors que personne ne remarque son isolement.
Elle comprend alors que nous ne détestons pas être seuls, mais l’idée d’être laissé·e pour compte. L’enfance nous a appris que rester en arrière est honteux. Nos vies deviennent tributaires du regard supposé d’autrui. Nous finissons par nous juger plus durement que le monde extérieur.
L’autrice critique aussi la comparaison permanente nourrie par les réseaux sociaux. Les groupes d’amis « parfaits » et les voyages « goals » envahissent nos écrans. Chacun peut croire être la seule personne sans « vraie bande ». L’industrie du divertissement entretient le mensonge : « être seul = être malheureux ».
Pour l’autrice, la vraie clé est de distinguer solitude et isolement. Être seul signifie être avec soi-même, pas être misérable. La solitude devient problème lorsque l’on se regarde avec honte et pitié. Ce regard détruit l’estime de soi plus que l’absence de compagnie.
Aujourd’hui, Renuka Gavrani vit sans grande bande d’amis, mais avec plus de liberté. Elle choisit son quotidien, proche de ses parents et de l’écriture. Elle construit une vie qu’elle aime au lieu de jouer la « fille cool ». Sa solitude devient un espace de choix plutôt qu’un signe d’échec.
L’autrice invite enfin le lecteur à faire une pause et à repenser sa croissance personnelle. D’abord, accepter que la solitude n’est pas une malédiction. Ensuite, transformer la loneliness en vraie solitude. Puis utiliser cette solitude comme période de croissance, thème des deux parties du livre.
Première partie
Chapitre 1 - Arrêter d'idéaliser la solitude
L’autrice part de ces contenus qui incitent à romantiser sa vie et reconnaît qu’ils la font rêver elle aussi. Pourtant, elle s’interroge sur le danger caché derrière ce concept. Selon elle, nous jouons déjà un rôle de film, sans en avoir conscience.
Depuis l’enfance, nous intégrons des scénarios où un personnage brisé est sauvé par un héros sauveur ou un ami idéal. Films et séries répètent la même histoire : quelqu’un de perdu, puis quelqu’un qui arrive et répare tout. Cette narration façonne notre manière d’attendre la vie.
Renuka Gavrani raconte avoir longtemps espéré une amitié parfaite, comme Joey et Chandler, et s’être sentie incomplète. Elle analyse ensuite ce désir avec du recul et le voit comme une croyance inconsciente. Une petite fille qui veut simplement reproduire un objet de rêve vu à l’écran.
Le problème, souligne la créatrice de contenus, est que notre imagination crée un espoir illusoire. En attendant un sauveur, nous décidons que nous ne sommes pas "assez" pour changer notre vie. Quand la réalité ne correspond pas à ce scénario, le sentiment de solitude s’aggrave.
L’autrice précise qu’on peut encore rencontrer de « bonnes personnes », mais surtout dans une logique de fausse amitié ou de réseau. Après un certain âge, les liens relèvent davantage du networking que des « âmes sœurs ». Prendre chaque personne gentille pour un futur meilleur ami promet déceptions et chagrins.
Pour elle, il faut arrêter de se voir comme une victime en attente. La vie du lecteur est une histoire inédite dont il est le personnage principal. Il dispose d’une liberté créative immense pour écrire un récit centré sur lui-même.
Renuka Gavrani invite finalement à renoncer aux scénarios de sauvetage romantique pour assumer la responsabilité de soi. La question devient alors : choisir de se plaindre d’un rôle passif ou décider enfin d’écrire sa propre histoire.
Chapitre 2 - La souffrance de cacher sa vraie nature
Poussés par la peur d’être un weirdo, les gens se transforment peu à peu en versions lisses et acceptables d’eux-mêmes. Ils disent oui à tout, copient les autres et s’éloignent progressivement de leurs vrais désirs.
L’autrice explique que cette adaptation permanente crée une fracture intérieure. Plus on cherche l’approbation extérieure, moins on écoute ce qui nous plaît vraiment. Le fossé entre soi authentique et soi social grandit jusqu’à rendre méconnaissable sa propre identité.
Pour Renuka Gavrani, la véritable loneliness naît lorsque l’on ne se retrouve plus en soi-même. On peut être entouré et pourtant se sentir vide. La solitude devient insupportable car elle rappelle la disparition du vrai soi, enfoui sous les rôles joués.
La créatrice de contenus reconnaît s’être longtemps oubliée dans le people pleasing. Elle raconte ses « oui » donnés contre son propre gré. Elle réalise alors qu’elle est idéale pour les autres, mais presque étrangère à elle-même.
« Il y a des jours où l’on se manque soi-même plus qu’on n’a jamais manqué à personne d’autre. » (Renuka Gavrani, L'art d'être seul, Chapitre 2)
Peu à peu, l’âme cesse d’envoyer des signaux à force d’être ignorée. Quand le silence intérieur devient trop lourd, le face-à-face avec soi fait mal. On peut alors se surprendre à se manquer soi-même plus que n’importe quelle autre personne.
L’autrice conclut que cette fuite de soi alourdit le cœur et brouille nos vrais besoins. Elle ne se présente pas comme experte, mais comme humaine passée par là. Les chapitres suivants viseront à redevenir soi-même afin de transformer le temps seul en véritable solitude.
Chapitre 3 - Comment être soi-même
L’autrice décrit comment le besoin d’acceptation pousse chacun à jouer plusieurs rôles selon les personnes. Partenaire, amis, collègues : à chaque relation, une version différente de soi se présente. À force d’ouvrir ces « onglets » de personnalité, la créatrice de contenus estime que le système interne finit par « planter ». Le vrai soi disparaît sous les versions fabriquées.
Renuka Gavrani reconnaît qu’elle aussi cherche parfois à paraître « voulue » plutôt qu’authentique. Elle souligne l’absurdité de perdre son identité, puis de chercher des « hacks » de self-love sans se connaître vraiment. Pour aimer quelqu’un, il faut le connaître ; il en va de même pour soi-même. L’autrice invite donc le lecteur à retrouver qui il est vraiment afin de pouvoir enfin tomber amoureux de son vrai soi.
1 — L'amour de soi commence par l'acceptation de soi
L’autrice observe la popularité du self-love sur les réseaux sociaux et s’en éloigne. Pour elle, ce discours tourne souvent à la plainte. Les marques exploitent cette mode pour vendre des produits déguisés en amour de soi.
Renuka Gavrani propose une définition centrée sur la connaissance de soi et l’acceptation. Connaître ses pensées, sa nature et sa personnalité devient la première étape. Ensuite vient le fait d’assumer pleinement ce qui se cache sous les bonnes manières.
La créatrice de contenus critique l’injonction sociale à être toujours gentil et irréprochable. Vouloir appartenir au camp des « bons humains » épuise. On se force à être doux avec les autres, même quand on est brisé.
L’autrice explique que les « méchants » de fiction nous fascinent car ils assument toutes leurs émotions. Ils rappellent que l’être humain n’est pas programmé pour être parfait. Supprimer sa part sombre coupe de sa vérité intérieure.
Au fil de son introspection, Renuka Gavrani reconnaît sa tendance à être égoïste parfois. Plutôt que se haïr pour ce trait, elle choisit de l’utiliser pour se préserver. Cette lucidité lui permet d’ajuster ses attentes dans ses relations.
Pour l’autrice, la vraie guérison commence quand on voit clairement ses défauts et qu’on les transforme. Le self-love ne se limite pas aux bains moussants et au maquillage. Il s’agit de se choisir chaque jour et de comprendre ses propres mécanismes.
Elle décrit enfin l’amour de soi comme une maison intérieure. Un espace où l’on peut être soi, sans masque ni perfectionnisme. Accepter ses zones « sombres » devient alors une façon de se reconnaître pleinement.
2 — L’amour de soi grandit avec la connaissance de soi
L’autrice affirme que le monde intérieur de chacun dépasse les sept merveilles du monde. Pourtant, elle refuse de proposer des hacks rapides pour se connaître. Pour Renuka Gavrani, l’être humain change sans cesse, ses goûts et priorités évoluent en permanence. On ne peut donc pas le traiter comme un simple projet à optimiser.
La créatrice de contenus insiste sur le fait que la connaissance de soi est une démarche à vie, surtout dans un monde saturé de distractions. En quelques secondes, on désire ce que les autres semblent aimer. Se connaître et ne pas se perdre devient un effort continu. Elle propose alors non pas des astuces magiques, mais des habitudes quotidiennes à mettre réellement en pratique.
A) Être en tête à tête avec son esprit
Quand nous sommes seuls, nous faisons face uniquement à notre esprit. Pour beaucoup, ce tête-à-tête ressemble à une punition. L’autrice raconte comment, pendant le Covid, son flot de pensées l’a submergée avant qu’elle décide d’y regarder de plus près.
Renuka Gavrani comprend que ce n’est pas le mental qui est l’ennemi, mais tout ce qui reste refoulé. Ce que nous n’osons pas admettre revient sous forme d’angoisses, de regrets et de culpabilité. Nous fuyons alors dans les distractions et parfois dans des relations toxiques.
Selon la créatrice de contenus, la vraie liberté commence quand on ose regarder ses pensées en face. Il faut accueillir chaque regret, chaque mauvaise décision, une à une. Une fois les couches du passé reconnues, la respiration devient plus légère et la paix intérieure possible.
L’autrice souligne que l’ignorance de soi conduit à accepter le minimum des autres. Ils nous distraient et nous évitent de penser, ce que nous croyons vouloir. Pourtant, il n’existe aucune échappatoire durable : tout ce qui est enfoui reste en nous et demande tôt ou tard à être entendu.
Elle propose un exercice simple : s’asseoir chaque jour 10 à 15 minutes avec son âme.
Lire ses pensées comme un grand livre, sans jugement, comme son propre thérapeute. Avec le temps, découvrir ses réactions et ses manies devient fascinant, presque comme tomber amoureux de soi-même.
]]>Résumé du livre "Sauver le temps : Découvrir une vie au-delà de la montre" de Jenny Odell : Et si le temps n’était ni argent, ni productivité à optimiser, mais un commun vivant à cultiver ensemble ? Saving Time propose de sortir du compte à rebours capitaliste pour habiter d’autres rythmes, plus justes pour nos corps, nos liens et la planète.
Par Jenny Odell, 2023, 364 pages.
Titre original : Saving Time. Discovering a Life Beyond the Clock.
Chronique et résumé de "Sauver le temps : Découvrir une vie au-delà de la montre" de Jenny Odell
À propos de Jenny Odell et de son œuvre
Jenny Odell est une artiste et autrice basée à Oakland, connue pour son travail sur l’attention, le territoire et les effets du capitalisme numérique sur nos vies. Ancienne enseignante à Stanford, elle mêle art, observation minutieuse du quotidien et réflexion politique dans des essais devenus des best-sellers, comme Pour une résistance oisive : ne rien faire au XXIe siècle (How to Do Nothing: Resisting the Attention Economy) et Sauver le temps (Saving Time: Discovering a Life Beyond the Clock).
Dans Pour une résistance oisive (2019), elle critique les plateformes qui capturent notre attention et nous enferment dans une exigence permanente de visibilité et de productivité. Plutôt que de prêcher la déconnexion totale, Jenny Odell propose de rediriger notre attention vers le monde proche : les oiseaux, les parcs, les communautés locales. Faire « rien », chez elle, signifie refuser la logique de l’attention-marchandise pour retrouver des formes d’appartenance, de soin et de contemplation.
Avec ce nouvel ouvrage, elle élargit cette critique : après l’économie de l’attention, elle s’attaque à notre manière de vivre le temps lui-même. Jenny Odell montre comment l’idée que « le temps, c’est de l’argent » structure le salariat, les inégalités sociales et la crise écologique, et défend d’autres temporalités, inspirées des luttes sociales et des cosmologies non occidentales. Prêt à libérer votre temps ?
Introduction : Un message pour le moment présent
Mousses et autres temps
Pendant les confinements liés au Covid-19, Jenny Odell observe la mousse qui pousse dans un petit pot et dans les fissures de la ville. Elle y voit un être capable de sécher, dormir longtemps, puis revenir à la vie quand l’eau revient. La mousse devient une image d’un temps cyclique, qui se contracte, se gonfle, disparaît, recommence.
À partir de là, l’autrice critique l’idée que « le temps, c’est de l’argent ». Elle montre que notre rapport au temps vient du salariat : vendre ses heures, voir sa valeur décidée par d’autres. Le burn-out vient alors moins d’un manque d’heures que d’un manque d’autonomie et de sens, alors que chacun ressent aussi d’autres rythmes comme les saisons, par exemple.
Jenny Odell relie cette pression temporelle à l’angoisse climatique. Standardisation des horaires, colonisation et exploitation de la nature relèvent d’une même logique extractiviste. Elle oppose deux visions du temps :
Chronos, temps linéaire qui mène au pessimisme ;
Kairos, temps de l’occasion où une décision ou une parole peuvent changer le cours des choses.
Volcans, tourisme et extraction
Avec l’exemple du volcan Ijen, filmé par l’influenceur Jack Morris, l’autrice montre comment un même lieu devient à la fois décor touristique et site de travail mortel pour les mineurs de soufre. Ces hommes risquent leur vie pour un salaire misérable, pendant que les touristes « profitent de l’instant ». Or, le temps des uns est ajusté à celui des autres.
Jenny Odell rappelle aussi que le volcan est un sujet issu de millions d’années de transformations géologiques, avec sa propre temporalité. Le voir comme un « qui » et non un « quoi » brise l’idée d’une nature inerte, simple ressource à consommer.
Sauver le temps : du personnel au politique
Jenny Odell ne promet pas de « gagner du temps ». Elle propose plutôt de relier notre temps personnel aux temps historiques, sociaux et climatiques. Changer seul ne suffit pas si les règles collectives restent les mêmes.
Elle s’appuie sur les réseaux d’entraide apparus pendant le Covid, qui montrent d’autres valeurs possibles :
Soin ;
Solidarité ;
Interdépendance.
Face au nihilisme climatique, Jenny Odell se tourne vers des moments de soulèvement collectif où tout semble pouvoir basculer. « Sauver le temps », pour elle, signifie retrouver un temps vivant, inventif, non réduit à l’argent, pour que notre futur reste ouvert.
Chapitre 1 : À qui appartiennent le temps et l'argent ?
Acheter le temps : badgeage, surveillance et salariat
Jenny Odell part de la révolte de physiciens italiens contre le badgeage pour montrer comment le temps de travail est acheté. Les chercheurs refusent de vendre leur présence minute par minute, car l’inventivité scientifique ne se mesure pas à l’horloge. Elle retrouve cette logique dans Les Temps modernes de Chaplin : le temps devient une matière première à optimiser jusqu’au ridicule.
Aujourd’hui, cette logique se prolonge dans les entrepôts Amazon, les call centers ou la restauration low-cost. Les corps sont suivis par GPS, les pauses toilettes comptées, chaque seconde surveillée par un robot-manager.
Avec les logiciels de productivity monitoring, la surveillance s’étend même au télétravail. Peu à peu, ce régime de surveillance façonne même notre idée de ce qu’est “bien utiliser” sa journée.
Pour Jenny Odell, ce qu’elle appelle le temps fongible – des heures identiques qu’on peut remplir de tâches – est une invention historique. Dire que « le temps, c’est de l’argent » cache un rapport de pouvoir entre vendeur et acheteur de temps.
L’employeur cherche soit à étendre la journée (grignoter les pauses, allonger les horaires), soit à intensifier la cadence (remplir tous les “trous” avec plus de travail). Les machines promettent de “gagner du temps”, mais ce temps libéré est réinvesti dans encore plus de production.
Discipline du temps, colonisation et salariat
Jenny Odell montre que la discipline du temps naît dans les monastères chrétiens. Les Cisterciens associent déjà ponctualité, efficacité et gestion du temps, au service de Dieu et du profit. Les horloges mécaniques sortent ensuite des monastères pour organiser les villes commerçantes, et donc contrôler la journée achetée aux travailleurs.
Avec les chemins de fer, la poste et les fuseaux horaires centrés sur Greenwich, le temps abstrait européen devient la norme mondiale. Cette standardisation accompagne la colonisation : les clochers missionnaires imposent la semaine de 7 jours dans des sociétés réglées habituellement sur les saisons, les plantes et les rituels qui leur sont associés. Faire intérioriser le mot d'ordre “Le temps c'est de l'argent” devient un outil de domination, pas seulement un dispositif économique.
Elle rappelle aussi que soldats, esclaves et domestiques sont les premiers traités comme “machines humaines”. Les plantations esclavagistes expérimentent déjà tableaux, calculs, mesures pour optimiser chaque jour de travail.
Le salariat apparaît ensuite comme une forme plus “respectable” de dépendance : au XIXᵉ siècle, certains parlent d'"esclaves salariés" (“wage slaves”), et comparent la vente de son temps à une forme de servitude.
]]>Résumé de "Switch : Osez le changement" de Chip Heath et Dan Heath : Vous voulez changer une habitude, transformer votre équipe ou relancer un projet enlisé, mais vous ne savez plus par où commencer ? Ce livre vous montre, pas à pas, comment rendre le changement plus simple, plus motivant et surtout durable.
Par Chip Heath et Dan Heath, 2012, 319 pages.
Titre original : Switch: How to Change Things When Change Is Hard (2010).
Chronique et résumé de "Switch : Osez le changement" de Chip Heath et Dan Heath
Introduction. Trois surprises à propos du changement
1 — Un problème de personne ou d'habitude se confond souvent avec un problème de situation
Les auteurs ouvrent l’introduction avec une expérience de Brian Wansink dans un cinéma de Chicago. Des spectateurs reçoivent du pop-corn rassis dans des gobelets moyens ou très grands. Ceux qui ont les grands gobelets mangent beaucoup plus, alors même qu’ils n’aiment pas vraiment le pop-corn. Ils refusent pourtant de croire que la taille du récipient influence leur comportement.
Si l’on ne connaît pas l’existence des deux formats, on conclut que certains sont raisonnables et d’autres sont des « goinfres ». Un spécialiste de santé publique penserait devoir éduquer ces gros mangeurs, changer leurs habitudes, leur expliquer les dangers. Les auteurs montrent au contraire qu’il suffit de réduire la taille des gobelets. Ce qui ressemble à un problème de personne est souvent un problème de situation.
Les auteurs généralisent cette leçon à tous les projets de changement. Nous transformons volontiers des problèmes simples en défis psychologiques complexes. Nous cherchons à modifier les intentions, les croyances ou la motivation des individus. Ils invitent plutôt à commencer par ajuster l’environnement, car celui-ci guide massivement nos choix, souvent à notre insu.
2 — L'épuisement ressemble beaucoup à de la paresse
Dans cette section, les auteurs expliquent que le changement échoue souvent non pas à cause de la paresse, mais à cause de l’épuisement. Ils rappellent que l’autosurveillance mentale (se contrôler, résister à des tentations, gérer ses émotions, affronter la peur, surveiller ses dépenses, rester concentré) consomme énormément d’énergie psychique.
Des expériences citées dans l'ouvrage montrent que des personnes qui doivent refouler leurs émotions ou faire beaucoup de choix deviennent ensuite moins endurantes et moins capables de résoudre des problèmes.
Or, habituellement, tout projet de changement repose justement sur une vigilance permanente du Conducteur (la raison), qui doit corriger des comportements devenus automatiques. Quand cette réserve de maîtrise de soi se vide, ce sont la créativité, la concentration, mais aussi la capacité à résister aux impulsions et à persévérer qui s’effondrent.
Chip et Dan Heath en concluent que le changement paraît difficile non parce que les gens sont trop « fainéants », mais parce qu’ils sont mentalement épuisés.
3 — La résistance découle souvent d'un manque de clarté
Finalement, les auteurs expliquent que ce que l’on interprète comme de la « résistance au changement » est souvent… un manque de clarté.
En entreprise, par exemple, les collaborateurs n’avancent pas parce qu’ils ne savent pas exactement vers quoi aller ni quoi faire concrètement. On lance des slogans vagues (« innover », « être plus orienté client », « réduire les coûts »), mais on ne donne pas d’images précises ni de gestes à adopter au quotidien.
Chip et Dan Heath montrent qu’une démonstration visuelle simple peut soudain rendre le problème évident et urgent. Ce n’est pas l’analyse rationnelle qui déclenche le mouvement, mais une vision claire qui parle à l’émotion.
La leçon centrale de cette section est donc la suivante : si les gens paraissent freiner des quatre fers, commencez par vérifier si la « route » du changement est vraiment balisée. Quand la destination est concrète et les premiers pas explicitement définis, la résistance diminue fortement, car l’énergie peut enfin se canaliser dans une direction lisible.
Partie I. Dirigez le conducteur
1 — Trouvez les éléments prometteurs
Préférez une solution locale plutôt qu'importée
Les auteurs expliquent que les changements durables reposent rarement sur des solutions importées. Ils montrent que les « bonnes pratiques » copiées d’ailleurs échouent souvent, car elles ignorent la culture locale et les contraintes réelles. Une idée brillante sur le papier peut rester théorique si elle ne part pas de ce que les gens vivent déjà.
Chip et Dan Heath illustrent ce point avec l’exemple de la lutte contre la malnutrition au Vietnam. Plutôt que d’appliquer un modèle occidental, Jerry Sternin observe les familles pauvres dont les enfants vont bien. Il découvre leurs micro-innovations quotidiennes et les diffuse comme solutions locales, faciles à adopter par les autres.
Les auteurs en tirent un principe : pour changer une situation, mieux vaut repérer ce qui marche déjà « sur place » que chercher la recette miracle ailleurs. Les comportements exemplaires, visibles dans le même contexte et avec les mêmes ressources, sont plus crédibles et rassurants. Ils donnent l’impression de perfectionner l’existant, pas de renier ses habitudes.
Enfin, cette approche locale réduit la résistance de l'Éléphant (les émotions) dont parlent les auteurs. Les gens imitent plus volontiers un voisin qu’un expert lointain ou un consultant payé cher. En faisant grandir des solutions nées du terrain, on augmente les chances que le changement s’enracine vraiment.
Attachez-vous à la solution plutôt qu'au problème
Il est aussi plus efficace de se concentrer sur la solution que sur le problème. L’exemple de la thérapie brève centrée sur les solutions (TBCS), développée par Steve de Shazer et Insoo Kim Berg, le montre. Contrairement aux approches classiques qui fouillent le passé pour trouver les causes (l’« archéologie » du problème), la TBCS s’intéresse uniquement à ce qui fonctionne déjà et à la manière de le reproduire.
Le thérapeute pose notamment la « question miracle » : à quoi ressemblerait la vie si le problème était résolu ? Puis il demande quand le patient a déjà vécu, même brièvement, quelque chose qui s’en rapproche.
Ces « exceptions » au problème sont analysées en détail :
Que faisait la personne ?
Comment se comportait-elle ?
Quels signes concrets distinguaient ces moments ?
L’idée centrale est que le patient possède déjà, au moins partiellement, les ressources pour changer ; il s’agit d’identifier ces réussites, même petites, et de les amplifier plutôt que de disséquer indéfiniment ce qui ne va pas.
2 — Définissez les étapes décisives
La paralysie de la décision
La « paralysie de la décision » apparaît lorsque le nombre d’options augmente, même si ces options semblent a priori bénéfiques. Ils illustrent ce phénomène avec une expérience médicale :
Quand un médecin a un seul nouveau médicament à tester, près de la moitié choisit de l’essayer avant la chirurgie ;
Dès qu’un deuxième médicament similaire est ajouté, beaucoup basculent vers l’option par défaut, l’opération lourde, simplement parce qu’ils n’arrivent plus à trancher.
Cette paralysie se retrouve dans la vie quotidienne : en boutique gastronomique, les clients goûtent davantage de confitures quand il y en a 24, mais achètent dix fois plus souvent lorsqu’il n’y en a que 6. De même, dans les plans d’épargne retraite, chaque tranche de dix fonds supplémentaires fait baisser le taux de participation, les salariés renonçant même à l’argent abondé par leur entreprise.
Les auteurs généralisent ensuite : nos journées sont saturées de micro-choix (courses, investissements, carrière), ce qui épuise le Conducteur rationnel et renforce l’attrait du statu quo.
Dans les organisations, la multiplication des options et des tensions stratégiques (croissance vs rentabilité, qualité vs rapidité, créativité vs efficacité) pousse les décideurs à reconduire mécaniquement le passé plutôt qu’à choisir. Cette paralysie nourrit l’inaction et rend indispensable la définition d’étapes décisives claires pour sortir du flou.
Fuyez l'ambiguïté, source de paralysie
Le statu quo rassure : tant que rien ne change, le Conducteur fonctionne en pilote automatique, guidé par les habitudes. Mais dès qu’un changement survient, la routine ne suffit plus. De nouvelles décisions apparaissent, plus nombreuses, et surtout moins balisées :
Choisir quoi manger en régime ;
Comment travailler avec un nouveau patron ;
Etc.
Cette multiplication de décisions inhabituelles épuise le Conducteur et le met en difficulté.
Mais ce n’est pas seulement la multiplication des options qui paralyse ; c'est aussi l’ambiguïté. En période de changement, on ne sait pas clairement quelles sont les possibilités ni ce qu’on attend de nous.
Cette incertitude pousse l’Éléphant à se réfugier vers le chemin le plus familier. Face à l’inconnu, l’Éléphant devient anxieux et préfère automatiquement la solution connue, même si elle est mauvaise.
Les auteurs en tirent une conclusion stratégique : l’ennemi, ce n’est pas la résistance, c’est l’ambiguïté. Pour éviter la paralysie de la décision, il faut définir des étapes décisives claires, concrètes, presque « mécaniques », plutôt qu’énoncer de grandes orientations abstraites.
Une vision globale est utile, mais elle ne suffit pas : ce sont les détails flous qui bloquent l’action.
3 — Indiquez la destination
Donnez un aperçu de votre destination
Les auteurs racontent l’histoire de Crystal Jones, jeune institutrice à Atlanta qui reçoit une classe de CP très hétérogène : certains enfants reconnaissent quelques mots, d’autres ne savent pas tenir un crayon. Pourtant, Crystal est convaincue qu’ils peuvent progresser. Elle construit un programme solide mais sait qu’il lui manque un élément clé : un objectif motivant et compréhensible pour les enfants.
Elle formule alors une destination simple et parlante : « Vous serez bientôt en CE2 ». Cette phrase donne une direction au Conducteur (la part rationnelle) et, surtout, motive l’Éléphant (la part émotionnelle).
Résultat ? Les élèves se projettent dans un futur désirable, concret et proche. À la fin de l’année, plus de 90 % d’entre eux lisent au moins au niveau CE2, alors que beaucoup ne connaissaient pas l’alphabet neuf mois plus tôt.
Les auteurs généralisent ensuite : en matière de changement, nous n’avons pas besoin de grandes visions à 30 ans, mais d’un aperçu de la destination à court ou moyen terme, formulé comme une image parlante de ce qu’il est possible d’atteindre.
Cet aperçu doit guider le comportement et toucher l’émotion, comme un « grand objectif audacieux » à taille humaine, capable de mobiliser à la fois la tête et le cœur.
Gérez le manque d'inspiration et l'excès de justifications
Un aperçu de la destination très motivant ne suffit pas si l’équipe manque d’inspiration ou résiste intérieurement. Dans ces cas, un nouvel ennemi apparaît : la justification. Avec un objectif flou comme « vivre plus sainement », l’Éléphant réclame chips et chocolat, et le Conducteur invente aussitôt de bonnes raisons pour céder, tout en gardant l’illusion de progresser.
Le même mécanisme opère avec des objectifs chiffrés en entreprise : un résultat inférieur à la cible est facilement requalifié en succès grâce à quelques excuses bien trouvées.
Les auteurs montrent aussi que nous exploitons ces zones grises dans notre vie privée, par exemple avec la règle « un verre de vin par jour » que l’on contourne en remplissant le verre à ras bord ou en « échangeant » un verre contre un futur jour d’abstinence.
Pour neutraliser ces justifications, ils recommandent des objectifs clairs, nets et précis, formulés en tout ou rien :
« Jamais de vin » ;
« Plus de chips du tout » ;
« Gymnastique tous les jours » ;
Etc.
Mais ces objectifs, purement restrictifs, n’inspirent pas : ils ressemblent davantage à une critique qu’à une vraie destination souhaitable. D’où la nécessité, annoncée pour la suite, de combiner le pouvoir émotionnel d’une vision engageante avec la force anti-justification d’un objectif strict.
Pourquoi fixer des objectifs clairs, nets et précis?
Lorsque l’on craint l’inaction ou une résistance silencieuse, des objectifs « clairs, nets et précis » deviennent indispensables. Ils réduisent les zones d’ombre, coupent court aux excuses et obligent chacun à se positionner. Cependant, Chip et Dan Heath rappellent qu’on n’a pas toujours besoin de règles aussi rigides pour avancer.
À partir de l’exemple de la chirurgienne Laura Esserman, ils montrent qu’une vision inspirante ne suffit jamais seule. Sa réussite vient de la combinaison entre un objectif ambitieux à long terme et une multitude de petits changements comportementaux très concrets.
Pour les auteurs, la recette du changement durable consiste donc à associer une destination motivante à des étapes décisives de court terme.
Ils soulignent enfin qu’il est illusoire de vouloir planifier tout le chemin du changement à l’avance. Au début d’un projet, il est plus réaliste de se concentrer sur bien démarrer et bien arriver. Le milieu du parcours évoluera de toute façon, et les objectifs clairs, nets et précis servent alors de boussole plutôt que de plan détaillé.
Partie 2. Motivez l'éléphant
4 — Touchez la corde sensible
Jouez sur les émotions
Les grands changements passent rarement par des tableaux Excel mais par une expérience émotionnelle. Ils racontent l’exemple de Target, alors simple chaîne de supermarchés régionale, qui veut devenir un leader du design accessible. Robyn Waters, responsable des achats, comprend que pour convaincre ses collègues, il faut toucher leur ressenti plus que leur raison.
Plutôt que de présenter des rapports, elle organise des démonstrations visuelles :
Bols de M&M’s aux couleurs vives ;
iMac colorés ;
Photos de rayons de vêtements où un seul polo bleu électrique crée un contraste frappant.
Les acheteurs réagissent spontanément : ils s’exclament, voient l’effet de la couleur, comprennent physiquement ce que signifie un univers de marque plus audacieux.
Cette stratégie finit par transformer les choix produits de Target et contribuer à son repositionnement. Pour Chip et Dan Heath, cet exemple illustre une leçon clé : même dans des organisations obsédées par les chiffres, c’est en parlant à l’Éléphant plus qu’au Conducteur que l’on parvient réellement à faire bouger les comportements.
Laissez notre capacité de compréhension hors de cause
Lorsqu’un changement ne se produit pas, on incrimine trop facilement un manque de compréhension : une mère se dit que sa fille conduirait mieux « si seulement elle comprenait » ; un scientifique pense que les politiques agiraient différemment « s’ils comprenaient » le climat.
Pourtant, les fumeurs savent très bien que la cigarette est nocive, tout comme les constructeurs automobiles américains savaient leur dépendance dangereuse aux 4x4 sans pour autant changer de stratégie.
Les auteurs rappellent ainsi l’écart entre savoir ce qu’il faut faire et être motivé pour le faire. Face à un comportement à changer, notre réflexe est d’ajouter de l’information, des arguments rationnels, des avertissements. Nous parlons alors au Conducteur alors que c’est l’Éléphant qu’il faut toucher.
Ils en concluent que compter sur la seule pédagogie rationnelle est une illusion frustrante : pour déclencher un véritable changement, il faut provoquer un choc émotionnel ou une mise en scène marquante.
Faut-il plutôt des émotions négatives ou positives ?
Mais le changement doit-il plutôt s’appuyer sur des émotions négatives ou positives ? De nombreux leaders misent sur la peur, la menace ou l’idée de « plateforme en feu » pour pousser les gens à agir. Ce réflexe existe d'ailleurs aussi en thérapie, avec le mythe du drogué qui doit « toucher le fond ».
Les émotions négatives sont efficaces pour déclencher des réactions rapides et ciblées, comme enlever un caillou de sa chaussure :
Fuir ;
Attaquer ;
Éviter un danger ;
Etc.
Mais Chip et Dan Heath soulignent que la plupart des changements importants (transition écologique, stratégie d’entreprise, relation de couple) exigent au contraire créativité, flexibilité et inventivité.
En s’appuyant sur les travaux de Barbara Fredrickson, ils expliquent que les émotions positives :
Élargissent notre champ d’attention ;
Favorisent l’exploration, l’apprentissage et l’ouverture aux idées nouvelles.
Pour les grands changements, ils recommandent donc de privilégier l’espoir, l’enthousiasme et l’intérêt plutôt que la peur.
5 — Faites paraître le changement plus petit
Fractionnez l'effort
La motivation augmente quand on a le sentiment d’avoir déjà avancé. Les auteurs partent d’une étude menée auprès de femmes de chambre d’hôtel, qui dépensent énormément de calories au travail mais ne se perçoivent pas comme sportives.
Un groupe est informé que ses gestes professionnels constituent déjà un véritable exercice physique, chiffres à l’appui (calories brûlées par tâche). Un mois plus tard, ces femmes ont perdu du poids, sans changer ni leurs horaires, ni leur alimentation, ni leur mode de vie.
Les auteurs rapprochent ce résultat d’une autre expérience : une station de lavage qui donne une carte de fidélité avec deux tampons offerts sur dix se remplit beaucoup plus vite qu’une carte de huit cases vides, alors que l’effort total est identique.
Conclusion : pour déclencher le changement, il faut donner l’impression que le chemin est déjà entamé. Mettre symboliquement « deux tampons » au départ rend l’objectif moins intimidant et pousse l’Éléphant à avancer.
Commencez par de petites victoires
Chip et Dan Heath expliquent également que, pour lancer un changement, il vaut mieux viser des succès modestes et immédiats plutôt que l’objectif final, trop lointain pour motiver.
Ils montrent qu’en réduisant l’ampleur de la tâche – par exemple, commencer par nettoyer la petite salle de bains ou découper un long trajet en tronçons de 100 km – on donne à l’Éléphant intérieur une première expérience de réussite, qui suffit à créer de l’élan.
Ils s’appuient sur l’idée de « small wins » de Karl Weick : une petite victoire rend le problème moins impressionnant, clarifie ce qu’il y a à faire et renforce le sentiment de compétence. On ne contrôle pas tous les facteurs d’un projet, mais on peut choisir comment définir la victoire finale et surtout les petites victoires qui y mènent.
Celles-ci doivent idéalement être à la fois significatives et à portée immédiate. À défaut, Chip et Dan Heath recommandent de privilégier l’accessibilité, quitte à ce que la victoire soit symbolique, car l’essentiel est de mettre les personnes en mouvement et de transformer l’inertie en dynamique de progrès.
6 — Faites grandir les gens
L'identité, facteur du changement
Cela dit, la clé d’un changement durable n’est pas seulement de modifier des comportements, mais de transformer la façon dont les gens se définissent eux-mêmes. Les auteurs expliquent comment une espèce de perroquet en voie d’extinction a été sauvée en devenant un symbole de fierté nationale, et non en culpabilisant la population.
L’organisation Rare reproduit cette stratégie dans de nombreux pays : en construisant une identité positive (« protecteur de la nature », par exemple), on donne aux individus l’envie d’agir et de persévérer.
Les auteurs s’appuient ensuite sur les travaux de James March pour opposer le modèle des conséquences (on pèse coûts et bénéfices) au modèle de l’identité (on se demande : « Qui suis-je ? Que ferait quelqu’un comme moi ? »).
Ils montrent que nos décisions importantes suivent souvent ce second modèle :
Infirmières fières de leur métier ;
Salariés de l’entreprise brésilienne Brasilata qui se voient comme des « inventeurs » ;
Habitants de Palo Alto qui se mettent à agir en « citoyens concernés » après un engagement minimal.
Toute tentative de changement qui contredit l’identité déclarée d’une personne a de fortes chances d’échouer ; inversement, ancrer le changement dans une identité valorisante donne de la motivation, de la fierté et un puissant sentiment de cohérence.
Prévoyez l'échec
Tout changement profond, surtout lié à une nouvelle identité, passe inévitablement par des faux pas. L’Éléphant déteste l’échec : au premier revers, il pousse à fuir. Pour éviter cette fuite, ils recommandent de prévoir l’échec : non pas l’échec final du projet, mais des échecs intermédiaires, intégrés dès le départ comme étapes normales du processus.
Les auteurs s’appuient alors sur l’état d’esprit de développement (Carol Dweck) : voir les capacités comme évolutives transforme les erreurs en occasions d’apprendre plutôt qu’en preuves d’incompétence. Dans les organisations, cela implique de se comporter en coach plutôt qu’en comptable, en préparant les équipes au « creux » émotionnel au milieu d’un projet (la courbe en U d’IDEO) plutôt qu’à une progression linéaire.
L’exemple de l’adoption de la chirurgie cardiaque mini-invasive montre que les équipes qui cadrent la nouveauté comme un apprentissage progressif réussissent, tandis que celles qui veulent « bien faire du premier coup » abandonnent. Anticiper l’échec, c’est donc protéger la motivation, encourager la pratique, et installer une culture où trébucher fait partie du chemin vers le changement.
Partie 3. Tracez le chemin
7 — Adaptez l'environnement
Rendez le parcours plus facile
Chip et Dan Heath montrent que nous surestimons les « défauts » des gens et sous-estimons le rôle de la situation. Quand un automobiliste nous coupe la route, nous le jugeons « abruti », alors que, dans notre propre cas, nous invoquons les circonstances.
C’est ce biais d’analyse – l’erreur fondamentale d’attribution – qui pousse à vouloir « réparer » les personnes plutôt que modifier leur environnement. Les auteurs défendent au contraire l’idée que, pour réussir un changement, il faut adapter le contexte afin que le comportement souhaité devienne le chemin le plus simple.
Ils illustrent ce principe par plusieurs exemples :
Des soldats héroïnomanes qui arrêtent presque tous en rentrant du Vietnam, non pas grâce à une volonté héroïque mais parce qu’ils sortent d’un environnement saturé de drogue ;
Des systèmes conçus pour forcer le bon geste (DAB qui ne délivre l’argent qu’après retrait de la carte, commande « en un clic » d’Amazon) ;
Une entreprise où l’on obtient l’adoption du logiciel de feuilles de temps simplement en supprimant un assistant électronique agaçant.
Dans tous les cas, les comportements changent dès qu’on rend le bon choix plus facile que le mauvais : adapter l’environnement, c’est tracer un chemin où même des personnes peu motivées finissent par se laisser entraîner.
Manipulez-vous vous-même
Les auteurs expliquent que, pour changer durablement, il est souvent plus efficace de se manipuler soi-même en modifiant son environnement plutôt qu’en comptant sur la seule volonté. Ils s’appuient sur les travaux de Brian Wansink : de simples changements de vaisselle (assiettes plus petites, verres hauts et étroits) suffisent à réduire la quantité ingérée sans même s’en rendre compte.
]]>Résumé du livre "Génération anxieuse : Comment les réseaux sociaux menacent la santé mentale des jeunes" de Jonathan Haidt : un livre événement qui alerte sur les dangers de façon lucide et informée, mais qui ne s'arrête pas là ! De nombreux conseils pour les individus et des solutions collectives sont proposés pour rendre la joie de vivre et le dynamisme aux jeunes happés par leurs écrans.
Par Jonathan Haidt, 2025, 424 pages.
Titre original : The Anxious Generation (2024).
Chronique et résumé de "Génération anxieuse : Comment les réseaux sociaux menacent la santé mentale des jeunes" de Jonathan Haidt
➡️ Introduction : Grandir sur Mars
Jonathan Haidt ouvre son livre avec une métaphore frappante : envoyer des enfants sur Mars. Il montre l’absurdité de confier l’avenir de nos enfants à des projets sans considération pour leur développement. Cette image sert à introduire un problème réel : l’enfance façonnée par la technologie.
Le spécialiste en psychologie sociale rappelle que les grandes entreprises numériques ont transformé la vie des adultes, mais aussi celle des enfants. Smartphones, jeux en ligne et réseaux sociaux se sont imposés sans études sérieuses sur leurs effets psychologiques. Les jeunes, particulièrement vulnérables, sont devenus des cibles idéales pour des produits conçus pour créer de l’addiction.
Il affirme que deux erreurs expliquent la montée de l’anxiété des enfants nés après 1995 : une surprotection dans le monde réel et une sous-protection dans le monde virtuel. Gen Z a grandi sans expériences libres dans la rue, mais avec une autonomie totale en ligne. Cette combinaison a profondément modifié le développement social et émotionnel.
Jonathan Haidt décrit le « Great Rewiring of Childhood », une réorganisation radicale de la vie des jeunes, comparable à une croissance sur Mars. Moins de jeu libre, plus d’écrans : les conséquences sont un effondrement de la santé mentale. Les filles, exposées à la comparaison sociale sur les réseaux, souffrent particulièrement.
L’auteur avance quatre réformes simples :
Pas de smartphone avant le lycée ;
Pas de réseaux sociaux avant 16 ans ;
Écoles sans téléphones ;
Plus de jeu libre.
Ces solutions peu coûteuses pourraient inverser la crise si elles sont appliquées collectivement. Il appelle parents, écoles et sociétés à agir vite, avant que la prochaine vague technologique ne rende l’univers virtuel encore plus absorbant.
Jonathan Haidt se fonde sur ses recherches en psychologie sociale et morale pour analyser cette transformation. Il montre que Gen Z possède aussi des forces : lucidité, envie de changement, capacité d’organisation. Selon lui, ce potentiel peut devenir une ressource pour reconstruire des conditions de développement plus saines.
Son livre propose une lecture urgente et claire d’un problème mondial : comment protéger l’enfance dans l’ère numérique ? En retraçant l’évolution de la santé mentale adolescente, il invite chacun à comprendre, réagir et reprendre le contrôle. Génération anxieuse (The Anxious Generation) se présente comme un guide énergique pour retrouver une enfance humaine, loin de Mars et proche de la Terre.
➡️ Partie 1 : Une vague déferlante
Chapitre 1 : La vague de souffrance
Jonathan Haidt rapporte les inquiétudes des parents face aux smartphones, aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux. Les conflits sont constants, les règles difficiles à imposer et la peur de perdre son enfant devient centrale. Derrière chaque récit se cache l’impression d’une génération happée par un monde virtuel sans limites.
Le spécialiste en psychologie sociale souligne que la crise de santé mentale des jeunes explose dès 2010. Les données révèlent une forte hausse de la dépression, de l’anxiété et de l’automutilation, surtout chez les filles préadolescentes. Ces troubles, appelés « internalisants », touchent désormais les deux sexes, bien que différemment.
Les preuves dépassent les simples déclarations : hospitalisations, passages aux urgences et suicides confirment une détresse réelle. Les garçons sont davantage touchés par les jeux vidéo et la pornographie, tandis que les filles souffrent surtout de la comparaison sociale sur Instagram. Le résultat est une génération fragilisée, en perte de repères réels.
Jonathan Haidt montre que ce phénomène est mondial. États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Australie ou pays nordiques connaissent la même vague d’anxiété adolescente. Même les enquêtes PISA indiquent une montée de la solitude scolaire à partir de 2012, sauf en Asie.
L’auteur écarte les explications économiques ou politiques. La cause la plus cohérente reste la combinaison smartphone et réseaux sociaux, qui a remodelé les liens sociaux en quelques années. Il appelle cette mutation brutale le Great Rewiring of Childhood, comparable à envoyer les jeunes grandir sur Mars.
Entre 2010 et 2015, l’enfance a basculé de l’expérience concrète à l’immersion numérique. Les adolescents ont perdu du jeu réel, du sommeil et du lien social. Résultat : une génération plus anxieuse, dépressive et isolée, qui illustre les coûts d’une enfance façonnée par le virtuel.
➡️ Partie 2 : Le contexte
Chapitre 2 : Ce dont les enfants ont besoin pendant leur enfance
Jonathan Haidt explique que l’enfance humaine est un apprentissage culturel unique. Contrairement aux animaux, l’enfant dispose d’une longue période pour façonner son cerveau. Cette lente croissance lui permet de développer les compétences sociales, culturelles et émotionnelles avant d’entrer dans l’âge adulte.
Il insiste sur l’importance du jeu libre. Les enfants y apprennent la coopération, la gestion des conflits et l’autonomie émotionnelle. Mais avec l’arrivée du smartphone, ces moments sont remplacés par un temps d’écran solitaire, réduisant les expériences concrètes nécessaires à la construction de l’identité.
Le spécialiste en psychologie sociale développe aussi l’idée d’attunement. Les enfants s’harmonisent naturellement avec les autres à travers rires, rythmes et interactions synchrones. Les écrans, eux, favorisent des échanges désincarnés et asynchrones, ce qui fragilise les liens affectifs et accroît la solitude.
Il montre ensuite que les enfants apprennent en copiant. Deux biais dominent : conformité et prestige. Les plateformes exploitent ces mécanismes en mettant en avant likes, partages et influenceurs. Résultat : les jeunes imitent des modèles virtuels, souvent éloignés des apprentissages utiles à la vie réelle.
Jonathan Haidt souligne enfin l’existence de périodes sensibles, surtout entre 9 et 15 ans. Ces années d’ouverture cognitive sont cruciales pour l’identité et la culture. Or, c’est précisément à cet âge que les adolescents reçoivent leur premier smartphone et sont happés par les réseaux sociaux.
Il conclut que l’enfance a été détournée entre 2010 et 2015. La Gen Z a traversé sa puberté en ligne plutôt que dans le monde réel. Privés de jeu libre, d’attunement et de modèles locaux, les jeunes se retrouvent plus anxieux, dépressifs et fragiles.
Chapitre 3 : Le mode découverte et le besoin de jeux risqués
Jonathan Haidt montre que les sociétés modernes ont commis une double erreur. Elles ont surprotégé les enfants dans le monde réel alors même qu’il était devenu plus sûr, et elles les ont laissés sans garde-fous dans le monde virtuel, saturé de menaces. Ce déséquilibre a déplacé l’apprentissage essentiel du risque vers des espaces numériques inadaptés.
Il explique que le cerveau fonctionne en deux modes :
"Découverte", tourné vers l’exploration et l’apprentissage ;
"Défense", centré sur la peur et la protection.
Les enfants développent la confiance et la curiosité grâce au jeu libre, aux défis et aux risques physiques modérés. Mais en réduisant leur autonomie, la culture de la peur a piégé une génération dans un état défensif permanent, marqué par l’anxiété.
L'auteur insiste sur l’idée que les enfants sont antifragiles. Comme les arbres qui ont besoin du vent pour devenir solides, ils doivent affronter frustrations, chutes et peurs pour grandir. Le jeu risqué — grimper, courir vite, se bagarrer, se perdre — agit comme un vaccin contre les phobies. À l’inverse, les écrans ne remplacent pas ces expériences : les erreurs y coûtent cher, amplifiées par la viralité et l’absence de repères stables.
Il rappelle que depuis les années 1990, l'obsession pour la sécurité (qu'il nomme safetyism) a envahi la parentalité anglo-saxonne. Les parents, influencés par la peur et la méfiance, ont restreint l’indépendance de leurs enfants, sous-estimant la valeur éducative du jeu libre. Ce climat a fragilisé le développement émotionnel, réduisant la tolérance à la frustration et augmentant la dépendance à la supervision adulte.
Le spécialiste en psychologie sociale conclut que les enfants s’épanouissent quand ils disposent d’un socle sécurisant et d’une large autonomie pour explorer. Le jeu libre et risqué leur permet de basculer durablement en discover mode, d’apprendre à gérer les menaces et de devenir des adultes plus confiants.
Chapitre 4 : La puberté et la transition bloquée vers l'âge adulte
Jonathan Haidt décrit la puberté comme une période de plasticité cérébrale intense, où les expériences façonnent durablement le cerveau adolescent. Les processus de myélinisation et d’élagage neuronal renforcent certaines connexions et en éliminent d’autres. Cela crée à la fois une vulnérabilité accrue au stress et une fenêtre unique pour développer des compétences sociales et émotionnelles.
Il dénonce les bloqueurs d'expérience qui perturbent cette phase cruciale. L'obsession pour la sécurité prive les jeunes des défis nécessaires à leur antifragilité, tandis que les smartphones remplacent les expériences réelles par des interactions virtuelles appauvries. Résultat : des adolescents moins résilients, plus anxieux et privés des apprentissages incarnés que réclame leur cerveau.
Historiquement, les rites de passage guidaient cette transition. Séparation, épreuves, puis réintégration donnaient un cadre clair vers l’âge adulte. Aujourd’hui, ces repères s’effacent, remplacés par une adolescence connectée sans seuils ni étapes, où tout contenu devient accessible dès le plus jeune âge.
Jonathan Haidt propose de reconstruire un chemin progressif vers l’autonomie. Chaque âge pair, de 6 à 18 ans, pourrait marquer de nouvelles responsabilités et libertés : tâches domestiques, liberté locale, apprentissage, premier travail, puis accès encadré au smartphone et aux réseaux sociaux. À 18 et 21 ans, les étapes légales consacreraient l’entrée dans l’âge adulte.
Il conclut que les enfants ne deviennent pas des adultes compétents par simple maturation biologique. Ils ont besoin de défis, repères et libertés croissantes pour grandir. Supprimer ces étapes au profit du virtuel bloque leur développement et les laisse vulnérables, anxieux et mal préparés à la vie adulte.
➡️ Partie 3 : Le grand recâblage
Chapitre 5 : Les quatre préjudices fondamentaux : la privation sociale, la privation de sommeil, la fragmentation de l'attention et la dépendance
Jonathan Haidt décrit les quatre grands dommages d’une enfance façonnée par le smartphone :
Privation sociale ;
Privation de sommeil ;
Fragmentation de l’attention ;
Addiction.
Ces transformations surgissent dès les années 2010, quand les applications conçues pour capter l’attention remplacent les activités réelles. L’auteur montre comment elles modifient profondément le développement émotionnel, cognitif et social des adolescents.
Il explique que la privation sociale découle de la chute brutale du temps passé avec des amis. Les interactions virtuelles ne remplacent pas le jeu libre, l’amitié incarnée et les apprentissages synchrones. Cette distance fragilise la confiance en soi et accroît la solitude.
La privation de sommeil touche la plupart des adolescents équipés de smartphones. Notifications, vidéos et réseaux retardent l’endormissement, réduisent la durée du sommeil et détériorent mémoire, humeur et attention. Le manque chronique de repos alimente anxiété et dépression.
L’attention fragmentée résulte d’une avalanche de notifications. Chaque vibration agit comme une invitation à quitter sa tâche, empêchant la concentration durable. Ce morcellement nuit au développement des fonctions exécutives, essentielles pour la planification et l’autonomie.
Enfin, l’addiction s’installe par les techniques de conditionnement inspirées du behaviorisme. Les récompenses variables déclenchent dopamine et envie de recommencer, sans jamais apporter de satisfaction durable. Comme avec les machines à sous, le cercle devient difficile à briser.
Jonathan Haidt conclut que l’addition de ces quatre maux explique la crise soudaine de santé mentale chez la Génération Z. La transition d’une enfance basée sur le jeu vers une enfance basée sur le smartphone a bouleversé l’équilibre psychologique mondial. Les bénéfices limités des réseaux ne compensent pas leurs coûts massifs.
Chapitre 6 : Pourquoi les réseaux sociaux nuisent-ils davantage aux filles qu'aux garçons ?
Jonathan Haidt illustre le piège des réseaux sociaux à travers l’histoire d’Alexis Spence, happée par Instagram à 11 ans. D’abord euphorique, elle sombre vite dans la dépression et l’anorexie, sous l’effet des contenus extrêmes proposés par l’algorithme. Son parcours montre comment ces plateformes exploitent la vulnérabilité des adolescentes.
Le spécialiste en psychologie sociale explique que les données confirment un lien fort entre usage intensif des réseaux sociaux et troubles mentaux chez les filles. Plus elles passent d’heures en ligne, plus leur risque de dépression explose. Les études expérimentales démontrent que réduire ou supprimer l’usage des réseaux améliore rapidement la santé mentale.
L'auteur souligne que l’effet dépasse l’individu : les réseaux modifient la culture collective. Conversations et jeux diminuent, remplacés par des microdrames en ligne. Même celles qui se tiennent à l’écart subissent cette transformation, preuve d’un impact systémique.
Il observe que les filles utilisent davantage les plateformes visuelles comme Instagram et TikTok, beaucoup plus nocives pour l’estime de soi. À l’adolescence, période marquée par la recherche d’intégration, elles se retrouvent bombardées d’images idéalisées, ce qui alimente anxiété, perfectionnisme et troubles alimentaires. Les « sociomètres » internes chutent, renforçant la honte et la fragilité émotionnelle.
L'agression relationnelle amplifie le phénomène : critiques anonymes, rumeurs, exclusions publiques. Le harcèlement en ligne devient permanent, aggravant solitude et pensées suicidaires. La cruauté adolescente prend une nouvelle ampleur, difficile à détecter par les adultes.
Le spécialiste rappelle aussi la contagion émotionnelle propre aux filles. Leur tendance à partager leurs sentiments favorise la diffusion de la dépression et d’autres troubles. Avec TikTok, certaines maladies psychogènes, comme les tics ou le DID, se propagent par capture de l'attention et imitation.
Enfin, Haidt met en avant la vulnérabilité des filles à la prédation sexuelle. Sollicitées par des hommes plus âgés et soumises à la pression des pairs pour envoyer des photos intimes, elles vivent dans un climat d’insécurité permanent. Cela alimente leur anxiété et les enferme dans le mode défensif.
Il conclut que les réseaux sociaux offrent plus de quantité que de qualité relationnelle. En multipliant les contacts superficiels, ils détruisent la profondeur des amitiés, socle essentiel du bien-être adolescent. Pour les filles, ce piège est particulièrement cruel : au lieu d’apaiser leur besoin de communion, il l’exacerbe et les plonge dans l’isolement.
Chapitre 7 : Que se passe-t-il avec les garçons ?
Jonathan Haidt montre que les garçons subissent eux aussi les effets du Great Rewiring, mais selon un parcours différent de celui des filles. Depuis les années 1970, ils connaissent une lente désaffection du monde réel, aggravée dans les années 2010 par les écrans omniprésents. Leur santé mentale décline plus tardivement, mais leur désengagement scolaire, social et affectif est profond.
Les transformations économiques réduisent la valeur de la force physique et favorisent les compétences scolaires où les filles excellent davantage. Le système éducatif punit plus les garçons, qui accumulent retards et exclusions. Richard Reeves parle d’un « long déclin des hommes », marqué par l’échec scolaire et la difficulté d’insertion professionnelle.
La culture du risque disparaît avec le safetyism et la surveillance parentale. Les garçons perdent l’occasion de se confronter physiquement aux défis, ce qui fragilise leur développement émotionnel. À partir de 2010, ils délaissent les comportements extériorisés comme la bagarre ou l’alcool, mais adoptent les symptômes internalisés : anxiété, dépression et sentiment d’inutilité.
Le monde virtuel attire les garçons avec deux lures puissants : pornographie et jeux vidéo. Le porno, disponible en continu, détourne leur énergie sexuelle et réduit leurs compétences relationnelles réelles. Les jeux vidéo procurent parfois des bénéfices cognitifs, mais deviennent pour 7 % d’entre eux une addiction destructrice, qui remplace amitiés, sommeil et apprentissage.
Comme les filles avec les réseaux sociaux, les garçons connaissent une récession de l’amitié. Leurs cercles d’amis réels se réduisent, remplacés par des liens virtuels fragiles. L’isolement progresse, renforcé par des communautés en ligne où certains adoptent des identités de NEET ou de hikikomori.
L'auteur rappelle le concept d’anomie développé par Durkheim : l’absence de normes stables mène au vide existentiel. C’est ce que vivent les garçons de la Génération Z, ballottés entre réseaux éphémères et absence de repères durables. Leur vie sociale fragmentée nourrit solitude et désespoir.
En définitive, les garçons comme les filles aboutissent au même constat : une vie qui paraît vide de sens. Leur trajectoire diffère, mais l’omniprésence des écrans, la perte des ancrages communautaires et la disparition des rites de passage les laissent déracinés et fragiles.
Chapitre 8 : Élévation et dégradation spirituelles
Jonathan Haidt explique que la vie centrée sur le smartphone entraîne une dégradation spirituelle touchant adolescents et adultes. Il introduit l’idée d’un axe vertical de divinité : certaines actions élèvent, d’autres abaissent. Les téléphones, en saturant notre attention, nous tirent vers le bas.
Le spécialiste en psychologie sociale s’appuie sur six pratiques spirituelles. La première est la sacralité partagée, étudiée par Durkheim. Les rituels collectifs élèvent les individus et créent de la cohésion, contrairement aux réseaux virtuels, disloqués et sans temporalité commune.
La deuxième est l’incarnation. Les corps en mouvement, en prière, en danse ou autour d’un repas partagé, renforcent la communion. La vie numérique, désincarnée, supprime ces expériences essentielles.
La troisième est la recherche de silence et de concentration. Les traditions méditatives apaisent le mental dispersé et favorisent l’unité intérieure. Les notifications, au contraire, éclatent l’attention et empêchent la présence.
La quatrième est la transcendance de soi. Les pratiques spirituelles réduisent l’activité du réseau cérébral centré sur l’ego. Les réseaux sociaux, obsédés par l’image personnelle, entretiennent l’égocentrisme et bloquent l’ouverture.
La cinquième est la capacité à pardonner. Les traditions religieuses encouragent la lenteur à juger et la rapidité à absoudre. Les plateformes numériques favorisent la colère, la dénonciation publique et l’absence de réconciliation.
La sixième est l’émerveillement devant la nature. La beauté naturelle déclenche l’awe, ouvre à la générosité et apaise l’anxiété. Le smartphone réduit ces expériences en les remplaçant par une avalanche d’images sans profondeur.
Jonathan Haidt rappelle enfin le « vide en forme de Dieu » décrit par Pascal. Si ce vide n’est pas comblé par des expériences nobles, il l’est par du contenu dégradant. Selon lui, la société doit reprendre le contrôle de ce qu’elle transmet pour élever plutôt qu’abaisser.
➡️ Partie 4 : Action collective pour une enfance plus saine
Chapitre 9 : Se préparer à l'action collective
Jonathan Haidt explique que retarder l’accès des enfants aux smartphones paraît difficile mais reste possible si l’on agit collectivement. Il compare cette situation à un produit dangereux rappelé du marché : une fois les risques connus, il faut corriger le tir. Selon lui, ce n’est pas trop tard pour inverser la tendance.
Le spécialiste en psychologie sociale décrit le piège des problèmes d’action collective. Chaque famille cède par peur d’exclure son enfant, et la norme devient l’usage précoce du smartphone. Parents, enfants et même entreprises se retrouvent pris dans un engrenage qui entretient un équilibre nuisible.
Il présente quatre leviers de sortie :
La coordination volontaire permet aux familles de s’unir, comme dans le mouvement Wait Until 8th.
Les normes sociales peuvent évoluer, en valorisant l’autonomie des enfants plutôt qu’en la criminalisant.
Des solutions technologiques comme les téléphones basiques ou la vérification d’âge peuvent limiter l’attrait des écrans.
Enfin, les lois peuvent fixer des règles protectrices et redonner de l’air aux familles.
Jonathan Haidt souligne que ses conseils ne sont pas universels mais reposent sur des principes solides. Il reconnaît les limites de la recherche et la difficulté du rôle parental dans un monde technologique changeant.
Pourtant, il insiste : protéger l’enfance exige une action collective. Restaurer une part de jeu libre et d’indépendance reste un objectif atteignable si les familles, les écoles et les gouvernements s’unissent.
Chapitre 10 : Ce que les gouvernements et les entreprises technologiques peuvent faire dès maintenant
Jonathan Haidt rappelle que les grandes plateformes ont été conçues pour capter l’attention humaine en exploitant nos vulnérabilités psychologiques. Les fondateurs savaient consciemment qu’ils créaient des boucles addictives de validation sociale. Comme les casinos, les entreprises extraient du temps et de la conscience, tout en vendant ces ressources aux annonceurs.
Le spécialiste en psychologie sociale décrit une course vers le bas où chaque entreprise doit exploiter davantage les failles humaines pour rester compétitive. Autoplay, défilement infini, notifications et algorithmes renforcent la dépendance, notamment chez les adolescents. Sans garde-fous, ce modèle marchandise l’attention et alimente une crise de santé mentale.
L’auteur identifie quatre actions prioritaires. D’abord, les gouvernements doivent imposer aux entreprises un devoir de protection envers les mineurs, inspiré du code britannique AADC, qui fixe des standards de conception respectueux des enfants. Ensuite, il faut relever à 16 ans l’âge de la majorité numérique, aujourd’hui fixé arbitrairement à 13 ans.
Troisième mesure : faciliter la vérification de l’âge sans sacrifier la vie privée. Des solutions existent, comme les jetons blockchain, les systèmes biométriques ou l’intégration dans les contrôles parentaux des grands fabricants. Quatrième mesure : encourager les écoles sans téléphones, en finançant casiers et pochettes sécurisées, afin de protéger la concentration et la santé mentale.
Jonathan Haidt montre aussi comment les lois punitives sur la négligence parentale découragent l’autonomie des enfants. Des réformes peuvent protéger les parents qui autorisent le jeu libre ou l’indépendance adaptée à l’âge. En parallèle, les villes devraient repenser l’urbanisme pour favoriser la mobilité des jeunes et multiplier les espaces de jeu accessibles.
L’auteur insiste sur l’importance du jeu et de la formation pratique. Les gouvernements doivent encourager le jeu à l’école, développer l’enseignement technique, financer les programmes d’apprentissage et valoriser les expériences de service ou de nature. Ces initiatives renforcent l’autonomie et soutiennent particulièrement les garçons, souvent démobilisés par l’école classique.
En conclusion, Jonathan Haidt affirme que l’action coordonnée des gouvernements, entreprises, écoles et parents peut inverser la transition néfaste vers une enfance centrée sur les écrans. La protection en ligne, l’assouplissement des règles dans le monde réel et le renforcement du jeu sont les clés d’une génération plus confiante et équilibrée.
Chapitre 11 : Ce que les écoles peuvent faire dès maintenant
Jonathan Haidt affirme que les écoles disposent déjà de deux leviers majeurs pour enrayer la crise de santé mentale des jeunes. Ces leviers sont l’interdiction totale des téléphones et l’augmentation du jeu libre. Selon lui, ces mesures simples et peu coûteuses surpassent bien des programmes sophistiqués déjà en place.
Le spécialiste en psychologie sociale cite l’exemple d’un collège du Colorado ayant supprimé les téléphones dès 2012. Résultat : moins de harcèlement, plus d’échanges entre élèves et de meilleurs résultats scolaires. Les études confirment que les téléphones fragmentent l’attention, accroissent les inégalités sociales et réduisent le sentiment d’appartenance.
Le deuxième levier est de rendre l’école plus ludique (play-full). À travers clubs de jeu, récréations prolongées et terrains enrichis de “loose parts”, les enfants développent autonomie, coopération et résilience. Les expériences menées montrent moins de problèmes disciplinaires, moins d’absentéisme et davantage de joie de vivre.
Jonathan Haidt recommande aussi le Let Grow Project (Projet Laissez grandir) un devoir consistant à réaliser une tâche nouvelle en autonomie, comme marcher seul ou cuisiner. Cette initiative renforce la confiance des enfants et libère les parents de la peur excessive. Elle agit comme antidote au climat d’anxiété et à l’hyper-surveillance.
Les écoles doivent aussi réengager les garçons, souvent en retrait depuis les années 1970. Plus de formation professionnelle, davantage de professeurs masculins et de modèles positifs peuvent inverser la tendance. Ces mesures complètent le rôle du jeu dans la socialisation et la motivation.
L’auteur conclut que la prévention doit commencer tôt, à l’école primaire et au collège. En devenant phone-free et play-full, les établissements construisent un environnement plus équilibré, réduisent l’anxiété et préparent des adolescents plus confiants. Un investissement préventif qui protège toute une génération.
Chapitre 12 : Ce que les parents peuvent faire dès maintenant
Jonathan Haidt rappelle la métaphore d’Alison Gopnik : le parent jardinier laisse l’enfant grandir librement, contrairement au parent charpentier qui façonne. Selon lui, les familles modernes ont trop contrôlé la vie réelle des enfants tout en les exposant sans protection au monde virtuel. Résultat : solitude, anxiété et manque de confiance.
Pour les plus jeunes, la priorité est le jeu réel, la diversité d’âges et la responsabilité progressive. Les enfants apprennent en aidant, en explorant et en imitant. Les écrans doivent rester limités : un usage interactif comme la visioconférence est bénéfique, mais l’exposition passive freine le développement. Les experts recommandent très peu de temps d’écran avant 6 ans.
Chez les 6–13 ans, l’auteur préconise plus d’autonomie : trajets seuls, soirées pyjama, clubs de jeu et camps sans écrans. Les parents doivent s’exposer à leur propre anxiété et constater la compétence grandissante de leurs enfants. Côté écrans, il conseille deux heures maximum par jour, de vraies limites collectives et une vigilance sur les signes d’addiction.
Pour les adolescents, l’accent doit être mis sur les responsabilités réelles : mobilité, emplois à temps partiel, engagements communautaires et aventures en plein air. Un échange scolaire ou une année sabbatique peut élargir leur horizon et consolider leur autonomie. Les écrans doivent rester encadrés, avec un usage progressif des réseaux sociaux, idéalement après 16 ans.
L’auteur souligne que l’indépendance progressive est le meilleur antidote à l’anxiété. Retarder le smartphone, multiplier les expériences concrètes et coopérer avec d’autres parents créent un cercle vertueux. Être jardinier, c’est offrir confiance et liberté, afin d’élever des jeunes confiants et compétents.
➡️ Conclusion : Ramener l'enfance sur terre
Jonathan Haidt explique qu’il voulait d’abord écrire sur les dégâts des réseaux sociaux sur la démocratie. Mais il a découvert un problème plus urgent : la transformation du développement des enfants en une existence centrée sur le téléphone. Cette mutation rapide, survenue entre 2010 et 2015, explique mieux que tout autre facteur la crise mondiale de santé mentale des adolescents.
Le spécialiste en psychologie sociale revient et insiste sur les quatre réformes simples qu'il prône :
Pas de smartphone avant le lycée ;
Pas de réseaux sociaux avant 16 ans ;
Des écoles sans téléphones ;
Beaucoup plus de jeu libre.
Ces mesures brisent les pièges collectifs, car chaque parent ou école qui agit facilite l’action des autres. Ensemble, elles peuvent améliorer la santé mentale en deux ans seulement.
Pour y parvenir, il faut parler haut et fort. Comme dans l’expérience du “fumoir” en psychologie sociale, le silence entretient l’inaction. Parents, enseignants, jeunes et citoyens doivent dire clairement que le modèle actuel détruit l’enfance. Ensuite, il faut se regrouper dans des associations et réseaux qui soutiennent l’indépendance et le jeu, afin de peser sur les écoles et les politiques.
Jonathan Haidt conclut que l’humanité a laissé ses enfants partir vers un monde virtuel qui les fragilise. Pourtant, l’enfance est faite pour l’exploration réelle, l’amitié et l’aventure. Le Grand Rebranchement fut un échec. Il est temps de mettre fin à cette expérience et de ramener l’enfance sur Terre.
Conclusion sur "Génération anxieuse : Comment les réseaux sociaux menacent la santé mentale des jeunes" de Jonathan Haidt :
Ce qu'il faut retenir de "Génération anxieuse : Comment les réseaux sociaux menacent la santé mentale des jeunes" de Jonathan Haidt :
Cet ouvrage est une invitation urgente et stimulante à repenser notre rapport à l’enfance à l’ère numérique. Jonathan Haidt, avec la rigueur du chercheur et la sensibilité d’un père, révèle comment une génération entière a été bouleversée par la montée fulgurante des smartphones et des réseaux sociaux. L’auteur ne se contente pas de dresser un constat alarmant : il propose des solutions concrètes, applicables par chacun, dès aujourd’hui.
Sa force réside dans sa clarté et son optimisme. Là où beaucoup se résignent, il démontre que le changement est possible. Retarder l’âge du premier smartphone, repousser l’accès aux réseaux sociaux, instaurer des écoles sans téléphones et multiplier les moments de jeu libre : ces quatre réformes simples peuvent transformer l’avenir des jeunes. Mieux encore, ce livre a pour ambition de redonner confiance aux parents et aux enseignants, souvent perdus face à un univers numérique qui s’impose sans frein.
En lisant ce livre, on comprend que chaque action individuelle compte, mais que c’est ensemble que nous pouvons réellement inverser la tendance. L’auteur nous encourage à parler, à agir collectivement, à créer une culture où l’enfance retrouve son espace naturel : celui de l’exploration, de l’indépendance et de la joie partagée.
Ce n’est pas seulement un livre sur les dangers du numérique, mais un guide lumineux pour bâtir un futur plus humain. En refermant ces pages, on ressent une énergie nouvelle : celle de participer à un mouvement qui ramène nos enfants à la terre, à la vie réelle, à leur plein potentiel.
Points forts :
Jonathan Haidt vulgarise avec brio des recherches complexes en psychologie et en sciences sociales pour les rendre compréhensibles à tous.
L’ouvrage ne se limite pas au diagnostic. Il offre des recommandations précises et réalisables pour les parents, les écoles et les décideurs.
Il montre comment chacun, en parlant et en s’organisant avec d’autres, peut contribuer à transformer une situation apparemment inéluctable.
Malgré le constat préoccupant, le livre insuffle énergie et espoir, en prouvant que le changement est possible et à portée de main.
Points faibles :
Je n’en ai pas trouvé.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu le livre de Jonathan Haidt « Génération anxieuse » ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Jonathan Haidt « Génération anxieuse ».
Visitez Amazon afin d’acheter le livre de Jonathan Haidt « Génération anxieuse ».
 ]]>
]]>Résumé du livre "Tous des idiots ? Mieux cerner ses collègues et ses proches" de Thomas Erikson : un livre phénomène ayant dépassé le million de lecteurs dans le monde, qui a pour ambition de décrypter les comportements de vos proches et de votre entourage pour vous aider à ne plus vous laisser berner.
Par Thomas Erikson, 2019, 275 pages.
Titre original : Surrounded by idiots (2019).
Chronique et résumé de "Tous des idiots ? Mieux cerner ses collègues et ses proches" de Thomas Erikson
INTRODUCTION - L’homme qui était entouré d’idiots
Thomas Erikson explique qu’au lycée, il remarque que certaines conversations sont fluides, tandis que d’autres échouent sans raison claire. Il teste différentes approches mais reste frustré, persuadé que certains sont « normaux » et d’autres défaillants. Cette vision naïve influence encore ses relations à l’âge adulte.
À 25 ans, il rencontre Sture, un chef d’entreprise persuadé d’être entouré d’idiots. L’expert en communication observe que son mépris détruit ses relations professionnelles et isole toute son équipe. Ce constat l’amène à réfléchir sur ses propres jugements.
Il comprend qu’il ne veut pas ressembler à Sture et décide d’étudier le fonctionnement humain. Ses recherches transforment sa manière de voir les autres et enrichissent sa vie personnelle et professionnelle. Il apprend que la théorie seule ne suffit pas, seule la pratique développe de vraies compétences.
Depuis, Thomas Erikson adopte plus de patience et juge moins ceux qui diffèrent de lui. Les conflits existent toujours, mais ils sont rares. L’auteur remercie Sture d’avoir éveillé son intérêt et invite ses lecteurs à parcourir ce livre pour entreprendre ce même voyage.
CHAPITRE 1 - Dans toute communication, c’est le destinataire qui décide
Thomas Erikson explique que dans toute communication, c’est toujours le destinataire qui décide de ce qu’il comprend. Le message est filtré par ses expériences, ses préjugés et sa personnalité. L’émetteur ne contrôle donc jamais totalement la réception.
L’expert en communication insiste sur l’importance d’adapter son style pour créer une zone de sécurité. Cette souplesse permet d’éviter les malentendus et d’améliorer la relation. Savoir lire les besoins de l’autre fait toute la différence.
« Nous voyons ce que nous faisons, mais nous ne voyons pas pourquoi nous le faisons. Nous évaluons donc les autres sur la base de notre perception de ce que nous faisons. » (Tous des idiots ?, Chapitre 1)
Il rappelle que la communication n’est pas un système parfait. Les comportements humains sont trop complexes pour être réduits à des règles fixes. Cependant, comprendre les bases évite les erreurs les plus graves.
En s’appuyant sur Carl Jung, il souligne que chacun agit selon des schémas comportementaux. Aucun style n’est meilleur qu’un autre. Nous pouvons être nous-mêmes seuls ou entourés de semblables, mais rarement ailleurs.
L’auteur montre que les mots ont un pouvoir énorme, mais aussi des interprétations multiples. Mal choisis, ils peuvent transformer une intention bienveillante en maladresse. Tout dépend donc de l’usage que l’on en fait.
Il compare le comportement humain à une boîte de vitesses. Certaines attitudes conviennent selon le contexte, d’autres non. Le défi est de trouver la bonne vitesse au bon moment.
Enfin, Thomas Erikson affirme que le comportement est prévisible, observable et modifiable. Chacun peut apprendre à écouter, à comprendre et à s’adapter. Tolérance et patience ouvrent la voie à des relations plus harmonieuses.
CHAPITRE 2 - Pourquoi sommes-nous devenus ce que nous sommes ?
Thomas Erikson explique que le comportement résulte d’un mélange d’hérédité et d’environnement. Les traits transmis par la famille forment une base, enrichie ensuite par les expériences de vie. Dès l’enfance, l’apprentissage se fait par mimétisme et par la recherche de satisfaction.
L’auteur distingue les valeurs fondamentales, profondément enracinées, des attitudes, construites à partir d’expériences. Les valeurs guident durablement nos choix, tandis que les attitudes évoluent au gré des situations vécues. Ensemble, elles façonnent le comportement de base, celui que nous exprimons naturellement.
Cependant, chacun porte des masques sociaux adaptés au contexte : travail, maison ou relations familiales. Ces ajustements montrent que le comportement visible diffère parfois de la personnalité profonde. L’expert en communication insiste donc sur l’importance de comprendre cette dynamique.
Il résume ce processus par une formule claire : Comportement = f(Personnalité × Facteurs environnants). Le comportement s’observe, la personnalité s’interprète et les facteurs extérieurs influencent chaque action. Selon lui, savoir regarder sous la surface permet de mieux comprendre autrui et d’éviter les jugements rapides.
CHAPITRE 3 - Introduction au système que vous êtes sur le point d’apprendre
Les quatre types de comportement selon Thomas Erikson (Tous des idiots ?, Chapitre 3)
Thomas Erikson présente un système de quatre comportements représentés par des couleurs. L’objectif est d’apprendre à les identifier chez soi et chez les autres. Rapidement, le lecteur reconnaît des visages familiers, parfois même le sien.
Chaque couleur révèle des qualités enviables : la détermination des Rouges, la sociabilité des Jaunes, la sérénité des Verts ou la rigueur des Bleus. Mais chaque profil comporte aussi ses excès : autorité excessive, bavardage, passivité ou méfiance permanente. L’auteur propose d’apprendre à repérer ces pièges.
Il encourage le lecteur à prendre des notes et à souligner les passages clés. Cette démarche facilite la mémorisation et aide à appliquer les connaissances dans la vie quotidienne.
CHAPITRE 4 - Le comportement Rouge
Thomas Erikson décrit les Rouges comme des personnalités colériques, dynamiques et ambitieuses. Ils fixent des objectifs élevés, prennent des décisions rapides et aiment relever les défis. Leur énergie et leur assurance en font souvent des leaders naturels.
Les Rouges aiment la compétition sous toutes ses formes. Qu’il s’agisse de travail, de sport ou même de jeux de société, ils veulent gagner. Leur communication est directe, parfois brutale, mais souvent perçue comme honnête et claire.
Toujours pressés, ils détestent la lenteur et privilégient l’efficacité. Ils avancent vite, parfois trop vite, mais assurent la dynamique des projets. Leur devise pourrait être : « mieux vaut agir que ne rien faire ».
Un Rouge croit que tout est possible s’il fournit assez d’efforts. L’impossible n’existe pas, seulement des défis plus longs à relever. Leur ambition dépasse souvent leurs propres limites, mais leur volonté les pousse toujours en avant.
Ils affichent une conviction si forte qu’ils entraînent facilement les autres, même lorsqu’ils se trompent. Leur détermination impressionne, mais peut aussi irriter ou intimider. Pourtant, leurs intentions ne sont généralement pas malveillantes : ils veulent avant tout réussir.
Les Rouges adorent le changement et ne craignent pas de bouleverser l’ordre établi. Leur flexibilité surprend, mais leur impatience peut déstabiliser leur entourage plus calme. Ils avancent toujours, quitte à abandonner rapidement un objectif atteint.
L’auteur cite Barack Obama, Mère Teresa, Donald Trump ou encore Arnold Schwarzenegger comme exemples de profils Rouges. Ces personnalités montrent la puissance, mais aussi les limites, de ce tempérament énergique et déterminé.
Thomas Erikson décrit les Rouges comme des personnalités intenses, ambitieuses et toujours en action. Ils fixent des objectifs élevés, prennent des décisions rapides et n’ont pas peur du risque. Leur énergie et leur assurance en font des leaders naturels, souvent perçus comme dominateurs.
La compétition rythme leur quotidien. Qu’il s’agisse de sport, de travail ou de loisirs, ils cherchent à gagner. Cette attitude peut agacer, mais leurs intentions sont rarement malveillantes : ils veulent simplement réussir. Leur communication directe et sans filtre est vécue à la fois comme une qualité et un défaut.
Les Rouges détestent la lenteur et valorisent l’efficacité. Ils avancent vite, parfois trop, mais savent maintenir la dynamique d’un projet. Ils croient que rien n’est impossible et que seul l’effort permet de franchir les obstacles. Leur flexibilité les pousse à changer de direction dès qu’une meilleure solution apparaît.
Cependant, leur intensité fatigue parfois leur entourage. Les Verts et les Bleus, plus prudents, peuvent être déstabilisés par leur impatience et leur soif de nouveauté. Mais leurs points forts restent puissants : courage, détermination et clarté. Des figures comme Barack Obama, Mère Teresa ou Arnold Schwarzenegger illustrent ce profil Rouge emblématique.
CHAPITRE 5 - Le comportement Jaune
Thomas Erikson décrit les Jaunes comme des personnalités sanguines, optimistes et enthousiastes. Ils voient toujours le bon côté des choses et transforment la vie en fête. Leur énergie, leur humour et leur chaleur rendent leur présence irrésistible.
Les Jaunes aiment communiquer et attirer l’attention. Ils parlent beaucoup, racontent des histoires et rassemblent naturellement les autres autour d’eux. Leur optimisme est contagieux, même dans les moments difficiles, et leur sociabilité leur permet de se faire des amis partout.
Comme les Rouges, ils prennent des décisions rapides, mais sur la base de leurs sentiments plus que de la logique. Leur créativité débordante les pousse à trouver des solutions originales et à dépasser les limites. Ils sont aussi de grands persuasifs, capables d’inspirer et de motiver par leur langage imagé et leur charisme.
Leur besoin vital de relations humaines en fait des bâtisseurs de liens et des sources d’inspiration. Cependant, leur spontanéité peut les conduire à des excès ou à des maladresses. Des figures comme George Bush Junior, Richard Branson, Dolly Parton ou encore Jim Carrey incarnent ce tempérament Jaune.
CHAPITRE 6 - Le comportement Vert
Thomas Erikson décrit les Verts comme les personnalités les plus fréquentes et les plus équilibrées. Ils représentent une forme de stabilité dans un monde dominé par des caractères plus extrêmes. Ni trop ambitieux, ni trop exubérants, ni trop perfectionnistes, ils incarnent une moyenne qui apaise les excès des autres profils. Leur calme naturel et leur attitude imperturbable apportent une sérénité bienvenue dans les groupes.
Les Verts sont avant tout gentils et loyaux. Ils privilégient la coopération et mettent toujours les besoins du groupe avant les leurs. Ils n’aiment pas les conflits et font tout pour maintenir l’harmonie. Ce sont des amis fidèles, des collègues fiables et des partenaires de confiance. Leur capacité à écouter sincèrement, sans chercher à dominer ou à juger, fait d’eux des personnes très appréciées. Ils se souviennent des détails importants, comme les anniversaires, et montrent une attention constante à leur entourage.
Leur point fort réside dans leur fiabilité. Lorsqu’ils s’engagent à faire quelque chose, ils respectent leur parole. Ils préfèrent avancer doucement mais sûrement, et leur constance assure la solidité des équipes. Leur esprit d’équipe est si fort qu’ils mettent parfois leurs propres besoins de côté pour préserver le collectif. Dans un environnement professionnel, leur prévisibilité et leur sérieux rassurent et stabilisent.
Mais leur passivité peut être une faiblesse. Ils évitent de se mettre en avant, hésitent à dire non et risquent d’être exploités. Leur peur du changement ou leur lenteur à s’adapter peut aussi freiner l’innovation. Pourtant, lorsqu’on leur laisse du temps et qu’on justifie les décisions, ils finissent par accepter et accompagner le mouvement. Leur écoute attentive, proche de la bienveillance, peut même devenir une arme efficace, comme le montre l’exemple d’une vendeuse Verte qui conclut une affaire uniquement en laissant parler son client.
En résumé, les Verts sont des piliers discrets mais essentiels. Leur douceur, leur stabilité et leur écoute équilibrent les excès des autres profils. Gandhi, Michelle Obama ou encore Luke Skywalker illustrent bien cette personnalité tournée vers le collectif, la tolérance et l’harmonie.
CHAPITRE 7 - Le comportement Bleu
Thomas Erikson décrit les Bleus comme des personnalités méthodiques, précises et soucieuses de l’ordre. Ils observent, analysent et évaluent en silence avant de s’exprimer. Leur univers est structuré : tout a une place définie, chaque tâche suit une logique claire. Pour eux, la qualité et la rigueur passent avant la rapidité. Leur calme apparent cache un esprit en alerte, toujours attentif aux détails.
Les Bleus sont avant tout réalistes. Là où d’autres voient des opportunités, ils perçoivent d’abord les risques et les erreurs possibles. Ils recherchent la sécurité, préfèrent vérifier plusieurs fois plutôt que d’avancer trop vite, et considèrent qu’un travail mal fait ne vaut pas la peine d’être entrepris. Cette prudence, parfois perçue comme du pessimisme, garantit néanmoins fiabilité et constance. Leur honnêteté les pousse à dire les choses telles qu’elles sont, même si cela complique parfois les relations.
Leur grande force réside dans leur fiabilité et leur précision. Un Bleu lit les manuels, respecte les règles et répète les processus sans se lasser. Ils n’aiment ni les raccourcis ni les improvisations et s’assurent que tout est correct à 100 %. Leur approche systématique évite les erreurs et assure la qualité. Mais leur perfectionnisme peut ralentir les décisions et agacer des profils plus rapides. Leur introversion les pousse aussi à rester discrets, préférant écouter plutôt que parler, mais chaque mot qu’ils prononcent est réfléchi et solide.
En résumé, les Bleus sont des garants de sérieux et de qualité. Leur stabilité et leur sens du détail équilibrent les excès des autres profils. Leur logique, parfois rigide, assure pourtant une grande solidité aux projets. Einstein, Bill Gates ou encore C-3PO illustrent ce type de personnalité attachée à la précision et à la rationalité.
CHAPITRE 8 - Le revers de la médaille – ou personne n’est parfait
L’auteur montre que chaque style a ses atouts mais aussi ses excès. Un trait positif peut virer au défaut lorsqu’il est poussé trop loin. Il rappelle qu’un jugement négatif traduit souvent une incompréhension plutôt qu’une réalité objective.
Les Rouges apparaissent dynamiques, rapides et centrés sur les résultats. Mais ils peuvent devenir autoritaires, impatients et dominateurs, suscitant peur et rejet. Leur franchise directe choque souvent, car ils disent brutalement ce qu’ils pensent sans filtre, au risque de blesser.
Les Jaunes séduisent par leur enthousiasme, leur créativité et leur aisance à communiquer. Pourtant, ils monopolisent parfois l’attention, coupent la parole et manquent de rigueur. Ils s’ennuient vite, oublient les détails, et passent d’un projet à l’autre sans conclure.
Les Verts sont appréciés pour leur calme, leur gentillesse et leur loyauté. Mais leur peur du conflit les rend indécis et passifs. Leur entêtement discret, leur résistance au changement et leur manque d’implication agacent ceux qui attendent de la clarté et de l’action.
Les Bleus offrent précision, sérieux et sens de la qualité. Mais leur perfectionnisme, leurs doutes et leur esprit critique fatiguent leur entourage. Ils vérifient tout plusieurs fois, ralentissent les projets et paraissent distants, voire froids dans les relations.
Thomas Erikson insiste : personne n’est parfait. Les forces et les faiblesses se reflètent toujours à travers les yeux des autres. Comprendre ces perceptions aide à mieux communiquer et à accepter que chaque couleur ait sa part d’ombre et de lumière.
CHAPITRE 9 - Apprendre des choses
L’auteur explique que l’apprentissage repose d’abord sur la curiosité. Ce qui l’a poussé à approfondir le sujet, c’est l’idée de Sture sur les idiots. Au fil des années, il lit, se forme, obtient des certifications et enseigne, mais admet n’avoir qu’effleuré la question.
Il rappelle que comprendre les gens est essentiel dans toutes les sphères : travail, couple, famille ou vie associative. Chacun, qu’il soit employé, dirigeant, indépendant ou parent, gagne à maîtriser ces connaissances. Les relations humaines déterminent la réussite bien plus que la technique seule.
Selon lui, lire un livre est une première étape, mais l’expérience pratique transforme réellement le savoir en compétence. Les conférences et séminaires offrent une base, mais la progression exige l’implication active. Sa mission est claire : réduire les conflits en diffusant cette méthode à grande échelle.
Il compare le langage des couleurs à celui d’une langue étrangère. Comme l’espagnol ou l’allemand, il demande pratique et régularité. Sans entraînement, les acquis s’effacent. Après ce livre, chacun doit appliquer ses connaissances au quotidien, même au risque de se tromper, pour progresser réellement.
La pyramide de l'apprentissage (Tous des idiots ?, Chapitre 9)
CHAPITRE 10 - Le langage corporel – ou pourquoi votre apparence est importante
L’expert en communication explique que le langage corporel révèle souvent plus que les mots. Il regroupe gestes, postures, expressions et distances sociales. Universel et culturel à la fois, il influence la perception qu’ont les autres de notre confiance, ouverture ou autorité.
Un Rouge se distingue par une poignée de main ferme, un regard direct et une posture en avant. Son corps traduit la volonté de contrôler et son ton reste puissant, rapide, sans hésitation. À l’inverse, un Jaune rayonne par ses gestes amples, ses sourires constants, son contact tactile et une voix mélodieuse, enthousiaste et débordante d’énergie.
Les Verts affichent une allure détendue et chaleureuse, souvent penchée en arrière. Leur voix douce et leur rythme lent respirent la patience. Leur langage corporel reste discret, mais chaleureux lorsqu’ils font confiance. Quant aux Bleus, ils se reconnaissent à leur immobilité : gestes rares, visage figé, distance respectée. Leur voix mesurée et monotone reflète contrôle et précision, même si elle peut sembler froide.
En résumé, chaque couleur parle avec son corps autant qu’avec ses mots. Observer ces signaux aide à comprendre les intentions réelles. L’auteur souligne que l’étude du langage corporel affine notre lecture des comportements et améliore la communication quotidienne.
✅ En savoir plus sur le langage corporel.
CHAPITRE 11 - Un exemple concret
Dans ce chapitre, l’auteur illustre la dynamique des couleurs à travers un souvenir marquant : une fête d’entreprise. Dans son agence bancaire des années 1990, il côtoyait un mélange typique de personnalités : des commerciaux Jaunes expansifs, des collègues Verts discrets, un responsable Bleu méfiant et un patron Rouge autoritaire. L’idée de la fête naît d’une conseillère Jaune, débordante d’enthousiasme, aussitôt validée par le patron Rouge, qui tranche rapidement et délègue l’organisation. Les Verts acceptent docilement d’aider, tandis que le Bleu, soucieux de logistique, freine l’ambiance par ses questions.
Une fois la fête lancée, les comportements s’inversent sous l’effet de l’alcool. Les Jaunes, habituellement joyeux et bavards, deviennent mélancoliques, doutant de leur valeur. Le Bleu, si réservé en temps normal, surprend tout le monde en dansant sur une table et en racontant des blagues crues. Le patron Rouge, d’ordinaire intimidant, tente maladroitement de se montrer chaleureux face aux Verts. Ceux-ci, enhardis, expriment enfin leurs frustrations et critiquent directement son style de management. L’ordre hiérarchique semble vaciller l’espace d’une soirée.
Mais dès le lundi, tout revient à la normale : les Jaunes plaisantent, le Bleu se tait, le Rouge reprend son rôle de chef et les Verts se font discrets. L’épisode démontre que les profils peuvent momentanément se transformer selon le contexte, mais leurs tendances profondes reprennent toujours le dessus. Pour l’auteur, c’est une invitation à observer ces variations dans la vie quotidienne afin de mieux comprendre et anticiper les comportements.
CHAPITRE 12 - L’adaptation
Thomas Erikson explique que l’adaptation est essentielle pour bien communiquer. Il rappelle que chacun croit avoir raison et juge les autres « idiots » quand ils ne pensent pas pareil. Pourtant, les personnalités fonctionnent différemment, et il faut accepter ces écarts.
L’expert en communication insiste : rester soi-même est naturel, mais s’ajuster demande énergie et conscience. Cette souplesse sociale facilite la coopération, même si certains y voient manipulation.
L’auteur illustre son propos avec Adriano, un entrepreneur Jaune, qui rejette les modèles par peur d’être manipulé. Ce cas montre que l’adaptation suscite parfois méfiance. Pourtant, comprendre les profils rend les choix plus simples et améliore les relations. Erikson précise qu’aucun système n’est parfait : c’est seulement une pièce du puzzle humain. L’important reste de mieux décoder les comportements pour ajuster sa communication.
Il détaille ensuite comment s’adapter à chaque couleur. Les Rouges veulent de la rapidité, de la clarté et du courage. Les Jaunes recherchent la bonne humeur, la nouveauté et l’attention personnelle, mais détestent les détails. Les Verts aspirent à la stabilité, à la prévisibilité et à la tranquillité, ce qui exige patience et douceur. Les Bleus attendent des faits précis, de la rigueur et de la qualité, tout en redoutant l’improvisation.
En conclusion, l’auteur insiste : il faut d’abord adopter le rythme de l’autre. On gagne alors confiance et reconnaissance. Mieux encore, chaque couleur peut compenser les faiblesses d’une autre, si chacun accepte de collaborer. L’expert en communication affirme que ce travail d’adaptation ouvre la voie à des relations plus fluides, constructives et respectueuses.
CHAPITRE 13 - Comment annoncer une très mauvaise nouvelle, ou quand une critique positive demeure malgré tout… une critique
Thomas Erikson montre que donner un avis, surtout négatif, est un défi pour la plupart des gens. Peu aiment annoncer une mauvaise nouvelle, et chacun la reçoit avec une sensibilité différente. Il souligne que l’absence de retour n’est pas une solution : elle empêche les progrès et fragilise la confiance. L’auteur insiste sur l’importance d’adapter sa méthode au profil de son interlocuteur pour qu’un message, même critique, puisse être entendu.
Avec les Rouges, il recommande d’aller droit au but, sans fioritures. Ces personnalités réagissent avec intensité, souvent en se défendant ou en attaquant. Pour éviter l’escalade, il faut rester calme, donner des exemples précis et factuels, puis demander à l’autre de reformuler l’accord trouvé. Le Rouge doit sentir que le message sert l’efficacité et les résultats, ce qui valorise son rôle de leader compétitif.
Les Jaunes, eux, se montrent réfractaires aux critiques venues de l’extérieur. Ils préfèrent changer à leur initiative. Erikson illustre ce point avec Janne, un ami qui monopolisait sans cesse la parole. Malgré des exemples concrets, Janne détournait l’attention ou interprétait mal le reproche. L’auteur explique qu’avec les Jaunes, il faut combiner douceur, humour, compliments et patience, tout en les amenant à admettre eux-mêmes le problème. Leur mémoire sélective des critiques facilite pourtant le rétablissement de la relation.
Les Verts représentent le cas le plus délicat. Une critique trop dure les blesse profondément et peut les pousser au retrait ou à l’inaction. Leur sensibilité relationnelle exige de la douceur, de la clarté et un rappel constant que seule leur attitude, et non leur personne, est concernée. L’auteur insiste sur le besoin de suivi, car les Verts évitent souvent le changement par passivité.
Enfin, les Bleus exigent des faits détaillés et vérifiables. Une critique vague ou teintée d’émotions est rejetée comme non professionnelle. Ils attendent des preuves écrites, des chiffres, des données. La franchise factuelle est la seule manière de gagner leur respect. Mais ces perfectionnistes, difficiles à faire changer, n’hésitent pas à critiquer les autres s’ils constatent la moindre erreur.
En conclusion, l’expert en communication rappelle que la critique doit toujours viser le comportement et non la personne. Chaque couleur exige une stratégie différente : fermeté pragmatique avec les Rouges, diplomatie patiente avec les Jaunes, douceur attentive avec les Verts, précision irréprochable avec les Bleus. L’efficacité d’un retour ne tient pas seulement au contenu du message, mais à la façon dont il est formulé et reçu.
]]>Résumé du livre "Mars et Vénus font la paix : savoir résoudre les conflits pour une vie de couple harmonieuse" de John Gray : la suite du grand classique de John Gray "Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus" dans laquelle l'auteur poursuit ses investigations sur les couples modernes — de quoi se faire plaisir, mais aussi retrouver le goût de la vie ensemble !
De John Gray, 2016, 416 pages.
Titre original : Men, Women and Relationships, Making Peace with the Opposite Sex (2014)
Chronique et résumé de "Mars et Vénus font la paix" de John Gray
Introduction
Une relation épanouie repose sur un équilibre entre effort et plaisir. Les femmes comprennent instinctivement que l’amour demande du travail émotionnel, tandis que les hommes, influencés par leur passé de pourvoyeurs, réservent souvent leur énergie à la sphère professionnelle. Cette différence de perception crée des malentendus, surtout quand un homme se retire dans sa « caverne » pour se détendre et que sa compagne y voit un désintérêt affectif.
Comme dans son premier livre, le psychologue John Gray explique dans Mars et Vénus font la paix que les hommes et les femmes fonctionnent comme s’ils venaient de planètes différentes : Mars et Vénus. Les hommes valorisent l’efficacité, les femmes privilégient l’échange émotionnel. Lorsqu’une femme parle de ses problèmes, elle cherche une écoute, pas une solution. Et lorsque l’homme se tait, il ne fuit pas : il se régénère. Respecter ces différences, c’est éviter les conflits inutiles.
La clé d’une relation réussie, c’est de ne pas chercher à changer l’autre, mais à le comprendre. Cela demande du temps, de la bienveillance et une communication adaptée à chacun. En apprenant à respecter les besoins et les rythmes de l’autre, les partenaires créent un espace de confiance où chacun peut s’épanouir pleinement, sans renier sa nature.
Chapitre 1 – Aimer un être différent de soi est un Art
L’auteur insiste d’abord sur une vérité essentielle mais souvent négligée : nous sommes tous différents. Pourtant, dans la vie de couple, nous cherchons souvent à faire changer l’autre, à le modeler selon nos attentes. Nous rejetons ses différences, surtout lorsqu’elles ne correspondent pas à notre manière de penser ou de ressentir. Ce rejet bloque l’amour véritable, qui ne peut exister sans acceptation inconditionnelle. Aimer vraiment, c’est respecter l’autre pour ce qu’il est, sans chercher à le transformer. En cessant de croire que l’autre doit nous ressembler, nous ouvrons la voie à une relation plus riche et plus profonde.
Cette prise de conscience s’accompagne d’une exploration des nombreuses manières dont les humains ont tenté de classer les personnalités : typologies psychologiques, astrologie, ennéagramme, ou encore modèles comportementaux utilisés en entreprise. Même si ces outils peuvent sembler réducteurs, ils aident à mieux comprendre que nos différences ne sont pas des défauts, mais des expressions variées de l’humanité. Ce n’est pas la différence qui blesse, mais notre jugement sur elle. Apprendre à apprécier l’autre tel qu’il est constitue le premier pas vers une relation harmonieuse.
Le psychologue illustre ces écarts à travers des couples fictifs : Kathy, qui veut parler à Tom de sa journée, se heurte à son besoin de silence ; Alise, qui surinvestit son couple, provoque sans le vouloir la passivité d’Henry ; Patrick, qui donne des conseils à Jennifer au lieu de l’écouter, nie ses émotions. Dans chaque cas, les intentions sont bonnes, mais mal comprises parce qu’elles s’appuient sur des codes opposés. La femme attend un échange émotionnel ; l’homme croit devoir apporter une solution ou prendre du recul.
Cette dynamique repose sur des tendances générales : les femmes ont besoin de partager, de parler, d’être écoutées, tandis que les hommes ont besoin d’espace, de solitude, de sentir leur compétence reconnue.
Quand ces besoins sont ignorés ou incompris, chacun se sent blessé. L’homme pense qu’on le critique ou qu’on l’étouffe ; la femme croit qu’on la rejette ou qu’on la méprise. L’un se tait, l’autre insiste, et les conflits s’enchaînent.
L’image de la « caverne » permet d’illustrer le repli masculin en cas de stress. C’est un besoin naturel de retrait, non un signe d’indifférence. Les femmes, elles, ressentent souvent le besoin de parler immédiatement. Cette opposition produit des malentendus, parfois très douloureux. Mais dès lors que l’on comprend ces mécanismes, le respect des besoins de chacun redevient possible.
En somme, les conflits naissent souvent de la fausse idée que notre partenaire doit penser et réagir comme nous. Reconnaitre que l’autre vient d’une autre “planète”, comme le propose l’auteur de Mars et Vénus font la paix avec humour, aide à cultiver la tolérance, la patience et l’émerveillement. En acceptant cette altérité, l’amour peut s’épanouir. C’est dans la complémentarité, et non dans la fusion, que naît la richesse d’un couple.
Chapitre 2 – Construire une relation amoureuse
Une relation gratifiante repose sur quatre piliers :
Communiquer avec bienveillance ;
Faire preuve d’ouverture ;
Ne pas juger ;
Assumer ses responsabilités.
Ces principes simples mais puissants permettent aux couples de mieux se comprendre, de s’aimer durablement et de se soutenir mutuellement.
John Gray commence par rappeler que la communication doit naître d’une intention sincère : comprendre et se faire comprendre. Quand elle est guidée par la peur, la colère ou la manipulation, elle devient toxique. Une anecdote au restaurant montre comment une question mal formulée peut créer un conflit inutile.
Lorsqu’il change sa manière d’interroger le serveur, John Gray obtient enfin une réponse claire et retrouve sa sérénité. Il réalise que ce n’était pas le fait d’attendre qui le rendait furieux, mais l’incompréhension. Dès qu’il obtient une explication, il redevient calme et aimant. Une bonne communication apaise, même dans des situations tendues.
Mais la communication seule ne suffit pas. Il faut aussi de l’ouverture d’esprit. Beaucoup de malentendus naissent de fausses interprétations. Chacun projette ses propres intentions sur l’autre, sans vérifier leur validité. Un geste, une expression, une parole peuvent être mal compris et créer un malaise durable.
L’auteur de Mars et Vénus font la paix évoque un couple, Martha et Joe. Elle croit que son mari la méprise alors qu’il se sent simplement impuissant. En réalité, ils s’aiment, mais ne se comprennent pas. Leur échange le montre : dès que leurs émotions sont reformulées avec justesse, la tension retombe.
Cette ouverture mène naturellement à une réduction des jugements. En cessant de vouloir avoir raison ou de cataloguer l’autre, on se rend plus disponible. On se libère aussi de ses propres critiques intérieures. Quand on se juge sévèrement, on finit par juger les autres. À l’inverse, quand on apprend à aimer les autres avec leurs défauts, on s’autorise à s’aimer soi-même avec plus de douceur. Cette dynamique vertueuse enrichit toutes les relations.
Mais pour que ces changements soient durables, il faut sortir du rôle de victime. John Gray insiste : assumer ses responsabilités est essentiel. Cela ne veut pas dire se blâmer, mais reconnaître que nos pensées, nos émotions et nos gestes influencent les réactions de l’autre. Même des sentiments refoulés, comme une rancune silencieuse, se font sentir et provoquent un rejet.
L’exemple de Linda montre qu’une femme peut vouloir bien faire tout en transmettant un malaise profond. Son mari, sans comprendre pourquoi, s’éloigne. Quand elle prend conscience de sa propre amertume et accepte de la transformer, leur relation renaît.
Les ressentiments cachés détruisent lentement le lien amoureux. Ils se traduisent par des gestes secs, une voix tendue, une absence d’élan. Même quand les intentions sont bonnes, ils bloquent l’amour. À l’inverse, quand on comprend que nos pensées peuvent influencer l’autre, on devient plus prudent, plus humble. On cesse de penser que l’autre devrait deviner ce qu’on ressent. On apprend à parler avec justesse, à demander sans reprocher, à aimer sans exiger.
Ces quatre piliers sont les fondations d’une relation épanouissante. Ils permettent d’aimer mieux, de s’aimer soi-même, et de construire une union forte, faite de respect, de compréhension et de tendresse partagée.
Chapitre 3 – Les différences fondamentales entre les hommes et les femmes
John Gray rappelle que les différences entre les sexes ne se limitent pas aux organes reproducteurs. Les caractéristiques physiques, comme la peau, la voix ou la masse musculaire, sont autant d’éléments biologiques qui distinguent les hommes des femmes. Ces distinctions préparent à comprendre les différences psychologiques, elles aussi marquées et complémentaires.
Les femmes sont plus intuitives et centrées sur les relations, tandis que les hommes sont plus rationnels et centrés sur l’action. Ces différences ne sont pas de simples constructions sociales. Elles sont biologiquement fondées mais influencées par l’environnement. Le problème survient quand l’un rejette sa nature profonde pour développer l’autre polarité. Ainsi, un homme sensible qui sacrifie sa virilité perd son équilibre. De même, une femme indépendante qui rejette sa vulnérabilité compromet son épanouissement affectif.
La complémentarité homme-femme repose sur deux forces : centrifuge (féminine) et centripète (masculine). La femme se tourne naturellement vers les autres, l’homme se recentre sur lui-même. Sous stress, ces traits s’exacerbent. Cela explique pourquoi les femmes se sentent ignorées et les hommes accablés. Les styles de communication contrastés aggravent l’incompréhension : la femme explore ses pensées à voix haute, l’homme résume sa réflexion par une conclusion directe.
La passion naît de l’attirance entre forces opposées. Chacun projette sur l’autre un aspect refoulé de lui-même. L’homme froid est attiré par la chaleur d’une femme, la femme dominante par un homme doux. Cette alchimie active un processus de réalisation de soi. Mais si chacun essaie de changer l’autre ou se conforme pour être aimé, le désir s’éteint.
L’auteur identifie quatre profils de résistance à l’équilibre :
Le macho (masculinité rigide) ;
La martyre (féminité soumise) ;
L’homme sensible (féminité dominante) ;
La femme indépendante (masculinité dominante).
Chacun projette ses jugements intérieurs sur le partenaire, générant conflits et incompréhension. La reconnaissance de cette dynamique est essentielle pour désamorcer les tensions.
Retrouver l’harmonie passe par l’accueil des deux polarités en soi. L’homme doit développer sa douceur sans renier sa force ; la femme, sa force sans renier sa douceur. Ce travail permet de préserver l’attirance, la complicité et l’amour durable. En somme, respecter les différences, c’est non seulement aimer l’autre tel qu’il est, mais aussi apprendre à s’aimer soi-même.
Chapitre 4 – Les hommes et les femmes n’ont pas la même vision du monde
Les hommes et les femmes perçoivent le monde à travers des formes de conscience différentes : ciblée pour les hommes, large pour les femmes. Les hommes avancent vers un but, séquencent les données, et concentrent leur attention sur un seul problème à la fois. Les femmes, quant à elles, adoptent une vue d’ensemble, perçoivent l’environnement global et naviguent parmi les détails en les reliant à un contexte émotionnel.
Cette divergence se manifeste dans les tâches quotidiennes. Une femme anticipe les besoins à venir, un homme reste focalisé sur l’objectif immédiat. Elle remplit son sac pour parer à toute éventualité ; lui garde l’essentiel sur lui. Au téléphone, elle peut écouter, cuisiner et consoler en même temps ; lui ne supporte pas qu’on le dérange. Elle explore un centre commercial pour le plaisir ; lui y va pour acheter un objet précis.
Sous stress, l’homme se replie, focalise encore davantage et devient émotionnellement absent. La femme, au contraire, s’éparpille, se sent submergée, veut parler. Ce besoin de verbaliser, souvent mal compris, vise simplement à réduire la charge mentale. L’homme croit devoir proposer des solutions alors qu’elle attend une écoute empathique. À l’inverse, lorsqu’il cherche de l’aide, il veut une réponse directe, pas une analyse émotionnelle.
Cette méconnaissance réciproque des attentes entraîne tensions et malentendus. L’homme se sent critiqué, la femme jugée. Pourtant, chacun cherche simplement du soutien. Connaître ces différences, c’est apprendre à mieux aimer, à mieux écouter, à préserver l’équilibre dans la relation.
Les conflits de couple surgissent souvent à cause de malentendus émotionnels. Lorsqu'une femme exprime ses besoins ou critiques, elle l’a déjà fait en interne. L’homme pense qu’elle l’accuse à tort, alors qu’elle a longuement réfléchi à sa propre implication.
En cas de tension, les femmes ont tendance à s’autoaccuser avant d’envisager que l’autre ait une part de responsabilité. Les hommes, eux, blâment d’abord leur entourage. Cette différence de perspective crée un déséquilibre dans la gestion des conflits.
Un homme qui manque d’estime de soi se montre souvent moralisateur. Plus il doute de lui-même, plus il critique les autres. La femme, dans la même situation, retournera plutôt ses reproches contre elle.
Quand une femme fait des remarques, l’homme croit souvent qu’elle ne s’est pas remise en question. En réalité, elle l’a déjà fait avant de parler. Ce décalage de perception empêche l’homme de comprendre la légitimité de ses demandes.
Pour éviter les conflits, il faut apprendre à écouter sans juger. L’homme doit comprendre que l’expression des besoins féminins n’est pas une attaque. La femme, de son côté, gagnera à ne pas interpréter l’accusation masculine comme un verdict définitif.
Chapitre 5 – Comment les hommes et les femmes réagissent-ils au stress ?
Face au stress, les hommes et les femmes réagissent selon des schémas opposés. L’homme tend à prendre du recul, à analyser objectivement la situation, et à chercher des solutions dans l’action ou le changement extérieur. La femme, elle, se tourne vers son monde intérieur, traverse d’abord une vague émotionnelle, puis tente de rétablir son équilibre en modifiant son état d’esprit. Ces deux démarches sont complémentaires, mais sources de malentendus si elles ne sont pas reconnues comme telles.
Un homme stressé peut devenir irritable, critique, voire destructeur s’il perd son objectivité. Il se coupe alors de sa force intérieure, ne parvient plus à se contrôler et laisse éclater une colère souvent démesurée. À l’inverse, une femme peut perdre sa clarté émotionnelle si elle ignore ses ressentis. En se forçant à être rationnelle sans avoir d’abord exploré ses émotions, elle devient exigeante, fermée, voire manipulatrice.
Lorsqu’une dispute éclate, ces différences se heurtent violemment. L’homme, croyant se soulager en parlant avec rudesse, blesse sa compagne qui n’oubliera ni les mots ni la douleur. La femme, en tentant de raisonner ou de critiquer, pousse l’homme à se refermer et à se taire. Chacun agit selon sa logique propre, sans comprendre que l’autre fonctionne autrement.
Sous pression, une femme cherchera d’abord à se transformer intérieurement. Elle tentera d’être plus tolérante, patiente, bienveillante pour apaiser ses tensions. L’homme, de son côté, préférera agir sur les causes extérieures du stress. Il changera de comportement, éliminera les obstacles, ou tentera de maîtriser son environnement pour retrouver son calme.
Quand leurs efforts n’aboutissent pas, chacun risque de basculer dans son « côté obscur ». La femme devient manipulatrice ou accusatrice, l’homme se montre dur ou indifférent. Ces dérives naissent du sentiment d’impuissance : elle n’est pas entendue, il se sent inefficace. Pour éviter ces impasses, il est crucial que chacun puisse exprimer ses besoins dans un climat d’écoute et de respect.
La violence, qu’elle soit physique, verbale ou passive, est souvent le signe d’une douleur non exprimée. Chez l’homme, elle peut naître d’un besoin de vengeance ou d’une incapacité à mettre des mots sur sa souffrance. Chez la femme, elle prend la forme de culpabilisation ou d’auto-dévalorisation, parce qu’elle n’a pas pu partager ses émotions en sécurité.
Pour retrouver l’harmonie, chacun doit apprendre à guérir par l’écoute, la parole et la compassion. L’homme doit reconnaître sa peine et la verbaliser avant qu’elle ne se transforme en colère. La femme doit oser dire sa tristesse sans s’enfermer dans un rôle de victime. C’est par cette reconnaissance des émotions que la paix intérieure – et conjugale – devient possible.
Chapitre 6 – Les symptômes du stress
Les hommes réagissent au stress par le retrait, l’irritabilité ou un repli total sur eux-mêmes. Ces réactions sont souvent mal interprétées par leur compagne, qui les perçoit comme du désamour ou de l’indifférence. En réalité, elles traduisent une stratégie masculine pour gérer l’accablement émotionnel sans s’effondrer.
Le retrait est la première réponse masculine. L’homme cesse de parler, se détache émotionnellement et devient insensible aux besoins de sa partenaire. Celle-ci se sent rejetée alors qu’il tente simplement de reprendre le contrôle en se coupant de ses émotions.
Lorsque la tension persiste, l’homme devient grincheux. Il grogne, oppose une résistance passive à toute demande, mais cette mauvaise humeur cache une volonté de rester centré sur ce qui le préoccupe. Les femmes, capables de passer facilement d’une tâche à l’autre, interprètent mal ce comportement qu’elles jugent injustifié.
En phase de stress aigu, l’homme opère un repli total. Il devient froid et silencieux, non par vengeance ou rejet, mais parce que ses émotions sont trop envahissantes pour être traitées. Comme les femmes se referment par choix, elles perçoivent ce mécanisme masculin comme une punition.
La femme, de son côté, réagit au stress en se sentant dépassée. Son attention se disperse sur une multitude de tâches perçues comme toutes urgentes. Elle donne encore plus qu’à l’accoutumée, néglige ses propres besoins et se retrouve à bout de souffle sans oser demander d’aide.
En s’enlisant, elle peut se montrer excessive, dramatisant des détails et reportant ses tensions sur son compagnon. Ce dernier, croyant à des reproches, se met sur la défensive et s’éloigne, ce qui augmente encore la détresse de sa compagne. Il ne comprend pas que cette intensité émotionnelle est issue d’un cumul de stress.
Finalement, la femme peut craquer et sombrer dans un épuisement nerveux. Elle pleure, se sent impuissante et perd tout espoir. L’homme, désemparé, croit qu’il ne pourra jamais satisfaire sa partenaire, alors qu’il suffirait souvent de prendre en charge quelques tâches simples pour alléger son fardeau.
Les hommes doivent comprendre que leur rôle n’est pas de résoudre les problèmes évoqués par leur compagne, mais de l’écouter avec bienveillance. Des phrases comme « Et quoi d’autre ? » ou « Continue… » l’aident à exprimer son ressenti et à retrouver son équilibre émotionnel.
Les femmes, elles, doivent apprendre à demander de l’aide sans exiger ni culpabiliser leur partenaire. Un homme grogne souvent non par refus, mais parce qu’il a besoin de temps pour quitter ce qui mobilise son attention.
Dans une relation équilibrée, chacun accepte de ne pas toujours être en mesure de soutenir l’autre. L’amour véritable n’exige pas que l’autre comble tous nos besoins, mais qu’il nous accompagne quand nous en faisons la demande, avec respect et liberté.
]]>Résumé de "L'art de la négociation" de Donald Trump : avant qu'il ne soit élu président des États-Unis, Donald Trump s'est fait connaître dans le milieu des affaires et de la télévision — dans son livre "L'art de la négociation", il dévoile ses techniques pour parvenir à ses fins et construire un succès durable grâce à la discussion… Un classique !
Par Donald Trump, 2019 (1989), 360 pages.
Titre original : The Art of the Deal, 1987.
Chronique et résumé de "L'art de la négociation" de Donald Trump
1 — Une semaine dans la vie de Donald Trump
« Je ne le fais pas pour l’argent. J’en ai suffisamment, plus que je n’en aurai jamais besoin. Je le fais pour le faire. C’est ma forme d’art. D’autres peignent de magnifiques toiles ou écrivent de merveilleux poèmes. Moi, j’aime conclure de gros deals, de préférence les plus grands. C’est comme ça que je prends mon pied. » (L'art de la négociation, Chapitre 1)
Ainsi commence l'ouvrage de Donald Trump. Dans ce premier chapitre, le milliardaire (qui, en ce temps, n'était pas encore président) nous raconte sa journée type.
Il affirme que les affaires sont son art : il ne cherche pas l’argent, mais le plaisir de conclure de grands deals. Il adopte un style de travail décontracté : pas de mallette, peu de réunions programmées, porte ouverte, imagination libre. Chaque matin à six heures, il lit la presse, rejoint son bureau à neuf, enchaîne une centaine d’appels, saute le déjeuner et continue à négocier jusque tard dans la nuit. Il vit dans l’instant, convaincu que le jeu n’en vaut la chandelle que s’il reste amusant.
Lundi, il mise sur Holiday Inns : un million d’actions achetées avec l’aide d’« Ace » Greenberg, trois options en tête – prise de contrôle, revente rapide ou rachat de ses titres avec prime. Parallèlement, il conseille Abe Hirschfeld sur un soutien politique à Cuomo, puis orchestre une opération caritative : il menace la banque d’Annabel Hill d’un procès pour « meurtre », débloquant les fonds et déclenchant une collecte médiatisée. Entre deux dépôts de plainte contre un entrepreneur défaillant, il supervise la rénovation éclair de la patinoire Wollman et choisit une couronne dorée géante pour l’atrium de Trump Tower. Le soir, après un dernier appel à NBC sur son projet des yards, le milliardaire rejoint son appartement, sans avoir mâché autre chose qu’un jus de tomate.
Mardi, il vise le Beverly Hills Hotel auprès d’Ivan Boesky, négocie un parking de 2 700 places à Atlantic City et s’interroge avec son comptable sur la nouvelle loi fiscale : moins de niches, mais taux maximal abaissé à 32 %. Il décline une présidence de gala pour Dave Winfield – pas question de taxer à nouveau ses amis – et échange avec le sénateur Danforth, l’un des rares à s’être battus contre la réforme. Son dilemme sur Holiday persiste : vendre pour engranger le profit ou conserver sa position avant une offensive. En fin de journée, il rédige une lettre cinglante au critique Paul Goldberger, persuadé que ce dernier prépare une charge contre Television City.
Mercredi, il visite une école pour sa fille, puis savoure un bain de presse à Wollman Rink : les tuyaux sont testés, le budget est inférieur de 400 000 dollars aux prévisions et l’ouverture est fixée au 13 novembre. De retour au bureau, il reçoit une offre confidentielle pour les yards, discute marbre et mosaïques du bassin de Mar-a-Lago et évoque avec des partenaires soviétiques la construction d’un hôtel face au Kremlin. Un ami texan lui présente un nouveau projet ; il se rappelle avoir économisé cinquante millions en écoutant son intuition lors d’une précédente affaire pétrolière. Il boucle la soirée par l’idée d’un « Trump Fund » destiné à racheter des immeubles saisis, tout en redoutant d’entrer en concurrence avec… lui-même !
Jeudi, il persuade Hirschfeld de rester démocrate, observe Wall Street s’enfoncer de 80 points tandis que son pari Holiday résiste, et planifie l’appel contre la NFL avec l’avocat Harvey Myerson. Stephen Hyde lui annonce que Trump Plaza triple son bénéfice mensuel malgré l’absence de parking ; Donald exige toutefois des suites supplémentaires pour dépasser la concurrence. Il assiste au véritable coulage du béton à Central Park, reçoit Fortune en vingt minutes chrono et approuve l’implantation d’un boulevard planté et d’un gratte-ciel record sur les yards. Le soir, il dîne à Saint-Patrick avec le cardinal O’Connor, impressionné par la finesse politique de l’archevêque.
Vendredi, la photo de Wollman trône dans le New York Times ; Trump expose aux urbanistes sa maquette : parcs publics, centre commercial linéaire, appartements vue Hudson, studios NBC accolés à la tour la plus haute du monde. À Trump Parc, il choisit un beige discret pour les cadres de fenêtres, sermonne un démolisseur sur ses « extras » et exige un béton parfaitement nivelé. Greenberg l’informe que Holiday adopte une « pilule empoisonnée » ; le milliardaire répond qu’aucun verrou financier ne l’empêchera d’acheter si telle est sa décision. Avant le week-end, il signe sa demande de licence au Nevada, visite une école, négocie l’achat d’un 727, encourage son émissaire en Australie pour le plus grand casino du monde et improvise un passage dans l’émission de David Letterman, prouvant qu’il saisit chaque occasion de transformer l’instant en publicité.
2 — Les clés du succès de Donald Trump
Voici les grands principes de la négociation dégagés par Donald Trump dans ce chapitre :
Penser grand (think big)
Protéger le risque (Protect the Downside and the Upside Will Take Care of Itself)
Maximiser ses options (Maximize Your Options)
Connaître son marché (Know Your Market)
Utiliser son levier (Use Your Leverage)
Valoriser l’emplacement (Enhance Your Location)
Faire parler de soi (Get the Word Out)
Riposter (Fight Back)
Tenir ses promesses (Deliver the Goods)
Maîtriser les coûts (Contain the Costs)
S’amuser (Have Fun)
Donald Trump fixe des objectifs vertigineux et pousse sans relâche pour les atteindre, convaincu que le talent pour négocier est inné ; l’intelligence compte, mais l’instinct prime. Ceux qui manquent de courage ignorent leur propre potentiel et se contentent d’admirer les "performeurs" depuis leur canapé. Le milliardaire voit dans chaque marché un terrain de jeu où seuls les plus audacieux osent vraiment gagner.
Sous l’angle « Penser grand », il abandonne rapidement Forest Hills pour la Fifth Avenue : il veut marquer l’horizon de projets monumentaux comme la West Side Yards ou un casino géant à Atlantic City. La grandeur exige une obsession contrôlée : il canalise sa névrose dans le travail et savoure la confrontation avec les promoteurs les plus coriaces de New York.
Pour « Protéger le risque », il envisage toujours le pire ; si la catastrophe reste supportable, le reste suivra. À Atlantic City, il retarde la construction jusqu’à l’obtention de sa licence et cède 50 % de ses profits à Holiday Inns en échange d’une garantie totale : mieux vaut un double assuré qu’un coup de circuit manqué. L’échec de l’USFL lui rappelle qu’on ne doit jamais rester sans plan B.
Trump multiplie les portes de sortie : s’il n’avait pas eu ses dérogations pour Trump Tower, un gratte-ciel de bureaux aurait vu le jour ; si la licence de jeu avait échoué, il vendait le terrain en gain rapide. Avec les railyards de Penn Central, il passe du logement subventionné au centre de conventions quand les finances municipales se dérobent.
Il se fie à son flair pour « Connaître son marché » : pas de consultants hors de prix, mais des cabdrivers, des riverains, des commerçants interrogés jusqu’à sentir le pouls d’un quartier. Les critiques changent de mode ; le public, lui, remplit Trump Tower, preuve que le milliardaire capte mieux les désirs que les théoriciens de l’architecture.
« Utiliser son levier » signifie ne jamais paraître pressé : il dramatise la fermeture possible du Commodore pour obliger la ville à agir, convainc Holiday Inns que son chantier est plus avancé qu’il ne l’est vraiment, et baptise Television City pour séduire NBC en jouant sur la fierté new-yorkaise. L’autre partie doit croire qu’elle a plus à perdre qu’à gagner en refusant.
Il démontre qu’un site moyen peut devenir premium : le nom Trump et une silhouette spectaculaire transforment Third Avenue en adresse convoitée, preuve que l’aura peut surpasser l’emplacement brut. Le secret : ne jamais payer trop cher, même pour un coin de rêve.
Pour « Faire parler de soi », il cultive la différence, la controverse et la hyperbole véridique : une colonne dans le New York Times vaut mieux qu’une pleine page de publicité facturée 40 000 $. Face aux questions piquantes, il reformule toujours à son avantage, parlant emplois et renaissance urbaine plutôt que luxe et privilège.
Quand il estime être lésé, il « Riposte » férocement : six tribunaux pour obtenir l’abattement fiscal de Trump Tower, bras de fer contre Holiday Inns pour reprendre Trump Plaza. Les envieux pullulent, mais il préfère être craint que roulé.
Reste à « Tenir ses promesses » : Carter avait l’audace de demander cinq millions pour sa bibliothèque mais manquait de substance ; Reagan, brillant showman, commence à laisser voir ses limites. Trump, lui, dépense sans compter pour ses atriums en marbre et ses escalators dorés ; l’exécution justifie le battage médiatique.
Il « Maîtrise les coûts » avec la même vigueur : un appel à vingt-cinq cents pour économiser 10 000 $ est toujours rentable. Trump Plaza sort de terre sans dépassement ; Wollman Rink renaît en quatre mois après sept ans de gabegie municipale.
Enfin, il s’amuse : l’argent sert de tableau de bord, mais l’adrénaline vient du jeu lui-même. Conscient de la fragilité de la vie, le milliardaire refuse de ruminer le passé ; il savoure l’instant, prêt à lancer le prochain pari dès que l’occasion se présente.
]]>Résumé de "Pourquoi personne ne m'en a parlé avant ?" de Julie Smith : un ouvrage de psychologie accessible pour mieux comprendre les ressorts du stress, de la déprime et du manque de motivation, notamment, et apprendre à les surmonter pour retrouver énergie, calme et joie de vivre — par l'une des influenceuses "psy" les plus en vue du moment !
De Julie Smith, 2023, 352 pages.
Titre original : Why has nobody told me this before (2022).
Chronique et résumé de "Pourquoi personne ne m'en a parlé avant ?" de Julie Smith
Introduction
Julie Smith était une jeune femme autrefois anxieuse ; aujourd'hui, elle se dit confiante et capable de surmonter les difficultés. Ce changement est-il magique ? Pas du tout ! Il vient de l’apprentissage d’outils simples et accessibles à tous.
Trop de gens ignorent le fonctionnement de leur esprit. Pour y remédier, l’autrice se met à publier des vidéos, sur TikTok notamment, puis se décide à écrire ce livre.
Son but ? Transmettre des compétences essentielles pour mieux vivre. Ces outils, utilisés régulièrement, renforcent la résilience et la conscience de soi. Cet ouvrage est donc comme une boîte à outils, qui vous aidera à affronter la vie avec clarté et force.
Partie 1 - Sur la vie en gris
1 - Comprendre les raisons d'un moral en berne
Julie Smith constate que tout le monde connaît des phases de déprime, mais que beaucoup les cachent par peur du jugement. Les personnes pensent souvent que le bonheur est un trait de personnalité ou que leur mal-être vient uniquement de leur cerveau, ce qui renforce leur sentiment d’impuissance.
Pourtant, l’humeur, comme la température corporelle, est influencée par des facteurs internes et externes. Manque de sommeil, stress ou déshydratation peuvent altérer l’état émotionnel. La psychologue montre qu’en comprenant ces influences, il devient possible d’agir.
Elle explique que pensées, sensations physiques, émotions et comportements sont liés. Ce cercle peut entretenir la déprime, mais aussi aider à en sortir. Il faut donc apprendre à repérer les signes, puis à utiliser des outils concrets pour modifier ses habitudes et ses réactions.
Le livre propose d’adopter une posture d’exploration : observer ce que l’on ressent, penser, faire, et en tirer des enseignements. Ces habiletés sont simples, accessibles, et efficaces, même hors d’une thérapie. Ce sont des leviers puissants pour reprendre la main sur sa santé mentale.
2 - Les pièges à éviter en matière de moral
Julie Smith explique que face à la déprime, beaucoup recherchent un soulagement immédiat : écrans, nourriture, alcool… Ces réactions, bien qu’efficaces à court terme, aggravent l’état émotionnel sur le long terme. Comprendre cette dynamique aide à choisir des stratégies plus saines.
Elle décrit aussi plusieurs biais de pensée qui renforcent la déprime, tels que :
Deviner les pensées d’autrui ;
Surgénéraliser ;
Raisonner avec ses émotions ;
Se fixer des injonctions irréalistes ;
Adopter un raisonnement tout ou rien ;
Etc.
Ces schémas, bien que fréquents, amplifient le mal-être. Il importe de repérer ces biais et de s’y entraîner régulièrement, par l’écriture, la discussion ou la pleine conscience. Il ne s’agit pas de supprimer les pensées, mais d’en prendre conscience et d’envisager d’autres interprétations plus nuancées.
Grâce à cette pratique, chacun peut éviter qu’un simple agacement devienne une journée de morosité. Cela demande de la patience, mais ces outils rendent la vie émotionnelle plus stable et plus libre.
3 - Les mesures utiles
Lorsque la déprime s’installe, les pensées négatives s’imposent comme un masque : elles parasitent la perception et influencent le comportement. Julie Smith montre que se distancier de ces pensées est essentiel. Grâce à la métacognition, chacun peut apprendre à les observer sans s’y identifier.
Ce recul passe par l’attention. Plutôt que lutter contre les pensées, il s’agit de choisir consciemment où diriger son projecteur mental. Trop souvent, l’esprit reste focalisé sur ce que l’on rejette, au lieu de s’orienter vers ce que l’on souhaite. L’attention, bien utilisée, redonne un cap.
Les pensées ruminées à répétition alimentent la spirale dépressive. Plus elles sont récurrentes, plus elles s’ancrent. Pour y remédier, des actions simples, comme bouger, changer de posture ou se poser la question suivante permet de rompre le cycle :
« Que ferait mon moi en forme ? »
Le lien humain aide aussi à sortir de cette boucle mentale. Un ami ou un thérapeute offre un miroir extérieur, recentre et éclaire. Parler, c’est déjà transformer la pensée.
La pleine conscience aide également à développer ce recul. Elle s’exerce comme un muscle : méditation guidée, observation sans jugement, recentrage volontaire. Plus on la pratique, plus on apprend à choisir comment réagir aux émotions et pensées.
Enfin, la gratitude renforce l’attention positive. Noter chaque jour trois éléments plaisants, même infimes, habitue l’esprit à chercher ce qui apaise. Cette pratique quotidienne renforce la stabilité émotionnelle et le sentiment de bien-être.
4 - Rendre les mauvais jours meilleurs
Lorsque la déprime s’installe, prendre une décision simple peut devenir épuisant. Le cerveau pousse vers des choix qui soulagent à court terme mais aggravent l’état général. Julie Smith recommande de viser des bonnes décisions, pas parfaites. Même minimes, elles créent un mouvement salutaire.
Plutôt que d’agir selon son humeur, il est utile de s’ancrer dans ses valeurs personnelles. Se demander ce qui est important pour sa santé mentale aide à agir avec cohérence. Il suffit parfois d’un petit pas répété chaque jour pour construire un changement durable.
La déprime amplifie souvent l’autocritique. On se juge durement, sans appliquer la compassion qu’on aurait pour un proche. L’autocompassion n’est pas de la complaisance, mais une posture honnête et encourageante, semblable à celle d’un bon coach.
Se demander comment on aimerait se sentir permet de ne plus seulement fuir la souffrance mais de choisir une direction. En remplissant un schéma basé sur les bons jours, on identifie les comportements et pensées à cultiver pour s’en rapprocher.
Enfin, imaginer un miracle où les problèmes disparaissent révèle ce qui compte vraiment. Ces indices éclairent les premiers petits gestes à poser au quotidien. Même si les difficultés persistent, il est possible d’avancer vers plus de clarté, d’équilibre et de sens.
5 - Maîtriser l'essentiel
Quand la santé mentale vacille, on néglige souvent les fondamentaux :
Sommeil ;
Alimentation ;
Exercice ;
Routine ;
Lien social.
Julie Smith les compare à des défenseurs dans une équipe : discrets mais décisifs. Sans eux, même une bonne attaque ne tient pas !
L’exercice physique agit comme antidépresseur naturel. Il augmente la dopamine, améliore l’humeur et favorise la résilience. Il n’a pas besoin d’être intense : une marche, une danse ou du yoga suffisent. L’essentiel est de commencer petit, avec plaisir, et de répéter.
Le sommeil régule l’humeur et renforce la capacité à faire face. Créer des conditions propices à l’endormissement – lumière naturelle le matin, calme le soir, apaisement mental – favorise un repos de qualité. Le sommeil ne se force pas : il se prépare.
L’alimentation influence directement le moral. Pas besoin d’un régime parfait, mais privilégier les aliments simples, complets et non transformés. Une amélioration progressive des choix alimentaires suffit à soutenir durablement l’équilibre émotionnel.
Une routine quotidienne prévisible stabilise l’esprit. Même minimes, des habitudes ancrées rétablissent un rythme et évitent les dérives. Elle permet aussi de se recentrer dès que l’on s’en éloigne, comme un point d’ancrage régulier.
Enfin, les relations humaines jouent un rôle clé dans la résilience. Même sans parler, être entouré apaise. Aller vers les autres avant d’en ressentir l’envie brise le cercle de l’isolement. Le lien, même simple, restaure un sentiment de sécurité intérieure.
]]>Résumé de "Comment naissent les émotions : la vie secrète du cerveau" de Lisa Feldman Barrett : écrit par une psychologue et neuroscientifique canado-étatsunienne, cet ouvrage est une référence sur la question de la cognition et des émotions — un ouvrage à lire par pur intérêt scientifique ou pour apprendre à apprivoiser vos sentiments et vivre mieux avec vous-même.
Par Lisa Feldman Barrett, 2017, 449 pages.
Titre original : How Emotions are Made. The Secret Life of Brain (2017).
Chronique et résumé de "Comment naissent les émotions : la vie secrète du cerveau" de Lisa Feldman Barrett
Introduction : Une hypothèse vieille de deux mille ans
Le 14 décembre 2012, un tireur tue vingt enfants et six adultes à l’école primaire Sandy Hook. Quelques semaines plus tard, le gouverneur du Connecticut, Dannel Malloy, évoque la tragédie dans son discours annuel. Sa voix se brise brièvement ; ce léger tremblement bouleverse Lisa Feldman Barrett, mais aussi le public, puis des millions de téléspectateurs. Tout le monde croit vivre la même « tristesse », comme si une réaction câblée déclenchait un circuit neuronal universel et bien reconnaissable.
C’est exactement ce que défend la « vision classique » des émotions, héritière de Darwin, Descartes, Ekman ou Pinker : chaque émotion serait un réflexe inné, produit par un circuit cérébral spécifique et associé à une “empreinte” corporelle typique — accélération cardiaque pour la peur, hausse de tension pour la colère, larme pour la tristesse, etc. Considérée comme universelle, cette théorie imprègne aussi bien la culture populaire (Inside Out, émoticônes, séries policières), que la technologie (logiciels d’“emotion analytics”),en passant par le droit et même les méthodes d’interrogatoire du FBI.
Pourtant, un siècle de recherches empiriques contredit cette vision. Les mesures du visage, du corps ou du cerveau révèlent une variabilité énorme : on peut être en colère sans tension élevée, avoir peur sans amygdale, sourire par politesse, pleurer de joie. Aucune “empreinte” fiable n’a jamais été isolée. Les expériences favorables à la vision classique sont aussi nombreuses que celles qui la réfutent, mais l’ensemble des données tend vers une conclusion : les émotions ne se déclenchent pas, elles se construisent.
Voici la « théorie constructionniste » défendue par L. F. Barrett : le cerveau, organe prédictif et plastique, combine en temps réel sensations corporelles, contexte culturel et expérience passée pour générer ce que nous appelons « tristesse », « colère » ou « joie ». Quand la voix du gouverneur se brise, l’autrice anticipe des réponses corporelles (cœur qui bat, gorge serrée), les ressent, puis les étiquette « tristesse » parce que sa culture lui a appris cette catégorie. Avec d’autres prédictions, les mêmes sensations pourraient devenir colère, peur ou gratitude. Les émotions sont donc réelles, mais conventionnelles : elles existent par accord collectif, à la manière de la monnaie, non comme des entités biologiques figées.
Ce changement de perspective a des conséquences majeures. Il explique par exemple l’échec de programmes coûteux comme SPOT (900 millions de dollars gaspillés pour “lire” les visages via la reconnaissance faciale), éclaire les biais médicaux qui font sous‑diagnostiquer les crises cardiaques chez les femmes. Comprendre la construction des émotions peut transformer la santé mentale et physique, l’éducation, la justice et nos relations quotidiennes.
L’ouvrage promet donc une révolution comparable à celles qu’ont vécues la physique avec Einstein ou la biologie avec Darwin. Les trois premiers chapitres présentent les nouvelles données ; les suivants détaillent le mécanisme de construction ; la dernière partie explore les applications pratiques, de la parentalité à la politique. Au‑delà du simple débat scientifique, l’autrice invite à embrasser l’inconnu, à poser de meilleures questions et à redéfinir ce que signifie être humain.
À la recherche des « empreintes » des émotions
Dans les années 1980, Lisa Feldman Barrett pense devenir psychologue clinicienne. Mais lors de ses expériences doctorales, elle se rend compte que la « vision classique » des émotions ne tient pas. Alors qu’elle tente simplement de répliquer des protocoles montrant que l’échec à ses propres standards rend dépressif et l’échec aux standards d’autrui rend anxieux, ses sujets n’arrivent pas à distinguer anxiété et dépression. Après huit tentatives, les résultats restent identiques.
L’autrice comprend alors qu’elle vient de mettre au jour une découverte : chacun discrimine les émotions avec plus ou moins de finesse, un talent qu’elle baptise « granularité émotionnelle ». Cette granularité, selon la théorie classique, devrait refléter la capacité à détecter de prétendues « empreintes physiologiques » : sourire pour la joie, frisson pour la peur, etc. Pour vérifier cette idée, la psychologue cherche un étalon objectif.
Elle se tourne d’abord vers le visage. Inspirés par Charles Darwin, trois scientifiques ont popularisé six expressions « universelles », photographiées chez des acteurs surjouant leur émotion :
Colère ;
Peur ;
Dégoût ;
Surprise ;
Tristesse ;
Joie.
Des centaines d’études montrent que, devant ces clichés, des participants du monde entier choisissent les mêmes mots. Pourtant, quand l’équipe de L. F. Barrett mesure réellement les muscles faciaux (EMG) ou recourt à un type de codage scientifique spécifique, la constance disparaît : les mouvements varient d’un individu à l’autre et même d’un instant à l’autre ; au mieux, ils signalent simplement « agréable » ou « désagréable ».
Chez les bébés comme chez les adultes, le contexte – posture, voix, situation – prime sur la mimique. Les « visages de base » sont donc des stéréotypes culturels, non des signatures biologiques.
La chercheuse examine ensuite le corps. Un article phare d’Ekman et al. (1983) semblait relier chaque émotion à un profil cardiaque et vasculaire distinct, mais il reposait sur la « facial feedback hypothesis » : demander aux sujets de prendre la pose d’une émotion.
Des répliques indépendantes et quatre méta‑analyses couvrant 22 000 participants échouent à retrouver des motifs stables ; la physiologie change selon la tâche, l’attitude corporelle ou la culture. Variation, pas uniformité : aucune empreinte autonome ne distingue fiablement colère, tristesse ou peur.
Reste le cerveau. Longtemps, l’amygdale passe pour le siège de la peur. Des patientes dépourvues d’amygdales semblent intrépides ; mais elles reconnaissent la peur dans les voix, la ressentent sous CO₂ enrichi, et d’autres personnes avec la même lésion éprouvent la peur normalement.
La règle de « dégénérescence » s’impose : plusieurs circuits peuvent produire la même émotion, et les mêmes neurones servent à des états mentaux différents. Les méta‑analyses d’imagerie qu’orchestrent L. F. Barrett et ses collègues – près de 100 études, 1 300 cerveaux – confirment qu’aucune région ni réseau n’est spécifique à une émotion ; l’amygdale, par exemple, s’active aussi bien pour nouveauté, apprentissage, douleur ou décision.
Peu à peu, la scientifique adopte la « pensée populationnelle » héritée de C. Darwin : une catégorie, ici « colère » ou « peur », rassemble des instances multiples et hétérogènes, sans prototype figé. Les programmes d’IA qui « devinent » l’émotion sur un scan ne lisent pas un état réel ; ils comparent un cas particulier à une moyenne abstraite. Ainsi, les empreintes émotionnelles relèvent du mythe.
Constat final de l’autrice : pour comprendre et améliorer la granularité émotionnelle – donc la santé, l’éducation, la justice – il faut abandonner la vision réflexe et universaliste. Les émotions se construisent, contextuelles et diverses, et non se déclenchent via des circuits dédiés. Cette prise de conscience ouvre la voie à une nouvelle théorie qui, selon la scientifique, redéfinit en profondeur la nature humaine.
Les émotions sont construites
Lisa Feldman Barrett explore comment l'émotion est simulée par le cerveau. L'autrice explique que l’émotion n'est pas simplement une réaction à des stimuli, mais une construction basée sur des anticipations et des expériences passées.
Selon la psychologue, le cerveau utilise des concepts pour anticiper et donner sens à l'expérience émotionnelle. Elle propose une nouvelle théorie sur l'émotion, en soulignant l'importance de la perception personnelle et de la culture dans la formation des émotions. C'est une approche plus nuancée et dynamique de la façon dont nous ressentons.
Lisa Feldman Barrett montre que notre cerveau ne « perçoit » pas passivement le monde ; il le simule en permanence à l’aide de souvenirs et de concepts. Devant une image de taches noires, nous restons « aveugles expérientiels » ; après avoir vu la photo complète, notre cortex visuel, l’amygdale et d’autres régions réorganisent instantanément leurs décharges : nous « hallucinons » l’objet caché, sans jamais sentir la machinerie interne qui crée cette vision.
La psychologue généralise : lire le mot pomme active déjà des neurones sensorimoteurs, comme si le fruit était présent. Ses exemples – soirée d’anniversaire « nourriture dégoûtante », odeurs de « purée de bébé » ou faux fromage moisi – montrent que ces simulations peuvent même provoquer nausées ou haut‑le‑cœur alors que rien, chimiquement, n’est toxique.
Au cœur du processus, les concepts agissent comme des emporte‑pièces : ils découpent le flux sensoriel interne (battements cardiaques, tensions, température) et externe (lumières, sons, odeurs) pour lui donner sens et guider l’action. Le même nœud à l’estomac devient faim, anxiété, dégoût ou désir selon le contexte culturel et situationnel. Quand l’autrice, par exemple, confond un début de grippe avec un coup de foudre lors d’un rendez‑vous, son cerveau construit une authentique attraction à partir de fièvre et de papillons gastriques ; ce n’est pas une erreur, mais le fonctionnement normal de la simulation.
Ainsi naît la théorie de la construction des émotions : à chaque instant, le cerveau utilise ses concepts émotionnels – appris dans une société donnée – pour fabriquer sur mesure une instance de peur, de joie ou de colère. Il n’existe ni « empreinte » corporelle, ni circuit dédié ; variation et dégénérescence neuronale sont la règle.
Autrement dit : les émotions relèvent d’une réalité sociale comparable à la distinction culturelle entre muffin et cupcake : mêmes ingrédients, fonctions différentes !
L. F. Barrett inscrit cette approche dans la tradition « constructionniste » : sociale (rôle des normes collectives), psychologique (combinaison de composants mentaux basiques) et neurobiologique (plasticité qui câble le cerveau selon l’expérience). Elle remplace donc les notions de « détection », « expression faciale » ou « réaction émotionnelle » par un vocabulaire neutre : configuration faciale, perception, instance d’émotion.
En conclusion, l’autrice affirme que nous ne sommes pas les jouets de circuits archaïques ; nous sommes les architectes de nos expériences affectives. Comprendre cette construction invisible ouvre la voie à repenser la psychologie, la santé, l’éducation et nos interactions quotidiennes.
Le mythe des émotions universelles
Lisa Feldman Barrett démontre que la perception des émotions dépend d’abord de concepts appris, et non "d’expressions" universelles programmées dans le visage.
Elle prend l’exemple de Serena Williams : hors contexte, beaucoup voient dans sa mimique un hurlement de terreur ; sitôt qu’ils apprennent qu’elle vient de remporter la finale de l’US Open 2008, la même configuration faciale devient un cri de triomphe. Le cerveau applique donc, à la volée, les concepts appropriés (ici peur puis victoire) pour simuler la signification des traits qu’il observe.
Pour tester ce rôle des concepts, la psychologue revisite la méthode classique dite “basic emotion method” (la méthode des émotions de base) : un acteur prend six poses stéréotypées (sourire, froncement, moue, etc.) et le participant choisit parmi six mots (joie, colère, tristesse, etc.). Dans le monde entier, la correspondance dépasse 80 % – mais ce succès reflète le choix forcé qui fait office d’antisèche et influence les sujets avec les mots‑concepts.
Dès que l’on retire cette liste, la performance chute (≈ 60 %). Si l’on présente simplement deux photos et qu’on demande « Ces personnes ressentent‑elles la même chose ? », l’accord tombe à ≈ 40 %. Mieux : en faisant répéter “anger, anger, anger” jusqu’à vider le mot de son sens, ou en testant des patients atteints de démence sémantique, la reconnaissance s’effondre encore ; les sujets ne discernent plus que du plaisant versus du déplaisant. Les jeunes enfants, avant de maîtriser des concepts émotionnels différenciés, montrent le même schéma.
La psychologue poursuit ses recherches en Namibie auprès des Himba, peuple quasi coupé des codes occidentaux : au lieu de répartir 36 photos en six piles “colère”, “tristesse”… ils créent une pile « rire » et une pile « regarder » ; le reste se mélange selon des critères comportementaux, preuve que leurs concepts n’indexent pas les poses “universelles”. Une équipe concurrente semblait avoir trouvé l’inverse ; Barrett révèle que ces chercheurs ont, en amont, enseigné les mots‑concepts anglais aux participants et les ont fait apprendre par essais‑erreurs, recréant ainsi artificiellement l’illusion d’universalité.
À ce jour, seul le sourire (ou le rire) paraît traverser les cultures, mais même son statut d’expression innée reste douteux : l’Antiquité gréco‑romaine n’associait pas la joie au sourire, apparu socialement au Moyen Âge puis popularisé avec la dentisterie moderne.
En réalité, conclut l’autrice, les innombrables études vantant des “expressions basiques” mesurent surtout la puissance des mots (sur laquelle jouent si bien la publicité et le copywriting) et des stéréotypes occidentaux à orienter la perception.
Comprendre que l’on construit les émotions des autres – comme celles que l’on ressent soi‑même – évite des erreurs coûteuses : qu’il s’agisse d’interpréter une photo de campagne électorale, de mener des négociations internationales ou de concevoir des algorithmes de “lecture des émotions” !
Cette remise en cause ouvre un nouveau programme scientifique : plutôt que chercher d’hypothétiques empreintes universelles, il s’agit d’étudier comment les visages et les corps varient réellement selon les contextes et quelles fonctions jouent les concepts émotionnels dans nos cultures.
L’origine des sentiments
Lisa Feldman Barrett explique que le cerveau, loin d’être un simple récepteur de stimuli, prédit en continu ce qui va se passer : il « simule » le monde et, surtout, l’état interne du corps. Cette activité prédictive permanente sert à gérer le budget énergétique de l’organisme : anticiper battements cardiaques, respiration, glucose, cortisol, etc.
Deux grands ensembles neuronaux s’en occupent :
Les régions gestionnaires (qui dépensent ou rechargent l’énergie) ;
Le cortex intéroceptif primaire (qui représente les sensations internes).
Ensemble, ils forment le réseau intéroceptif, centre névralgique de la survie… et socle des émotions. Les prédictions intéroceptives fabriquent des sensations simples de bien‑être ou de malaise, de calme ou d’agitation : c’est l’affect, qui colore chaque instant de la vie. Quand la source de l’affect reste floue, le cerveau le traite comme une information sur le monde ; on parle de réalisme affectif.
Par exemple, la neuroscientifique rapporte des études montrant que des juges affamés refusent davantage de libérations conditionnelles, et qu'un soldat qui a faim peut confondre un appareil photo avec une arme.
Cette influence corporelle est si puissante que les régions du cerveau chargées de la gestion du budget énergétique inondent tout le cortex de leurs prédictions ; perception, décision et action deviennent indissociables de l’état physiologique. Autrement dit, le mythe de l’acteur rationnel et celui du cerveau triunique (couches reptilienne, limbique, corticale) s’écroulent : raison et émotion ne s’opposent pas, elles s’entrelacent au niveau métabolique.
Mal gérer son budget énergétique (stress chronique, manque de sommeil) déséquilibre l’affect ; cultiver de bonnes habitudes (repos, relations chaleureuses, alimentation saine) le rééquilibre. Des stimulations cérébrales profondes montrent même qu’en modulant le réseau intéroceptif, on peut soulager une dépression sévère en temps réel.
En bref, l’autrice affirme que « croire, c’est ressentir » : nos prédictions façonnent à la fois ce que nous voyons, pensons et éprouvons. Comprendre ce mécanisme, c’est reprendre la main : nous sommes les architectes, non les victimes, de nos expériences affectives et émotionnelles !
]]>Résumé de "Apprendre l'optimisme. Le pouvoir de la confiance en soi et en la vie" de Martin Seligman : le père de la psychologie positive révèle ici tous les secrets d'une vie épanouie et joyeuse — un ouvrage classique rempli de références scientifiques et de ressources pratiques pour vous aider à transformer la perception que vous avez de votre propre existence.
Par Martin Seligman, 2008, 378 pages.
Titre original : Learned Optimism (1990).
Chronique et résumé de "Apprendre l'optimisme. Le pouvoir de la confiance en soi et en la vie" de Martin Seligman
Partie I. En route vers une vision de la vie : qui frappe à votre porte ? Ami ou ennemi ? Une prise de conscience
1 — Tout va bien ! Rien ne va plus ! Une question de regard sur la vie ?
Un père observe sa fille endormie dans son berceau et s’inquiète de son manque de réaction aux bruits. Il pense qu’elle est sourde. La mère lui explique que l’enfant est encore en train de se développer. Le pédiatre finit par rassurer le père après un test. Que se passe-t-il ?
Ce récit montre deux attitudes différentes face aux difficultés. Le père imagine toujours le pire et se laisse envahir par la peur. La mère, quant à elle, reste sereine et voit les événements comme temporaires. Chacun réagit selon son style de pensée (appelé aussi "mode d'explication").
Les études scientifiques citées dans l'ouvrage démontrent que les pessimistes se découragent rapidement. Ils voient l’échec comme définitif et se blâment eux-mêmes. Les optimistes, pour leur part, considèrent les revers comme passagers. Ils réussissent mieux à l’école, au travail et dans leur vie sociale.
La psychologie moderne explique ces différences par le contrôle personnel. Les pessimistes se sentent impuissants et s’enferment dans leur malheur. Les optimistes, en revanche, se sentent capables d’agir et de changer les choses. Ce contrôle personnel joue un rôle crucial dans la réussite et la santé.
Martin Seligman remet en question les théories traditionnelles de la dépression. La dépression est ici conçue non pas comme une fatalité, mais comme le résultat d’interprétations négatives des événements. Grâce à cet ouvrage, vous allez découvrir qu’il est possible d’apprendre à penser autrement.
En fait, des compétences cognitives permettent de transformer la douleur en énergie positive. C'est la "science de l’optimisme" proposée par le célèbre psychologue. Celle-ci montre que chacun peut changer son mode de pensée. Les pessimistes peuvent apprendre à modifier leur manière d’interpréter les échecs. Ils peuvent ainsi réduire leur sentiment d’impuissance et améliorer leur bien-être.
2 — Se sentir impuissant, un sentiment qui n'est pas rare
À 13 ans, Martin Seligman comprend qu’un séjour chez son ami Jeffrey signifie un problème sérieux à la maison. Cette fois, son père, d’ordinaire solide et stable, semble troublé. Il s’effondre peu après, victime de plusieurs AVC, et devient physiquement et émotionnellement dépendant. Ce choc marque Seligman à vie.
Adolescent, il s’intéresse à Freud, séduit d’abord par la justesse apparente de ses interprétations. Mais avec le temps, il rejette ses méthodes et se tourne vers la psychologie expérimentale. À 21 ans, il rejoint le laboratoire de Richard Solomon, où il assiste à une scène inattendue : des chiens, incapables d’échapper à une décharge, finissent par abandonner, même lorsqu’une issue s’offre à eux.
Seligman comprend que ces chiens ont appris à être impuissants. Ce sera le point de départ de sa théorie de la learned helplessness (impuissance acquise). Avec Steven Maier, il conçoit des expériences prouvant que, lorsqu’un animal comprend qu’aucune action ne peut soulager sa souffrance, il cesse d’agir.
Ce constat remet en question le dogme du behaviorisme, qui exclut la pensée des causes du comportement. Seligman et Maier montrent que les attentes et croyances jouent un rôle décisif.
Ils découvrent aussi que cette impuissance peut être prévenue ou guérie. Chez l’humain, les expériences de Donald Hiroto le confirment : certaines personnes résistent à l’impuissance. Ce pouvoir d’agir face aux épreuves n’est pas inné, il peut s’apprendre. Pour le psychologue, cette découverte ouvre un espoir immense contre la dépression.
3 — Comment affrontez-vous la vie et ses vicissitudes ? Comment expliquez-vous ce qui vous arrive ?
En 1975, Martin Seligman présente sa théorie de l’impuissance apprise devant les plus grands chercheurs d’Oxford. Mais à la fin de sa conférence, un certain John Teasdale le met au défi : pourquoi certaines personnes deviennent-elles impuissantes et d’autres pas, même face aux mêmes épreuves ? Cette critique bouscule Seligman, qui décide de retravailler sa théorie.
Avec Teasdale, puis avec les chercheuses Lyn Abramson et Judy Garber, il élabore un concept clé : le style explicatif. Ce style correspond à la manière dont chacun interprète les causes des échecs et des réussites.
Trois dimensions le composent :
La permanence (est-ce que le problème durera ?) ;
La globalité (touche-t-il tous les aspects de ma vie ?) ;
La personnalisation (est-ce ma faute ou celle de facteurs extérieurs ?).
Les personnes optimistes pensent que les échecs sont temporaires, limités à un domaine précis, et ne remettent pas en cause leur valeur personnelle. À l’inverse, les pessimistes voient les problèmes comme durables, globaux et causés par leurs propres faiblesses. Ces croyances influencent profondément la santé mentale, la réussite et même l’immunité.
Seligman conçoit alors un test sur l'optimisme permettant de déterminer le style explicatif d’une personne. Les résultats révèlent à quel point l’individu est susceptible de développer un état de découragement, voire de dépression.
Bonne nouvelle 1 : ce style n’est pas figé. Grâce à certaines techniques, il est possible de transformer une vision pessimiste du monde en une perspective plus souple et pleine d’espoir.
Bonne nouvelle 2 : Vous pouvez réaliser ce test dans l'ouvrage (voir pages 49-57) !
4 — Degré de pessimisme, mélancolie et dépression
La dépression, selon Martin Seligman, est une version amplifiée du pessimisme. Étudier ses mécanismes permet de mieux comprendre les pensées négatives qui nous traversent lors d’un échec. Il distingue trois formes : la dépression normale (temporaire et courante), la dépression unipolaire (sans phase maniaque) et la dépression bipolaire (avec épisodes maniaques). Si cette dernière est clairement biologique et traitée par médicament, la majorité des cas unipolaires trouvent leur origine dans des problèmes de vie et une manière pessimiste de penser.
À travers de nombreuses études, Seligman montre que la dépression partage huit des neuf symptômes de l’impuissance apprise, dont :
Perte d’énergie ;
Repli ;
Troubles du sommeil ;
Manque d’intérêt ;
Pensées négatives ;
Etc.
Chez les humains comme chez les animaux, les individus exposés à des situations qu’ils ne peuvent pas contrôler cessent progressivement d’agir. Cette passivité se prolonge, même lorsque de nouvelles opportunités apparaissent.
Les chiffres sont alarmants. Deux grandes enquêtes ont révélé qu’au fil du siècle, les cas de dépression sévère ont été multipliés par dix, notamment chez les jeunes adultes. Et les premières dépressions frappent aujourd’hui dix ans plus tôt qu’avant.
La cause ? Seligman avance que notre manière d’expliquer les échecs joue un rôle déterminant. Si l’on pense que nos actions sont vaines, on se condamne à l’impuissance. À l’inverse, ceux qui croient que leurs efforts peuvent changer les choses restent actifs. Cette idée ouvre une piste précieuse : en changeant notre style explicatif, on peut apprendre à résister à la dépression.
5 — Ce que je pense, je le ressens
Dans les années 1980, la compréhension et le traitement de la dépression évoluent radicalement grâce à deux pionniers : Albert Ellis et Aaron Beck. Ils montrent que la dépression n’est pas un trouble mystérieux, mais le fruit de pensées négatives conscientes et répétées. Leur approche, connue sous le nom de thérapie cognitive, repose sur un postulat simple : changer la manière dont on explique ses échecs permet de sortir de la dépression.
Selon Martin Seligman, la combinaison d’un style explicatif pessimiste (causes internes, permanentes et globales) et de la rumination (rejouer sans cesse les pensées négatives) est le terreau de la dépression. À l’inverse, les optimistes ou les personnes orientées vers l’action résistent mieux aux coups durs.
La thérapie cognitive aide les patients à identifier leurs pensées automatiques, les remettre en question, les remplacer par des pensées plus nuancées, et à interrompre la rumination. Contrairement aux antidépresseurs, qui soulagent temporairement, cette méthode permet une transformation durable du mode de pensée, réduisant les risques de rechute.
"Après un échec, chacun éprouve des sentiments passagers d'impuissance. On sombre dans la tristesse, l'énergie physique fait défaut, l'avenir est sombre et fournir le moindre effort présente des difficultés insurmontables. Certains récupèrent presque immédiatement et voient tous leurs symptômes d'impuissance acquise se dissiper en l'espace de quelques heures. D'autres, au contraire, restent dans un état d'impuissance pendant des semaines ou, si l'échec est grave, des mois, voire plus longtemps." (Apprendre l'optimisme, Chapitre 5)
Des études confirment que le pessimisme précède et prédit la dépression, y compris chez les enfants. L’épidémie actuelle touche particulièrement les femmes, en partie parce qu’elles ont tendance à ruminer davantage que les hommes.
Seligman conclut que, tout comme on peut changer son corps, on peut rééduquer son esprit. La dépression n’est pas une fatalité, et la clé du changement repose sur la capacité à modifier notre dialogue intérieur.
]]>Résumé de "Petit manuel de philosophie à l'intention des grands émotifs" de Llaria Gaspari : un livre accueillant et attachant pour comprendre quelles sont nos émotions, qui nous sommes et mieux agir au quotidien en acceptant nos sentiments et toutes ces bizarreries qui font que nous sommes tous humains.
Par Llaria Gaspari, 2023, 243 pages.
Titre original : Vita segreta delle emozioni (2021).
Chronique et résumé de "Petit manuel de philosophie à l'intention des grands émotifs" de Llaria Gaspari
Qui est Llaria Gaspari ?
Llaria Gaspari est une philosophe et écrivaine italienne, née en 1986 à Milan. Après avoir étudié la philosophie à l’École normale supérieure de Pise, elle poursuit ses recherches à l’Université Panthéon-Sorbonne de Paris, où elle se spécialise dans l’étude des passions et de la pensée du XVIᵉ siècle. Cette formation académique rigoureuse se retrouve dans son œuvre, qui mêle habilement réflexion philosophique et exploration des émotions humaines.
Son premier roman, Etica dell'acquario (2015), marque l’entrée de Llaria Gaspari dans le monde littéraire. Ce livre allie philosophie et intrigue policière, une combinaison originale qui interroge les rapports entre éthique et comportement humain. Elle enchaîne avec Lezioni di felicità (2019), une œuvre où elle aborde la quête du bonheur avec une perspective humoristique et une analyse philosophique fine, tout en plaçant l’humain au cœur de ses réflexions. En 2021, dans Vita segreta delle emozioni, elle s’intéresse davantage aux émotions, leur influence sur nos vies et comment elles façonnent notre existence.
Loin d'être une simple réflexion académique, son écriture se veut accessible à tous, cherchant à établir un lien entre la philosophie et les préoccupations quotidiennes. Son dernier ouvrage, Petit manuel philosophique à l'intention des grands émotifs (2022), traduit parfaitement cette démarche. Elle y explore les subtilités des émotions humaines et offre des clés pour comprendre et apprivoiser ses propres sentiments dans un monde de plus en plus complexe.
Aujourd'hui, Llaria Gaspari divise son temps entre Rome et Paris, où elle enseigne la philosophie et l'écriture créative, tout en continuant à publier des ouvrages qui interpellent et nourrissent la réflexion des lecteurs modernes.
Nostalgie - L'émotion au passé morbide
"Le passé est une terre étrangère : on y fait les choses autrement qu’ici." (Leslie P. Hartley, citée dans Petit manuel philosophique à l'intention des grands émotifs)
Le terme "nostalgie" trouve son origine dans un contexte médical. Johannes Hofer, un médecin alsacien, l'utilise pour décrire une pathologie chez des jeunes soldats suisses qui, après avoir quitté leur patrie, développent une tristesse liée à leur éloignement. La nostalgie, un désir ardent de retour chez soi, est différente du simple mal du pays. Le terme implique un désir inaccessibile, un souhait de retour dénué de possibilité, une souffrance émotionnelle liée à l'impossibilité de revenir.
L'autrice évoque une période de sa jeunesse lorsqu'elle se rend en Allemagne pour poursuivre ses études. Au début de son séjour, elle fait l'expérience de la solitude ; un mois passé sans interaction, où seule la compagnie d'un étudiant coréen lui permet de sortir de l'isolement. Ce mois d'attente, au milieu de paysages monotones et d'un quotidien ennuyeux, fait naître en elle un fort désir de retour, un besoin désespéré de retrouver sa maison et ses proches. Cet appel du passé est pour elle une forme de nostalgie, qu'elle décrit comme une émotion déchirante et réconfortante à la fois.
Malgré ses difficultés initiales, Llaria Gaspari finit par s'adapter à la vie allemande, par apprendre la langue et par trouver une forme de bonheur. Cependant, l'ombre de cette nostalgie, liée au désir de retourner chez elle, ne la quitte jamais complètement. Elle se souvient de ses soirées solitaires, pleurant sur la mer et la distance. Ces moments d'isolement sont devenus pour elle une référence de la nostalgie pure, une souffrance qui rend tout souvenir encore plus précieux.
Llaria Gaspari établit un lien entre la nostalgie et les mythes antiques, en particulier celui d'Ulysse, dont le désir de retourner chez lui, à Ithaque, est une figure de la nostalgie par excellence. Même sur une île enchantée, entouré de confort et d'immortalité avec la nymphe Calypso, Ulysse ressent une douleur profonde, un besoin irrésistible de revenir à sa terre natale. Cette idée de la nostalgie comme une quête impossible mais nécessaire pour l'intégrité humaine est au cœur de la réflexion sur cette émotion.
La nostalgie est une maladie à la fois moderne et ancienne. Elle existe depuis longtemps et a été explorée par des écrivains et des philosophes à travers l'histoire. Elle peut être une souffrance intime, incommunicable, car chacun la vit différemment.
Regret et remords, ou : j'avoue que j'ai vécu
Llaria Gaspari évoque ensuite son trouble neurologique, l’amusie, qui l'empêche de pleinement ressentir la musique. Ce handicap influence son lien avec les mots et la poésie. Son désir de comprendre la musique se heurte à cette incapacité de saisir et de mémoriser les mélodies.
Elle raconte aussi un souvenir d'enfance où, à 9 ans, elle apprend un poème de Giuseppe Ungaretti sur Mohammed Scheab, un jeune homme solitaire et apatride. Ce poème, qu'elle mémorise, évoque des thèmes de solitude, de regret et de perte, des émotions qu'elle commence à comprendre avec le temps.
Le regret, selon la philosophe, est une émotion liée à la prise de conscience du temps qui passe et des occasions perdues. Il diffère de la nostalgie, qui est associée à la perte de lieux, tandis que le regret concerne les choix manqués et les erreurs commises.
Pour ressentir le regret pleinement, il faut avoir vécu et avoir perdu, car cette émotion naît de la confrontation avec des décisions non prises et les conséquences des choix passés. Le regret, contrairement au remords, est lié à l'acceptation de la perte, alors que le remords reflète la volonté de réparer une faute.
Llaria Gaspari explique comment le regret se transforme à mesure qu'on vieillit, et comment la jeunesse, protégée par son insouciance, ignore cette douleur. Elle raconte une expérience personnelle d'enfance où elle pleure dans le confessionnal, mais sans encore éprouver de remords, ce qui lui semble étrange aujourd'hui.
Elle illustre son propos avec l'exemple de son dernier amour perdu, où le regret de ce qui n'a pas été vécu émerge. Llaria Gaspari reconnaît que la vie implique des choix qui se font au détriment d'autres possibles, et que le regret est une conséquence inévitable de ce processus.
Elle conclut en expliquant que la littérature, la philosophie et l'humanisme trouvent leur origine dans cette recherche de sens autour des émotions humaines universelles, telles que le regret et le remords. Ces émotions, bien que profondément intimes et solitaires, révèlent notre humanité partagée.
L'angoisse est une question
"L’homme ne sait pas se mesurer ; ses miroirs sont déformants ; Ses Arcadies les plus vertes pullulent de spectres, Ses utopies cherchent la jeunesse éternelle, Ou l’autodestruction." (H. W. Auden, cité dans Petit manuel philosophique à destination des grands émotifs)
Dans ce chapitre, Llaria Gaspari partage son expérience de l’angoisse, un trouble qu’elle vit depuis l’enfance et qui a profondément affecté sa vie, notamment son incapacité à passer l'examen du permis de conduire malgré plusieurs tentatives.
L’angoisse, pour elle, est un compagnon constant, et cette émotion s'est manifestée dès ses cinq ans sous la forme d’une douleur thoracique inexpliquée. Ce premier épisode marquera le début d’une relation intime et conflictuelle avec l’angoisse. L'autrice admet que cette émotion, bien qu'incommodante, lui a aussi permis de faire face à des situations difficiles.
Elle décrit comment l’angoisse se traduit physiquement par des symptômes comme la sensation d’étouffement et une peur intense sans objet précis. L’angoisse est différente de la peur, qui est une réaction immédiate à un danger réel. L’angoisse, elle, est diffuse, constante et envahit l’esprit, devenant un fardeau invisible que l’on porte constamment, tout en étant difficile à comprendre pour ceux qui ne la vivent pas.
Cette réalité est partagée par les héros tragiques comme Électre, qui, dans la tragédie de Sophocle, incarne parfaitement le poids de l’angoisse par ses lamentations incessantes et ses tourments intérieurs.
L'écrivaine fait également référence à d'autres symptômes tels que l’insomnie et les palpitations. Elle relie l’angoisse à un conflit intérieur. Le chœur d’Électre, par ses reproches, rappelle l’incompréhension sociale face à l’angoisse, une émotion qui reste souvent invisible et incomprise.
Llaria Gaspari continue en explorant les racines historiques de l'angoisse. Les anciens pensaient déjà que l’anxiété était liée à un excès d’imagination ou de mélancolie. À travers les siècles, l’angoisse a été traitée de différentes manières, depuis les remèdes antiques comme l’opium et la mandragore, jusqu'aux découvertes modernes en psychiatrie.
Freud, qui a reconnu l’angoisse comme un symptôme lié à des conflits inconscients, a souligné l’importance de comprendre et d’accepter ces émotions pour mieux les traiter. L’autrice lui rend hommage en soulignant que l’angoisse, bien que difficile à vivre, a aussi joué un rôle catalyseur dans sa vie, la poussant à écrire et à se confronter à ses propres peurs.
Elle finit par réfléchir à la manière dont la société moderne traite l’angoisse, souvent en cherchant à la supprimer plutôt qu’à l’écouter. Selon elle, il est crucial de prendre au sérieux cette émotion et de comprendre ce qu’elle cherche à nous dire. Il est capital, notamment, d'accepter notre propre imperfection et d’écouter notre anxiété pour mieux la comprendre, plutôt que de chercher immédiatement à la neutraliser.
Pour Llaria Gaspari, la véritable guérison passe par l'acceptation de cette émotion, en la transformant en un moyen de grandir et de mieux comprendre le monde. L'écriture devient ainsi un moyen d’exorciser l’angoisse, de lui donner une forme et une voix, pour mieux coexister avec elle et se réinventer.
Compassion, ou : se découvrir humains
La philosophe explore maintenant l'expérience de la compassion. C'est une émotion complexe qui n'est pas nécessairement altruiste. Pour illustrer sa pensée, elle raconte une nouvelle expérience personnelle vécue en 2016 lors d'un tremblement de terre en Italie, après lequel elle décide de donner son sang en signe de solidarité, alors que la vue du sang la bouleverse profondément.
Cette action est motivée par la proximité d’une tragédie, mais elle commence à se demander si son geste était vraiment empreint de compassion ou si c’était simplement une manière de se sentir impliquée sans comprendre véritablement la souffrance des autres…
Llaria Gaspari revient sur l’étymologie du mot "compassion", qui signifie "souffrir avec". Elle note que la souffrance semble plus facilement partagée que la joie, et se demande si cet acte d'ajouter sa propre douleur à celle d'autrui permet vraiment d’alléger la souffrance ou s'il s'agit plutôt d'une appropriation narcissique de la douleur d’un autre.
Cette réflexion la mène à une analyse plus profonde sur la nature de la compassion. Selon elle, celle-ci peut être une émotion égoïste qui cherche à se libérer de l'angoisse personnelle en projetant cette souffrance sur autrui.
L’autrice évoque aussi le philosophe Voltaire, qui, après le tremblement de terre de Lisbonne, critique l'optimisme théologique en questionnant la bonté d’un monde où de telles tragédies se produisent. Elle mentionne également Lucrèce, qui compare la compassion à l'observation d'un naufrage, soulignant combien il est facile de contempler la souffrance d’autrui sans y participer activement. La compassion, dans ce sens, est une réaction complexe et parfois paradoxale, entre détachement et implication.
Mais un tournant dans sa pensée se produit lorsqu'elle rencontre une jeune femme pendant un atelier d’écriture. Celle-ci garde une paire de chaussures qu'elle a portées lors de l'événement tragique. Cette image de la souffrance vécue en première personne la touche profondément. C'est à ce moment qu'elle ressent véritablement de la compassion, non comme un acte superflu ou égoïste, mais comme une reconnaissance sincère de la douleur de l'autre.
Elle conclut que la compassion, bien qu’elle ait des aspects difficiles et parfois égoïstes, est un moyen de reconnaître notre vulnérabilité commune. Elle cite Spinoza et d'autres philosophes pour montrer que cette émotion, loin d'être pure, est liée à la conscience de notre propre fragilité humaine, et qu’elle peut nous rapprocher de l’autre, dans un geste de solidarité véritable.
Antipathie, l'émotion inconfessable
"Nos expériences nous marquent ; nos antipathies nous précèdent." (Leo Longanesi, cité dans Petit manuel philosophique à l'intention des grands émotifs)
La notion d'antipathie est comparée à la façon dont les chiens interagissent entre eux. Lors de ses promenades avec son chien, elle observe comment les chiens se rencontrent, se reniflent et déterminent instantanément s'ils s'apprécient ou se détestent, sans aucune ambiguïté.
Ces rencontres canines, simples et directes, contrastent avec la complexité des relations humaines où l'antipathie, souvent perçue comme un défaut, est difficile à accepter. Elle souligne qu'en tant qu'humains, nous devons composer avec des émotions plus nuancées, comme la culpabilité, lorsque nous ressentons de l'antipathie envers quelqu'un, et que cette émotion est difficile à accepter ou à justifier.
L'autrice confesse qu'elle éprouve de l'antipathie envers certaines personnes, souvent dès la première rencontre, et qu'elle se sent coupable de ces jugements instantanés. Plutôt que de simplement accepter cette antipathie, elle tente de la réprimer en compensant par une gentillesse excessive, ce qui entraîne des déceptions.
Mais elle remarque que l'antipathie, lorsqu'elle est ignorée ou réprimée, peut devenir plus forte et contre-productive. Elle en vient alors à la conclusion qu'il est plus sain de reconnaître et d'accepter l'antipathie, sans chercher à la justifier ni à la réprimer. L'autrice plaide pour un rapport plus conscient avec cette émotion : il faut prendre le temps de comprendre pourquoi certaines personnes provoquent en nous de l'antipathie, sans chercher à se convaincre que c'est injustifié.
Elle s'appuie sur les travaux de Spinoza, qui affirme que les émotions ne se soumettent pas à la raison, et explique que l'antipathie est une émotion "naturelle", immédiate et instinctive. Llaria Gaspari cite également l'Encyclopédie, où d'Alembert parle de l'antipathie comme d'une "inimitié naturelle" et mentionne des exemples d'animaux ou de phénomènes naturels, comme l'aversion instinctive entre certains animaux.
Elle souligne que l'antipathie est souvent inévitable et qu'elle peut être projetée sur tout et tout le monde, indépendamment des actions ou comportements de l'autre.
L'autrice conclut que l'antipathie n'est pas nécessairement négative et peut être un moteur pour la fiction. Elle évoque la littérature, qui nous permet de vivre les antipathies sans conséquences sociales, en nous offrant une catharsis. Les personnages de romans, même antipathiques, sont une invitation à accepter cette émotion et à comprendre nos propres défauts humains.
Enfin, elle suggère que l'antipathie, loin de signifier un échec, peut nous enseigner à mieux comprendre la nature humaine et à accepter nos propres faiblesses sans chercher à les cacher. Accepter la possibilité de paraître antipathique est, selon elle, un signe de maturité, et elle l'attribue en partie à son expérience de l'écriture et de la littérature.
Colère funeste ou colère importune ?
Llaria Gaspari rappelle la célèbre colère d'Achille dans L'Iliade. Elle commence par la description de la colère comme premier mot de la littérature grecque, soulignant son rôle central dans le récit homérique. Achille, le héros de l’Iliade, incarne une colère primordiale qui se déclenche lorsqu’Agamemnon lui prend Briséis, son trésor de guerre et esclave préférée. Cette colère, démesurée et obstinée, refuse de se laisser dompter par la raison.
Pour Achille, sa rage est justifiée par l’honneur personnel. Il refuse de reprendre les armes, peu importe les conséquences. Cette « colère juste » relève d’une société antique fondée sur la honte, où l’honneur se gagne et se défend publiquement, à travers la reconnaissance des autres, et non par la culpabilité intérieure qui caractérise nos sociétés modernes.
L’autrice compare la colère d’Achille à d’autres exemples dans la littérature et la culture. Par exemple l'Ajax de Sophocle, qui incarne une rage incontrôlable et irrationnelle. Ajax, privé des armes d’Achille, sombre dans la folie et massacre un troupeau de brebis, croyant tuer ses ennemis. Sa colère le conduit à un acte irrationnel et grotesque, illustrant le côté destructeur de celle-ci quand elle se tourne en folie. Ce thème apparaît également dans la Bible, où même Dieu, dans l'Ancien Testament, est pris de colère.
L'expression moderne de la colère est différente. Freud, par exemple, analyse la colère à travers la statue de Moïse de Michel-Ange, soulignant l'effort intérieur de maîtriser cette émotion. Ce contrôle de soi est vu comme un combat pour ne pas laisser exploser la rage. C'est d'ailleurs un thème qui résonne dans la réflexion de Sénèque sur la colère et la manière de la réprimer dans sa philosophie stoïque.
En parallèle, l’autrice relate ses propres expériences de colère, montrant comment elle peine à l’exprimer de manière appropriée. Elle compare sa propre incapacité à se mettre en colère avec l’expérience d’Achille, soulignant sa difficulté à faire valoir ses droits et à se défendre face à l’injustice.
Elle décrit des situations où sa colère aurait été justifiée, comme face à des agressions sexuelles ou des comportements inappropriés, mais où elle a préféré la réprimer. Cela montre une difficulté profonde à accepter l’expression de la colère, souvent liée à la honte et à la peur du jugement social. Elle évoque un événement où, en défendant une amie accusée à tort, elle a finalement manifesté sa rage, mais de manière maladroite.
Llaria Gaspari conclut en se demandant si elle pourra un jour pleinement s'autoriser à exprimer sa colère. Elle reconnaît que sa tendance à réprimer cette émotion se fait au détriment de son bien-être. Elle se questionne sur sa propre incapacité à s'emporter et considère qu'elle est liée à un manque de confiance en elle et à une peur intérieure. Elle ajoute que la société réprime généralement davantage la colère des femmes que celle des hommes.
Envie : l'œil et le mauvais œil
L'écrivaine évoque son enfance, qui était marquée par une peur étrange et irrationnelle de l'envie, qu'elle associait à un malheur imminent. Aujourd'hui, elle note que cette crainte reproduisait l'histoire d'Andromède, enchaînée à un rocher par les dieux, après que sa mère se soit vantée de sa beauté.
De même, Llaria Gaspari, enfant, croyait que les compliments pouvaient attirer l'envie divine et avait créé une sorte de superstition autour de cette émotion. Sa peur de l'envie se manifestait par une réticence à accepter les compliments, qu'elle percevait comme une menace.
Bien qu'elle soit consciente de son propre comportement névrosé et superstitieux, elle explique que l'envie est souvent liée à un désir de nuire à autrui pour des raisons personnelles et inconscientes. Ce regard porté sur l'autre, parfois déguisé en admiration, doit être considéré avec méfiance. Dans La Belle au bois dormant, par exemple, la faute des parents de la princesse, qui négligent d'inviter la méchante fée, leur coûte cher.
Le mot envie provient du latin "invidere", signifiant "regarder avec animosité". Ce regard, rempli de désir et de haine, est comparé à une forme de magie, qui a le pouvoir de détruire par l'acte d'observer. D'ailleurs, ce concept se retrouve dans de nombreuses cultures sous la forme du "mauvais œil".
Elle souligne également que l'envie est l'opposée de la félicité : alors que la félicité est fertile, expansive et bienveillante, l'envie est asséchante et destructrice. Elle crée une souffrance gratuite chez l'envieux, qui se compare constamment aux autres et se voit comme une victime injustement exclue de certains privilèges. En outre, cette souffrance est inutile, car même si l'envieux obtenait ce qu'il désirait, il resterait insatisfait, pris dans un cycle d'auto-dénigrement et de ressentiment.
Mais quel est son propre rapport à l'envie ? Elle se souvient de son enfance, où elle se sentait différente, exclue des jeux et des plaisirs de ses camarades en raison de la manière dont elle avait été éduquée. Elle décrit un paradoxe dans sa vie : bien qu'elle ait été épargnée de nombreux désirs matérialistes, une part d'elle-même était secrètement envieuse.
Cette dualité, entre son orgueil et ses désirs réprimés, l'a conduite à ne pas comprendre l'envie chez les autres, mais aussi à rejeter l'idée de l'éprouver elle-même. C'est seulement en rencontrant les écrits de Melanie Klein, psychanalyste qui a étudié l'envie chez les enfants, qu'elle a pris conscience de l'aspect humain et universel de l'envie.
Klein explique que l'envie n'est pas un péché ou une défaillance, mais une émotion naturelle. Cette reconnaissance de l'envie comme une partie intégrante de l'expérience humaine permet à Llaria Gaspari de comprendre que l'envie est partagée par tous, y compris par ceux qui la refoulent ou la projettent. En grandissant, elle a appris que l'envie ne venait pas seulement de la comparaison, mais aussi du manque de confiance en soi, un aspect qui, paradoxalement, alimentait cette émotion.
Jalousie, paradoxe et supplice
"La mémoire est la tourmenteuse des jaloux." (Victor Hugo, cité dans Petit manuel philosophique à l'intention des grands émotifs)
Llaria Gaspari admet d’abord qu’elle a menti pendant des années en niant sa jalousie. Cette émotion, qu’elle réprouvait profondément, est pourtant au cœur de son récit. Lors d’une interview, elle évoque un souvenir d’enfance marquant : un caprice lié à sa fourrure rose, symbole de son désir d’être aimée et de son besoin de se faire remarquer.
Ce souvenir révèle un moment où elle a cherché à imposer sa volonté contre l’ordre des adultes, un comportement enfantin dicté par un orgueil démesuré, mais aussi par l’émotion de la jalousie, née du changement dans sa vie après la naissance de sa sœur.
Elle remarque que ce souvenir de la fourrure rose symbolise un sentiment de jalousie, un besoin d’attirer l’attention dans un contexte où l’autonomie et l’amour étaient désormais partagés avec sa sœur. Ce caprice, bien que comique et anodin, est perçu par l'autrice comme une réaction jalouse face à l’arrivée d'un rival, une forme de possession infantile et possessive.
La souffrance du jaloux est liée à une idée de l’insécurité et de l’incertitude quant à l’amour de l’autre. Elle cite le personnage d’Othello, dont la jalousie, exacerbée par les manipulations de Lago, le conduit à tuer sa femme, Desdémone, malgré son amour sincère. La jalousie, en effet, fait naître des doutes constants et des souffrances profondes, alimentées par des soupçons et des failles émotionnelles.
Cette émotion est souvent exacerbée par l’idée de la perte d’affection, ainsi que par la peur de l’abandon. Elle est alimentée par des fantasmes et des peurs irrationnelles.
Llaria Gaspari évoque aussi la "jalousie rétrospective", une forme de jalousie basée sur des spéculations sur le passé amoureux, nourrie par des doutes et des inquiétudes sans fondement concret.
Le philosophe Spinoza affirme que la vertu elle-même est une forme de béatitude, et que la véritable récompense ne réside pas dans l’attente d’une validation extérieure, mais dans l’acceptation des émotions humaines, y compris la jalousie.
La clé pour surmonter cette émotion est donc de la reconnaître, d’accepter nos faiblesses et de se tourner vers la gratitude et l’émerveillement, afin de s’ouvrir à une vie plus pleine et moins dominée par les passions négatives. La jalousie, comme d’autres émotions, est humaine et inévitable, mais elle ne doit pas définir notre relation à soi et aux autres.
Émerveillement, ici naît la philosophie
Llaria Gaspari se questionne sur l'impact de la technologie : amenuise-t-elle notre capacité à éprouver de l'émerveillement ? En grandissant dans les années 90, elle a vécu une époque où la communication était marquée par des surprises, comme les appels téléphoniques inattendus ou les photos argentiques qui prenaient plusieurs jours à être développées. Souvent, cette attente provoquait l'émerveillement.
Aujourd'hui, avec la domination des smartphones et des applications, ces moments de surprise se sont raréfiés. Les téléphones mobiles, par exemple, ont transformé la manière dont nous communiquons, au point que les appels impromptus sont presque devenus inexistants.
Ce changement a aussi engendré ce que l'on appelle la "ringxiety" (contraction de ring, sonner, et anxiety, angoisse), une angoisse d'entendre son téléphone sonner, même quand il est en mode silencieux !
Tout comme pour les appels téléphoniques, la photographie a évolué. À l'époque analogique, l'attente de découvrir les photos prises offrait un moment de surprise, où l’on découvrait des détails et des perspectives inconnues sur soi-même et les autres. Aujourd'hui, avec la photographie numérique, nous avons instantanément accès à l'image, sans surprise, et nous avons la possibilité de supprimer les photos qui ne nous conviennent pas.
Ce contrôle sur notre image nous éloigne également de l'émerveillement, car nous avons perdu la spontanéité du moment capturé. Les selfies, en particulier, montrent notre désir de maîtriser la perception qu'ont les autres de nous et d’éliminer tout ce qui pourrait être inattendu.
La technologie, en apportant des solutions pratiques et une immédiateté d'accès à l'information et à la communication, a donc modifié notre rapport à la surprise et à l'émerveillement. Toutefois, malgré ces changements, la capacité à s'émerveiller reste essentielle à notre bien-être et à notre développement intellectuel et émotionnel.
Elle évoque en particulier Descartes, qui considérait l'émerveillement comme la première des passions, celle qui pousse à la recherche et à la philosophie, et qui nourrit la curiosité humaine.
L’autrice cite également Aristote et Platon, pour qui l’émerveillement était la source de la philosophie, la force motrice de la quête de compréhension du monde. Cette notion est renforcée par Schopenhauer, qui souligne que seul l'homme, parmi tous les êtres vivants, éprouve une forme de stupeur face à sa propre existence, un processus qui mène à la réflexion métaphysique.
L'émerveillement est un retour à l'étonnement enfantin, un regard neuf sur le monde, et une ouverture à l'inconnu. Pour préserver l'émerveillement, il est crucial de rester vulnérable et ouvert à l'inattendu. L’émerveillement, loin d’être une naïveté, est un état essentiel pour la philosophie, la réflexion, et la vie elle-même.
« Bonheur atteint, par toi / On marche sur le fil d'une lame »
Llaria Gaspari raconte qu'elle a passé une nuit seule dans un hôtel de sa propre ville, un luxe qu'elle s'accorde rarement. Elle décrit ce moment comme un moyen de se retirer du monde et de réfléchir sur le bonheur.
Alors qu’elle écrit sur ce thème, elle se remémore la pandémie qui a paralysé le monde et éveillé en elle un sentiment de culpabilité, comme si penser au bonheur était égoïste en période de souffrance collective. Mais elle finit par se libérer de cette culpabilité et accepte l'idée que le bonheur n'est pas un privilège à expier mais une vocation humaine, une quête légitime.
Elle évoque le bonheur selon les Grecs. Ceux-ci le définissaient comme une vertu, une quête d’autonomie et de connaissance de soi. Le bonheur n'est pas un moment fugace mais un parcours qui inclut aussi les souffrances.
Elle cite Épicure et Socrate qui soulignaient que le bonheur demande de rester fidèle à soi-même, de ne pas se trahir, et de se connaître. Elle fait également référence aux travaux de Jean Rouch et Edgar Morin, qui en 1960 ont filmé des Parisiens en leur posant la question "Êtes-vous heureux ?", pour immortaliser un instant de bonheur.
Le bonheur, selon la philosophe, n'est pas un idéal abstrait ou un moment figé, mais une expérience qui se construit au fil du temps. Elle critique la tendance moderne à associer le bonheur à des moments parfaits et à les immortaliser sur les réseaux sociaux, soulignant que ce processus peut, en réalité, nous en éloigner.
Elle fait le parallèle avec sa propre enfance, où elle a cherché à capturer chaque instant parfait avec un appareil photo, mais où elle a également compris que les souvenirs ne sont pas simplement des images, mais des expériences vécues et ressenties profondément.
Llaria Gaspari conclut que le bonheur n’est pas un caprice ou une illusion, mais une forme de sagesse qui repose sur la compréhension de soi et de la vie. Elle souligne l'importance de vivre pleinement chaque moment, sans chercher à tout contrôler ni à le retenir, mais en appréciant ce que la vie a à offrir, y compris les moments de tristesse, car ils font aussi partie du voyage vers le bonheur.
Gratitude, la sensation d'être au monde
"Bienfaiteur : personne qui entreprend d’acquérir de grandes quantités d’ingratitude, sans se soucier réellement du prix, lequel reste néanmoins à la portée de chacun." (Ambrose Bierce, cité dans Petit manuel philosophique à l'intention des grands émotifs)
Durant son enfance, l'écrivaine avait un rêve : recevoir un chien en cadeau. Ce désir, inspiré d'une scène de La Belle et le Clochard, l'a poursuivi pendant des années. Puis, à sept ans, lors de vacances dans les Apennins, elle rencontre un chien errant qui la fascine. Il est soigné par son père, et, touchée par cette scène de bonté, elle espère l’adopter.
Mais, après un court moment de bonheur, le chien disparaît, et son rêve se brise. Les années passent, et bien que ses parents lui offrent d’autres animaux, le désir d’un chien reste intact. Cependant, elle se résigne progressivement à l’idée que ce rêve ne se réalisera jamais.
Beaucoup plus tard, elle décide de franchir le pas et d’adopter un chien. Avec l’aide de son fiancé, elle se rend dans un chenil à Rome, où elle rencontre un chien nommé Stanislao, un petit chien blond au regard triste. Ils l’adoptent, et le chien, bien qu’effrayé par le passé, commence à leur accorder sa confiance.
Touchée par ce chien maltraité, Llaria Gaspari comprend la différence entre le fantasme d’un chien idéal et la réalité d’une adoption pleine d’incertitudes et de peurs.
Rebaptisé Emilio, ce chien devient une métaphore de l’amour et de la gratitude. Au début, Emilio craint tout : les balais, les bruits, l’isolement. Mais peu à peu, il se laisse apprivoiser et, avec patience et amour, il développe une relation de confiance avec l’autrice et son fiancé. L’expérience lui enseigne à accepter l’amour sans réserve, à dépasser ses peurs et à accepter ce qu’il reçoit sans culpabilité.
Il n'est pas toujours facile d’accepter l’aide des autres et de reconnaître les bienfaits qu’on reçoit. Llaria Gaspari elle-même cesse peu à peu de se sentir indigne d’être aimée et apprend à recevoir sans culpabilité. Elle cite plusieurs philosophes pour souligner que la gratitude est la clé d’une relation authentique, basée sur l’échange, la reconnaissance mutuelle et la compréhension de soi-même.
Llaria Gaspari termine en affirmant que la gratitude et l’amour, bien que complexes et souvent entravés par des barrières intérieures, sont essentiels à l’épanouissement humain. Elle réalise que la véritable relation est celle qui se nourrit de confiance et d’acceptation.
L’amour véritable ne se mesure pas, ne se négocie pas, mais se vit pleinement.
Conclusion sur "Petit manuel de philosophie à l'intention des grands émotifs" de Llaria Gaspari :
Ce qu'il faut retenir de "Petit manuel de philosophie à l'intention des grands émotifs" de Llaria Gaspari :
Petit manuel philosophique à l’intention des grands émotifs de Llaria Gaspari est un véritable guide pour ceux qui cherchent à comprendre, maîtriser et apprécier la richesse des émotions humaines. Dans cet ouvrage, l’autrice nous invite à un voyage à la fois intellectuel et introspectif, en explorant avec finesse les concepts de la philosophie des émotions tout en apportant des réponses concrètes aux défis quotidiens que posent nos sentiments.
À travers des réflexions inspirées des grands penseurs de l’histoire, Llaria Gaspari aborde la complexité des émotions, telles que la tristesse, la joie, la colère ou l’angoisse, en les démystifiant et en les inscrivant dans un cadre philosophique accessible. Ce manuel se distingue par sa capacité à rendre les idées philosophiques à la fois claires et appliquées, tout en utilisant des exemples simples tirés de la vie quotidienne pour illustrer ses propos.
La philosophe nous propose des outils pour mieux gérer nos sentiments et les intégrer de manière constructive dans nos vies. Elle nous pousse à cultiver une forme de sagesse émotionnelle, qui permet de mieux comprendre nos réactions et d’apprendre à vivre avec elles de façon harmonieuse.
Bref, ce livre est donc un véritable petit trésor pour ceux et celles qui souhaitent allier philosophie et développement personnel. Que vous soyez en quête de sérénité, de compréhension ou simplement d’un éclairage philosophique sur vos émotions, Petit manuel philosophique à l’intention des grands émotifs est une lecture indispensable.
Avec son style clair et engageant, il permet à chacun de mieux se connaître et de naviguer avec plus de sagesse dans le monde des émotions. Un ouvrage à mettre absolument entre les mains de tous ceux et celles qui souhaitent vivre plus pleinement et sereinement !
Points forts :
Llaria Gaspari explique des concepts philosophiques complexes de manière simple et claire ;
Le livre offre des outils pratiques pour mieux comprendre et gérer ses émotions ;
Il encourage une gestion sage des émotions pour vivre plus harmonieusement ;
Le livre est fluide et facile à lire, même pour ceux qui ne sont pas familiers avec la philosophie.
Points faibles :
Petit manuel philosophique à l'intention des grands émotifs est un très beau livre. Je n’ai pas trouvé de défauts !
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu le livre de Fabien Olicard « Votre attention est votre superpouvoir » ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Fabien Olicard « Votre attention est votre superpouvoir ».
Visitez Amazon afin d’acheter le livre de Fabien Olicard « Votre attention est votre superpouvoir ».
 ]]>
]]>Résumé de "Au cœur de l'esprit critique : Petit guide pour déjouer les manipulations" de Séverine Falkowicz (avec Clément Naveilhan et Mr ContraDico) : un manuel adapté à l'ère numérique pour apprendre à repérer les mensonges et autres fake news afin de ne pas se laisser berner bêtement et de naviguer avec plus d'aisance dans l'océan informationnel.
Par Séverine Falkowicz (avec Clément Naveilhan et Mr ContraDico), 2023, 269 pages.
Chronique et résumé de "Au cœur de l'esprit critique : Petit guide pour déjouer les manipulations" de Séverine Falkowicz (avec Clément Naveilhan et Mr ContraDico)
Chapitre 1 — Avez-vous dit zététique ?
À l'origine, un intérêt pour le paranormal
Étymologiquement, le terme zététique vient de zetetikos (en grec), c'est-à-dire "qui aime chercher". Pour le dire en deux — ou plutôt quatre — mots : c'est "l'art du doute". En tant que discipline ou "art", la zététique se propose de mettre à disposition un ensemble de "techniques efficaces" afin d'assurer votre "autodéfense intellectuelle".
Bien entendu, il ne s'agit pas de tout mettre en question, mais d'apprendre comment douter ET comment s'assurer de sources fiables en lesquelles avoir confiance.
La zététique a fait ses débuts avec les phénomènes paranormaux et s'étend aujourd'hui à l'étude des "pseudosciences" — ces disciplines qui ont l'air d'être des sciences, mais qui échouent à en satisfaire les exigences — et même des croyances familières ou des thérapies étranges dans le domaine de la médecine et de l'alimentation.
Une démarche basée sur le doute raisonnable
Deux éléments clés de la démarche zététique sont :
Le doute ;
La vérification des informations.
Démarche dite rationnelle (appuyée sur la logique), la zététique s'intéresse aux faits, qu'elle distingue des croyances. Les faits sont établis à partir d'une méthode scientifique.
La méthode expérimentale, qui est très importante en science, est fondée sur un principe de falsification : il s'agit de rechercher des arguments qui invalident notre hypothèse de départ.
Une chose à retenir : la frontière entre croyances et faits n'est pas définitive. Ce que nous tenons aujourd'hui pour vrai peut se révéler, à l'étude, être une croyance (c'est-à-dire infondé du point de vue scientifique).
Développer son esprit critique
Selon le sociologue Gérald Bronner :
"Nous pouvons (...) définir l'esprit critique comme la capacité à faire confiance à bon escient, après évaluation de la qualité des informations, opinions, connaissances à notre disposition, y compris les nôtres." (Commission Bronner, 2022, cité dans Au cœur de l'esprit critique, p. 13)
Il est question d'apprendre à s'approprier correctement nos savoirs et à les utiliser avec justesse. Ce qui n'est pas facile, car nous avons des biais (nous y reviendrons) et que nous évoluons dans des environnements — notamment numériques — qui nous incitent parfois à l'erreur.
La zététique nous aidera à séparer le bon grain de l'ivraie, à la fois en nous et en dehors de nous. Et elle le fera à la fois pour nous aider à être plus intelligents (plus "critiques", donc) et pour aider les autres, lorsque cela est nécessaire.
]]>Résumé de "Les Philo-cognitifs. Ils n'aiment que penser et penser autrement…" de Fanny Nusbaum, Olivier Revol et Dominic Sappey-Marinier : un livre tout à fait original pour voir ce qui se cache sous le concept trop général de "haut potentiel" et découvrir toute la singularité des personnes qui aiment — non, adorent ! — se remuer les méninges.
Par Fanny Nusbaum, en collaboration avec Olivier Revol et Dominic Sappey-Marinier, 2019, 204 pages.
Chronique et résumé de "Les Philo-cognitifs. Ils n'aiment que penser et penser autrement…" de Fanny Nusbaum, Olivier Revol et Dominic Sappey-Marinier
Avant-propos
Trois experts – une psychologue, un enseignant-chercheur et un médecin – explorent ensemble le haut potentiel intellectuel. Leur parcours, entre expériences personnelles et recherches scientifiques, les conduit à analyser les mécanismes neurologiques et affectifs des personnes surdouées. Après des années d’échanges et de collaborations, ils proposent une typologie des profils atypiques et insistent sur l’importance d’une neuro-éducation adaptée.
Leur approche, loin d’être figée, évolue grâce aux contributions des patients et aux avancées en neurosciences. Si la plupart des philo-cognitifs trouvent des stratégies d’adaptation, d’autres rencontrent des difficultés affectives et cognitives qui justifient un accompagnement spécifique.
L’objectif de ce livre est de transformer les obstacles en tremplins, dans une dynamique de psychologie positive. Inspirés par l’image de l’albatros de Baudelaire, les auteurs proposent une lecture optimiste du haut potentiel, perçu non comme un fardeau, mais comme un levier de réussite et d’épanouissement !
CHAPITRE PREMIER - Du haut potentiel à la philo-cognition
Les mots pour les dire...
"Philo-cognitif : c’est donc le terme que nous avons choisi pour qualifier ces individus atypiques. On commence à les considérer depuis peu de temps : une cinquantaine d’années, c’est très peu dans l’histoire de l’humanité ; et dans ce laps de temps, on n’a cessé de tâtonner pour les définir." (Les Philo-cognitifs, Chapitre 1)
Les enfants à haut potentiel présentent des aptitudes intellectuelles avancées, mais avec des différences selon les domaines et parfois une dyssynchronie entre raisonnement et gestion émotionnelle. Ils partagent souvent un humour vif, une rapidité d’apprentissage, une intolérance à l’injustice et des difficultés sociales.
Cependant, ces descriptions restent trop générales pour définir précisément le phénomène. La question de son existence réelle se pose, d’autant plus que ses caractéristiques sont larges et parfois floues. Sans classification claire, le risque d’un effet Barnum persiste, rendant difficile l’identification objective du haut potentiel.
Surdon, précocité, haut potentiel...
Le haut potentiel intellectuel souffre d’un manque de définition claire et d’une terminologie fluctuante selon les époques et cultures. Les termes surdoué, précoce et haut potentiel présentent tous des limites.
« Surdoué » implique une performance exceptionnelle dans un domaine précis, souvent associée à un don inné, alors que certaines réussites résultent davantage d’un entraînement intensif et d’un environnement propice.
« Précoce » suggère une avance cognitive temporaire, alors qu’il s’agit plutôt d’une qualité durable du fonctionnement cérébral.
Quant à l’analogie avec les zèbres, elle ne reflète pas la diversité des profils et ne repose sur aucune base scientifique.
Le terme haut potentiel semble le plus approprié mais reste imprécis. Il sous-entend une intelligence en sommeil nécessitant une transformation pour s’exprimer pleinement, ce qui ne correspond pas toujours à la réalité. Certains individus à haut potentiel rencontrent des obstacles qui limitent leur expression intellectuelle, tandis que d’autres possèdent une intelligence déjà optimisée.
De plus, une intelligence supérieure ne garantit pas forcément de meilleures performances. Le concept manque encore de critères stabilisés et ne permet pas une classification homogène des individus concernés. Cette imprécision rend difficile un consensus sur la manière de définir et d’accompagner ces profils atypiques.
L'arbitrage de la science
L’étude scientifique du haut potentiel intellectuel est récente, rendant sa définition et sa mesure complexes. Les statistiques varient selon les critères d’observation : la prévalence oscille entre 1,5 % et 3 %, avec des biais de recrutement importants.
Des idées reçues persistent, comme une prépondérance masculine ou un taux élevé d’échec scolaire, bien que ces chiffres manquent de fiabilité. Les échantillons étudiés regroupent des profils hétérogènes, issus de milieux divers (associations, consultations cliniques, compétitions intellectuelles).
Ces limites méthodologiques compliquent l’identification d’un modèle unifié du haut potentiel, laissant encore place à de nombreux questionnements.
Trois caractéristiques majeures pour une façon de penser singulière
✔️ Je suis, donc je pense : l'hyperspéculation
Les individus à haut potentiel partagent un besoin irrépressible de penser, nommé hyperspéculation. Cette réflexion compulsive pousse à analyser, questionner et extrapoler, refusant les explications simplistes. Certains orientent leur pensée vers des objectifs précis, tandis que d'autres « pensent pour penser ».
Ce processus inclut un hypercontrôle, qui vise à maîtriser l’incertitude par l’analyse et la planification. Sur le plan neurologique, ces fonctions s’appuient sur le réseau exécutif, impliquant le cortex préfrontal dorso-latéral et le cortex pariétal postérieur, zones essentielles au raisonnement, à la mémoire de travail et à la régulation cognitive.
✔️ Comme un sixième sens : l'hyperacuité
Les individus à haut potentiel présentent une hyperacuité sensorielle, émotionnelle et proprioceptive. Leur hypersensibilité émotionnelle leur permet de détecter finement les émotions, mais peut aussi entraîner une surcharge affective. Leur hypersensorialité amplifie la perception des stimuli, rendant l’analyse fine mais parfois envahissante.
Leur hyperproprioception affine la perception corporelle, mais peut compliquer l’ajustement moteur. Ces caractéristiques s’appuient sur le réseau de la saillance, impliquant l’insula, l’amygdale et le cortex cingulaire antérieur, jouant un rôle clé dans la gestion des émotions, de l’attention et de la perception, influençant leur rapport au monde.
✔️ Un réassemblage permanent des idées : l'hyperlatence
Les individus à haut potentiel présentent une hyperlatence, c'est-à-dire un traitement inconscient intensif de l’information basé sur une pensée analogique en arborescences. Ce processus favorise l’apprentissage, la créativité et la résolution de problèmes, mais peut aussi conduire à une rumination mentale lorsqu’aucune cohérence n’émerge.
Ce mode de pensée repose sur le réseau par défaut, actif au repos, impliquant le cortex préfrontal médian, le cortex cingulaire postérieur et les jonctions temporo-pariétales. Ce réseau gère la mémoire, l’introspection et la régulation émotionnelle, jouant un rôle clé dans la conscience réflexive et la conceptualisation, mais aussi dans la vulnérabilité au stress et aux pensées envahissantes.
Trois fois mieux !
Les philo-cognitifs possèdent une connectivité cérébrale supérieure : ils traitent l'information de manière particulièrement rapide et efficace. Cette connectivité accrue, interhémisphérique et intra-hémisphérique, suggère une supériorité cognitive globale plutôt que spécifique.
Trois réseaux cérébraux majeurs sous-tendent ces capacités :
Le réseau par défaut (introspection et mémoire) ;
Le réseau exécutif (raisonnement et contrôle cognitif) ;
Le réseau de la saillance (gestion des émotions et de l’attention).
L’IRM fonctionnelle révèle une activité accrue dans ces régions, confirmant une organisation cérébrale optimisée pour la compréhension, l’apprentissage et la régulation cognitive et émotionnelle.
Comment appeler ces penseurs atypiques ?
Faisons donc un premier point. Le terme philo-cognitif désigne un individu animé par un besoin intense de penser, structuré autour de trois processus :
Hyperspéculation (raisonnement compulsif) ;
Hyperacuité (sensibilité exacerbée) ;
Hyperlatence (pensée analogique automatique).
Hyperlatence (pensée analogique automatique). Ce profil ne signifie pas forcément une compétence exceptionnelle mais une capacité accrue à collecter, analyser et intégrer les informations. La réflexion philosophique et l’extrapolation constante sont centrales, au point de ressembler à une addiction cognitive. Ce fonctionnement, souvent invisible, transforme chaque situation en source de questionnement, illustrant une pensée en mouvement permanent.
Les philo-cognitifs se posent des questions en permanence, souvent de manière inconsciente, transformant chaque détail en sujet de réflexion profonde. Leur pensée augmentée les pousse à remettre en question les évidences, mais peut aussi saturer leur raisonnement, entraver l’action et accentuer un besoin de contrôle.
Leur hyperconscience du monde les rend plus vulnérables au stress, au cynisme et à la somatisation, sans forcément atteindre un seuil pathologique. Cette complexité rend leur accompagnement difficile, car leurs difficultés sont diffuses et fluctuantes, rendant leur prise en charge moins évidente que celle de troubles clairement identifiés.
Les deux profils
Loin des stéréotypes, les philo-cognitifs présentent des profils variés. Deux types émergent : le profil complexe et le profil laminaire, différant par leur rapport au monde, à eux-mêmes et à leurs comportements.
Philo-complexe ou philo-laminaire ?
Les philo-laminaires possèdent une pensée fluide, structurée et cohérente, avec un QI homogène souvent supérieur à 140. À l’inverse, les philo-complexes ont une pensée fulgurante mais hétérogène, marquée par une dyssynchronie cognitive. Leur QI (120-135) montre de grandes disparités entre raisonnement élevé et vitesse de traitement plus faible.
Ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre...
Les philo-laminaires et philo-complexes appartiennent à la même famille, partageant une pensée spéculative et émotionnelle commune. Chaque philo-cognitif possède ces deux dimensions à des degrés variables, mais avec une dominante stable. Ce rapport peut évoluer au fil du temps sans jamais s’inverser complètement.
Le modèle de cognition de F. Nusbaum (Les Philo-cognitifs, Chapitre 1)
Les philo-cognitifs peuvent évoluer entre complexité et laminarité selon leur âge, contexte et expériences, mais conservent toujours une dominante initiale, qui s’accentue en situation d’insécurité. Un équilibre 50 % complexe / 50 % laminaire est rare, la plupart affichant un rapport moyen de 60 % / 40 %.
Les philo-complexes montrent une connectivité cérébrale prédominante à gauche, tandis que les philo-laminaires sont plus latéralisés à droite. Bien que ces profils puissent se moduler avec le temps, leur identité cognitive reste stable.
Vous voulez en savoir plus ? Les prochains chapitres décrivent ces profils sous une forme simplifiée.
CHAPITRE 2 - Ouvreurs de voies : Les philo-complexes
Les philo-complexes se distinguent par leur pensée fulgurante, leur créativité intense et leur sensibilité exacerbée, qui a tendance à rendre leurs interactions avec le monde souvent dissonantes. Leur énergie débordante, leur originalité et leur quête incessante de sens les rendent fascinants, mais parfois déconcertants…
Portrait chinois
]]>Résumé de "Braver sa nature sauvage" de Brené Brown : un livre sur l'appartenance et l'estime de soi par l'une des auteures de développement personnel les plus plébiscitées de ces dernières années — L'idée principale ? Ne changez rien, mais soyez enfin qui vous êtes !
Brené Brown, 2018, 162 pages.
Titre original : Braving the Wilderness (2017).
Chronique et résumé de "Braver sa nature sauvage" de Brené Brown
Chapitre 1 : Partout et nulle part
Quand Brené Brown écrit, la peur l’envahit. Elle doute de sa légitimité, surtout quand ses recherches bousculent les idées reçues. Elle se demande si elle a le droit de choquer ou de remettre en cause des croyances établies. Dans ces moments, elle s’entoure mentalement de figures courageuses qui l’inspirent.
Elle pense à J.K. Rowling, Bell Hooks, Shonda Rhimes, Oprah Winfrey, Maya Angelou. Ces voix l’aident à garder le cap, à ne pas céder à la peur ou à l’autocensure. Brené Brown rejette aujourd’hui l’ancienne méthode consistant à satisfaire les critiques et les cyniques. Cette approche étouffait son authenticité.
Son lien avec Maya Angelou reste profond. La poétesse la guide depuis ses années universitaires. Pourtant, une citation la déstabilise : « Vous êtes libre quand vous comprenez que vous n’êtes de nulle part. » Pendant des années, l’auteure rejette cette idée.
Pour Brené Brown, ne pas appartenir représente une douleur ancienne et viscérale. Dès l’enfance, elle vit l’exclusion. À l’école, son prénom complet, Casandra Brené Brown, la fait passer pour afro-américaine. Dans une Louisiane encore marquée par la ségrégation, cela suffit à l’écarter des fêtes et des cercles sociaux.
L’apprentissage de la solitude
Elle vit les rejets des deux côtés, sans comprendre pourquoi elle dérange. Sa différence devient un obstacle. Elle cherche désespérément une place, un groupe, une reconnaissance. Chaque déménagement rend cette quête plus difficile.
Son grand espoir réside dans l’équipe des Bearkadettes (sorte de danse chorégraphiée nommée "meneuses de claque"). Elle s’entraîne intensément, suit un régime strict, et croit en ses chances. Mais son numéro n’apparaît pas sur la liste. Ses parents gardent le silence. Ce rejet, couplé à l’absence de réconfort familial, devient fondateur.
Convaincue de ne pas mériter l’amour ni l’appartenance, elle apprend à se conformer. Elle lit les attentes des autres, s’adapte, joue des rôles. Elle devient caméléon, mais s’éloigne d’elle-même. Plus tard, elle choisit l’observation des comportements comme mode de survie.
En analysant les autres, elle développe des compétences qui l’amènent à la recherche. Pourtant, elle reste coupée de son authenticité. À 21 ans, elle est perdue, en fuite. Puis, elle rencontre Steve, qui la voit vraiment. Leur relation lui offre un espace de réparation.
Peu après, elle entame un parcours vers la sobriété. Elle teste plusieurs groupes, sans trouver sa place. Elle comprend que sa vraie dépendance est une fuite constante de la vulnérabilité. Elle commence alors à s’écrire des permissions pour vivre pleinement.
Retrouver sa voix
Lors d’un tournage avec Oprah Winfrey, elle se sent nerveuse, peu présente. Un collègue lui rappelle de vivre l’instant au lieu de l’analyser. Ce conseil provoque un déclic. Elle s’écrit une permission d’être joyeuse et gauche.
Cette journée devient un moment fondateur. Elle rencontre Maya Angelou, qui lui dit : « Ne te laisse pas ébranler. » Ces mots résonnent comme une bénédiction. Brené Brown comprend qu’elle doit s’ancrer pleinement en elle-même.
Plus tard, à une conférence, elle refuse de se déguiser en femme d’affaires. Elle choisit de s’habiller comme elle est vraiment. Elle refuse aussi de censurer sa foi ou son langage. Elle veut rester fidèle aux histoires qu’on lui confie.
Elle partage ses doutes avec Steve, qui l’écoute sans jugement. Il lui rappelle qu’elle appartient à leur foyer, à leurs enfants. Ce soutien lui permet de saisir enfin le sens des mots de Maya Angelou. Elle comprend que la véritable appartenance commence par soi-même.
En relisant l’entrevue complète de la citation qui la gênait, elle découvre que Maya Angelou affirme s’appartenir à elle-même. Cette révélation transforme le récit fondateur de sa douleur. Elle n’a plus besoin d’un groupe pour exister. Elle accepte enfin de ne pas s’ébranler.
Chapitre 2 : La quête de la véritable appartenance
Brené Brown explore la notion de véritable appartenance, ce besoin humain profond d’être accepté pour ce que nous sommes réellement. Elle distingue l’appartenance authentique de la conformité ou de la quête d’approbation, qui, loin d’y mener, en sont les ennemis.
Présenter son moi imparfait au monde exige une acceptation de soi complète. Mais cette définition évolue. La véritable appartenance ne dépend pas des autres : elle réside en nous. Elle nécessite parfois de rester seul, debout dans la vulnérabilité, l’incertitude et la critique.
Dans un monde divisé, s’appartenir devient un acte de courage. Il ne s’agit pas de rejoindre un groupe ou d’adhérer à une idéologie, mais de se relier à quelque chose de plus grand : l’amour et l’esprit humain. Même isolés, nous restons connectés. La véritable appartenance commence donc par une foi profonde en soi et la capacité de rester fidèle à son identité dans un monde incertain.
Définition de la véritable appartenance
Dans le cadre d’une recherche en théorie ancrée qualitative, Brené Brown explore la préoccupation majeure liée à l’appartenance. Les participants souhaitent appartenir à un groupe sans renoncer à leur authenticité, leur liberté ou leur pouvoir. Ils dénoncent une culture polarisée du « nous contre eux », source de déconnexion spirituelle.
Beaucoup redoutent que la peur et le mépris aient remplacé l’humanité partagée, l’amour et la compassion. Cette crise d’appartenance apparaît surtout spirituelle, non religieuse, traduisant un besoin profond de se sentir connectés aux autres sans se conformer.
Brené Brown pose quatre questions pour comprendre comment certains développent une véritable appartenance enracinée en eux. Les réponses dégagent quatre éléments clés, ancrés dans le monde actuel et réel. Ces éléments sont au centre des chapitres suivants :
Les gens sont difficiles à haïr de près. Rapprochez-vous.
Contrez les conneries avec la vérité. Soyez poli.
Tenez-vous la main. Avec des étrangers.
Dos fort. Devant doux. Cœur sauvage.
Sa démarche ne suit donc pas une idée préconçue : elle suit les données, même lorsqu’elles révèlent un monde chaotique.
La nature sauvage
Brené Brown compare la véritable appartenance à une nature sauvage : un lieu solitaire, indompté et exigeant, à la fois redouté et recherché. Appartenir pleinement à soi-même nécessite de braver cette nature, de quitter ses refuges idéologiques et d’oser la vulnérabilité.
Ce chemin, imprévisible, ne peut être dicté par autrui. Il implique de s’ouvrir aux autres sans renier son identité, de dialoguer malgré les divergences. La véritable appartenance est active, pas passive. Elle demande du courage, de l’inconfort, et un engagement sincère envers l’authenticité, même dans l’adversité. C’est une pratique personnelle et spirituelle, non une simple adhésion sociale.
Aptitudes à la bravoure
Brené Brown affirme que pour s’aventurer dans la nature sauvage de la véritable appartenance — cet espace de solitude, de courage et d’authenticité — un élément est essentiel : la confiance. Elle s’appuie sur la définition de Charles Feltman, qui voit la confiance comme le choix de rendre quelque chose de précieux vulnérable aux actions d’autrui. La méfiance, au contraire, suppose que ce qui compte n’est pas en sécurité avec l’autre.
Pour clarifier ce concept complexe, Brené Brown développe l’acronyme BRAVING, une grille qui s’applique autant à la confiance en soi qu’en les autres :
Faire confiance aux autres :
Boundaries (limites) : respect des limites, capacité à dire non.
Reliability (fiabilité) : tenir ses engagements, connaître ses limites.
Accountability (responsabilité) : reconnaître ses erreurs et réparer.
Vault (coffre-fort) : préserver la confidentialité des confidences.
Integrity (intégrité) : choisir le courage, l’éthique, et vivre ses valeurs.
Nonjudgment (impartialité) : exprimer ses besoins sans crainte d’être jugé.
Generosity (générosité) : interpréter les intentions d’autrui avec bienveillance. (Braver sa nature sauvage, Chapitre 2)
Faire confiance à soi-même implique de se poser ces mêmes questions avec les pronoms personnels :
B — Ai-je respecté mes propres limites ?
R — Ai-je été fiable ?
A — Me suis-je tenu responsable ?
V — Ai-je respecté la confidentialité et partagé de façon appropriée?
I — Ai-je agi avec intégrité ?
N — Ai-je demandé de l’aide sans me juger ?
G — Ai-je été généreux envers moi-même ? (Braver sa nature sauvage, Chapitre 2)
Ce chemin vers la reconnaissance est paradoxal. Il semble absurde d’appartenir partout et nulle part, mais c’est pourtant vrai. Carl Jung et Maya Angelou affirment tous deux la valeur de cette vérité profonde : elle est exigeante, mais sa récompense est immense.
« La véritable appartenance est la pratique spirituelle de croire et d’appartenir à vous-même si profondément que vous pouvez partager votre moi le plus authentique avec le monde et trouver le sacré à la fois dans le fait de faire partie de quelque chose et de vous tenir debout seul dans la nature sauvage. La véritable appartenance n’exige pas de changer qui vous êtes, mais d’être qui vous êtes. » (Braver sa nature sauvage, Chapitre 2)
Chapitre 3 : Grande solitude : une crise spirituelle
Brené Brown évoque le « high lonesome », un cri musical du bluegrass, symbole d’une douleur profonde transformée en expérience partagée. L’art a ce pouvoir : il donne forme à la solitude et au chagrin pour qu’ils deviennent sources de connexion. Aujourd’hui, au lieu de partager nos blessures par la musique ou les récits, nous crions, nous nous replions, nous nous opposons.
Pour l'autrice, le monde traverse une crise spirituelle collective. Nous avons rompu notre lien d’humanité partagée. Cynisme, peur et méfiance dominent. Nous nous divisons selon nos idéologies, oubliant notre interconnexion essentielle, ancrée dans l’amour et la compassion.
Braver cette crise exige un courage immense. Se taire ou se battre ne fait qu’amplifier la solitude. Peu cherchent à bâtir des ponts entre les différences. Or, la véritable appartenance repose sur cette humanité commune. Pour la retrouver, il faudra oser sortir des lignes et affronter la nature sauvage relationnelle.
Nous répartir
Brené Brown s’appuie sur les travaux de Bill Bishop pour montrer comment la société américaine s’est idéologiquement et géographiquement fragmentée. En cherchant le confort de l’homogénéité, les gens se regroupent avec ceux qui partagent leurs idées, ce qui accroît l’extrémisme, étouffe la dissidence et renforce les stéréotypes.
Cette polarisation crée une solitude croissante, même au sein des familles. Malgré des divergences profondes, beaucoup refusent de couper les liens avec leurs proches. La société valorise pourtant les factions au détriment des relations humaines.
Brené Brown constate que cette répartition n’a pas nourri le sentiment d’appartenance, mais a provoqué isolement, méfiance et repli. Les comtés deviennent idéologiquement uniformes, tandis que les taux de solitude doublent. Le paradoxe est clair : plus les gens vivent entre semblables, plus ils se sentent seuls. Comprendre la nature de cette épidémie de solitude devient crucial pour restaurer le lien humain et la véritable appartenance.
Regard de l'extérieur
La solitude, définie par John Cacioppo comme un isolement social perçu, survient lorsque nous nous sentons déconnectés des autres. Contrairement au fait d’être seul, qui peut être réparateur, la solitude signale un manque de liens significatifs : famille, amis, communauté. Elle affecte même notre perception des lieux, qui peuvent parfois « vibrer de déconnexion ».
Espèce sociale, l’humain a biologiquement besoin de connexion pour s’épanouir. Cacioppo explique que notre cerveau envoie des signaux – comme la faim ou la soif – pour signaler ce besoin vital. Mais la solitude est stigmatisée, associée à la faiblesse ou à l’anormalité. Cette honte nous pousse à nier notre solitude, même lorsqu’elle résulte de pertes ou de deuils.
Le danger est réel : le cerveau solitaire entre en mode autoprotection, réduisant l’empathie et renforçant la défensive. Ce cercle vicieux aggrave l’isolement. Il faut d’abord reconnaître la solitude comme un avertissement, puis rechercher des connexions de qualité, non de quantité.
Selon une méta-analyse, la solitude augmente de 45 % le risque de mort précoce, un taux supérieur à ceux liés à l’obésité ou à l’alcool. La connexion humaine n’est donc pas un luxe, mais une nécessité biologique.
La peur nous a menés ici
La peur est identifiée comme le moteur principal de la fragmentation sociale et de la déconnexion. Alimentée par le terrorisme, les violences et les discours polarisants, elle pousse les individus à se retrancher dans des bunkers idéologiques. Ces refuges promettent sécurité, mais renforcent solitude et isolement. Les vraies conversations, vulnérables et inconfortables, sont évitées.
Pourtant, la véritable appartenance exige de braver cette nature sauvage intérieure, en quittant le confort pour la connexion. L’espoir repose sur une masse critique de personnes prêtes à écouter, ressentir et se relier, au-delà des différences. C’est ainsi que la peur cesse de gagner.
"Je viendrais vers toiJe traverserais les mers Pour soulager ta peine." (Town Van Sandt, cité dans Braver sa nature sauvage, Chapitre 3)
Chapitre 4 : Les gens sont difficiles à haïr de près. Rapprochez-vous
Dans un monde saturé de haine, de polarisation politique et de jugements instantanés, Brené Brown invite à passer du regard global à l’expérience personnelle. En zoomant sur nos vies, nous découvrons que la haine généralisée s’effondre face à des relations humaines réelles et nuancées.
Face à la douleur, beaucoup choisissent la colère comme refuge, mais s’y accrocher nous ronge. La colère, si elle est transformée, devient un catalyseur de courage, de justice et de connexion. Refuser de haïr, comme l’illustre la lettre d’Antoine Leiris après la mort de sa femme au Bataclan, devient un acte radical de résistance.
Reconnaître notre souffrance et celle des autres est essentiel pour guérir. La haine dissimule souvent une peine non reconnue. Pour bâtir un monde plus humain, nous devons transformer notre douleur, briser les cercles de l’égoïsme et reconnecter par la compassion. La haine coûte trop cher. La vraie force est dans la vulnérabilité et l’amour.
Il y a toujours des limites, même dans la nature sauvage
Se rapprocher des autres implique d’affronter des conflits réels, parfois douloureux, surtout au sein de la famille. Pour maintenir une véritable appartenance, il faut définir des limites claires. Les participants à la recherche insistent sur deux formes de sécurité indispensables à la vulnérabilité : la sécurité physique et la sécurité émotionnelle. Cette dernière ne signifie pas fuir le désaccord, mais refuser le langage déshumanisant.
La déshumanisation transforme l’autre en ennemi, en être « moins que », rendant acceptable l’exclusion morale. Elle commence par des mots et se poursuit par des images. Dans l’histoire, elle a justifié des génocides, l’esclavage et les violences extrêmes.
Le langage inhumain est le premier signe. Une fois les gens réduits à des caricatures ou à des menaces, l’empathie disparaît, et le conflit se fige dans une opposition bien/mal. Tous les humains sont vulnérables à ce processus. Reconnaître ce glissement est essentiel pour préserver notre humanité partagée et résister à l’exclusion morale.
Le courage d'étreindre notre humanité
La déshumanisation commence souvent par des mots et des images qui excluent certaines personnes. Ce processus, largement alimenté par les réseaux sociaux, pousse à rejeter sans nuance ceux avec qui nous sommes en désaccord. Pourtant, cette tendance nuit autant à ceux qu’elle vise qu’à ceux qui y participent. La véritable appartenance exige de tracer une ligne claire fondée sur le respect de la dignité humaine.
Voici cinq principes à retenir selon Brené Brown :
Si des insultes sexistes vous choquent envers certaines femmes, elles devraient vous déranger dans tous les cas, peu importe leur camp politique.
Si un propos vous a blessé parce qu’il vous visait, soyez attentif aux paroles similaires dirigées contre d’autres.
Le langage dégradant, d’où qu’il vienne, doit être dénoncé, même s’il vise un adversaire politique.
Traiter des personnes comme des bêtes ou des objets est un signal d’alerte : cela facilite l’exclusion morale.
Si des images haineuses vous offensent selon leur cible, elles doivent toutes vous inquiéter, quel que soit leur auteur.
Déshumaniser n’est pas tenir responsable. Cela ne favorise ni la justice ni le changement. L'auteure appelle à dépasser les faux choix entre loyauté et responsabilité. Aimer un groupe, c’est aussi le rendre meilleur en nommant les abus. Refuser les espaces où la dignité est bafouée, ce n’est pas chercher le confort émotionnel, c’est refuser la violence symbolique. La véritable appartenance commence par le courage de réhumaniser.
Transformation des conflits
Pour mieux naviguer les conflits, la Dre Michelle Buck — interrogée par Brené Brown pour le livre — propose une approche qui transforme la confrontation en connexion. Plutôt que de fuir ou de «convenir de ne pas être d’accord», elle suggère d’explorer les intentions sous-jacentes de chacun. Cela permet de dépasser les malentendus et de renforcer la relation.
Elle recommande aussi de déplacer la conversation du passé vers un avenir commun à construire ensemble. Pour elle, il ne s’agit pas de «résoudre» mais de transformer le conflit, en créant de nouvelles perspectives et une compréhension mutuelle plus profonde. Enfin, elle insiste sur l’importance de ralentir, de poser des questions comme «Dites-m’en davantage» et surtout d’écouter pour comprendre, pas pour répondre.
]]>Résumé de "Seuls ensemble" de Sherry Turkle : une psychologue reconnue se demande si nous vivons dans un monde avec "de plus en plus de technologies" et de "moins en moins de relations humaines" et elle en vient à la conclusion qu'il faudrait peut-être repenser notre façon d'être ensemble en société — un livre événement par l'une des spécialistes de sciences humaines les plus en vue du moment.
Sherry Turkle, 2015, 523 pages.
Titre original : Alone together (2011).
Chronique et résumé de "Seuls ensemble" de Sherry Turkle
Préface — Trois tournants
Sherry Turkle a une longue expérience en tant que psychologue et anthropologue. Étudiante à Paris, elle est ensuite partie faire carrière au célèbre Massachussetts Institute of Technology (MIT) pour y étudier "les cultures informatiques". Plus précisément, elle s'intéresse aux rapports intimes que nous entretenons avec le monde numérique.
Au cours des 40 dernières années, elle a écrit trois livres importants :
The Second Self (1984) ;
Life on the Screen (1995) ;
Alone together (2011) (traduit par Seuls ensemble) ;
Reclaiming Conversation (2015) (traduit par Les yeux dans les yeux).
Introduction — Seuls ensemble
« La technologie se présente comme l'architecte de nos intimités. » (Seuls ensemble, Introduction)
Toute la technologie dite "numérique" — depuis l'utopie virtuelle de Second Life aux hamsters de compagnie Zhu Zhu — nous est présentée comme une série d'améliorations artificielles de la réalité. Mais ces "améliorations" sont-elles réelles ? Et sont-elles sans risque ?
Pour l'auteure, il y a un inconvénient majeur à cette promesse de l'hyperconnexion numérique, à savoir la possibilité de la perte des relations humaines directes. Elle le montre bien en citant l'histoire d'une jeune fille qui envoie des textos à son amie alors qu'elles sont dans la même maison !
Sur la base de ce constat, Sherry Turkle propose de demander :
« comment en sommes-nous arrivés là — et sommes-nous contents d'y être ? » (Seuls ensemble, Introduction)
Sherry Turkle utilise plusieurs anecdotes et arguments pour présenter son propos.
Par exemple, alors qu'elle emmène sa fille au New York Museum of Natural History, celle-ci lui dit que le musée aurait dû utiliser des robots à la place des tortues Galápagos, au lieu d'emprisonner des créatures vivantes. Selon l'autrice, beaucoup d'autres enfants réagissent de la même façon, et cela l'inquiète.
Elle critique également le livre d'un expert en intelligence artificielle, David Levy, qui promeut les relations romantiques avec les robots. Elle craint qu'une interaction avec un objet inanimé "comme s'il" était vivant puisse, d'une manière ou d'une autre, nous faire "perdre" une dimension essentielle de notre humanité.
La technologie moderne promet de nous rapprocher. Ce qui est sûr, c'est qu'elle s'appuie sur nos "vulnérabilités humaines" — à savoir, en premier lieu, le besoin d'intimité avec autrui et de connexion sociale. Mais nous aide-t-elle vraiment à combler ce besoin, ou nous fait-elle courir de nouveaux risques ? Telle est toute la question de cet ouvrage.
Première partie — Le moment robotique : nouvelles solitudes, nouvelles intimités
Chapitre 1 — Nos plus proches voisins
Quelles sont nos relations aux robots domestiques qui peuplent déjà nos quotidiens ? L'auteure a mené de nombreuses études pour tenter de répondre à cette interrogation.
Tout d'abord, en tant qu'étudiante du MIT dans les années 1970, elle a fait l'expérience d'ELIZA, un programme informatique de base qui avait pour propriété essentielle de mimer un dialogue avec un psychothérapeute.
En réalité, ELIZA se contentait souvent de reformuler (éventuellement sous forme de questions) ou de paraphraser les propos de l'utilisateur. Mais la plupart des personnes l'ayant utilisé étaient prises au jeu et lui révélaient leurs secrets.
Pour Sherry Turkle, les participants ne pensent en rien qu'ils parlent à une véritable intelligence, mais ils "jouent le jeu", en quelque sorte. Autrement dit, ils sont complices du programme et utilisent les capacités du programme pour provoquer ce qu'ils attendent, à savoir des réponses réalistes d'ELIZA.
Il en va sensiblement de même pour les enfants avec les Furbies, ces peluches animées qui peuvent interagir avec leurs propriétaires. À travers les interviews qu'elle a menées durant de longues années, Sherry Turkle découvre que les petits considèrent les Furbies comme vivants, tout en sachant qu'ils ne sont pas "biologiquement vivants".
En fait, les enfants n'ont pas peur de brouiller les catégories : ils voient leur Furby à la fois comme une machine et comme un être vivant. Wilson, un petit garçon interrogé par l'auteure, affirme qu'il peut "toujours entendre la machine à l'intérieur".
D'un autre côté, dans ses études sur l'usage des Tamagotchis par les enfants, Sherry Turkle a remarqué que certains d'entre eux pleurent la mort de leurs petits animaux de compagnie électroniques. Elle donne ainsi l'exemple d'une petite fille qui refuse d'appuyer sur reset après la "mort" de son Tamagotchi.
Selon l'auteure, la pensée de ces enfants est directement liée à leurs interactions — c'est une pensée pragmatique, orientée vers l'action. Ils se prennent au jeu, comme si les Tamagotchis étaient en vie, et se demandent : que veut-il ? Quelles sont les expériences significatives que j'ai eues avec lui ?
Chapitre 2 — Assez vivants
Sherry Turkle amène avec elle huit Furbies dans une école primaire au printemps 1999. Directement, les enfants essaient de se connecter avec les jouets en leur parlant. Ils remarquent que les Furbies ont beaucoup en commun avec eux :
Ils ont des besoins ;
Ils sont distincts les uns des autres ;
Enfin, ils ont besoin d'être nourris.
Étrangement, certains enfants utilisent le vocabulaire des êtres vivants pour parler des machines, et parfois s'appliquent à eux-mêmes le vocabulaire des machines pour parler d'eux-mêmes. Un flou se crée. Pour l'auteure :
« [Les Furbies] promettent la réciprocité parce que, contrairement aux poupées traditionnelles, elles ne sont pas passives. Ils font des exigences. Ils se présentent comme ayant leurs propres besoins et leur vie intérieure. » (Seuls ensemble, Chapitre 2)
Autre expérience : le « test à l'envers ». Ici, des adultes tiennent trois "choses" à l'envers :
Une Barbie ;
Une gerbille (sorte de hamster) ;
Et enfin un Furby.
Apparemment, les gens sont plus réticents à laisser le Furby à l'envers trop longtemps. Pourquoi ? Car celui-ci, contrairement aux deux autres, est capable de dire "J'ai peur" (langage programmé dans la machine). Ils savent que c'est un robot, et pourtant c'est plus fort qu'eux, ces paroles les touchent.
Sherry Turkle raconte encore les opinions de deux garçons sur les robots, à vingt-cinq ans d'intervalle.
En 1983, l'auteure parle à Bruce, un garçon qui pense que, bien qu'un robot puisse faire moins d'erreurs, les défauts des humains sont ce qui les rend spéciaux.
En 2008, elle s'entretient avec Howard, qui voit quant à lui l'infaillibilité d'un robot comme un avantage. Il pense qu'un robot est susceptible de donner de meilleurs conseils qu'un humain, car il a accumulé davantage de connaissances.
Dans le cas de Bruce, c'est l'humanité et sa singularité qui sont mises en avant. La réponse de Howard, quant à elle, est typique de l'optimisme qui caractérise les constructeurs de technologies numériques et de robots. Mais celle-ci, pour Sherry Turkle, comporte le risque de se satisfaire des relations robotiques.
En d'autres termes, l'auteure craint que nos interactions répétées avec des robots sociables ne mènent à une réduction de ce que nous considérons comme "la vie", et tout particulièrement la vie humaine, avec les liens sociaux complexes qui la caractérisent.
Chapitre 3 — De vrais compagnons
C'est ce qu'elle cherche à exemplifier à partir d'un autre cas : la relation entre les robots AIBO — les chiens robots — et leurs propriétaires. Est-ce un véritable animal de compagnie ? Et plus important : est-ce que le fait de faire "comme si" il s'agissait d'un vrai chien peut amener ces personnes à se suffire de ce type de relation, somme toute limitée ?
Que leur manquent-ils ? Pour Sherry Turkle, la réponse est claire : l'altérité, à savoir la capacité de voir le monde à travers les yeux d'un autre.
Pour l'auteure, comme le robot n'est pas vivant, il devient simplement une prothèse ou une extension de la personne qui le possède. Lorsque nous interagissons avec des êtres humains, nous avons l'habitude de considérer l'altérité. Ne pas le faire est même le signe certain d'un problème psychologique (personnalité narcissique, manipulatrice, etc.).
Dans leurs relations avec AIBO, les enfants sont à nouveau pragmatiques. Ils le considèrent "comme si" il était un animal de compagnie normal et agissent en fonction. Toutefois, une jeune fille interviewée par l'auteure dit que l'AIBO est plus facile que les animaux de compagnie à certains égards parce qu'elle peut l'éteindre, à la différence d'un "vrai" animal vivant.
Sherry Turkle appelle cela un « attachement sans responsabilité ». Selon elle, s'habituer à ce type d'interaction peut être risqué dès lors qu'il influence nos rapports avec les autres personnes.
Bien sûr, il y a des nuances à faire. Les personnes n'interagissent pas de la même manière avec ces robots et ces interactions ne disent pas la même chose de notre façon d'agir avec les autres. À la fin du chapitre, l'auteure présente plusieurs exemples qui permettent de nuancer le propos.
Chapitre 4 — Enchantement
My Real Baby est une poupée robotique sortie en 2000. C'est un robot sociable légèrement plus avancé que le Furby. Il mûrit et devient plus indépendant. Sa "personnalité" est peu à peu façonnée par la façon dont il est traité par son propriétaire.
Sherry Turkle étudie les interactions entre My Real Baby et les enfants âgés de 5 à 14 ans. Elle remarque tout d'abord qu'ils voient les robots sous un jour positif, à la manière dont ils sont présentés dans les blockbusters hollywoodiens (R2D2 dans Star Wars ou Wall-e, par exemple).
L'auteure s'intéresse à la question de savoir si les enfants pensent que les robots pourraient, à l'avenir, prendre soin d'eux ou de leurs proches (enfants ou personnes âgées). Elle récolte des réponses — et des questions — intéressantes.
Certains se demandent concrètement si les robots ont de l'empathie pour eux. Selon Sherry Turkle, c'est une idée particulièrement courante chez ceux qui ont des parents absents. Un enfant nommé Kevin, âgé de 12 ans et particulièrement précoce, demande à l'auteure :
« Si les robots ne ressentent pas de douleur, comment pourraient-ils vous réconforter ? »
Mais d'autre part, Sherry Turkle remarque aussi que le comportement pragmatiste de bon nombre d'entre eux ne change pas : ils se satisfont de l'action simulée du robot et s'inquiètent seulement du fait qu'il pourrait tomber en panne.
Lorsqu'elle les interroge sur l'utilisation des robots pour aider leurs grands-parents, certains enfants affirment qu'ils pourraient être utilisés pour intervenir en cas de problème (chute, mort, etc.) ou de les aider à se sentir moins seuls. Mais certains enfants craignent aussi que leurs grands-parents en viennent à aimer le robot plus qu'eux !
Sherry Turkle termine ce chapitre par deux autres illustrations intéressantes.
Elle donne d'abord l'exemple de Callie, une jeune fille de 10 ans qui a une relation forte avec son jouet My Real Baby. Comme son père est souvent absent, la présence du robot la réconforte et lui fait "se sentir plus aimée". Investie d'un sentiment de responsabilité, elle se considère même comme la mère du bébé.
Tucker, un enfant de sept ans, est atteint d'une maladie grave. Il utilise AIBO pour exprimer ses sentiments sur la mort, sur son corps et sa propre peur de mourir. Il compare AIBO à son chien, mais considère que l'AIBO "fait mieux". Selon Sherry Turkle, il identifie le robot à « un être qui peut résister à la mort par la technologie ».
Chapitre 5 — Complicités
Sherry Turkle fait la découverte du robot Cog pour la première fois en 1994, au MIT. Cog est un robot assez évolué qui apprend de son environnement et cherche à créer du lien social.
Lors de nouvelles expériences avec des enfants, Sherry Turkle présente deux robots — Cog et Kismet (un autre robot "sociable") — à un groupe d'enfants. Ceux-ci, naturellement curieux, interagissent avec les robots et cherchent à faire connaissance.
Ils essaient de plaire aux robots et se font les complices de l'effort des concepteurs pour rendre les robots plus humains qu'ils ne le sont vraiment. Ils parlent et ils dansent avec eux ; bref, ils cherchent à attirer leur attention et à créer du lien social.
Même lorsque les concepteurs expliquent à certains enfants le mécanisme qui se cache derrière ces robots, ou bien lorsque ceux-ci tombent en panne, les élèves interrogés continuent de trouver des justifications et des explications pour conserver cet aspect "vivant".
Pour aller plus loin, Sherry Turkle raconte notamment l'histoire d'une petite fille de 11 ans qui, en raison de ses origines indiennes, a quelques difficultés à s'intégrer dans le groupe.
Elle n'aime pas la façon dont les filles qu'elle fréquente font semblant d'être ses amies, puis se moquent de son accent. Par contraste, elle aime la "fiabilité" de Cog. Selon Sherry Turkle, la petite fille s'assure ainsi d'être aimée, sans risquer le rejet d'autrui.
Une autre petite fille, à l'inverse, considère que c'est de sa faute si le robot ne parle pas suffisamment. Elle se demande pourquoi il n'est pas très bavard et s'en impute la responsabilité. Ici, c'est un sentiment d'échec qui est fabriqué par la relation avec la machine.
L'auteure donne de nombreux autres exemples très parlants. À chaque fois, elle pose la question du sens de créer des robots sociables. Quelles sont les implications éthiques de ce type de technologie et sommes-nous capables de les assumer ?
"Voulons-nous vraiment être dans le business de la fabrication d'amis qui ne pourront jamais être des amis ?" (Seuls ensemble, Chapitre 5)
L'amitié avec les robots ne pourra jamais être réciproque. Ce sera toujours une projection de nos propres sentiments sur un être finalement indifférent. Autrement dit, l'amitié véritable nécessite l'altérité.
Chapitre 6 — L'amour au chômage
Connaissez-vous Paro ? C'est un robot thérapeutique introduit dans certaines cliniques à partir du printemps 2009. Sa cible : les personnes âgées et, avant tout, les résidents des maisons de retraite. C'est l'occasion, pour Sherry Turkle, de revenir sur ses réflexions et ses observations auprès de ce groupe d'individus.
Sherry Turkle raconte d'abord les expériences qu'elle a menées avec My Real Baby. Elle explique que le robot est bien accepté, même si, de façon générale, elle remarque que les personnes âgées cherchent surtout à interagir avec les personnes humaines réelles qui organisent l'étude ou prodiguent les soins.
L'auteure raconte ensuite son incursion auprès des chercheurs en robotique. En 2005, elle assiste à un symposium intitulé « Caring Machines [machines de soin] : l'intelligence artificielle dans les soins aux personnes âgées ». Elle questionne notamment les participants au sujet du titre du symposium lui-même : veut-on vraiment que les machines prennent soin de nos ainés ?
Selon elle, prendre soin est ce qu'elle nomme "le travail de l'amour". Il s'agit avant tout d'une activité fondamentalement humaine.
Plus tard, toutefois, elle parle avec Tim, un homme d'âge moyen qui affirme que le robot Paro améliore la vie de sa mère. Celle-ci, selon lui, semble plus vivante grâce à la compagnie du robot. Mais est-elle pour autant moins seule qu'auparavant ? Telle est l'inquiétude de l'auteure.
Voici quelques autres exemples donnés par Sherry Turkle :
Une personne âgée nommée Andy devient très attachée à un My Real Baby et en vient à lui parler comme à son ex-femme.
Johnathan, un autre résident, ancien ingénieur, est plus terre-à-terre. Il démonte My Real Baby et trouve une puce informatique dont il ignore la composition.
Une femme âgée nommée Edna préfère le jouet à sa véritable arrière-petite-fille de 2 ans parce qu'elle peut jouer avec elle sans aucun risque. Le robot la détend.
Les robots comme Paro ou encore Nursebot (un autre robot de ce genre) commencent à intégrer les maisons de repos. Ils peuvent aider dans certaines tâches, comme la prise de médicaments. Mais nous devons faire attention aux conséquences inattendues de ces technologies sur les liens sociaux et, en particulier, sur la façon dont nous prodiguons l'amour et les soins.
Chapitre 7 — Communion
Sherry Turkle relate une série d''études visant à tester les compétences du robot Kismet dans la conversation entre adultes. Rich, jeune homme de vingt-six ans, participe à cette expérience.
Il commence par activer ce que l'auteure a appelé dès le premier chapitre "l'effet ELIZA". C'est-à-dire qu'il cherche activement à faciliter la relation avec le robot afin de créer l'illusion de son caractère "vivant". Peu à peu, un rapport se crée et Rich se prend au jeu — au point d'oublier que le lien est factice !
Avec Domo, une version améliorée de Kismet pensée pour l'aide ménagère, les effets sont semblables. Selon son concepteur, peu importe de savoir que le robot n'as pas de sentiments ; ce qui compte, c'est ce que nous ressentons lorsqu'un robot, par exemple, nous tient la main.
Mais Sherry Turkle n'est pas d'accord avec ce point de vue. Elle considère que, derrière ce "fantasme de communion", se cache en réalité "l'indifférence ultime" du robot. Et que cette indifférence n'est pas sans conséquences.
Selon le psychologue Clifford Nass, les personnes tendent à éviter les conflits ou à blesser les "sentiments" de l'ordinateur, même s'ils savent, au fond d'eux, que l'ordinateur n'en a pas. C'est toute la thématique de l'"informatique affective", une discipline inventée par Rosalind Picart dont parle l'auteure à la fin de ce chapitre.
Deuxième partie — En réseau : dans l'intimité, de nouvelles solitudes
Chapitre 8 — Toujours connectés
Sherry Turkle se souvient d'un groupe de personnes surnommées « les cyborgs » au MIT, dans les années 90. "Errant dans et hors du réel physique", ils étaient les premiers passionnés des jeux en ligne.
Leur attachement à l'espace virtuel semblait bizarre et marginal dans ces années-là. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? L'auteure souligne que beaucoup d'entre nous vivent comme cela désormais, que ce soit par le biais des réseaux sociaux ou des jeux en ligne comme Second Life.
Pour Sherry Turkle, notre vrai moi, notre moi physique, se confond peu à peu avec notre moi virtuel. Ou, à tout le moins, l'un et l'autre se transforment mutuellement. La psychologue-anthropologue prend plusieurs exemples tirés de ses recherches plus récentes.
En voici un. Pete est un homme d'âge moyen qui vit un mariage malheureux. Mais il a une femme virtuelle dans Second Life. Selon lui, cette relation en ligne aide effectivement son mariage dans la vie réelle à perdurer.
Pourquoi ? Car elle lui donne un exutoire. Dans le jeu, il peut aborder des sujets que sa femme refuse d'entendre. Les moments où il se sent le plus "lui-même", c'est dans le jeu, dit-il encore.
Sherry Turkle s'intéresse aussi au multitâche et à ses implications. Elle rappelle des études ayant montré les effets plutôt négatifs, en terme d'efficacité d'apprentissage, notamment, de ce mode de travail.
Par ailleurs, l'auteure remarque que la patience des gens diminue à mesure que les technologies de communication nous offrent des services toujours plus rapides. Les nuances se perdent aussi. Dans un monde où les réponses instantanées deviennent la norme, il faut faire court et direct.
Sherry Turkle voit ainsi une « symétrie effrayante » émerger : à mesure que les robots sont promus au rang d'être (quasi-) vivants, les personnes qui communiquent en ligne sont rétrogradées au stade de « machines maximisantes », sommées d'être toujours plus efficaces.
Finalement, Sherry Turkle observe un lien fort entre la robotique et les réseaux sociaux. Nous sommes profondément séduits par les deux technologies.
Les robots sociaux attirent les utilisateurs avec leurs besoins artificiels et créent une réponse positive chez les utilisateurs, qui se mettent à "jouer le jeu".
Les réseaux sociaux exigent de nous un engagement de plus en plus intense. Nous nous sentons obligés, ici aussi, d'entrer dans le jeu et de répondre le plus rapidement possible aux notifications et aux messages qui nous sont envoyés.
Chapitre 9 — Grandir constamment reliés
Depuis l'apparition des smartphones, de nombreux adolescents (et adultes) sont "scotchés" à leurs écrans. Quitte, parfois, à les utiliser lorsqu'ils conduisent ou quand ils savent que cela est dangereux.
La génération native d'Internet pense que la connexion via les réseaux sociaux est quelque chose d'acquis, de déjà-là et de premier. Mais, selon l'auteure, cette attitude peut nuire à l'auto-réflexion, qui passe par l'intimité et la solitude.
Par ailleurs, le médium lui-même, à savoir la forme des messages que nous envoyons, encadre la façon dont nous pensons et réagissons. L'auteure craint que le caractère rapide, court et direct des messages déposés sur les réseaux sociaux empêche les adolescents d'exprimer et de ressentir complètement leurs sentiments.
Aujourd'hui, une étudiante qui envoie des messages 15 fois par jour n'est pas considérée comme "anormale". Mais pensez-y. Était-ce ainsi il y a dix ans ? Pas du tout. À cette époque, vous auriez sans doute trouvé cela "bizarre". Les codes sociaux et culturels changent.
Sherry Turkle utilise de nombreux entretiens qu'elle a elle-même réalisés afin de montrer comment les jeunes se "créent des identités" en ligne et comment celles-ci peuvent causer des troubles intérieurs ou participer à réparer (partiellement ou artificiellement) des blessures dans la vie réelle.
Trish, par exemple, est une jeune fille de 13 ans qui est maltraitée physiquement. Dans les Sims Online, elle se crée une famille respectueuse et aimante.
Katherine, 16 ans, expérimente diverses personnalités dans ce même jeu.
Mona et un autre lycéen s'inquiètent de la relation de conséquence entre la création de leur profil sur Facebook et les opportunités qu'ils peuvent avoir dans la vie réelle. Leur profil virtuel peut avoir des conséquences importantes sur leur bien-être et leur avenir.
Sherry Turkle montre qu'un certain nombre d'étudiants sont fatigués de cet "audit" constant et de cette simplification de soi-même qu'implique l'univers des réseaux sociaux.
En résumé :
« Les réseaux sociaux nous demandent de nous représenter sur un mode très simplifié. Et devant notre public, nous nous sentons ensuite tenus de nous conformer à ces représentations simplificatrices. » (Seuls ensemble, Chapitre 9)
Chapitre 10 — Plus la peine de passer un coup de fil
Dans ce chapitre, Sherry Turkle continue son investigation sur les réseaux sociaux et la communication en ligne de façon plus générale.
Elle donne l'exemple d'Elaine, 17 ans, qui préfère envoyer des textos plutôt qu'appeler. Pourquoi ? Car cela lui donne le temps de construire ses pensées sans pression et souvent pendant qu'elle est seule. Ici, le message écrit peut aider la réflexion.
Audrey, 16 ans, est quant à elle timide. Elle préfère envoyer des textos, plutôt que de parler. Mais c'est surtout parce qu'elle n'aime pas mettre fin aux appels. Ses parents sont divorcés et ses frères sont souvent occupés ; dès lors, elle ressent chaque fin d'appel comme un rejet. Avec les textos, c'est plus simple, dit-elle.
Cela dit, elle avoue que, lorsqu'elle a déménagé, elle aurait aimé dire au revoir à l'un de ses amis par téléphone ou en personne, plutôt que par message écrit.
D'ailleurs, les adolescents ne sont pas les seuls à préférer les textos. L'auteure cite une femme adulte qui cherche à convertir son mari à ce mode de communication. Lui qui préfère téléphoner se voit contraint d'écrire afin d'être "plus efficace".
Sherry Turkle utilise de nombreux autres exemples en relation aux textos. À chaque fois, elle montre bien l'ambiguïté de ce médium. En effet, celui-ci peut aider à l'expression. Mais il contraint également énormément les échanges.
Et — comme nous avons toujours le mobile à côté de nous — il ne permet plus que rarement les moments de solitude et de remise en question.
Chapitre 11 — Réduction et trahison
Sherry Turkle se prête ici au jeu et crée un personnage de Second Life nommé Rachel. Elle affirme que "quand nous jouons à recréer notre vie via un avatar, nous exprimons nos espoirs, nos forces et nos fragilités".
À nouveau, l'auteure n'est pas contre la technologie. Elle reconnaît même qu'un tel « jeu » peut avoir des effets thérapeutiques ou éducatifs sur la vie réelle d'une personne.
Les psychologues distinguent deux processus mentaux que Sherry Turkle propose d'utiliser pour penser les formes de vie en ligne :
Le « retour du refoulé » ;
Le « travail sur les problèmes ».
Le « retour du refoulé » désigne ici le fait de rester bloqué au sein des mêmes conflits intérieurs, sans pouvoir avancer et trouver une solution. Votre présence en ligne ne vous aide pas à grandir, mais plutôt à vous cacher.
Par contraste, en « travaillant sur les problèmes », vous utilisez l'univers virtuel pour explorer de nouveaux comportement et mettre un terme à vos soucis.
Par exemple, Joel, un programmeur informatique à succès, utilise Second Life pour « explorer son potentiel d'artiste et de leader ». Son avatar est un éléphant miniature nommé Rashi qui organise et construit de grands projets artistiques et bâtiments dans le jeu et qui est respecté pour cela.
La vie en ligne de Joel "rejaillit" de façon positive sur sa vie hors ligne.
En revanche, Adam a plutôt tendance à s'enfermer dans le virtuel et à "laisser tomber" sa vie réelle. Il est insatisfait de sa vie hors ligne et en particulier de son travail. Mais il aime sa vie virtuelle dans Quake, un jeu de tir à la première personne auquel il joue seul ou avec des amis. Il aime aussi Civilization, un jeu dans lequel il peut construire des univers entiers.
« Tel est le secret de la simulation : elle offre l'exaltation de la créativité sans la pression, l'excitation de l'exploration sans le risque. » (Seuls ensemble, Chapitre 11)
Cette caractéristique peut être mise à profit pour évoluer dans la vie, ou simplement nous divertir. Mais elle peut aussi susciter des phénomènes d'addiction et la perte des repères avec le monde réel.
Chapitre 12 — De vraies confessions
Sur un site appelé PostSecret, les gens envoient des cartes postales manuscrites confessant quelque chose, et ces confessions de cartes postales sont ensuite mises en ligne. Il existe plusieurs sites de ce genre où l'idée est, à chaque fois, de faire part aux autres internautes de ses questionnements les plus intimes.
Sherry Turkle remarque qu'il est plus facile de se confesser de cette façon. En effet, nous pouvons rester plus évasifs et nous nous dévoilons sous couvert d'anonymat. Mais c'est aussi moins efficace, car nous ne confrontons pas à une relation directe (avec un ami ou un membre de la famille, par exemple).
En fait, ces confessions en ligne sont, dans un sens, semblables à ces compagnons robots analysés dans la première partie. Comme avec eux, nous n'avons plus à traiter avec de vraies personnes ; nous pouvons juste nous satisfaire de faire "comme si" nous nous excusions vraiment, ou comme si nous réparions vraiment nos erreurs.
Par ailleurs, confesser ses problèmes en ligne augmente le nombre de réponses auxquelles nous pouvons nous attendre. Or, ce ne sont pas toujours des réponses bienveillantes ou justifiées, loin de là. La "cruauté" des internautes peut rendre l'expérience vraiment pénible.
Enfin, ces messages peuvent avoir pour effet de limiter l'empathie de ceux qui les lisent. Nous doutons de l'aspect "réel" et sincère de la confession. Et comme nous estimons qu'il pourrait s'agir d'une "performance", nous nous lassons des messages.
Chapitre 13 — Angoisses
Autre phénomène analysé par Sherry Turkle : le stress et l'anxiété. L'anxiété est monnaie courante à l'ère du numérique. Nous avons peur de manquer une information ou un bon plan (le fameux FOMO pour fear of missing out) et nous avons le sentiment simultané que tout est disponible et de devoir toujours être accessible.
Pour l'auteure, c'est d'ailleurs à partir des attentats du 11 septembre que les mobiles sont devenus "des symboles de sécurité physique et émotionnelle". En l'ayant toujours avec nous, nous nous sentons davantage protégés. Même si ceux-ci nous stressent aussi d'un autre côté.
À la fin du chapitre, Sherry Turkle aborde la question délicate du harcèlement sur Facebook et celle de la surveillance généralisée qu'impliquent les réseaux sociaux. Elle rappelle l'importance cruciale de la vie privée pour la démocratie.
Chapitre 14 — La nostalgie des jeunes
Finalement, Sherry Turkle note que de nombreux jeunes aspirent à une connexion plus profonde et en face à face. Ils se sentent enfermés dans le cercle vicieux créé par la technologie numérique. Envoyer des textos, par exemple, crée « une promesse qui génère sa propre demande ».
La promesse est que vous pouvez envoyer un SMS et demander à un ami de le recevoir en quelques secondes, ;
La demande est que l'ami soit obligé de répondre.
Robin, une jeune journaliste ambitieuse de 26 ans, se sent par exemple obligée de garder son BlackBerry avec elle à tout moment. Elle se sent même anxieuse et presque malade lorsqu'il n'est pas à bout de bras.
Pourquoi cet attachement si fort aux mobiles ? Parmi ses arguments, Sherry Turkle fait valoir que l'une des raisons pour lesquelles les enfants d'aujourd'hui souhaitent être connectés est qu'ils ont grandi en concurrence avec les téléphones pour attirer l'attention de leurs parents.
Conclusion — Des débats nécessaires
La psychologue et anthropologue démontre que les ordinateurs nous "utilisent" — et nous façonnent — autant que nous les façonnons. Nous inventons de nouvelles technologies pour nous aider à vivre et à travailler au quotidien, mais celles-ci nous transforment profondément !
L'un de ses amis et collègues handicapés, Richard, lui raconte comment il valorise l'aide que lui apportent les personnes humaines. Selon lui, un robot ne pourrait pas agir vis-à-vis de lui de cette façon. L'être humain, dit-il, surtout quand il est fragile, a besoin d'être raccroché à son histoire et à des liens concrets de fraternité. C'est ce qui lui donne sa dignité.
Non, la seule "performance du sentiment" ne suffit pas. Bien sûr, nous pouvons être tentés par cette solution, car nous contrôlons (ou pensons mieux contrôler) les rapports que nous entretenons avec les robots. Mais nous nous exposons moins à l'altérité.
Par ailleurs, nous risquons de ne plus supporter la solitude, pourtant essentielle à la création de nouvelles idées. Constamment aux prises avec cette performance du sentiment (aussi bien avec les robots qu'avec les autres virtuels), nous en oublions de nous retrouver avec nous-même pour nous poser ou réfléchir.
Au final, Sherry Turkle voit bien que certaines générations ressentent davantage le besoin de se mettre au vert et de concevoir d'autres formes de connectivité — c'est d'ailleurs tout l'objet du cyberminimalisme.
Que ce soit avec les robots ou les réseaux sociaux, nous pouvons créer des limites. Les robots, par exemple, peuvent très bien nous aider dans certaines tâches, mais nous ne devrions pas nous laisser avoir par l'illusion de l'amour robotique — dans le domaine des soins, surtout.
En somme, c'est à nous de reprendre le contrôle des usages acceptables et indésirables !
Épilogue — La lettre
Sherry Turkle raconte ici une anecdote personnelle. Elle envoie un texto à sa fille, qui prend une année sabbatique à Dublin avant l'université. Mais elle est insatisfaite : elle se souvient avec nostalgie des lettres qu'elle envoyait et recevait de sa propre mère alors qu'elle était à l'université.
Elle se rappelle que ces lettres étaient longues, sincères et pleines d'émotions. Bien qu'elle apprécie les échanges écrits et les visioconférences par Skype avec sa fille, quelque chose lui manque. Et elle remarque aussi que d'autres mères sont dans la même situation.
Alors, que faire ? Sherry Turkle évoque différentes méthodes pour « capturer la vie ». Il y a l'art et la science, bien sûr. Mais aussi la volonté, pour certaines personnes, d'archiver leur vie complète en écrivant des mémoires — ou en consignant chaque petit moment sur Instagram ou sur Facebook !
Pourtant, au quotidien, comment échanger de façon à la fois simple et plus profonde ? Sherry Turkle propose à sa fille de s'écrire des lettres, comme elle le faisait quand elle était elle-même plus jeune. Une correspondance à l'ancienne, pourquoi pas !
Conclusion sur "Seuls ensemble" de Sherry Turkle :
Ce qu'il faut retenir de "Seuls ensemble" de Sherry Turkle :
Ce livre se lit presque comme un roman. Pourtant, il repose sur un nombre impressionnants d'études et d'expériences réalisées par l'auteure et ses collègues pendant plus de quatre décennies. Grâce à sa force narrative et sa rigueur scientifique, l'ouvrage est devenu un classique à la fois dans les universités et en dehors.
Ses deux champs d'expérimentation sont :
La conception et la commercialisation de robots domestiques et en particulier de robots sociaux (jouets, robots domestiques, de compagnie, de soin, etc.) ;
L'apparition, grâce à Internet, de mondes en ligne divers (jeux, réseaux sociaux, etc.) et d'une connexion accrue (via les messageries, les textos, etc.).
Elle remarque une similitude entre ces deux domaines. En effet, à chaque fois, les êtres humains, jeunes ou vieux, se prêtent au jeu de la simulation et en oublient qu'ils deviennent, à leur tour, les jouets de réactions préprogrammées.
Or, ce qui l'intéresse plus que tout, c'est de voir comment ces relations à sens unique affectent notre sens de l'intimité, de la solitude et des relations humaines.
Et sa contribution principale consiste à documenter avec précision les difficultés auxquelles nous sommes confrontés avec les technologies actuelles issues de la robotique et d'Internet. À savoir :
Le risque de se couper de l'altérité et de l'imprévisibilité ;
La tentation de préférer des émotions artificielles aux joies et aux peines concrètes ;
Le manque de solitude nécessaire à la constitution du soi et des relations humaines.
Pour autant, Sherry Turkle, qui est une fine psychologue et anthropologue, ne considère pas qu'il faille — comme on dit — jeter le bébé avec l'eau du bain. Selon elle, il existe des usages positifs de la robotique ainsi que des réseaux sociaux et des jeux en ligne. Mais ce n'est qu'en les pratiquant avec conscience et réflexion que nous pouvons en tirer le meilleur.
Points forts :
Un style personnel qui permet d'entrer dans l'étude comme s'il s'agissait d'un roman ;
De très, très, très nombreux exemples issus de toutes ses études de terrain et entretiens ;
Un effort théorique solide ;
Une bibliographie et des annexes intéressantes.
Point faible :
C'est un livre peu ardu, mais qui en vaut la peine.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu le livre de Sherry Turkle, « Seuls ensemble » ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Sherry Turkle, « Seuls ensemble ».
Visitez Amazon afin d’acheter le livre de Sherry Turkle, « Seuls ensemble ».
 ]]>
]]>Résumé de "Comment réussir une négociation" de Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton : un classique absolu de la littérature sur la négociation (politique, business, famille) vendu à plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde — une approche simple et pragmatique qui fait l'unanimité (ou presque) depuis 1981 !
Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton (pour les nouvelles éditions), 267 pages, 2002.
Titre original : Getting to Yes (1981).
Chronique et résumé de « Comment réussir une négociation » de Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton :
Partie I. Le différend
1 — Pas de négociations sur des positions
Pour les auteurs, une négociation réussie est une négociation qui aboutit à un accord :
Judicieux ;
Efficace ;
Qui ne compromet pas les relations existantes.
Or, la façon dont nous négocions habituellement répond rarement à ces trois exigences. Souvent, en effet, nous négocions « à la dure » en partant de positions déterminées, puis en allant vers le compromis.
C’est comme cela, par exemple, que nous marchandons dans une brocante (un exemple pris par les auteurs, p. 31-32). Parfois, cela fonctionne. Mais pas toujours. Et pas souvent de la meilleure manière possible.
Étudions les failles de cette « négociation sur des positions » un peu plus en détail.
La discussion sur des positions ne permet pas d’aboutir à un accord judicieux
Premier point : l’accord judicieux est difficile à atteindre car l’amour-propre entre souvent en jeu. Comme nous avons pris une position de départ, nous ne voulons pas en sortir, car ce serait risquer de « perdre la face ».
Au final, quand l’accord est trouvé, c’est souvent de guerre lasse. Nous coupons la poire en deux « pour arrêter les frais ». Mais en réalité, nous restons souvent sur notre faim et l’accord n’est pas aussi avantageux qu’il aurait pu l’être.
La discussion sur des positions est dépourvue d’efficacité
Logiquement, ce type de négociation qui n’en finit pas n’est pas très efficace. Les négociations sur les positions traînent en longueur et s’enlisent. Pourquoi ? Car, pour être sûrs de parvenir à nos fins, nous partons de positions extrêmes, afin de nous donner une marge d’évolution.
À chaque instant, nous devons décider que faire. L’autre partie est dans la même situation. Il y a trop de décisions à prendre. Les concessions sont lentes à se former et chacun cherche à gagner le plus de temps. Bref, ce n’est pas très efficace !
La discussion sur des positions compromet les relations existantes
En affrontant ainsi leurs volontés, les négociateurs en finissent par abîmer leurs relations. Nous nous fâchons, nous nous frustrons. Nous avons le sentiment de n’avoir pas été profondément entendus.
« La colère et la rancœur suscitées par une aventure de ce genre durent parfois toute une vie. » (Comment réussir une négociation, Chapitre 1)
Quand les parties en présence sont nombreuses, la négociation sur des positions est pire encore
C’est déjà compliqué à deux, mais lorsqu’il y a encore plus de parties en présence, ce type de négociation aboutit encore plus souvent à des blocages et à des tensions extrêmes.
La gentillesse ne constitue pas une réponse
« Face à ce mode de négociation « dure », il existe un mode de négociation « doux » qualifié par le terme de « gentillesse ». Dans ce cas, nous cherchons à satisfaire nos amis en évitant le conflit. Dès lors, nous changeons facilement d’avis et nous faisons des offres en vue d’arriver à un accord le plus rapidement possible.
Le problème avec cette manière de faire, c’est que nous pouvons facilement nous faire abuser. Tout d’abord, l’accord risque de ne pas être à notre avantage. Mais surtout, nous nous mettons « à la merci » du négociateur « dur ».
La solution de rechange
Toutes les négociations comportent deux niveaux :
Le fond, ce qui doit être décidé ;
La forme, c’est-à-dire la partie procédurale, la façon dont la négociation sera menée.
Sans toujours nous en rendre compte, nous négocions sur la forme aussi bien que sur le fond. En fait, il s’agit d’un jeu (ou d’une négociation) sur les règles du jeu elles-mêmes (faut-il être doux ou dur ?).
C’est au niveau de ce « méta-jeu » qu’il faut se placer. Au lieu d’utiliser des techniques de négociation douces ou dures, il est préférable d’utiliser le système appelé « négociation raisonnée » ou « négociation sur le fond » inventé par les auteurs.
Celui-ci, selon Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton, peut être utilisé dans presque toutes les situations.
Il contient quatre éléments :
Hommes : séparer les gens du problème.
Intérêts : se concentrer sur les intérêts, pas sur les positions.
Solutions : inventer plusieurs options avant de se décider.
Critères : insister sur l’établissement de critères objectifs.
Démêler les gens et leurs émotions du problème en question permet aux deux parties de travailler ensemble en équipe, plutôt que l’un contre l’autre. L’accent mis sur les intérêts porte quant à lui à privilégier les besoins réels des personnes plutôt que leur égo. Penser à de nombreuses solutions aide à soulager la pression et à accroître la coopération, tandis que l’utilisation d’une norme externe et équitable au lieu d’en rester à la seule volonté des négociateurs.
Ces éléments peuvent et devraient être utilisés aux trois étapes de la négociation :
L’analyse. ;
La mise au point d’un plan ;
La discussion.
Si vous suivez cette façon de négocier raisonnablement, le résultat sera probablement un règlement du conflit judicieux, efficace et à l’amiable.
Partie II. La méthode
2 — Traiter séparément les questions de personnes et le différend
Les négociateurs sont avant tout des personnes
« Une donnée fondamentale que l’on a tendance à oublier au cours de négociations, en particulier au sein de grosses entreprises ou de conférences internationales, c’est que les autres, ceux de la partie adverse, ne sont pas des représentants abstraits mais des êtres humains. » (Comment réussir une négociation, Chapitre 2)
Eh oui, les négociateurs sont des gens ; ils ont des désirs, des besoins et des préjugés. C’est encore plus vrai — ou encore plus visible — lorsque nous nous disputons avec notre conjoint ou conjointe, par exemple.
Parfois, ces relations humaines concourent à la réussite de la négociation : lorsque l’amitié prime. Mais souvent, nous comprenons mal les bonnes intentions d’autrui et nous nous sentons rapidement menacés. Notre égo prend le dessus.
Résultat : une réaction en chaîne de récriminations qui aboutit à l’échec de la négociation.
L’intérêt du négociateur est double : le différend ET la relation avec l’adversaire
Les négociateurs ont en général deux objectifs :
Obtenir ce qu’ils veulent (c’est-à-dire servir leur propre intérêt) ;
Maintenir une bonne relation avec l’autre partie.
Il est rare, en effet, que nous nous moquions complètement de la pérennité de la relation avec autrui. Même dans le commerce, nous souhaitons fidéliser le client pour qu’il revienne. Il faut donc se montrer conciliant pour que celui-ci accepte de faire de nouveau appel à nous.
Le problème, c’est que les deux objectifs s’embrouillent très souvent lorsque nous négocions à partir de positions « dures ». Par exemple, nous profitons des défauts personnels d’autrui pour l’emporter et cela crée une rupture qui peut être définitive.
Traiter séparément les questions de relation et celles de fond : il faut aborder sans détour les problèmes humains
Les différences personnelles devraient être résolues, non pas en faisant des concessions (et encore moins en se laissant manipuler), mais en changeant la façon dont nous traitons l’autre partie.
Autrement dit, nous devons apprendre à traiter nos partenaires avec psychologie. Or, les psychologues utilisent une classification des problèmes humains en 3 grandes catégories :
Perception ;
Affectivité ;
Communication.
Nous devons appliquer les conseils qui suivent aussi bien à nous-mêmes qu’aux autres personnes qui entrent dans la négociation.
La perception
Les personnes ou les pays se disputent autour de possessions ou d’événements. Mais le plus souvent, peu importe les faits. Vous pouvez chercher à apporter des preuves, celles-ci ne sont qu’un argument parmi d’autres.
Ce qui importe avant tout, c’est la perception qu’a l’autre du problème. Le conflit naît et se situe au niveau des idées différentes que les deux parties ont formées. Il faut donc être capable de se mettre dans la peau de l’adversaire. C’est capital.
« Le pouvoir de se mettre dans la peau de son adversaire n’est pas donné à tout le monde ; c’est pourtant un des talents les plus essentiels qu’un négociateur devrait posséder. » (Comment réussir une négociation, Chapitre 2)
Il n’est pas nécessaire d’être en accord avec le point de vue d’autrui, ; simplement de prendre le temps de le comprendre. Ce faisant, nous éliminons certains préjugés et nous améliorons notre capacité à négocier et à résoudre le conflit.
Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton donnent plusieurs autres conseils pour améliorer la perception réciproque des négociateurs :
Ne supposez pas que vos peurs décrivent leurs intentions.
Ne prétendez pas que votre problème est de leur faute.
Discutez et reconnaissez leurs perceptions, y compris celles qui vous semblent sans importance.
Surprenez-les en allant à l’encontre de leurs préjugés négatifs à votre égard.
Incluez-les dans tous les aspects d’une décision.
Assurez-vous qu’ils considèrent l’accord comme juste et non comme une concession humiliante.
L’affectivité
Les auteurs commencent par mettre en avant le fait que nous devrions, en tant que négociateurs, constamment faire attention aux émotions qui nous traversent et qui traversent la partie adverse. Ces émotions peuvent être la colère, la peur ou la distraction, par exemple.
Il est toujours bon de « prendre la température » et de chercher à modifier le curseur pour atteindre un état de calme et de confiance.
Pour ce faire, concentrez-vous sur les cinq « préoccupations essentielles » des individus ou des groupes. À savoir le besoin d’/de :
Autonomie ;
Appréciation ;
Affiliation ;
Rôle ou de but ;
Statut.
Par ailleurs, veillez à :
Respecter l’identité, c’est-à-dire l’image de soi de l’autre partie.
Reconnaitre les émotions et inviter autrui à partager les siennes.
Permettre à chacun de se « défouler » pendant un moment.
Éviter de répondre aux accès de colère.
Proposer des gestes symboliques (une poignée de main, un repas partagé, de courtes excuses).
De cette façon, nous pouvons garder les relations sur des bases affectives saines.
La communication
« Sans communication, point de négociation », disent les auteurs. En effet, la négociation suppose la communication pour arriver à une décision commune. Mais ce n’est pas aussi facile que ça en a l’air !
Trois problèmes principaux bloquent régulièrement la communication.
Lorsque celle-ci n’a pas pour fin de se comprendre mutuellement mais plutôt de manipuler des tiers (spectateurs au débat, par exemple) ;
Quand les négociateurs cessent tout simplement d’écouter la partie adverse, le plus souvent afin de préparer leur propre réplique ;
Quand il y a malentendu véritable, en raison d’une barrière linguistique ou culturelle.
Pour chercher à tempérer ou résoudre ces trois enjeux, Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton proposent les alternatives suivantes :
Se placer dans une attitude d’écoute active et montrer que l’on comprend :
S’exprimer de manière claire pour être compris ;
Parler de soi, et non des autres ;
S’exprimer dans un but précis.
Mieux vaut prévenir
« Il est toujours préférable de traiter les questions de personnes avant qu’elles ne deviennent des problèmes. » (Comment réussir une négociation, Chapitre 2)
Pour ce faire, vous veillerez à établir une relation constructive avec votre interlocuteur, c’est-à-dire ne pas avoir peur de se montrer comme une personne à part entière. Cela dit, vous ferez attention, dans la négociation elle-même, à ne pas attaquer la personne elle-même, mais toujours l’objet du différend lui-même — en prenant soin de laisser la personne (son identité, ses besoins légitimes, etc.) en sécurité.
3 — Se concentrer sur les intérêts en jeu et non sur les positions
Pour trouver une solution judicieuse, il faut concilier les intérêts, pas les positions
« Faire la distinction entre positions et intérêts, voilà ce qui compte vraiment dans une négociation. » (Comment réussir une négociation, Chapitre 3)
Mais comment faire ? En fait, les intérêts sont « les moteurs silencieux de l’action ». Ce sont nos besoins, nos craintes, nos désirs et nos soucis réels. Par contraste, les positions en sont « les bruyantes manifestations ». D’où l’importance de savoir bien écouter.
Selon Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton, l’avantage de partir des intérêts est que ceux-ci offrent plusieurs voies de règlement du conflit. Par ailleurs, la conciliation d’intérêts vaut mieux que le compromis sur les positions parce qu’il est toujours possible de trouver davantage de points communs au niveau des intérêts.
En effet, « sous » chaque position, il y a plusieurs intérêts qui peuvent se révéler conciliables ou antagoniques. Et c’est parce que nos intérêts divergents que nous pouvons nous entendre.
« Le cas du marchand de chaussures et de son client en est l’illustration la plus simple : ils ont besoin d’argent et de chaussures l’un et l’autre, mais inversement : le chausseur préfère gagner 50 dollars et vendre ses chaussures, le client préfère prendre les chaussures et donner ses 50 dollars. Ils sont faits pour s’entendre ! » (Comment réussir une négociation, Chapitre 3)
Comment déterminer les intérêts en jeu
Il existe au moins deux techniques pour faire surgir les intérêts des parties en cause.
La première est de poser la question « Pourquoi ? » en se mettant à la place de l’adversaire.
La deuxième consiste à se poser la question « Pourquoi pas ? » en se demandant pourquoi l’adversaire refuserait la première proposition qu’il pense que nous lui ferions.
Vous devez également prendre en compte le fait qu’il existe plusieurs intérêts en jeu. Souvent, les négociateurs parlent pour des mandants (des personnes qui l’ont chargé de négocier). Il faut retrouver toute la palette des intérêts qui s’expriment plus ou moins clairement dans les négociations.
Le plus souvent, ce sont les exigences fondamentales de l’être humain qui jouent le rôle le plus important. À savoir :
La sécurité ;
Le bien-être économique ;
L’appartenance à une communauté ;
L’identification ;
La maîtrise de sa destinée.
Les auteurs conseillent de dresser la liste des intérêts en jeu afin de les garder en mémoire tout au long de la procédure de conciliation.
Chacun doit aborder la question de ses préoccupations
Lorsque nous nous engageons dans une négociation raisonnée, nous souhaitons parler de façon constructive des intérêts en jeu. Bien. Mais quelle est la marche à suivre pour que ce soit efficace ?
Voici les derniers conseils des auteurs :
Soyez concret dans vos explications ;
Admettez les intérêts d’autrui dans la discussion ;
Commencez par une question et non une solution ;
Soyez orienté vers l’avenir ;
Expliquez ce que vous voudriez faire au lieu de vous justifier ;
Soyez résolu mais conciliant, ouvert aux idées d’autrui ;
Restez ferme sur la question débattue et conciliant avec les participants.
4 — Imaginer des solutions procurant un bénéfice mutuel
Diagnostic
Souvent, les négociations sont centrées sur des questions uniques — une somme d’argent à recevoir ou un territoire à garder, la garde des enfants dans un divorce, etc. — où nous pensons qu’il y aura toujours un gagnant et un perdant. Ou, si nous ne sommes pas perdants, nous éprouvons à tout le moins une insatisfaction.
Finalement, une solution optimale est souvent négligée et il en résulte beaucoup de « pertes ». C’est l’exemple du partage de l’orange : si je veux manger la chair et que l’autre veut la peau pour faire un gâteau, pourquoi s’obstiner à la couper en deux et à donner à chacun une partie ? Il aurait été plus judicieux de donner toute la pelure à l’un et toute la chair à l’autre.
« Nous devons donc nous efforcer de trouver des options qui élargissent la ressource contestée au lieu de simplement la diviser. Mais pourquoi les négociateurs négligent-ils la plupart du temps cette approche raisonnée ou « sur le fond » ?
Pour quatre raisons selon Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton :
Les jugements hâtifs (vouloir aller trop vite) ;
La recherche de la seule et unique réponse (croire qu'il n'y a qu'une bonne solution) ;
L'hypothèse selon laquelle les limites du gâteau sont fixées une fois pour toutes ;
L'idée que les difficultés de l'adversaire ne regardent que lui.
Au contraire, toute la méthode de la négociation raisonnée passe, comme nous allons le voir, par l'empathie et la recherche concertée de solutions variées.
Ordonnance
Quatre lignes directrices pourront vous aider à améliorer la recherche de solutions mutuellement satisfaisantes :
Dissocier l'invention et la décision ;
Élargir le champ des possibles (carte en rond) ;
Rechercher un bénéfice mutuel ;
Faciliter la tâche de l'adversaire quand il devra se prononcer.
La première consiste à séparer le processus créatif du processus de décision : « Inventez d'abord, décidez plus tard ». Pour ce faire, les auteurs conseillent de mettre sur pied des sessions informelles de brainstorming en petits groupes.
Une autre façon de faire (complémentaire) est d'élargir le champ des possibles. Les auteurs proposent une carte "en rond" qui vous aidera à inventer des solutions (p. 115) :
Questions à résoudre ;
Analyse et diagnostic de la situation ;
Angles d'attaque ;
Solutions.
Une troisième proposition consiste à rechercher un bénéfice mutuel qui élargit les ressources. Le secret est de trouver des choses qui coûtent très peu à une partie, mais que l'autre partie souhaite vraiment.
La quatrième ligne directrice est de faire en sorte qu'il soit facile pour l'autre partie de dire oui. Penser à dessiner votre solution de telle manière à ce qu'elle soit facile à mettre en œuvre et que chaque partie se sente honorée.
5 — Exiger l'utilisation de critères objectifs
Les décisions fondées sur la seule volonté sont coûteuses
Nous l'avons vu tout au long des précédents chapitres, les compromis issus des négociations dures ou douces ne sont pas souvent optimaux. Ils prennent du temps et, lorsqu'ils aboutissent, laissent souvent une partie insatisfaite. La ressource en jeu aurait pu être allouée de manière plus juste et plus efficace.
L'un des critères de la méthode de la négociation raisonnée consiste à exiger l'utilisation de critères objectifs.
En quelles circonstances utiliser un critère objectif ?
Parfois, aucune des parties ne peut trouver une solution à un conflit. Dans cette situation, une partie extérieure et neutre peut être amenée pour décider de la question.
Par exemple, si un entrepreneur et un acheteur ne peuvent pas se mettre d'accord sur la profondeur minimale de la fondation d'un bâtiment, ils peuvent se référer aux normes des régulateurs locaux ou à la pratique courante de la région.
De cette façon, la décision est établie sur des bases objectives plutôt que sur la volonté des négociateurs. De tels accords sont plus stables, car ils reposent sur des règles éprouvées ; ils sont également plus efficaces, car des normes communes résolvent automatiquement de nombreux problèmes.
La mise au point d'un critère objectif
"Si l'on décide d'adopter la méthode de négociation raisonnée, deux questions se posent : comment mettre au point des critères objectifs, comment les utiliser dans la discussion." (Comment réussir une négociation, Chapitre 4)
Les auteurs passent en revue différents types de critères et de procédures à utiliser dans les négociations. Concernant le critère d'équité (qui signifie "justice"), il doit "être indépendant de la volonté des parties en présence" et "acceptable pour les deux parties en présence". Dans la réalité, il existe une diversité de critères objectifs possibles et il faudra donc prioritairement tomber d'accord sur celui (ou ceux) à utiliser.
Au sujet des procédures équitables, les auteurs évoquent l'importance de mettre en place des systèmes qui minimisent l'injustice (ou le sentiment d'injustice). Par exemple :
La procédure "l'un coupe, l'autre choisit" ;
Le tirage au sort ;
Le choix à tour de rôle ;
L'arbitrage d'un tiers ;
Etc.
Fonder les discussions sur un critère objectif
Il faut se mettre d'accord sur les procédures et les critères à utiliser. Mais comment faire ? Comment convaincre l'adversaire ? Trois principes fondamentaux doivent guider les discussions :
Présenter chaque question comme la recherche commune d'un critère objectif ;
Être disposé à raisonner et rester ouvert à la recherche de critères mieux adaptés ;
Demeurer impassible face aux pressions, mais s'incliner devant les principes.
Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton développent ces trois aspects en donnant de nombreux exemples. Retenons ici que l'établissement de principes objectifs permet de résister aux pressions (chantages, pots de vin, etc.) d'une partie ou de l'autre et d'obtenir justice plus aisément.
Partie III. Oui mais…
6 — Que se passe-t-il quand la partie adverse est manifestement plus puissante ?
Se protéger
"Quand on se précipite à l'aéroport parce qu'on craint de rater le départ d'un avion, on agit comme si c'était une question de vie ou de mort. En y réfléchissant à tête reposée, on se rend compte qu'on aurait fort bien pu prendre le suivant sans que cela constitue une catastrophe." (Comment réussir une négociation, Chapitre 6)
Il en va de même avec les négociations. Nous avons tendance à nous précipiter quand nous avons investi beaucoup de temps dans les discussions. Nous risquons alors de nous montrer trop "doux" et de laisser l'adversaire prendre le dessus.
Pour éviter de tomber dans cet écueil, vous pouvez fixer un seul non négociable, au-delà duquel vous refuserez d'aller. Mais c'est revenir à une forme de négociation "dure" qui limite l'imagination. À la place de cette stratégie classique, les auteurs privilégient la MEilleure SOlution de REchange — ou MESORE.
La MESORE est un "moyen d'évaluer tout accord pour savoir si l'on a intérêt ou non à le signer". Elle repose sur l'hypothèse de ce qui serait réalisé si l'accord n'aboutissait pas au bout d'un certain temps.
Il convient d'y penser sérieusement, et non de façon vague. Autrement dit, vous devez savoir clairement quelles sont les options réalistes de remplacement qui s'offrent à vous si l'accord n'aboutit pas ou ne prend pas la direction initialement souhaitée.
Tirer le meilleur parti de ses atouts
La MESORE se révèle plus importante que l'argent, l'influence sociale ou le poids politique respectif de chaque partie. Mais comment l'élaborer ? Vous devrez agir en trois temps :
Imaginer plusieurs solutions de repli qui vous conviendraient si l'accord devait échouer ;
Approfondir les idées les plus intéressantes et concevoir leur mise en application pratique ;
Opter pour la meilleure d'entre elles.
Vous devriez également faire de même avec l'adversaire — c'est-à-dire étudier quelle est sa MESORE probable. Si vous la trouvez, vous serez davantage en mesure de trouver un accord judicieux, efficace et amical.
Quand l'adversaire est tout-puissant
Lorsque l'autre est vraiment plus fort, il faut chercher à s'appuyer autant que possible sur les principes objectifs décidés en amont, aussi bien les critères d'équité que les procédures équitables.
Avoir une bonne MESORE vous permettra également de gagner en force, puisque vous vous sentirez capable de quitter la table des négociations lorsque l'adversaire cherchera à vous intimider.
"Un négociateur qui possède une MESORE est donc plus apte non seulement à déterminer l'accord minimum qu'il peut accepter mais encore à l'obtenir. Rechercher sa MESORE est certainement la ligne de conduite la plus efficace qu'il puisse adopter quand il affronte un négociateur apparemment plus puissant." (Comment réussir une négociation, Chapitre 6)
7 — Que se passe-t-il quand la partie adverse refuse de jouer le jeu ?
Nous pouvons nous retrouver dans des situations où l'adversaire refuse de jouer le jeu de la négociation raisonnée. Dans ce cas, il se placera le plus souvent dans une posture de position "dure" et cherchera par tous les moyens à nous faire plier. Que faire, dans ce cas ?
Trois angles de réponses sont à envisager :
Ce qu'il convient de faire personnellement, à savoir suivre la méthode raisonnée afin de créer une dynamique positive ;
Ce que l'adversaire peut faire et à quoi nous pouvons l'amener par la "négociation jiu-jitsu".
L'utilisation d'une tierce personne "pour orienter la discussion sur les intérêts, les propositions et les critères".
La première tactique fait, d'une certaine manière, l'objet de tout le livre, puisqu'elle consiste simplement à mettre en œuvre la négociation raisonnée de façon résolue dans l'espoir que l'autre y reconnaitra également son intérêt. Concentrons-nous donc sur les deux autres.
La négociation jiu-jitsu
La bonne tactique consiste à ne pas répondre aux critiques qui nous poussent dans nos retranchements. Pourquoi ? Pour éviter le cercle vicieux des contre-critiques qui nous ferait revenir à une négociation "dure" classique.
L'enjeu consiste plutôt à l'esquiver et à "la faire dévier dans le sens de la question en cours"
"Au lieu de résister à ses efforts, il faut les canaliser pour qu'ils participent à la recherche des intérêts communs, à l'invention de solutions avantageuses fondées sur des critères objectifs." (Comment réussir une négociation, Chapitre 7)
Pour maîtriser cet art de la négociation, il vous faudra (p. 168-171) :
"Découvrir sur quoi repose la position de l'adversaire au lieu de l'attaquer."
"Rechercher la critique et les conseils de la partie adverse, sans défendre ses propres idées."
"Savoir ramener les attaques personnelles vers les questions de fond."
"Poser des questions et attendre."
La procédure à texte unique
Au lieu de partir de positions et de faire des concessions qui nous laissent fatigués et aigris, mieux vaut parfois avoir directement recours à une personne tierce — un médiateur. Celui-ci peut utiliser la procédure à texte unique pour agir efficacement, amicalement et judicieusement.
Prenons l'exemple d'un couple avec deux projets de maison différents (donné par les auteurs). Ils font un appel à un architecte. Celui-ci décide de s'enquérir des intérêts de chacun (et non de leurs positions), puis réalise une liste de desiderata qu'il soumet à leurs critiques.
À partir de là, il peut créer un avant-projet. De nouveau, ronde de critiques de la part du mari comme de la femme (il est plus facile de critiquer que de faire des concessions, rappellent les auteurs). Deuxième projet et même dynamique, jusqu'à aboutir à un accord.
Le cercle, ici, est vertueux. Pourquoi ? Car :
Il n'a pas engagé l'amour propre des époux, ni le sien.
Il a fait au mieux à partir des intérêts (désirs, besoins, craintes, etc.) de chacune des parties, et les a invités à construire ensemble un projet unique.
En outre, il a pris en compte une série de contraintes (légales, physiques, etc.) objectives. Les époux savent ce qui les attend et peuvent se décider ensemble.
Dans la suite du chapitre, Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton proposent une étude détaillée d'un autre cas issu de la vie réelle : une négociation entre un propriétaire et son locataire : l'affaire Agence Jones/Frank Turnbull (p. 178-193).
8 — Que se passe-t-il quand la partie adverse triche ou recourt à des moyens déloyaux ?
Parfois, les négociateurs sont particulièrement coriaces et n'hésitent pas à employer des méthodes douteuses pour "gagner" coûte que coûte la négociation. C'est ce que les auteurs nomment la négociation truquée.
Le plus souvent, nous nous irritons tout en "laissant passer" et en nous promettant que nous ne ferons plus jamais affaire avec cette personne (ou ce groupe). Ou bien alors nous rétorquons en rendant coup pour coup.
Comment y répondre plus sainement ? En prenant conscience que :
"La négociation truquée n'est jamais qu'une manière de tirer la couverture à soi sur la forme. On réagira donc en faisant une question de procédure — quelle est la méthode de négociation choisie par les parties ? Et l'on entamera donc une négociation raisonnée sur la procédure." (Comment réussir une négociation, Chapitre 8)
Comment discuter des règles de négociation
Il faut nécessairement :
Comprendre ce qu'il se passe et mettre le doigt sur les tactiques employées) ;
Exprimer à l'autre ce que nous avons compris ;
Lui proposer de discuter de la forme de la négociation.
Autrement dit, il faut appliquer la négociation raisonnée à la forme elle-même en cherchant à comprendre les intérêts qui poussent l'adversaire à tricher et en l'amenant à un accord sur les règles à suivre.
Pour vous aider à identifier ce qui se passe, les trois sections suivantes sont consacrées à trois catégories de tactiques déloyales :
Le mensonge délibéré ;
La guerre psychologique ;
Les pressions.
Les mensonges délibérés
Dans cette section, les auteurs abordent les types de mensonges délibérés :
Faux renseignements (un classique pour tromper l'adversaire) ;
Autorité mal définie (identification claire du mandant et des marges de manœuvre du négociateur) ;
Intentions sujettes à caution (incertitude sur le respect de la parole donnée).
Cela dit, ne considérez pas que cacher une partie de son jeu équivaut à l'une de ces formes de triche. Vous pouvez garder certaines informations pour vous, même dans la négociation raisonnée. L'important est de suivre la méthode et, le cas échéant, de faire appel à une personne tierce pour aider à la construction d'une solution.
La guerre psychologique
Une autre façon de colorer négativement la procédure de la négociation consiste à s'en prendre aux sentiments des personnes en les mettant mal à l'aise. Les auteurs abordent les cas des/de :
Situations angoissantes ;
Attaques personnelles ;
Tactique du bon et du méchant ;
Menaces.
Au lieu de menaces, vous pouvez opter pour des avertissements. Ceux-ci ne visent pas à réclamer et à annoncer une punition pour la partie adversaire, mais plutôt à montrer que vous protégerez vos intérêts.
De façon générale, le négociateur raisonné refusera de répondre à ces intimidations et cherchera toujours à remettre la discussion sur des rails constructifs.
La stratégie de la pression dans la négociation de position
"Cette stratégie consiste à placer d'emblée l'adversaire dans une position où lui et lui seul sera en mesure de faire des concessions." (Comment réussir une négociation, Chapitre 8)
Voici quelques "mauvaises manières" utilisées par les négociateurs coriaces :
Refus de négocier ;
Exigences extrêmes ;
Exigences sans cesse croissantes ;
Stratégie de blocage ;
Le coup du partenaire têtu ;
La temporisation ;
Le choix décisif ("c'est à prendre ou à laisser").
Chacune de ces tactiques est exposée en détail par Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton.
Refuser d'être une victime
Refuser d'être une victime, cela signifie qu'il est possible de déclarer ouvertement que nous souhaitons voir advenir une négociation en bonne et due forme. Nous pouvons nous montrer fermes sur ce point et nous devrions l'être.
Par ailleurs, nous ne devrions pas nous laisser aller à être un "bourreau". Pour ce faire, nous pouvons nous demander ce que nous sommes en train de faire ou prêt à faire. Certaines questions peuvent nous aider à maintenir le curseur vers l'équité, l'efficacité et l'amabilité. Par exemple :
"Est-ce une démarche que j'adopterais en face d'un ami ou d'un membre de ma propre famille ?"
"Si la totalité de ce que j'ai dit et fait était rendue publique, est-ce que j'en éprouverais de la gêne ?"
Etc.
En conclusion : trois remarques
"Je le sais depuis toujours."
Les préceptes et idées développées ici forment "ce que le bon sens et l'expérience commune mettent à la portée de chacun de nous". Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton ne prétendent donc pas avoir inventé de toutes pièces une nouvelle méthode, mais plutôt s'être inspirés de pratiques déjà existantes.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron
La négociation se pratique… Sans cela, vous ne deviendrez pas un négociateur expert. Et tous les livres que vous lirez — même les meilleurs — n'y changeront rien.
"Gagner."
"Demander à un négociateur "alors, qui a gagné ?" est à peu près aussi déplacé que de poser la même question aux deux conjoints d'un ménage." (Comment réussir une négociation, Conclusion)
L'objectif de la négociation n'est pas de "gagner" mais d'"entrer dans une collaboration constructive destinée à élaborer une solution judicieuse à tel ou tel problème commun"
Conclusion sur "Comment réussir une négociation" de Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton :
Ce qu'il faut retenir de "Comment réussir une négociation" de Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton :
Comment réussir une négociation est un livre qui mêle politique, affaires et développement personnel avec beaucoup de perspicacité et de pertinence. Roger Fisher et William Ury ont tous deux présidé le Harvard Negociation Project, rebaptisé Global Negociation Initiative.
Ce livre a été s'est vendu à 15 millions d'exemplaires et a été traduit en 35 langues. il est l'un des ouvrages les plus fréquemment cités sur les listes des meilleurs livres de négociation.
Bref, c'est un classique ! Et dans un sens, il pourra vous rappeler des autres livres comme Cessez d'être gentil, soyez vrai sur la communication non-violente.
Rappelez-vous que la négociation raisonnée a pour but de construire une solution judicieuse (équitable), efficace et à l'amiable entre les parties, en insistant sur trois points :
La focalisation sur les intérêts et non sur les personnes ou les positions ;
L'invention de solutions partagées qui procurent des bénéfices mutuels ;
L'utilisation de critères objectifs et de procédures équitables.
Points forts :
Un manuel très clair et instructif ;
De très nombreux exemples venus des affaires, de la politique et de la vie privée ;
10 questions supplémentaires en fin d'ouvrage pour y voir encore plus clair ;
Une préface à la nouvelle édition, ainsi que les préfaces antérieures ;
Un classique absolu de la négociation à avoir dans sa bibliothèque.
Points faibles :
Je n’en ai pas trouvé.
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu le livre de Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton « Comment réussir une négociation » ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre de Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton « Comment réussir une négociation ».
Visitez Amazon afin d’acheter le livre de Roger Fisher, William Ury et Bruce Patton « Comment réussir une négociation ».
 ]]>
]]>Résumé de « Quand la machine apprend : la révolution des neurones artificiels et de l’apprentissage profond » de Yann Le Cun : l’expert en intelligence artificielle français a séduit la Silicon Valley en contribuant de façon essentielle au développement du machine learning et du deep learning — il partage ici le récit de cette fascinante histoire !
Par Yann Le Cun, 2019, 394 pages.
Chronique et résumé de "Quand la machine apprend : la révolution des neurones artificiels et de l'apprentissage profond" de Yann Le Cun
Qui est Yann Le Cun ?
Yann Le Cun est un expert en intelligence artificielle. Récipiendaire du prestigieux prix Turing, il enseigne à l'université de New York. Il a été l'un des grands initiateurs de l'apprentissage machine et en particulier de l'apprentissage profond lié à la reconnaissance d'images.
Ses travaux ont fait de lui l'un des spécialistes les plus reconnus du domaine et l'ont amené à exercer des fonctions importantes pour la compagnie Facebook.
Dans ce livre de vulgarisation, comme vous allez le voir, Yann Le Cun revient en détail sur son parcours biographique, tout en expliquant sa démarche scientifique. Rien ne sert donc d'en dire trop ici. Lisez la suite !
NB. Si les principaux chapitres ont été conservés tels quels, l'intérieur de chaque chapitre a été résumé et certaines sections ont été fusionnées ou supprimées pour faciliter la compréhension d'ensemble ;).
Chapitre 1 — La révolution de l'IA
"Beaucoup d'observateurs ne parlent plus d'une évolution technologique, mais d'une révolution." (Quand la machine apprend, Chapitre 1)
Et si nous étions au début d'une nouvelle ère technologique ? Sans aucun doute, l'IA est d'ores et déjà omniprésente dans notre quotidien, depuis les logiciels de reconnaissance vocale jusqu'aux logiciels de création d'images, nous avons pris l'habitude de rencontrer l'intelligence artificielle dans notre vie de tous les jours.
Mais ce monde de l'IA n'en est qu'à ses débuts. En fait, "ses limites sans sans cesse repoussées", dit avec enthousiasme Yann Le Cun. De la good old fashioned IA (GOFAI), nous sommes passés à de nouvelles manières de construire et de penser l'intelligence des machines et leur apprentissage.
C'est notamment le passage de ces GOFAI au machine learning, puis au deep learning, dont l'auteur est justement l'un des chefs de file et des pionniers.
Essai de définition
"Je dirais que l'intelligence artificielle est la capacité, pour une machine, d'accomplir des tâches généralement assumées par les animaux et les humains : percevoir, raisonner et agir. Elle est inséparable de la capacité à apprendre, telle qu'on l'observe chez les êtres vivants. Les systèmes d'intelligence artificielle ne sont que des circuits électroniques et des programmes informatiques très sophistiqués. Mais les capacités de stockage et d'accès mémoire, la vitesse de calcul et les capacités d'apprentissage leur permettent d'"abstraire" les informations contenues dans des quantités énormes de données." (Quand la machine apprend, Chapitre 1)
Yann Le Cun est ambitieux et croit en l'innovation qui l'a fait connaître : le deep learning — et en particulier ces réseaux de neurones convolutifs dont nous reparlerons dans la suite de cette chronique. C'est un outil très puissant, mais qui demeure encore limité, car très spécialisé.
Un algorithme est une "séquence d'instructions", une "recette de cuisine" de mathématiciens, rien de plus. Facebook et Google, par exemple, n'en ont pas qu'un (supposé omnipotent ou presque), mais plutôt une "collection", chacun travaillant à une tâche précise.
Commençons par dire un mot du développement de l'IA depuis le milieu du XXe siècle, tout en faisant davantage connaissance avec l'auteur.
Chapitre 2 — Brève histoire de l'IA… et de ma carrière
L'éternelle quête et les premiers sursauts de l'IA
La volonté de donner la vie à des automates n'est pas neuve. Que vous pensiez aux projets du docteur Frankenstein ou à d'autres ouvrages de science-fiction (et même à des mythes anciens), cette idée est présente en l'homme. Faire émerger la vie et la pensée de ses propres mains : voilà l'idée de base.
Mais c'est autour des années 1950, et aux États-Unis, que s'initient les premières grandes manœuvres qui aboutiront à la création du champ d'études nommé "intelligence artificielle.
L'auteur reprend à son compte la notion d'"hiver" de l'IA. Tout se passe en effet en plusieurs étapes. Les premiers engouements des années 1950 et 1960 sont freinés à partir des années 1970. Les institutions états-uniennes et occidentales coupent les fonds à leurs chercheurs.
✅ À noter : pour compléter ce teaser et avoir un aperçu plus général de cette histoire, vous pouvez lire, par exemple, la chronique de L'intelligence artificielle pour les nuls.
Entrée en scène
Penchons-nous plus attentivement sur l'histoire de Yann Le Cun. Il commence à faire ses études dans une école d'ingénieur en électronique à Paris en 1978. En passionné, il lit beaucoup et croise les disciplines. Depuis la linguistique jusqu'à la cybernétique, en passant bien sûr par les mathématiques et l'informatique, tout ce qui se rapproche de l'IA l'intéresse.
Il est encore étudiant à l'IESIEE (son école d'ingénieurs) lorsqu'il a sa première intuition d'algorithme d'apprentissage qui donnera, des années plus tard, les algorithmes dits de "rétropropagation du gradient".
Entré en doctorat en 1984, il travaille beaucoup avec une maîtresse de conférence nommée Françoise Soulié-Fogelman. Grâce à cette collaboration, il va pouvoir réaliser un stage d'un mois en Californie au sein du laboratoire Xerox PARC.
Mais c’est en 1985 que sa vie professionnelle « bascule », lors d’un symposium aux Houches (Alpes françaises). Yann Le Cun y tisse des liens qui le mèneront à travailler au Bell Lab trois ans plus tard. Durant cette année, il dévoile à ses pairs ses recherches. Ceux-ci sont impressionnés.
Durant la seconde moitié des années 1980 (pourtant qualifiées d’hiver de l’IA), Yann Le Cun va patiemment contribuer à l’émergence du champ d’études dit « connexionniste » en IA.
Il termine son doctorat en 1987 et rejoint Geoff Hinton (grand spécialiste et co-inventeur de la "rétropropagation", qui recevra plus tard le prix Turing avec Yann Le Cun) à l'université de Toronto.
Les années Bell Labs
Les travaux du chercheur y sont appréciés. Pourtant, les projets en cours n'arrivent pas à se vendre. Malgré le développement d'un système de compression des données plus efficace que JPEG et PDF (nommé DjVu), c'est l'échec commercial. En cause, pour l'auteur, l'incapacité à commercialiser correctement le logiciel.
Un tabou ?
En fait, au milieu des années 1990, les recherches de Yann Le Cun et de ses quelques collègues deviennent l'objet d'une sorte de rejet ou de tabou par le reste de la communauté du machine learning. Pourtant, bon nombre de chercheurs travaillent ensemble et s'influencent l'un l'autre.
Au début des années 2000, il décide de relancer dans la recherche fondamentale (qu'il avait plus ou moins laissé tomber au Bell Labs pour le projet plus appliqué de DjVu). Il refuse, pour cela, un poste de direction dans la toute jeune entreprise… Google !
Il est embauché en tant que professeur à la New York University en 2003. Avec la "ferme intention de redémarrer un programme de recherche sur les réseaux de neurones et de démontrer qu'ils marchent".
Mais toujours pas facile de se faire accepter… Le reste de la communauté boude cette bande de scientifiques qui refusent le courant majoritaire du machine learning. Pour rendre leurs travaux plus sexys, Yann Le Cun et ses amis renomment leur projet en deep learning. Au début, rien.
Il faut attendre 2006 et surtout 2007 pour que la notion commence à circuler largement et soit peu à peu acceptée dans la communauté scientifique.
]]>Résumé de « L’Erreur de Descartes » d’Antonio R. Damasio : un succès inattendu de librairie pour un livre qui navigue entre neurosciences et philosophie pour démontrer toute l’importance des émotions sur nos manières de penser et d’agir.
Antonio R. Damasio, 1994 (2010 pour la dernière édition), 394 p.
Chronique et résumé de « L’erreur de Descartes » d’Antonio R. Damasio :
Avant d'aller plus loin : qui est Antonio Damasio ?
Neurobiologiste de renom, Antonio Damasio est le directeur du Brain and Creativity Institute (Institut pour l'étude neurologique de l'émotion et de la créativité) de l'université de Californie du Sud. Il enseigne également au Salk Institue for Biological Studies dans la région de San Diego (La Jolla).
Il s'est fait connaître du grand public par la publication de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique exigeante et de grande qualité. L'Erreur de Descartes (initialement paru en 1995, actualisé en 2010) est le premier et sans doute le plus connu. Mais d'autres ont également eu un grand succès :
Le Sentiment même de soi : corps, émotions, conscience (1999) ;
Spinoza avait raison : joie et tristesse, le cerveau des émotions (2003) ;
L'ordre étrange des choses : la vie, les émotions et la fabrique de la culture (2017) ;
Sentir et savoir : une nouvelle théorie de la conscience (2021).
Préface à la nouvelle édition
Antonio Damasio propose ici un résumé très rapide du développement des neurosciences et de ses espoirs pour l'avenir. Il cite rapidement les pionniers de la psychologie scientifique du début du XXe siècle ayant questionné le rôle des émotions chez les humains :
Charles Darwin ;
William James ;
Sigmund Freud ;
Charles Sherrington.
Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, un fossé s'est creusé entre le domaine naissant des neurosciences (qui s'intéresse au fonctionnement du cerveau humain) et l'étude des sentiments. Heureusement, la publication de L'Erreur de Descartes a changé la donne.
Selon l'auteur, il existe des marqueurs somatiques (expliqués plus loin dans l'ouvrage) qui permettent de faire le "pont" entre émotion et raison. Cela permet de montrer que :
Certes, les émotions peuvent créer des préjugés et nuire au raisonnement.
Mais qu'elles interviennent également de façon beaucoup plus positive qu'on ne le croit souvent.
En fait, selon Antonio Damasio, la raison a évolué à partir des émotions. Celles-ci peuvent augmenter la prise de décision et son efficacité et ainsi nous assurer de meilleures chances de survie.
Notre instinct nous guide en se rappelant des bonnes décisions prises par le passé. Plus encore, nos sentiments et nos émotions jouent un grand rôle dans l'apprentissage et, notamment, dans l'apprentissage des règles sociales.
Les sciences humaines et sociales (et par extension, le marketing (digital), par exemple) peuvent-elles apprendre quelque chose de la neurobiologie ? C'est ce qu'espère l'auteur !
Introduction
Les philosophes et les scientifiques opposent souvent raison et passion. Mais l'auteur souhaite remettre en question cette opposition. Comment en est-il venu à se questionner à ce sujet ?
Il raconte une anecdote d'un patient qui ne pouvait plus ressentir d'émotions en raison d'une maladie neurologique. La personne était intelligente, mais elle ne pouvait plus, suite à son problème de santé, prendre des décisions "socialement appropriées" ou "personnellement avantageuses".
Que s'était-il passé ? Pour l'auteur, c'était le signe que prise de décision rationnelle et émotions avaient un lien. En tant que spécialiste de neurobiologie, Antonio Damasio en a fait une hypothèse scientifique : la raison nécessite la capacité de ressentir des sentiments pour agir correctement.
Après 20 ans de recherche clinique, son hypothèse devient enfin une théorie "viable". Son travail montre que le cerveau n'est pas le seul centre de raisonnement. En fait, il semble que les pensées humaines soient régulées au sein d'une organisation complexe de réseaux neuronaux qui dépasse le seul cerveau.
Tous nos ressentis et émotions participent à nous faire agir dans un sens ou dans un autre. Plus précisément, c'est grâce à eux que nous pouvons adhérer à des principes moraux ou des conventions sociales. Éthique et biologie sont donc étroitement corrélées.
Autre contribution majeure des recherches de l'auteur : l'idée que les sentiments ne sont pas seulement "dans la tête" mais plutôt un reflet de ce qui se passe dans l'ensemble du corps. En réalité, ils sont des guides internes qui permettent une surveillance continue de l'état du corps et qui nous renseignent sur notre état (douleur, plaisir, joie, satisfaction, etc.).
Nous avons tendance à oublier que notre cerveau — où nous plaçons notre "esprit" et notre intelligence — est le fruit d'une évolution qui commence par le reste du corps. Or, c'est d'abord par les organes sensoriels que nous appréhendons notre environnement ; la raison ne vient que dans un deuxième temps !
Première partie
Chapitre 1 : Désagrément dans le Vermont
Antonio Damasio commence par raconter l'histoire de Phineas P. Gage, un travailleur des chemins de fer très promis à une belle carrière dans le Vermont de la fin du XIXe siècle. Doué, proactif et sociable, il avait tout d'un futur leader.
Malheureusement, un accident survint : le cheminot reçut une barre de métal droit dans la tête, transperçant de la joue jusqu'au crâne. Il n'en mourut pas, mais — chose étrange — sa personnalité changea du tout au tout. Il avait toujours un côté rationnel, mais n'avait plus aucune discipline et ne pouvait plus se comporter correctement en société.
Licencié par son employeur, il mourut à 38 ans. Son cas devint célèbre auprès des médecins.
Pourtant, les scientifiques de l'époque n'interrogèrent pas directement le lien entre le dommage cérébral et les défaillances éthiques et sociales de Phineas P. Gage, excepté son propre médecin, le Dr. Harrow.
Pour Antonio Damasio, cette histoire montre qu'agir de façon personnellement et socialement avantageuse requiert au moins deux composantes :
La connaissance des règles sociales ;
Le fonctionnement correct des systèmes cérébraux qui y sont liés.
Toutefois, de nombreuses énigmes restent à éclaircir, et les témoignages et les relevés réalisés à l'époque ne permettent pas de lever tout le mystère.
Chapitre 2 : L'étude du cerveau de Gage
Antonio Damasio explique comment l'affaire fut résolue dans le monde scientifique à l'époque :
Les médecins Paul Broca et Carl Wernicke considérèrent que les lésions cérébrales avaient causé une aphasie (altération du langage). Après quelques hésitations, le monde scientifique se rangea sous cette explication.
L'hypothèse du Dr. Harlow (selon laquelle les dommages causés à certaines zones du cerveau affecteraient le comportement social) n'a, quant à elle, pas été reprise aussi largement par le corps scientifique et médical.
Néanmoins, le Dr. Harlow réussit à convaincre la famille de Phineas Gage de donner le crâne du pauvre homme à la science pour plus d'études. Il se trouve aujourd'hui à la Harvard Medical School.
Beaucoup plus récemment, la neuroscientifique Hanna Damasio développa un système novateur pour réétudier le cerveau de Phineas Gage. Elle remarqua que les zones dédiées au langage et au mouvement étaient intactes, mais que l'hémisphère gauche et la région préfrontale étaient eux davantage touchés.
Or, les recherches récentes montrent que ces régions sont impliquées dans la prise de décision. Sa conclusion va donc plutôt dans le sens de l'hypothèse du Dr. Harlow.
Si vous êtes intéressés par les détails de l'anatomie du système nerveux, Antonio Damasio propose un "intermède" assez technique sur ce sujet p. 48-55.
Chapitre 3 : un Phineas Gage d'aujourd'hui
Elliot est le nom fictif d'un patient qu'Antonio Damasio a évalué durant sa carrière. Sa personnalité avait radicalement changé à la suite de lésions du cortex préfrontal dues à une opération pour lui retirer une tumeur cérébrale.
Pour l'auteur, le cas d'Elliot était "une version particulièrement pure" de l'état de Phineas Gage : son intellect demeurait ici aussi intact, mais ses aptitudes à décider correctement pour lui-même et en contexte social avaient empiré.
Comme Phineas, Elliot avait perdu son emploi. Malheureusement, il n'avait reçu aucune prestation d'invalidité de l'État, car celui-ci n'avait pas reconnu son problème. C'est pourquoi son médecin cherchait à faire connaître sa maladie en venant trouver l'auteur de L'erreur de Descartes.
Comme Phineas, il commença à avoir des attitudes bizarres, comme collectionner des déchets. Pire, il ne parvenait plus à faire des plans pour le futur et à maintenir une attitude sociale ; il divorça même deux fois. Pourtant, Elliot paraissait étrangement distant lorsqu'il racontait toutes les tristes histoires qui lui étaient arrivées. Et il en était conscient…
C'est là que le neurobiologiste se rendit compte qu'il fallait qu'il prenne en compte les émotions ! Lors de tests ultérieurs menés en laboratoire, Antonio Damasio prit conscience que son patient connaissait les règles de conduite sociale, mais n'arrivait pas à les appliquer dans la vie réelle.
Il émit alors pour la première fois son hypothèse centrale : la réduction de la réactivité émotionnelle d'Elliot devait être liée, d'une manière ou d'une autre, à son incapacité à agir correctement en société.
Chapitre 4 : De sang-froid
"Personne n'a jamais douté que, dans certaines circonstances, l'émotion perturbe la faculté de raisonnement. Les preuves en sont abondantes et sont à l'origine du conseil fort juste que nous avons tous appris depuis notre plus jeune âge : Gardez la tête froide, contrôlez vos émotions ! Ne laissez pas vos passions interférer avec votre jugement." (L'Erreur de Descartes, p. 83)
Bien sûr, les émotions peuvent nous mener à faire des choix terribles et à agir de façon manifestement "irrationnelle". Pour autant, Antonio Damasio refuse que nous considérions les émotions comme une "faculté mentale surnuméraire" et comme un "à-côté de la pensée rationnelle" qui serait "de trop".
En fait, les histoires de Phineas et d'Elliot nous apprennent aussi autre chose : le manque d'émotions peut également être à l'origine de comportements irrationnels. L'auteur, bien sûr, ne s'est pas contenté de ces deux cas ; il a étudié chez d'autres patients et ceux-ci ont confirmé cette hypothèse.
Cela dit, l'erreur serait d'identifier trop rapidement des zones du cerveau avec ces facultés. En réalité, il existe de nombreuses interactions entre "sites cérébraux" et celles-ci interviennent dans le rapport entre émotions, raisonnement et prise de décision.
C'est ce que l'auteur souhaite montrer en présentant plusieurs autres cas assez techniques tout au long du chapitre. Finalement, il lui apparaît que les dommages peuvent non seulement venir du cortex préfrontal, mais également de :
La zone de l'hémisphère cérébral droit qui traite les signaux du corps ;
Certaines structures du système limbique (et en particulier l'amygdale).
Deuxième partie
Chapitre 5 : L'élaboration d'une explication
À partir de ce chapitre, l'auteur va chercher à élaborer une explication scientifique aux constats qu'il a réalisés dans sa carrière et qu'il a résumés dans la première partie du livre. Le contenu des chapitres devient plus complexe et plus technique. L'auteur se livre à plusieurs distinctions et explications de base.
Par exemple, il distingue le corps et l'organisme. Le second est l'ensemble de l'individu, dont la frontière est la peau. Le corps, quant à lui, est l'organisme "moins les tissus nerveux" (système nerveux central et périphérique).
Un organisme change constamment. Il peut être dans un état mental ou corporel à un moment donné, et en changer à un autre moment. Les relations entre le mental et le corporel se réalisent via deux "canaux" spécifiques :
Le système nerveux périphérique ;
Le système sanguin (par lequel transitent les hormones, neurotransmetteurs, etc.).
Lorsqu'un organisme reçoit un stimulus, il y répond par une action, un mouvement. Ces mouvements peuvent être volontaires ou non (c'est-à-dire automatiques). Le mouvement délibéré est lié à la pensée et aux images qui peuvent se former à l'esprit.
L'organisme interagit non seulement avec lui-même, mais avec l'extérieur ; son milieu. Celui-ci se rend présent à l'organisme via ses 5 sens. Les informations ainsi recueillies seront transmises au cerveau qui les traitera de façon sélective.
La mémoire est un élément crucial qui nous aide également à raisonner. Il faut distinguer entre les images qui nous viennent directement de la perception (via nos sens) et celles que nous nous formons à partir de la mémoire (nos souvenirs).
Selon Antonio Damasio, la mémoire est fondamentalement "reconstructive", à savoir qu'elle recompose une image du passé à partir de différents éléments et zones du cerveau, sans reproduire à l'identique l'événement. Connaître, c'est accumuler les représentations qui nous viennent des sens et de la mémoire. Nous pensons et parlons d'abord à partir d'images qui se forment dans notre esprit.
Bien que nous nous réinventions constamment, nous avons aussi un "ensemble de préférences de base" constituées pour notre survie au cours de l'évolution.
Chapitre 6 : La régulation biologique de la survie
Les instincts nous permettent de répondre rapidement à des stimuli de notre corps ou de l'environnement. Par ailleurs, nos émotions et sentiments manifestent certains instincts. Ainsi, quand nous avons faim (instinct) et que nous nous plaignons (sentiment), c'est parce que le niveau de sucre dans notre corps commence à diminuer (stimuli corporels).
Les instincts sont indispensables à notre survie. Ils sont une forme de mécanisme pré-organisé qui nous aide à classer les événements selon des catégories négatives ou positives. Grâce à la mémoire, nous pouvons nous souvenir d'événements passés et ainsi pré-classer les événements futurs.
Ici, corps et esprit ne sont pas distincts mais travaillent complètement ensemble. L'enjeu ? Accroître les chances de survie de l'organisme !
Pour Antonio Damasio, il est clair que la pensée ne vient pas d'une origine divine, mais bien des processus longs et complexes de l'évolution biologique. Selon lui, nous pouvons utiliser la neurobiologie pour étudier la manière dont nous agissons et prenons nos décisions.
Pour autant, cela ne signifie pas nécessairement réduire l'explication des comportements humains à la biologie ; afin d'étudier ceux-ci, le scientifique plaide plutôt pour l'utilisation de méthodes interdisciplinaires qui associeraient neurosciences et sciences humaines.
Chapitre 7 : Les émotions et leur perception
Antonio Damasio considère la différence entre :
Certains animaux comme les reptiles qui ne possèdent que d'anciennes structures cérébrales, fonctionnent à l'instinct et vivent souvent dans des environnements simples ;
Les organismes dont le cerveau comprend des structures plus récentes, telles que le néocortex, qui doivent tenir compte de plus de facteurs lorsqu'ils prennent des décisions et vivent dans des milieux plus complexes.
Nous retrouvons ici, d'une certaine manière, la différence entre "le système 1 et le système 2", pour reprendre l'expression d'un livre fameux : un cerveau reptilien qui agit par pure habitude ou instinct et un cerveau développé capable de prendre des décisions précises et subtiles en fonction de situations changeantes.
Cela dit, c'est un peu plus complexe que ça ! Tout le chapitre vise à montrer que les émotions (sensées cantonnées au premier niveau) s'invitent constamment dans la prise de décision et le raisonnement.
Le chercheur distingue trois types d'émotions :
Primaires = depuis la naissance (joie, tristesse, colère, peur et dégoût)
Secondaires = appréciations plus fines de l'environnement en fonction du passé ;
Sentiments d'arrière-plan = qui nous donnent une image de l'état de notre corps à un moment T.
Le scientifique distingue également les émotions (emotions) et les sentiments (feelings). Tous les sentiments ne génèrent pas d'émotions, alors que toutes les émotions génèrent des sentiments.
À noter : c'est une vérité qui est à la base, notamment, des ateliers du rire où le simple fait de produire le rire crée progressivement l'émotion qui lui correspond !
Nos sentiments et nos émotions sont tout aussi concrets que nos organes ou notre langage, par exemple. Ils sont, de ce fait, parfaitement "étudiables" par la biologie contemporaine. Cependant, Antonio Damasio y insiste, cela ne signifie pas que ce type d'interprétation matérialiste, scientifique, suffise à rendre compte de leur richesse.
Chapitre 8 : L'hypothèse des marqueurs somatiques
Nous voici arrivés au cœur de l'hypothèse scientifique de l'auteur. À nouveau, si vous souhaitez entrer dans les détails techniques et rigoureux de l'explication, il est préférable de vous référer directement à l'ouvrage. Nous nous en tenons ici aux grandes lignes.
Qu'est-ce qui constitue une prise de décision ? Selon le chercheur, la prise de décision est le but ultime du raisonnement. Son résultat est le choix lui-même (aller dans tel sens ou tel autre). Pour penser et nous décider, nous avons besoin d' :
Une connaissance de la situation actuelle ;
Des options d'action disponibles et de leurs conséquences ;
Une capacité inhérente à trier et jauger ces situations, options et conséquences.
Antonio Damasio suggère en outre, nous l'avons vu, que les émotions sont tout aussi importantes que la raison et la mémoire dans le raisonnement et la prise de décision.
Par ailleurs, il met en avant (après d'autres, bien sûr) que certaines décisions peuvent être :
Inconscients (vous ne choisissez pas consciemment d'avoir faim) ;
Conscients, mais sans raisonnement (vous ne raisonnez pas quand vous vous protégez contre un danger).
Jusqu'alors, nous pensions que raisonnements intuitifs et raisonnements délibérés et rationnels devaient être strictement séparés, tant au niveau logique que sur le plan biologique. C'est ainsi que le voyait notamment le philosophe Descartes. Or, selon Damasio, c'est faux ; ces différents types de raisonnements opèrent à partir du même noyau neurobiologique.
Bien sûr, nous avons aussi vu que certaines personnes, comme Phileas Gage (voir chapitre 1), peuvent raisonner rationnellement sur un plan mathématique, par exemple, et pourtant échouer à prendre des décisions justes sur un plan social. Pour l'auteur, cela montre que ces décisions en contexte social sont particulièrement complexes et ne peuvent être gérées de la même façon.
En fait, ces décisions ne peuvent fonctionner sur un mode purement utilitaire de coûts et bénéfices, en évacuant toute émotion. Et c'est là qu'intervient l'hypothèse des marqueurs somatiques — la clé de l'argument d'Antonio Damasio.
Que signifie cette expression ? Dit simplement, c'est l'idée qu'un sentiment instinctif (gut feeling) peut déjouer tous nos plans cartésiens. Le corps (soma en grec) provoque une image et lui associe un sentiment viscéral. De ce fait, il "oblige" l'esprit à restreindre les options disponibles en en rejetant automatiquement certaines de façon émotionnelle.
Bref, les marqueurs somatiques court-circuitent la pensée rationnelle ! Ils font partie des émotions secondaires, mais trouvent leur base dans les émotions primaires. Dès l'enfance, nous acquérons un ensemble de marqueurs somatiques qui dirigeront notre vie durant (ou tenterons de le faire).
Certaines conditions socio-politiques (régimes autoritaires, etc.) ou individuelles (maladies, etc.) peuvent contrarier le développement et l'expression corrects de ces marqueurs somatiques.
Troisième partie
Chapitre 9 : La mise à l’épreuve de l’hypothèse des marqueurs somatiques
Pour tester son hypothèse, Antonio Damasio conduisit plusieurs expériences avec son équipe. Il rapporte en particulier le succès de deux expériences rassemblées sous le nom générique du test du "jeu de poker".
Dans la première version de l'expérience, des cartes sont distribuées à un "Joueur" (le sujet de l'expérience) à qui l'on demande de gagner le plus d'argent possible en piochant des cartes dans deux paquets distincts. Certaines cartes lui font gagner gros (paquets A et B) et d'autres moins (paquets C et D). Parfois même, certaines cartes exigent de lui qu'il paie une somme plus ou moins importante (quand elles sont "mauvaises", les cartes du paquet A exigent un remboursement important).
Le Joueur découvre, chemin faisant, comment éviter les plus grosses pertes tout en cherchant à optimiser ses gains :
Les joueurs "normaux" apprennent à préférer progressivement les paquets C et D par prudence.
Ceux qui ont des lésions frontales spécifiques agissent à l'inverse en persistant à jouer "risqué".
Plusieurs interprétations sont dégagées par le chercheur et ses collègues. Pour choisir parmi elles, un autre test fut imaginé dans lequel la punition était première (les cartes "négatives" arrivant plus souvent que les cartes "positives", qui font gagner de l'argent). Les résultats de ce deuxième test permirent d'y voir plus clair.
Pour mettre un mot sur leurs résultats, les scientifiques forgèrent l'expression de "myopie de l'avenir". Selon eux, ces tests montrent que "les patients atteints de lésions frontales souffriraient d'une profonde exagération de ce qui pourrait être une tendance fondamentale normale, à savoir : se saisir du présent plutôt que de miser sur l'avenir".
Voici ce qu'en dit encore Antonio Damasio :
"Il semble bien que les patients atteints de lésions frontales aient perdu ce qu'ils avaient acquis par l'éducation et la socialisation. L'une des aptitudes les plus caractéristiques de l'homme est d'apprendre à orienter son comportement en fonction de perspectives lointaines et non en fonction d'objectifs immédiats, apprentissage que nous commençons à faire dès l'enfance. Les lésions frontales, chez nos patients, mettent à mal non seulement tous les acquis accumulés jusque là, dans ce domaine, mais empêchent toute acquisition nouvelle. Le seul côté un peu positif de ce triste constat est que, comme c'est souvent le cas en neuropathologie, il ouvre des perspectives au progrès de la science. L'effet des lésions nous permet d'entrevoir la nature des processus qui ont été perdus." (L’Erreur de Descartes, Chapitre 9)
Chapitre 10 : Le corps dans le fonctionnement mental du cerveau
Percevoir le monde, ce n'est pas seulement une attitude passive de réception ; c'est aussi de l'action. Lorsque je perçois, mon corps agit ou mieux, interagit avec son environnement.
Prenons un exemple. Si vous vous baladez la nuit et que vous vous sentez suivi, votre esprit et votre corps reconnaissent tous les deux la menace et initient des changements pour assurer votre survie. Et si vous décidez de fuir, tous les systèmes de votre corps seront déjà alignés pour suivre cet objectif !
Corps et cerveau interagissent constamment entre eux et avec le monde via les circuits neuronaux. C'est ainsi que le corps peut se maintenir en équilibre (homéostasie).
Mais Antonio Damasio va plus loin. Il soutient que le concept de soi est un état biologique qui est constamment mis à jour. Rien à voir avec l'idée d'un inspecteur ou d'un juge qui agirait "par-delà" le corps, comme jugé sur sa tour d'ivoire. Sans corps, pas de vie de l'esprit !
Inversement, le développement de l'esprit assure la survie en donnant aux organismes un moyen de s'adapter aux changements imprévus dans le génome. Cela signifie aussi que le corps est la priorité de l'esprit. Première tâche de celui-ci : comprendre quelles sont les limites du corps, sa "géographie". Deuxième tâche : localiser les interactions à l'extérieur du corps grâce aux sens.
En fait, l'esprit surveille constamment l'état du corps et interagit avec lui en arrière-plan pour s'assurer de notre survie. D'ailleurs, remarque-t-il, « quand vous voyez, vous ne voyez pas seulement : vous sentez que vous voyez quelque chose avec vos yeux ».
L'auteur se pose encore une autre question importante dans ce chapitre : quel est le fondement biologique de la conscience ? Nous pouvons chercher à le comprendre à partir de certaines pathologies.
Si les personnes malades sont généralement capables de décrire le changement d'état par rapport à eux-mêmes, les anosognosiques complets (personnes incapables de reconnaître le mal dont elles souffrent) ne le peuvent pas. Pourquoi ?
C'est peut-être, d'après l'auteur, parce qu'elles ont subi des dommages au sein de leur "moi neural". Ils deviennent incapables de reconstruire une image neuve de l'état de leur corps pour la comparer à l'ancien.
Le moi neuronal comprend deux ensembles de représentations qui sont constamment mis à jour :
Les événements autobiographiques, tels que la notion d'identité, de routines et d'aspirations.
Les représentations du corps tel qu'il est actuellement et le compare à la façon dont il est généralement.
D'habitude, ces processus restent masqués. Pourtant, ces pathologies nous donnent des indices de ce qui passe hors de la scène. Le chercheur va même jusqu'à émettre des hypothèses sur la formation de la subjectivité comme "troisième étape" à partir de ces deux premières étapes (voir p. 325-329).
Chapitre 11 : La passion fondant la raison
Bien que certaines de ses idées aient été vérifiées par l'expérience, le propos central de l'auteur demeure une hypothèse qui demande encore du travail afin d'être totalement validée.
Par ailleurs, Antonio Damasio met en garde contre des interprétations trompeuses de ses théories. Il ne dit pas que les émotions et les sentiments sont "supérieurs" à la raison ni qu'ils l'emportent toujours face au raisonnement. S'ils font partie du processus de raisonnement, cela ne diminue en rien l'importance de celui-ci.
Nous pouvons néanmoins apprendre à comprendre ce qui se passe au sein de ces interactions, et en particulier lorsque ce "monde intérieur" ne fonctionne plus.
Pour Antonio Damasio, l'erreur fondamentale de Descartes — quelle que soit l'interprétation qu'on fasse de sa philosophie par ailleurs — consiste dans la séparation du corps et de l'esprit. Et le problème est que sa pensée reste influente dans le milieu de la recherche, y compris en neurobiologie ou en neurochimie.
Pour l'auteur, la rationalité humaine est fragile et finie — et c'est parce qu'elle est incorporée. Il importe donc de changer de paradigme afin de pouvoir nous appréhender de façon plus complète et aussi plus humble.
Post-scriptum
Antonio Damasio dit avoir écrit L’Erreur de Descartes afin de donner un aperçu de la recherche en neurobiologie au plus grand nombre et pour faire comprendre comment ce savoir peut affecter la façon dont nous envisageons l’humanité.
Par ailleurs, il a écrit pour que le corps médical change de perception sur la question des rapports entre le corps et l'esprit. Si elle modifie son paradigme pour prendre en compte les interactions constantes entre corps, émotions et raison, la médecine sera en mesure de développer de meilleurs traitements et d'être plus respectueuse du patient.
Pour l'instant, la situation académique n'est, selon lui, pas satisfaisante. Les étudiants de tous les cursus devraient apprendre les bases de la psychologie humaine. Dans les facultés de médecine ou de neurosciences, il faudrait éduquer davantage les étudiants à l'empathie.
En fait, le "biais cartésien" — qui dissocie nettement raison et passion — ne fait pas du bien à la recherche et devrait être modifié pour :
Faire davantage de progrès ;
Augmenter l'efficacité du diagnostic et du traitement des maladies psychologiques ;
Redonner confiance en la médecine occidentale.
Antonio Damasio poursuit ses investigations. Ses plus récentes recherches ont par exemple établi que la douleur et le plaisir sont tous deux nécessaires pour qu'un organisme fonctionne normalement et efficacement. Ce sont des dispositions innées qui ont pour fonction de configurer correctement nos instincts. Ceux-ci peuvent ensuite servir à établir des stratégies de prise de décision complexes.
Conclusion sur « L’Erreur de Descartes » d’Antonio R. Damasio :
Ce qu’il faut retenir de « L’Erreur de Descartes » d’Antonio R. Damasio :
Retenez que :
Le raisonnement est éclairé par les émotions et les sentiments ;
Pour raisonner correctement, nous avons besoin de l'intégrité des systèmes de notre cerveau (et non seulement d'une petite partie où se logerait la "raison").
Le raisonnement prend ses sources dans l'esprit autant que dans le corps ;
Celui-ci évolue avec l'expérience et peut en général être amélioré.
Contrairement à ce que pensait le philosophe René Descartes, la raison n'est ni pure, ni complètement immatérielle. Si cette théorie s'avère exacte, alors elle impliquera une reconfiguration profonde de nos façons de voir le monde et notamment nos interactions sociales.
Points forts :
Un livre savant par l'un des plus grands neuroscientifiques actuels ;
Des explications claires malgré la complexité du sujet, avec des sections spécifiques pour introduire certains termes techniques ;
De nombreuses images qui aident à la compréhension ;
Une écriture agréable, qui allie la raison à l'émotion, notamment via des anecdotes personnelles.
Point faible :
C'est un peu difficile à lire, mais l'effort en vaut la peine !
Ma note :
★★★★★
Avez-vous lu le livre d’Antonio R. Damasio « L’Erreur de Descartes » ? Combien le notez-vous ?
[ratings]
Visitez Amazon afin de lire plus de commentaires sur le livre d’Antonio R. Damasio « L’Erreur de Descartes ».
Visitez Amazon afin d’acheter le livre d’Antonio R. Damasio « L’Erreur de Descartes ».
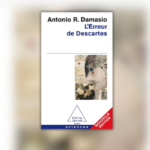 ]]>
]]>